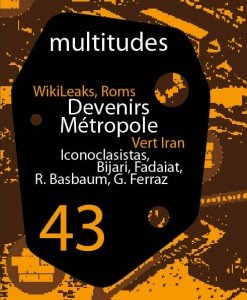À partir du mot d’ordre actuel à l’échelle mondiale du « droit à la ville »[1], se constituent de nouveaux mouvements urbains de contestation qui aspirent à une participation autonome au développement de la ville à l’encontre de l’hégémonie néolibérale. Les actions et revendications liés au « droit à la ville » sont très diversifiées : à la Nouvelle Orléans, les locataires des logements sociaux exigent de retourner dans leurs domiciles de départ au prix abordable[2]; à Madrid des locataires travailleuses du sexe protestent contre leur mise à l’écart de leur quartier (http://antitriball.wordpress.com) ; à Istambul, une communauté de Roms s’est opposée à la démolition de leur petite cité[3] ; dans des villes moyennes allemandes comme Wuppertal, de larges fronts se constituent contre des plans locaux d’austérité, et à Hambourg des collectifs d’artistes ont occupé les derniers bâtiments historiques du Gängeviertel afin d’empêcher des projets immobiliers. Pratiquement toutes les protestations urbaines ont repris le leitmotiv du « droit à la ville » d’une manière ou d’une autre. Comment s’explique cet immense attrait international, et quel potentiel contient-il pour le déploiement de mouvements sociaux urbains ?
La ville est notre usine
Depuis leur origine, les villes ont été le lieu de protestations et de révoltes sociales[4], de même qu’elles présentèrent longtemps la mesure de la régulation publique des États sous le capitalisme. Au XXe siècle, le développement régional et les programmes de construction de logements correspondaient à la tentative de résoudre les conflits inhérents aux sociétés industrielles au niveau des collectivités territoriales pour une pacification[5]. À l’époque de l’organisation fordiste, les plans de développement du territoire assurèrent les bases spatiales de la production industrielle. Les programmes de logement visèrent aussi bien la satisfaction des ouvriers qualifiés et de leur famille que la neutralisation des « classes dangereuses » par le biais de la mixité sociale[6]. Au XXe siècle, la ville fut le lieu et l’objet de la régulation étatique – ici se trouvèrent les fondements de la production industrielle et de la régulation fordiste. Pour cette raison, Manuel Castells a désigné les villes comme étant les lieux d’une « consommation collective » disposant d’un rôle propre au sein de l’organisation sociale[7]. Contrairement au procès de valorisation de l’industrie, l’urbain fut désigné comme une ressource pouvant satisfaire des besoins non couverts par le marché et des individus isolés. Le concept de « consomption collective » part de l’hypothèse que les fonctions de reproduction sociale s’organisent dans le cadre d’un espace clairement délimité. Dans ce contexte se déroulèrent et déroulent encore des mouvements sociaux et des interventions politiques.
Michael Hardt et Toni Negri ont discuté la signification actuelle des métropoles pour la multitude en soulignant le changement fondamental qui est intervenu dans le rôle de la ville pour les rapports de production. Selon les auteurs, la métropole serait le lieu de la production « biopolitique » parce qu’elle constitue l’espace du commun, l’espace de gens qui vivent ensemble, qui partagent des ressources, qui communiquent et qui échangent aussi bien des marchandises que des idées[8]. La production biopolitique assure ainsi une base pour faire accéder les individus au réservoir commun que contient la métropole et qui se manifeste à travers des langues, des images, des idées, des affects, des codes, des coutumes et des pratiques. La ville n’est donc plus comprise comme le cadre de reproduction et le réceptacle de la production industrielle, mais elle se présente elle-même comme une force productive : « Ce que l’usine était pour la classe ouvrière industrielle, la métropole l’est pour la multitude » (op. cit. : 109). Les métropoles sont des espaces de production, de rencontre, mais aussi les espaces du conflit et de la rébellion. Le passage de l’industrie à l’économie cognitive implique aussi bien un déplacement spatial des lignes de conflit, mais encore une transformation fondamentale des rapports de production. Selon Negri et Hardt, le cycle de production biopolitique s’autonomise du capital, car ses structures de coopération émergent à partir du procès de production de sorte que toute tentative visant à fixer ceux-ci par avance ne font qu’entraver la productivité (op. cit.). Les qualités de l’espace urbain ne sont plus extérieures aux rapports de production, mais font partie des sources de la productivité. Dans cette optique, les formes de la valorisation de la productivité sociale se déplacent. Hardt et Negri distinguent la production de richesse de l’usine industrielle – qui engendre du profit sous le commandement direct des capitalistes – de la production de rente générée par la métropole qui correspond à la seule modalité dont dispose le capital de s’approprier sa création autonome de richesse (op. cit. : 110). La production du commun se présente ainsi sous la forme de la vie urbaine car la production biopolitique transforme tous les espaces en espaces de production. Les deux auteurs définissent les valeurs immobilières comme une manifestation du bien commun, puisque celles-ci intègrent les qualités de l’environnement dans le prix.
Cependant, la valeur d’usage n’est pas réductible à une fonction de consomption ou de production ; en tout état de cause elle couvre les deux aspects. Les mouvements urbains qui se réfèrent au droit à la ville évoquent les deux fonctions dont il est question ici. S’ils revendiquent une meilleure qualité des services municipaux ou de meilleurs équipements d’infrastructures (par exemple contre la privatisation de la gestion communale de l’eau ou la fermeture d’une piscine), cela désigne la fonction classique de la ville comme lieu de la « consomption collective » alors que les mobilisations contre l’expulsion de certains groupes sociaux de leurs quartiers habituels ou en faveur du maintien d’espaces autonomes convoquent une productivité commune dans le cadre de l’économie cognitive.
Des mouvements sociaux
dans la ville entrepreuneuriale
Les mouvements qui font appel au droit à la ville couvrent un éventail large positions dans le changement urbain, de la défense de dispositifs de l’État social comme les logements publics de la Nouvelle-Orléans[9] à l’amélioration des conditions de travail précaires au sein de la campagne Justice for Janitors[10], en passant par les revendications d’artistes d’Hambourg[11].
La réussite des mouvements de contestation dépend non seulement des ressources de mobilisation, mais encore de la capacité intégrative des politiques de la ville. Ainsi, les protestations des afro-américains de la Nouvelle-Orléans autour du droit au retour, après la tempête Katrina, n’ont pas échoué en raison de la faiblesse de la mobilisation, mais parce que la ville s’est fixé comme priorité une gentrification avancée[12]. En revanche, la campagne des personnels de nettoyage aux États-Unis a réussi en s’appuyant d’une part sur une mobilisation aussi forte que prolongée, mais aussi sur une internationalisation de la contestation qui a provoqué une dégradation de l’image des entreprises multinationales se voulant partenaires responsables des autorités municipales. Le succès partiel des artistes d’Hambourg – qui ont empêché la démolition d’un quartier et renégocié ses baux – fut rendu possible par l’intégration par les artistes rebelles du leitmotiv de la « Creative City » de la politique de développement local.
Il nous semble donc important de contextualiser les chances de réussite des mouvements sociaux dans les politiques urbaines locales. Les politiques urbaines contemporaines ont souvent été saisies dans leur penchant vers la « ville entrepreneuriale ». David Harvey[13] et Bob Jessop[14] en ont distingué trois dimensions. D’abord, la concurrence entre villes sous la forme d’investissements publics privés afin de, d’avantages fiscaux pour attirer habitants, flux touristiques et grands évènements. Les villes se concurrencent alors comme des entreprises qui se battent pour des parts de marché. Le second aspect de l’orientation entrepreneuriale réside dans la gestion managériale de la municipalité : budgétisation et évaluation des services publics ou des logements sociaux sont liés à un outsourcing de domaines jugés peu rentables comme l’offre culturelle en direction des jeunes ou le travail d’intégration des migrants. Une troisième dimension est constituée par l’orientation entrepreneuriale de l’action publique, qui repose sur une opposition très néolibérale entre la créativité dynamique des entrepreneurs et l’inertie conservatrice des propriétaires traditionnels. Typiques de cette optique, sont les expérimentations de partenariats public-privé (Public-Private-Partnership) estiment que les administrations municipales pourraient utiliser sans peine la puissance des investissements les canaliser dans le sens politique souhaité. Pourtant, les municipalités doivent le plus souvent supporter les coûts initiaux de ces projets sans obtenir de contrepartie, dans l’espoir d’effets indirectement bénéfiques de relance économique. Ici émerge l’illusion que la création de richesses puissent « filtrer » à travers les couches sociales, de telle sorte que les bénéfices des groupes aisés aident en définitive aussi ceux qui ne possèdent rien. Jusqu’à présent, personne n’a jamais été en mesure d’expliquer comment ce modèle puisse fonctionner dans la réalité, sans que cela détériore le rayonnement du concept de « filtrage ». Les mouvements sociaux qui cherchent à obtenir une répartition des richesses et des ressources urbaines se sont toujours opposés à ces politiques urbaines d’inspiration néolibérale.
Une autre orientation bien connue de la politique urbaine entrepreneuriale est la « Creative City ». Partant des thèses de Richard Florida[15], expert canadien en développement urbain, nombre de villes cherchent désormais à créer des conditions de vie, d’emploi et d’habitat propres à attirer cette « classe créative ». On y range les employés et cadres qualifiés des métiers cognitifs des nouveaux services, les métiers culturels aussi bien que les représentants des agences de relations publiques ou encore les scientifiques des laboratoires de R&D. L’auteur décrit les créatifs comme des êtres exigeants, frôlant la posture de diva, qui ne sont pas obligés de suivre les offres d’emploi, mais qui apportent au contraire leur travail dans les villes où il leur semble bon vivre. Florida énumère des facteurs « doux » comme décisifs dans la lutte pour attirer la classe créative : une atmosphère urbaine tolérante, des possibilités de réalisation de soi, ainsi qu’une riche offre culturelle et de loisirs. Tout comme les orientations entrepreneuriales classiques, la politique urbaine visant à attirer les créatifs se situe sur le plan de la concurrence entre villes. Depuis l’entrée dans le nouveau siècle, les grandes métropoles du globe tentent toutes à se doter d’une image de « Creative City »[16]. Une telle floridisation des politiques urbaines, qui présente la face souriante de la ville entrepreneuriale, a trouvé une certaine adhésion dans les milieux politiques alternatifs. Les groupes et initiatives issus des milieux artistiques et créatifs peuvent emprunter ce terrain afin d’augmenter leurs chances de trouver des partenaires parmi les élites municipales qui leur permettent de satisfaire leurs revendications spécifiques.
Le droit à la ville,
davantage qu’un slogan qui claque
La revendication d’un droit à la ville d’Henri Lefèbvre (1968), pour obtenir un accès général aux ressources et services urbains, n’est pas juridique, mais pointe la légitimité d’une économie politique constituante susceptible de réunir de multiples acteurs urbains dans une forme de coopération durable[17]. En même temps, le droit à la ville convoque la vision d’un développement urbain alternatif, juste et émancipateur. Les utopies urbaines ne se contentent pas d’esquisser une matrice pour un meilleur développement pour mettre à l’épreuve les projets concrets qui sont en cours, tant sur le plan économique d’une redistribution des richesses en faveur des groupes marginalisés ou discriminés que culturel pour la reconnaissance des différences dans les modes de vie. Sa dimension politique, enfin, vise une co-production du développement urbain par l’ensemble des groupes qui partagent la ville.
Si la revendication du droit à la ville a été élaborée par Lefèbvre dans un contexte de la gestion urbaine fordiste de l’après-guerre en France[18], son langage conceptuel est toujours adéquat pour les conflits urbains de l’ère néolibérale[19]. Dans Le droit à la ville, Henri Lefèbvre saisit, dès 1968, la ville capitaliste dans ses modes de ségrégation socio-économiques avec ses formes d’aliénation dont la « tragédie des banlieusards », relégués bien loin des centres urbains dans des dortoirs[20]. Le droit à la ville s’adresse d’abord à ces groupes marginalisés, au sens propre du terme, mais la revendication englobe en définitive toutes les ébauches discursives et pratiques du développement urbain du futur. Il ne se limite pas à l’usage des espaces de la ville, mais implique l’accès aux débats politiques ou stratégiques des évolutions à venir. Au vu du développement fordiste de la ville, Lefèbvre définit un droit à la centralité et un droit à la différence comme les deux faces substantielles du droit à la ville. Le droit à la centralité implique l’accès des habitants aux infrastructures sociales ou cognitives alors que le droit à la différence interprète la ville comme un lieu de rencontre, de reconnaissance mutuelle et de délibération. Cela rappelle l’idée plus récente de la ville comme « machine intégrante » dans la sociologie urbaine qui considère la capacité de la ville à condenser les différences afin d’en faire une plus-value sociale. Sur un troisième plan, le droit de la ville invoque la promesse utopique de l’urbanité comme puissance créative de la ville. En arrière-fond, le compromis de classe fordiste apparaît comme une gestion fonctionnelle de la ville qui ne satisfait pas les besoins sociaux. Ainsi, le droit au logement a engendré des habitats de masse qui incluent une perte des qualités urbaines sans aucune place pour des espaces urbains ouverts, susceptible d’organiser la vie culturelle.
Vers la fin des années 1990, l’exigence de Lefèbvre a connu une renaissance dans de nombreuses recherches géographiques et urbaines, mais aussi au sein de plusieurs mouvements sociaux[21]. À travers cette réappropriation, l’objet de la critique passe à la ville néolibérale, dans sa forme et ses modes de marginalisation nouveaux. Les groupes immédiatement concernées par ce processus sont les perdants économiques, les exclus des quartiers en voie de gentrification et autres migrants poussés à l’illégalité par le durcissement législatif, qui posent à nouveaux la question de la participation à la vie urbaine.
La force d’attraction du concept de droit à la ville pour des mouvements contestataires s’explique notamment par son caractère polyvalent, revendicatif et utopique, qui ne se limite pas à un droit individuel au sens juridique classique[22]. Le droit à la ville esquisse la vision d’une bonne vie et nourrit l’imaginaire des mouvements sociaux, tout en légitimant des stratégies de réforme plus concrètes[23]. En ce sens, le droit à la ville remplit des fonctions bien distinctes au sein des mouvements de protestation :
Il s’agit d’abord d’une ressource de légitimation, qui utilise la revendication normative pour obtenir une adhésion publique large. Le droit à l’accés aux ressources urbaines revêt ici une dimension universelle, dans son refus de toute forme d’exclusion[24].
Il représente une référence et une mesure pour l’organisation juste de la cité, en permettant ainsi l’institutionnalisation (locale) d’un éventail de revendications urbaines. Les instruments, programmes et modèles des municipalités peuvent être mis à l’épreuve.
Il donne une orientation pratique au mouvement social lui-même, en suggérant une forme d’autogestion et en favorisant des pratiques de réappropriation urbaine. Le droit à la ville soutient une (re) politisation de la politique municipale, dans le sens d’une délibération publique de tout ce qui touche au bien commun de la cité.
Il offre enfin un concept organisationnel susceptible de supporter de larges coalitions, puisque le droit à la ville permet de lier plusieurs initiatives assez marginales sous le toit commun d’un rassemblement majoritaire[25]. Dans certaines villes aux États-Unis, à Hambourg ou encore Stuttgart, des tentatives se font jour d’institutionnaliser de tels réseaux.
La restructuration néolibérale de la société se manifeste en conclusion de plus en plus nettement à l’échelle de la ville. Les utopies et alternatives sociales viseront donc nécessairement son organisation urbaine. Le droit à la ville encourage la mobilisation de groupes marginalisés tout en augmentant les chances d’un mouvement social unitaire, plus global, qui ouvre la perspective d’un mode de socialisation libéré du marché et de l’État.
Traduit de l’allemand par Alexander Neumann