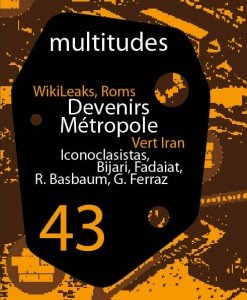Un territoire qui devient métropole se reconnaît animé par deux tensions contradictoires : l’attraction par un centre dont l’histoire, l’économie, va qualifier ensemble, et le développement intensif de périphéries sur lesquelles le centre veut affirmer davantage son contrôle. Le territoire d’une métropole est hiérarchisé, sélectif, productif, spécialisé, et, par sa géographie organisée autour d’un fleuve ou un estuaire, il relie et rassemble au-delà de ce qu’il maîtrise. Les métropoles inventent de nouvelles formes de souveraineté, et la plus simple de ces formes est la mise en attente, une attente différenciée selon les zones.
Habiter dans les territoires du devenir métropole, c’est, pour ceux qui viennent de loin participer à la vie de la métropole, accepter d’être relégués dans des parties périphériques de la ville, dans une seconde zone. L’emploi du mot zone pour désigner les « cibles » des politiques urbaines est particulièrement frappant dans le cas français où être habitant d’une métropole, c’est vivre dans une « zone urbaine sensible », aller à l’école dans une « zone d’éducation prioritaire », obtenir son premier emploi dans une « zone foncière urbaine », chercher son futur logement dans une « zone d’aménagement concerté », qui doit appartenir à une zone résidentielle, bien reliée à une zone d’activité. Depuis qu’il existe des métropoles, depuis qu’on constate un débordement du territoire communal par les politiques d’État, le zonage, en France comme à l’étranger, est la pratique de base de l’urbanisme qui consiste, via une carte, à doter les espaces, habités ou non, de droits différenciés de transformation. Une désignation qui permet à des acteurs puissants, collectivités locales ou aménageurs, de prendre l’initiative de définir le devenir des espaces qui les intéressent. La participation des habitants ou des acteurs mineurs ne peut alors se manifester qu’en réaction, en résistance. La métropole institue un nouveau niveau de souveraineté où il faut voir les choses en plus grand, de plus haut, modifier les circuits existants de la représentation, et où on ne peut s’opposer au jour le jour qu’en détail, car on ne sait pas trop à quoi on s’attend.
Un espace d’action désaffecté et sectorisé
Tantôt le territoire communal ne suffit pas à contenir l’afflux des migrants vers la grande ville, leur installation à la périphérie est condamnée comme pratique informe et menaçante, que ce soit à Paris, à Berlin ou dans d’autres capitales. Tantôt les territoires communaux sont découpés en zones plus petites pour répondre à des impératifs d’aménagement. Que ce soit par le bas ou par le haut, la zone est la manière de distinguer dans le territoire métropolitain un espace rendu homogène, indifférent à ses propriétaires, à ses locataires et autres usagers, et transformé en réceptacle d’une politique imposée communément à tous, une politique d’État.
La zone, en ville comme chez les militaires, est un territoire, un espace habité et utilisé par d’autres, à homogénéiser par l’action publique pour l’incorporer à l’espace dominant. La réalité existante y est vécue par les agents du pouvoir comme complexe, indistincte, confuse, d’où la pratique inventée par l’urbanisme d’en faire une étendue représentée simplement par ce que l’action permettra d’en observer ou ce qu’elle permettra d’y substituer, ce qu’on appelle aujourd’hui un territoire de projet. Certaines zones sont d’ailleurs perçues de manière positive, mais à en encadrer tout de même pour que leurs usagers, leurs propriétaires, leurs locataires ne puissent pas en faire n’importe quoi, pour canaliser leur fréquentation. Les zones d’aménagement paysager du patrimoine urbain architectural définissent des conditions d’amélioration et de modernisation qui mobilisent les propriétaires pour la valorisation de leurs biens mais excluent de manière tout à fait légitimée des habitants non fortunés de ces espaces à l’entretien desquels ils ne sont pas capables de participer. Les zones touristiques sélectionnent dorénavant les employés acceptant le travail du dimanche, devenu possible et donc obligatoire dans ces espaces délimités. Dans les zones résidentielles, les conditions d’usage des sols et de transformation des propriétés existantes, réservent le droit de construire à ceux qui en ont les moyens. Toutes ces zones contribuent chacune à sa manière à la dynamique d’accumulation métropolitaine.
Habiter une métropole c’est à la fois faire sa zone, se profiler un territoire particulier lié à ses activités et à ses goûts[1] mais c’est aussi se confronter à une multitude de zones, dont aucune ne correspond aux limites territoriales sur lesquelles s’exerce le pouvoir communal, et la représentation des citoyens. Faire sa zone, zoner, est une pratique de liberté, une pratique libérale. Elle peut avoir une dimension politique chez ceux qui incorporeront à leurs pérégrinations des territoires non familiers, et se feront les habitants d’une métropole étendue à l’ensemble de ses composantes réelles. Mais cette promenade urbaine, aussi sympathique et ouverte soit-elle, n’est qu’un prélude à une démarche politique, pour laquelle les métropoles existantes ou en projets n’offrent aucun lieu pertinent.
Chaque zone de la métropole, ou du territoire urbanisé, bénéficie d’un agencement administratif spécifique qui prévoit une participation limitée, qui fait remonter aux maires concernés des informations demandant éventuellement leur action. Ce sont souvent les mêmes habitants qui s’investissent dans les mécanismes de participation de ces zones superposées, avec un désir de « leadership », parfois relayé par des associations généralistes ou des partis d’opposition. L’empilement des zones, le formatage de leur action par l’obligation de travailler à la résolution de problèmes, s’oppose efficacement à « la parole habitante » qui chercherait à construire des alternatives, sauf exception. Qu’il concerne les droits à construire, les opérations d’aménagement ou les politiques sociales, le zonage réussit à fragmenter l’espace politique, à dissocier la participation de la représentation. Il faudrait connaître les langues de tous les pays étrangers pour prendre la mesure mondiale de cette fragmentation du territoire du commun, de cette délimitation d’« urban areas » ciblés par des politiques urbaines spécifiques, parmi lesquels des « areas » plus ou moins « deprived », c’est-à-dire défavorisés, réservés par les métropoles à leurs migrants ruraux puis aux étrangers, à des travailleurs non qualifiés, et aux perdants de la promotion sociale. L’obsolescence du logement social ou plus récemment son caractère inacessible sont devenus paradoxalement les facteurs principaux de cette mise à l’écart.
Un espace d’inégalités mesurées
La métropole est un ensemble discontinu d’espaces aux contours et aux qualifications floues, un univers de différences irreprésentables subsumées sous des qualifications homogénéisantes, et marquées au sol dans des ensembles immobiliers dont les formes symbolisent la fonction. Les pouvoirs administratifs et la rumeur publique dessinent des périmètres au sein desquels on « bénéficie » de mesures particulières, des aires urbaines où les initiatives se font expérimentales, des lieux observés sur lesquels ils recueillent des rapports réguliers, où les politiques sont évaluées, où les habitants et usagers sont pris pour objets. Des canaux sont officiellement aménagés pour que quelques uns participent à cette politique de prise en compte, de mise en chiffres, mais surtout prennent conscience de l’impossibilité de ramener leur quartier dans le droit commun. Ce n’est pas seulement l’attitude des jeunes qui en fait des « zones de non droit », mais aussi les effectifs des services publics inférieurs à la normale, et surtout l’absence des initiatives portées ailleurs par des habitants plus favorisés.
Les zones foncières urbaines s’arrêtent au milieu des rues, donnant d’un côté le droit d’avoir un emploi aidé, de l’autre non, distribuant l’inégalité des chances par arrêté préfectoral. Le pouvoir administratif discrimine les espaces à doter de droits différents, après concertation avec les élus et les professionnels sans doute, mais sans les jeunes destinataires de cette mesure, sur lesquels l’arbitraire s’abat sans possibilité de contestation. Il s’agit d’abord de faire sentir le pouvoir comme tel, de forcer à le faire respecter en s’appuyant sur les besoins les plus vitaux, sur l’urgence. L’existence de procédures et leurs modalités sont l’essentiel, le contenu et son utilité un prétexte, d’autant plus que la procédure veut être plus par rapport à son objectif affirmé. La fin justifie les moyens, et les moyens sont structurellement insuffisants, et c’est le contexte économique qui juge : quand il est porteur et que les emplois abondent le dispositif semble après tout valable.
Les effets de frontières se multiplient avec la multiplication des zones. La plupart des concernés trouvent les moyens de justifier les procédés, de s’y identifier. La métropole se fragmente, pour le regard public et administratif, en espaces fonctionnels catégorisés par leur activité dominante. Les conduites des habitants se calquent en retour sur ces images mentales à travers lesquelles leurs besoins de revenus, de prestations, sont examinés. La compétition se développe entre ces zones administratives, comparées sans cesse par les journalistes ou les politiques, et s’insinue là où elle semblait dénuée de pertinence économique, dans ces zones défavorisées, où elle incite à la réussite individuelle, à sortir du lot.
Un espace de désorientation et de désir
Au début du XXe siècle, le centre de la ville, le cœur de la métropole, se présentait à l’habitant des campagnes, au migrant, qui affluaient pour y trouver du travail, et y jouir du spectacle des commerces, comme un lieu où le droit faisait de nombreuses exceptions, où la loi prenait quelques vacances, et où il ne faisait pas bon jouer les pères la morale. La ville était une zone érogène, le lieu de rencontre des petites vertus, un espace marqué par l’indifférence pour les infractions des autres en échange de la tolérance à la prolifération des siennes. L’espace public se faisait accueillant à un certain dérèglement des pratiques de plaisir. L’espace urbain de la grande ville, de la métropole, s’est affirmé dès cette époque en supplément du travail industriel, en excès, rajoutant à l’usage fonctionnel des transports en commun sur le trajet domicile-travail un usage indéterminé. La ville était le lieu de la liberté, du dépassement des limites, du côtoiement des passions. Métropolis, vue par les peintres, de Toulouse-Lautrec à Grosz, c’était la visite au bordel dans lequel se rencontraient des représentants de toutes les classes sociales, où se brisait, le temps d’une passe ou d’un verre, la hiérarchie de l’entreprise et des corporations. L’univers urbain était alors ostensiblement celui du désir irrépressible, de la capacité à franchir les frontières de la légalité, de l’évidence des lieux supposés clandestins, de l’émergence et de la notoriété de figures déclassées. La ville quadrillée par le travail soutenait toutes les dimensions du non travail comme indispensables à sa reproduction, organisait l’assistance à ceux qui en étaient dépourvus, rapprochait ceux qui pouvaient s’aider à en retrouver, et qui vivaient en attendant. Cette ville chaudron faisait peur, et l’imagination se déchaînait chez les urbanistes pour l’entourer de cités jardins et autres lieux ordonnés qui mettraient fin à cette débauche d’affectivité. La métropole d’aujourd’hui a hérité de cette moralisation, elle est lisse et passante, froide et indifférente, presque entièrement privatisée. La rue n’a plus d’aspérités architecturales et sociales. La place est nette pour la circulation des flux, et la participation de chacun à cette circulation.
La grande ville désoriente : son espace polyaimanté entre le grand centre attracteur − la zone patrimoniale et touristique où l’accès est cher et fortement réglementé − et les petits centres qui lui ont été agrégés − héritiers des villages autrefois voisins −, se parcourt dans tous les sens. Dans la métropole, la personne que vous abordez en plein centre pour demander votre chemin n’est jamais de là, elle est elle-même à la recherche d’un bâtiment administratif pour faire une démarche. Et pourtant personne ne se perd finalement, la signalétique urbaine a remplacé l’enracinement. Mais les nouveaux habitants de la ville fixent pour la plupart leur attention sur leurs nouveaux proches, et s’établissent, de manière au moins temporaire, près de gens originaires de la même région. Un goût de la proximité qui légitime de prime abord la démocratie du même nom, celle limitée à l’état de la voirie, mais qui se révèle surtout un passe-temps sympathique pour habitants vieillissants.
Les personnages clés du grand territoire urbain étaient définis au début du XXe siècle comme des attracteurs des désirs émergents de la désorientation métropolitaine: la prostituée, la tenancière du restaurant, le maître ou la maîtresse d’école, le banquier, et autres figures « libres » d’attaches familiales directes. La métropole était un lieu d’apprentissage de nouvelles mœurs, un lieu de formation, ou parfois de perdition. Georg Simmel[2] et Alexander Doblin[3] ont décrit chacun l’une des options de cet apprentissage, la sociologiquement correcte et la romanesquement fantasmée. Le Berlin des années 1920 rendait particulièrement sensible la désorientation produite par la déterritorialisation, dans une ville ruinée par la guerre, qui n’avait pas la ressource de la croissance économique, mais qui venait d’être transformée en un grand espace administratif sillonné par des transports en communs. Les interactions avec des étrangers croisés dans la rue ou dans un bistrot se transformaient en amitiés durables au gré des séductions, et des entreprises intéressées dans lesquelles les uns entraînaient les autres.
La grande ville, la métropole, repousse la zone qui l’entoure imaginairement mais attire à elle les travailleurs qui viennent de partout en construisant d’imposants transports rapides – pendant que Paris se dote du métropolitain, Berlin ouvre le U-Bahn à l’intérieur de la ville et le S-Bahn qui la relie à ses banlieues − et constitue un espace de type nouveau, où la fonctionnalité l’emporte en apparence sur le désir. Ces services de transport facilitent les trajets domicile-travail et matérialisent un bassin d’emploi, où de tout point de la zone desservie, on puisse se rendre en un autre point en moins d’une heure. Aujourd’hui les TGV et les Intercités repoussent encore les frontières de la ville. La métropole vit à la même heure, dans la limite d’une heure ou deux. Et elle est ponctuée de stations qui sont autant de points de repère, une grille de similitudes et de différences. Ces repères signalent des lieux d’habitat et de travail, mais aussi des relais vers les lieux de loisirs, de shopping, des activités dont le poids croit dans les transports métropolitains. La métropole se nourrit du loisir, du spectacle, à travers lesquels elle se forme comme espace public de la modernité, espace de représentation, de mise en relation et de diffusion. Une pratique centrale, le long de rues célèbres, minée par l’aménagement croissant de zones spécialisées en périphérie, qui en retour renforce la fréquentation du centre plus valorisé parce que plus ancien. Depuis la zone, depuis la périphérie, le centre de la métropole est un lieu de déambulation, de consommation différée, d’information sur la mode, de broyage du politique.
La zone, sujet/objet de l’urbanisation
À la faveur de la démilitarisation de ses fortifications, Paris « embellie, agrandie, assainie », − a dit un Haussmann très gaullien −, s’est dotée d’une zone périphérique, lieu de toutes les aventures louches, des habitats précaires, et autres processus mineurs, bordant la récente homogénéisation de la capitale élargie aux villages périphériques. Cent ans d’urbanisme sont presque venus à bout des nouveaux arrondissements. Et le travail urbain repart aujourd’hui sur une nouvelle couronne à assujettir, un nouvel espace à homogénéiser avec ou sans la participation des habitants.
Quelle que soit la ville, quelles que soient les modalités, l’urbanisation en «peau de léopard » par taches de couleurs distinctes, liées aux opportunités foncières, témoigne du lien profond entre l’affirmation métropolitaine et la conservation des inégalités héritées. La métropole est un projet d’homogénéité symbolique producteur de tensions le long desquelles se développent des luttes tournant parfois à l’émeute, mais surtout des entreprises nouvelles sociales ou culturelles nouvelles, souvent microscopiques et indviduelles. L’innovation est un compromis entre le processus de domination et l’obligation de tenir compte des droits des occupants réels, l’obligation de tenir compte des différences de sol, de relief, mais surtout de l’invention des habitants profitant de la présence des autres et parfois coopérant avec eux pour proposer de nouveaux services. La grande ville est pleine d’interstices, que de grands architectes recommandent aujourd’hui de cultiver, avec des pommes de terre, des tomates, des fleurs, pour la biodiversité. Désir des habitants pour le jardinage, voire la survie, mais aussi aveu que le pouvoir de la finance n’est pas sans limites, qu’il se nourrit de ce qui lui est indifférent, et que cette vie indifférente au qu’en dira-t-on est le propre de la métropole.
Que faire de la zone, qui borde la métropole et qui la nourrit, qui la menace en permanence d’une dévaluation et d’une absorption ? Habitat social et boulevard autoroutier, construction de « rings » successifs, a été la réponse de plusieurs grandes villes. L’homogénéisation centrale s’étend, mais pas tout à fait, elle n’arrive à jouer que comme tendance dans les espaces qu’elle relie, à se heurter d’autant plus à l’inertie, qu’elle touche des espaces de plus en plus périphériques. La zone éclate en opportunités multiples aux confins des communes, de l’autre côté des voies de chemins de fer, ou des réserves pour autoroutes. Construire de la citoyenneté, de la participation, depuis ces lieux, aptes à l’aménagement sans rien à ménager, prend des voies oppositionnelles. Le pouvoir est quotidiennement en question, pour ce qu’il pourrait donner de plus.
Plus la métropole grandit et plus on attend, plus les espaces publics se transforment au jour le jour en zones d’attente[4]. Dans la queue des supermarchés, à la porte des expositions, sur les listes de demandeurs de logements, dans les agences de l’emploi, aux urgences hospitalières, pour l’inscription dans un établissement côté, l’attente est une conduite sociale très commune. Une conduite démocratique en théorie, régie exclusivement par l’ordre d’arrivée, mais une conduite sans parole collective et qui mobilise chez chacun la réflexion secrète sur les moyens d’échapper à la règle ; les moscovites en ont fait un art. La métropole développe l’aptitude à négliger la démocratie et à valoriser les ressources productrices d’une singularité individuelle. Ainsi se forme une nouvelle société urbaine tout à la fois sans limite et ponctuelle. Dans cette ponctualité le jeune zonard trace sa route, singulière, étrange ; il frôle les espaces de la centralité. Il pourrait s’y arrêter s’il y était invité. Il, ou elle, attend.