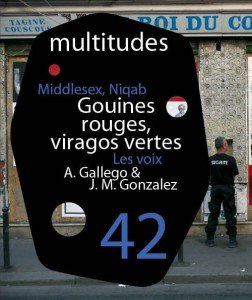Le texte s’intitule : In the Shadow of the American Dream. C’est le troisième d’une série de huit essais autobiographiques de David Wojnarowicz (Close to the Knives: A Memoir of Disintegration, New York, Vintage Books, 1991). Après deux textes racontant la vie à la rue, la drague des clients ou des amants sur les quais, c’est le premier à prolonger le témoignage en revendication et en attaque contre la droite conservatrice. Le livre s’organisant de manière globalement chronologique, on peut rapporter ce changement à l’évolution des préoccupations de l’auteur qui, à la fin des années 80, se trouvait de plus en plus impliqué dans l’activisme politique autour du VIH. Premier texte à diagnostiquer l’état général des États-Unis, l’incurie du gouvernement en matière de santé publique et de droits des minorités, c’est donc le premier à être vocal, au sens où, en américain, being vocal signifie « protester, tenter de faire entendre des revendications ». De fait, c’est aussi le texte du recueil où figure la plus grande diversité de voix : voix devinée dans les câbles électriques (p.28), voix mécaniques des haut-parleurs au musée de la bombe atomique (p.36), grésillements de navajo dans l’autoradio (p.39), voix érotisée d’un chanteur de country (p.43), voix qu’on croit entendre au désert (p.39-42) et qu’on trouve – peut-être – lors d’un plan cul sur le siège passager d’un inconnu (p.57). Autant de raisons de penser que, dans ce récit d’une virée au désert, se figure aussi comment une voix en vient à exister politiquement. Observons sa naissance dans les premières pages du texte.
Abstraction du langage
L’incipit est abrupt : I had almost become completely abstracted. Puisque l’essai s’ouvre sur un réveil difficile (p.24-25), on pourrait penser que cette « abstraction « désigne l’état induit par un cauchemar : « J’étais devenu presque complètement abstrait (et mon réveil avait peine à me ramener à la réalité concrète).» Mais on peut ponctuer autrement : « I » had almost become completely abstracted. Et imaginer que le cauchemar, ce soit qu’un Je ne désigne plus rien d’autre que l’instance d’énonciation et que le discoureur ne figure dans son discours qu’au titre d’origine déclarée. Bien sûr, cela n’est qu’un mauvais rêve : du simple fait que toute énonciation est située, comment parler pourrait-il m’exposer au seul titre de locuteur ? Avec moi parlent – au moins – le lieu d’où je parle, le médium que j’emploie… À défaut de voix, ce sera l’encre – ou un clavier ; à défaut de résonance, le dépôt sur une surface, réelle ou virtuelle. Toujours mon propos s’en trouvera situé (dans les sous-sols de l’ancienne université de Lausanne, sur les pages d’une revue de gauche). Et de même que mon timbre de voix et mes intonations, ces lieux l’auréoleront de connotations… Ce caractère inévitablement médial et situé de mon discours, accordons-nous de l’appeler voix, en un sens élargi. Et comprenons alors qu’en rêvant l’abstraction du je, le narrateur envisage le cas-limite d’une totale aphonie. Dans son cauchemar flottent en tout cas « les lèvres, ou les pommettes, ou les doigts, d’un homme, ou d’une femme, qui parle sans qu’on entende le moindre son » (p.25) – comme si, en effet, aucune parole n’éliminait tout à fait son corps de résonance et qu’il en traînait toujours quelques restes, plus ou moins méconnaissables. Davantage : à supposer même que l’énonciateur s’abstraie entièrement, le lecteur resterait encore libre de lui imaginer une voix. En ce sens, plus notre voix se fait discrète, plus elle se soumet à l’usager de l’énoncé, à ses catégories, à ses grilles de lectures. Rien d’étonnant, dès lors, à ce qu’une araignée (ou la noire abstraction de son abdomen) hante cette presque aphonie et que le je menace à chaque instant de se trouver pris dans sa toile invisible. Ce à quoi le narrateur tente d’échapper, ce n’est donc pas seulement à un rêve pénible, mais aussi à la tentation de ne se rapporter à soi qu’en tant qu’être parlant. Et being vocal se trouve ainsi une première fois défini, par l’abstrait, et par la négative : c’est tenter de se rapporter à soi depuis un élément extérieur au langage sans lequel nous ne pouvons parler
Abstraction de la vie
Mais l’« abstraction » qui menace la voix n’est pas seulement celle du langage. Dans la suite de l’essai, le terme est employé dans un contexte ouvertement politique : « riches Blancs et riches Blanches font tout pour rendre abstraite la vie humaine, et traitent les minorités comme s’il ne s’agissait que de pigeons d’argile » (p.58). Si l’on prend cette image au sérieux, l’abstraction peut être comprise comme une technique de gestion de l’espace public, qui empêche les minorités d’y apparaître autrement que comme des cibles muettes. Du coup, parmi les éléments extérieurs au langage, sans lesquels nous ne pouvons parler et qui risquent toujours de parler avec nous, il faudrait aussi compter l’appartenance à une « classe », à une « race », etc. ainsi que les expériences qui témoigneraient d’une telle appartenance. Le risque indiqué par l’incipit, ce serait alors celui qu’encourent des subalternes à ne se comprendre qu’à travers les grilles de lecture des dominants. Quant à l’abstraction linguistique, elle serait moins un risque qu’un dangereux refuge, où peuvent être tentés de s’effacer ceux qui, en parlant, risquent à tout moment d’exposer leur minorité. À ce point, on peut se demander si Wojnarowicz appartient bien à une telle classe des « sans-voix » : après tout il est blanc et ses œuvres graphiques se vendent assez pour lui payer sa voiture. Son homosexualité, son anarchisme, son passé de vagabondage et de prostitution n’empêcheront pas son livre d’être publié. Il ne sera pas davantage censuré. Toutes proportions gardées, sa position est peut-être symptomatique du rapport que, dans les démocraties occidentales, la plupart des citoyens entretiennent avec le pouvoir : sans être eux-mêmes réduits au silence, ils ne peuvent s’empêcher de constater que certaines de leurs expériences le sont. Notamment quand ils sont confrontés à des situations où leurs pensées, leurs sentiments proviennent de ce vécu disqualifié. Anecdote, minuscule : pendant que des collègues enseignants discutaient d’un spectacle présenté aux élèves et d’un mime de fellation qu’ils jugeaient dégradant pour la jeune actrice qui le jouait, pouvais-je évoquer mon plaisir à sucer des bites ? Pourtant, c’était à partir de là que mon appréciation de la scène différait de la leur, et que je pouvais y lire autre chose qu’une soumission à autrui. En l’occurrence, j’ai eu l’impression qu’aussitôt évoquée, cette expérience aurait été descendue – fragile pigeon d’argile. Elle est donc restée sans voix. Néanmoins, elle peut aider à comprendre cette opération que Wojnarowicz appelait l’abstraction de la vie humaine : nul vécu n’est en lui-même pertinent ; l’importance des expériences d’où l’on voudrait parler est déterminée par d’autres. Pour cette raison, being vocal, ce n’est pas simplement prendre la parole, pour critiquer tel ou tel aspect de notre situation commune : c’est aussi tenter de faire importer les expériences d’où nous parlons. Dernière image de ce rêve : celle d’un homme emprisonné, flottant parmi les abstractions – les siennes ou celles d’un autre, peu importe. Car celui qui ne peut faire valoir les expériences qui le constituent tend à parler avec la voix d’un autre, depuis une vie dont seule compte l’acceptabilité – qu’elle soit ou non la sienne. Le cauchemar dont le narrateur tente d’émerger peut ainsi figurer un processus d’irréalisation des voix – forcément à l’œuvre dans un monde tous ont une voix, mais où tout vécu ne peut être vocalisé. Or, quand toutes les voix parlent depuis les expériences (réelles ou fictives) de quelques-uns, peut-on encore parler de démocratie ? En ce sens, démocratiser une société, cela ne se limiterait donc pas à donner à tous ses membres la même voix abstraite. Dans la mesure où chacun, alors même qu’il parle devient autre chose qu’un être parlant, cela impliquerait au minimum de cultiver, à large échelle, la disposition à écouter toutes les expériences qu’elle génère.
Vol de voix
Ceci dit, notre narrateur n’a peut-être pas le temps d’attendre qu’une telle culture de l’écoute produise ses fruits. Car à peine sorti de son rêve d’aphonie, il lui faut lutter contre le silence que celui-ci figure, et tâcher de produire sa voix – même en l’absence d’une oreille bienveillante. « Je me sens capturé par l’étreinte du gouvernement » (p.28). Cette phrase est la première de l’essai où le narrateur tente de décrire sa situation politique ; c’est l’amorce d’un projet auquel l’essai reviendra : trouver son mot à dire sur l’action de l’État. Ce mot fulgure brièvement au détour d’une phrase, comme encore incertain : « [this] country [is] slowly dying beyond our grasp ; ce pays est en train de lentement mourir, hors de notre portée ». Mais qui est ce nous ? Quelle est cette mort ? Nous devrons attendre pour le savoir, car à peine le narrateur esquisse-t-il ce premier diagnostic, qu’il le dissout dans le paysage : comme si ce n’était pas de lui que venait cette idée, mais d’un chant du vent dans les lignes télégraphiques ; comme si les oiseaux l’écrivaient dans l’air, d’un vol évoquant la forme de voyelles ou de sons qu’on prononce. À peine ébauchée, la critique de l’État se trouve ainsi déléguée à une autre voix. Tous les mots crachés par le stylo semblent volatils – envolés sitôt posés, tels d’étranges oiseaux aux ailes de lettres. Même la chose à dire fuit dans l’indicible, aussi hors de portée que son référent étatique. L’impossibilité d’enrayer l’agonie nationale semble ainsi entraîner celle d’en parler. Étonnante paralysie. Mais qui, de fait, est liée à la nature même du projet vocal : n’implique-t-il pas, avant même de décrire la situation, d’y intervenir, en faisant importer le lieu d’où proviendra ma description ? Or si, comme nous l’avons suggéré, cette importance ne dépend pas de moi, toute possibilité d’intervention semble bloquée. Comment empêcher le mal de progresser, si l’un de ses symptômes est précisément l’aphonie de ceux qui auraient intérêt à le décrire ? Pire encore qu’envolée, cette voix commence toujours par m’être volée.
Pose de voix
Le narrateur pourrait s’étendre longuement sur cette paradoxale dépossession. Mais il sent le besoin de se secouer un peu. Et pour ce faire, il s’amuse à conduire en aveugle, sur des distances de plus en plus longues – « et cela devient un combat : ouvrir les yeux avant que ne m’emporte le côté de la route. C’est comme si, de l’intérieur de mon corps, quelqu’un d’autre était assis au volant. Le corps qui conduit comprend le danger qui approche peu à peu, et cet autre corps sourit dans les tréfonds obscurs du premier » (p.29). Aux tentations apophatiques, le narrateur préfère ainsi un exercice pratique, qui change son rapport à lui-même et à ce qui l’entoure : « Quand les yeux finissent par s’ouvrir, ils ne révèlent rien de neuf sur le monde, si ce n’est un léger glissement dans le paysage : la preuve qu’un plus grand risque de mortalité ne m’apprend rien. On ne voit pas les choses ou l’existence à neuf, en plus grand ou plus brillant. Nul dieu, nul ange qui caresse mes paupières de ses ailes ». L’exercice peut laisser perplexe : le narrateur avait-il tant d’espoirs théologiques ? Espérait-il vraiment, dans son périple au désert, entendre tonner la Voix qui lui manquait ? On peut en douter. En fait, et aussi surprenant que cela puisse paraître, cette conduite à l’aveugle relève de la pose de voix. Les chanteurs savent que les exercices qui préparent l’émission vocale peuvent être presque silencieux : on respire, on grimace, on place des consonnes… Dans notre cas, l’exercice travaille sur une condition de la production vocale, à savoir une modulation conjointe du rapport à soi et à la réalité sociale. Car la voiture que le narrateur subvertit n’est pas qu’un habitacle roulant ; dans la mesure où elle installe son conducteur à une certaine distance de la réalité sociale qu’il traverse, elle est, dit-il, « l’équivalent physique des nouvelles du soir » : à peine aperçue, et vite dépassée, la pauvreté qui se traîne en bord de route devient un souvenir avant même qu’on l’ait remarquée (p.31). Le parallèle peut sembler douteux. Il suggère néanmoins qu’en conduisant à l’aveugle, le narrateur tente de se réapproprier un appareil de production sociale du regard. Et que, si la voix lui manque, rien ne sert de gloser sans fin cette absence, ou ce défaut : mieux vaut s’attaquer aux dispositifs qui, pour lui-même comme pour les autres, la maintiennent dans l’inaudible.
Point vocal
L’occasion lui en sera fournie par un fait divers : au volant d’une Camaro, un adolescent d’origine indienne est monté sur un trottoir pour écraser un étudiant qu’il ne connaissait pas ; depuis, on lui attribue d’autres meurtres semblables. Le narrateur se demande alors pourquoi, en fin de compte, de tels accès de violence sont si rares : « why weren’t more of us doing this ? (p.32) Pourquoi n’étions-nous pas davantage à faire ça ? » Question décisive. En quelque sorte : le point vocal de l’essai – au sens où y aboutissent une première fois les tentatives de vocalité, et que la suite consistera surtout à explorer les nouvelles possibilités qu’ouvre cette prise de voix. On peut commencer par remarquer que ce nous est le premier du texte à désigner plus de deux personnes ; et qu’à la différence du our de la p.28, il envisage un collectif dans ce qu’il pourrait faire et non dans son impuissance (non, écraser des gens n’est pas hors de notre portée). Comme la conduite à l’aveugle, ce meurtre subvertit ce que le véhicule implique d’assignement : la section précédente se concluant sur la vision d’un Navajo à l’air piégé dans sa voiture à l’arrêt (p.30), l’acte du jeune Indien ne peut apparaître que comme une réaction à un tel parcage. Plus généralement, l’enchaînement indique aussi que cet acte prend une valeur exemplaire et représente toute une série d’actions du même type (any of these things, p.32). À la différence d’une revendication, provenant d’une position reconnaissable et reconnue par les abstracteurs d’existence (telle que SDF, native american, etc.), cet énoncé joue en fait sur une double indétermination : celle du this (quelles sont les autres actions qui peuvent ressembler à celle-ci ?) et celle du us (dans quel ensemble se situe l’énonciateur ?). L’événement y étant mis en résonance avec d’autres, sans qu’un nom vienne identifier cette série, dont l’identité est laissée à l’appréciation d’un nous. Mais celui-ci n’est pas dénombrable : s’y incluront tous ceux que cet événement affecte d’une certaine manière. Voyons donc laquelle. Dans les éditions suivant le fait divers, les quotidiens ont produit nombre de témoignages : d’untel qui avait réchappé de peu à une agression semblable, d’unetelle qui s’était fait suivre par une mystérieuse voiture, etc. Mais à travers chacune de ces voix s’exprime une seule et même manière de sentir : tous parlent en victimes, réchappées ou potentielles. En (se) posant sa fameuse question, le narrateur réagit donc moins à la violence du jeune homme qu’à une manière d’en être affecté. Au chœur victimaire, il oppose la sensibilité d’un nous qui se rapporte à la violence depuis la tentation qu’il se sent de la commettre. Or, c’est à partir de ce rapport à soi et à la violence que le meurtre devient représentatif d’autres actes, ce qui permet à chacun d’inclure ses propres expériences dans l’ensemble qu’il représente. C’est à partir de cette même (auto-)affection que le meurtre devient symptomatique de l’état du pays. En ce sens, les expériences que chacun est alors libre d’inclure au côté de ce symptôme acquièrent une pertinence nouvelle. Et quiconque se reconnaît dans ce nous se trouve placé dans un nouveau rapport à ce qu’il vit ou a vécu, et dans un nouveau rapport à la société qui l’entoure. Le devenir-meurtrier est devenu ce quelque chose d’extérieur au langage à partir de quoi il est possible de se faire entendre – le substrat dont la voix est une modulation
Politisation par résonance
Peu après qu’il ait évoqué ce chœur des victimes, des images défilent dans la tête du narrateur : celle d’un pendu squelettique, celle d’un visage spectral au-dessus des immeubles nocturnes : « l’actuel président, flottant, désincarné, et haut de dix rumeurs (ten stories tall) ». Si la première image indique un désir du chœur (voir le jeune Indien pendu), la seconde suggère que ses voix sont celles qui, chaque nuit, réélisent Reagan ou Bush père. Cela voudrait dire qu’en politique, les voix ne compteraient pas de la manière que l’on croit. Au décompte électoral, la question du narrateur oppose ainsi une autre politisation des voix, où les voix agissent par les (auto-)affections qui résonnent à travers elles. D’autre part, si quelques voix colportées par la presse ont le pouvoir de réélire le président, il faut encore penser qu’elles ne résonnent pas dans le vide, mais qu’elles se multiplient, en entraînant d’autres voix dans leur sinistre unisson. En somme, cette politisation des voix ne provient plus de l’expérience d’un auditeur (bienveillant ou non), mais d’un chanteur. Professionnels ou amateurs, nombre d’entre eux pourraient en effet témoigner : « Après avoir entendu La Traviata avec Pavarotti et Freni, j’étais chaud, la voix en place – plus besoin de me mettre en voix. » Je me rappelle aussi être sorti d’un récital le larynx serré, simplement parce que la technique de l’artiste… ne me convenait pas. De tels exemples rappellent qu’une voix ne touche pas qu’une oreille et une mémoire. Avant de résonner, et pour avoir une chance d’être entendue, une voix implique une certaine disposition du corps qui la produit. D’autre part, quand la voix résonne, elle peut transmettre cette disposition aux corps qui l’entendent. En ce sens, being vocal, c’est contribuer à ce que d’autres le soient d’une manière analogue, et expriment les mêmes dispositions. Si la voix qu’élève le narrateur n’a rien d’acoustique, puisque confiée aux mots de son carnet, puis à la page imprimée, elle n’en vise pas moins à concurrencer d’autres voix imprimées, en tentant de répandre dans la société une autre manière de se rapporter à elle, à partir d’une autre manière de se rapporter à soi-même. Cette politisation de la voix par résonance se distingue encore de sa version électorale (par décompte) en ce que les voix n’y font plus partie d’un ensemble dénombrable, mais d’une collectivité ouverte, susceptible de s’agrandir à chaque fois qu’on écoute une de ses voix.
Tribus, plan cul, etc.
Mon essai doit s’achever. Celui de Wojnarowicz continue. Essentiellement (me semble-t-il) en variant, ou en développant la séquence qui mène à cette première production vocale. On le verrait ainsi élaborer un concept de tribu, strictement corrélé à celui de voix ; ou vocaliser d’autres expériences que celle du devenir-tueur : celle de l’auto-destructivité (p.39-42), mais aussi celle du casual sex entre hommes. Autant dire que d’aucun verront Wojnarowicz prendre le risque d’un « communautarisme » : de refermer l’ensemble ouvert par la résonance vocale sur celui d’un collectif pré-dénombré. Pour ma part, il me semble que cette clôture n’a pas lieu. Mais je vous laisse en juger : les tribus (p.37-38) sont-elles bien définies par la capacité de s’entre-affecter vocalement, à travers le vacarme dominant ? Davantage qu’au fait de sucer (illégalement) un inconnu, l’émotion ressentie par le narrateur (p.57) ne tient-elle pas à la confiance que, ayant pu vocaliser une expérience, il pourra en vocaliser d’autres ? Pour ma part, ce texte m’a fait entendre qu’en matière de voix, cultiver la démocratie, ce n’est ni simplement donner à tous une même voix (abstraite), ni cultiver les dispositions à l’écoute, mais surtout entretenir celles à devenir voix.