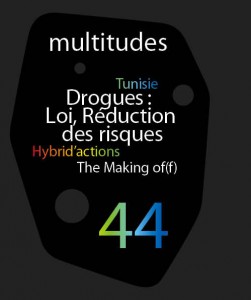Des quartiers aux cartels
En ces temps de crise mondiale, les marchés des drogues illicites sont particulièrement dynamiques. L’offre de cannabis et de cocaïne s’est démultipliée depuis la fin des années 1990 à travers des réseaux de distribution et de revente nombreux et complexes. Alors que l’héroïne a connu un net déclin en Europe, la culture du pavot est revenue à un stade jamais égalé en Afghanistan, qui exporte désormais de l’héroïne pure vers les pays consommateurs. Cette offre répond manifestement à une demande sociale, tout en la stimulant en retour par un accès facilité aux produits. Si l’on s’en tient au cannabis, en Europe, selon les données de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) datant de 2008, on estime que près de 70 millions de personnes ont consommé au moins une fois du cannabis, 23 millions au cours de la dernière année et 12,5 millions au cours des trente derniers jours. Les pays où la prévalence de l’usage régulier au sein de la tranche d’âge de quinze à trente-quatre ans est la plus faible étaient la Grèce, la Lituanie, la Suède (1,5 %), les pays où elle est la plus forte étant l’Espagne (15,5 %), la France (9,8 %) et le Royaume uni (9,2 %). Les enquêtes en population générale conduites par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) indiquent que le nombre d’usagers de cannabis varie de 1,2 millions usagers réguliers à 3,9 millions dans l’année, alors que celui de cocaïne était en 2005 de 1,1 millions d’expérimentateurs et 250 000 usagers dans l’année – même si ces données sous-estiment le nombre réel d’usagers.
Cette évolution a suscité assez peu d’interrogations sur les divers facteurs qui la nourrissent[1]. La drogue reste un tabou, et la loi son totem. C’est plus que partout ailleurs le cas en France : le débat public peine à s’ouvrir de façon pragmatique. Comme on le constate à propos de la dépénalisation du cannabis ou des salles de consommation à moindre risque ; les dénonciations morales et les discours démagogiques l’emportent, maintenant le statu quo sur la loi de 1970 souvent complétée mais jamais remise en cause depuis quarante ans malgré ses nombreux effets pervers ; les solutions alternatives à la pénalisation et à la médicalisation peinent à se faire entendre alors qu’elles viendraient en aide aux usagers. En fait, la question des drogues renvoie à un imaginaire des classes dangereuses, elle est associée aux « banlieues », et trouve dans la figure des « jeunes à casquettes » son emblème. Si le sentiment peut se répandre que l’économie criminelle est partout et donc nulle part – à l’instar des mafias –, cet imaginaire « spatialise » l’illicite, il l’ancre dans un territoire. La politique du gouvernement est à cet égard symptomatique : il ne s’agit plus de mener une « guerre contre la drogue », à l’échelle internationale, mais une « guerre nationale » contre les trafiquants des cités sensibles. On ne saurait mieux résumer l’impuissance sidérante de l’État à régler les problèmes dont il participe pourtant.
La place des drogues dans les quartiers pauvres
Il y a dix ans, nous constations déjà la place centrale des drogues dans la vie sociale des quartiers pauvres des banlieues françaises[2]. Il ne s’agissait pas seulement de prendre acte de la diffusion massive des usages de cannabis et d’héroïne dans ces espaces urbains, ni de considérer simplement que certaines cités étaient devenues des « supermarchés de la drogue », selon l’expression consacrée. Il s’agissait d’analyser comment ce processus de diffusion amorcé peu après Mai 68 dans un contexte de crise économique et de mutations profondes du marché du travail avait modifié fondamentalement la trame des relations sociales entre les habitants. Ainsi, tout au long des années 1980 et 1990, les rapports entre les générations ont été radicalement bouleversés par la banalisation du shit, et surtout de la came, qui a fait beaucoup de morts par overdoses et le sida. Ces usages ont marqué une rupture par rapport à l’expérience des parents. « On ne savait pas ce que c’était la drogue, la toxicomanie, le sida… ». De même, l’émergence dans les cités dégradées d’une micro-économie de la drogue a profondément modifié le rapport des plus jeunes à l’école et au travail salarié, faisant du deal l’équivalent d’un travail. Cette économie a profondément remodelé la hiérarchie et le sens des conduites délinquantes, les modes de socialisation déviante, les codes et les territoires des « voyous »[3]. Si ce que les jeunes des cités appellent le bizness a pris le relais de formes d’économies de la débrouillardise antérieures (petits commerces, récupération de métaux, travail au noir, etc.), il a impliqué un changement d’échelle en irriguant certains territoires de flux financiers considérables et en rendant possible des trajectoires fulgurantes qui ont suscité bien des convoitises et des violences.
Les quartiers ouvriers tenaient leur homogénéité d’une logique de conflits de classe structurés autour du travail à l’usine et d’une logique de la communauté assurant une solidarité et des régulations informelles des conduites déviantes. La délocalisation, le chômage de masse et la précarité, le racisme et les discriminations ont contribué à défaire ces logiques et à accélérer la fragmentation de quartiers de plus en plus fermés sur eux-mêmes. Dans ce contexte, la drogue a pu émerger comme une préoccupation majeure des habitants, au même titre que le chômage et l’insécurité. C’est du même coup l’ambiance des quartiers qui a changé. La délinquance est devenue plus visible, elle a changé de visage avec une fréquence accrue des agressions, des incivilités, elle est aussi devenue moins « lisible ». Aux bagarres du samedi soir et querelles de voisinages dont les codes étaient connus de tous se sont substitués des micro-conflits d’un genre nouveau, en apparence partis de rien, régis par une logique de l’embrouille[4]. Les « ambiances stressantes » se sont ainsi banalisées, comme par exemple lorsque des dizaines de toxicomanes en manque attendent le matin dans la rue d’acheter leur dose et que des voitures de police en patrouille paraissent dissuader les dealers de les servir, ou lorsque tout le monde dans la cité connaît ces derniers mais ne dit mot par peur des représailles. En même temps, la diffusion des drogues a cristallisé des formes insoupçonnées de lien social (solidarité, injustice, résistance) et a été contenue par des modes de socialisation des tensions assurant une protection relative.
Reconfiguration des marchés
et politique du chiffre
Tous ces constats restent largement valables dix ans plus tard. Mais qu’est-ce qui a changé ? Il me semble que deux types de phénomènes sont à prendre en compte. Tout d’abord les trafics illicites dans les cités ont subi une transformation majeure avec l’effondrement du marché de l’héroïne, que l’on peut dater au milieu des années 1990, suite à la mise en place des programmes de substitution et à l’apparition d’une politique de santé publique en France[5]. La came était omniprésente dans les grandes métropoles (Paris, Lille, Marseille, Toulouse, etc.) et a constitué une « catastrophe sociale et sanitaire », selon la formule du professeur Henrion ; elle a quasiment disparu dans les quartiers. Le cannabis est devenu le principal produit d’appel du deal dans les cités, ce qui a entraîné une relative dissémination des trafics et une concurrence renforcée entre les dealers. La généralisation des portables, qui étaient encore rares à la fin des années 1990, a aussi joué un rôle dans ce changement, les clients pouvant plus facile joindre leur fournisseur en se libérant des lieux de deal de notoriété publique des proches comme de la police. C’est en quelque sorte le « modèle livraison pizza » qui s’est mis en place. Parallèlement, les trafics multicartes (cannabis, cocaïne, ecstasy, etc.) se sont développés, offrant plusieurs produits là où la spécialisation était plutôt la règle. Ainsi la cocaïne s’est fortement démocratisée. Au cours de ces dernières années, le tabou qui frappait les « drogues dures » semble s’être dissipé, et de nombreux témoignages signalent une progression rapide de la consommation de cocaïne. On sait assez peu de choses à ce propos, sinon que la « coke » appelle des usages moins urbains et plus discrets que le cannabis, davantage liés à des contextes festifs en dehors des quartiers[6].
Tous ces phénomènes ont contribué à rendre moins visibles les trafics. Ils ont aussi entraîné une plus forte concurrence entre les « équipes » contrôlant les terrains de revente. Dans le cas des terrains fonctionnant comme des « supermarchés », couvrant une zone de chalandise étendue visant une clientèle large, par comparaison aux « commerces de proximité », ces effets de concurrence peuvent expliquer un climat de violences débouchant parfois sur le recours à des armes à feu. Les dealers protègent leur bizness avec des fusils à pompe, des pistolets ou même des kalachnikovs, ou pour régler leurs comptes avec des bandes rivales. Les fusillades sont devenues banales en région parisienne, notamment à La Courneuve, Saint-Ouen, Sevran, Villiers-le-Bel et dans bien d’autres communes. En province, ces scènes ne sont pas rares non plus[7]. On observe aussi un passage de générations, comme à Marseille où les règlements de compte font rage entre gangs des cités et clans traditionnels. De ce point de vue, la situation s’est donc manifestement durcie.
Mais ce qui a changé, c’est aussi dix ans de sarkozysme, et par là le regard porté sur ces phénomènes travaillés par un imaginaire policier diffus. Alors que le bilan de la politique sécuritaire semble faire débat, trois aspects me semblent remarquables. Le premier est d’ordre institutionnel. À une production législative abondante multipliant et renforçant les mesures répressives s’est ajoutée une réorganisation des services de police et de justice soumis à de nouvelles injonctions relevant moins d’une logique de service public que d’une culture managériale. La promotion d’une « politique du résultat » illustre à elle seule ce changement à l’œuvre pour d’autres contentieux (sans-papiers, infractions à la circulation routière, etc.). Elle se trouve aujourd’hui fortement contestée par les syndicats de fonctionnaires. Ceci se traduit bien dans les données d’interpellation pour infractions à la législation sur les stupéfiants : au niveau national, elles sont passées de 2000 à 2010 de plus 100 000 à près de 150 000.
Ces interpellations concernent dans plus de quatre cas sur cinq des usagers de cannabis, comme c’était déjà le cas au tournant des années 2000. Elles peuvent se lire – c’est le deuxième aspect – comme le produit d’une modification des pratiques policières : aux missions de sécurité publique se sont substituées des logiques d’intervention. Ce changement s’est concrétisé par une présence policière plus importante dans certains quartiers, contrairement à l’idée répandue selon laquelle les cités seraient devenues des « zones de non droit », une répression accrue de la petite délinquance commise notamment par des mineurs, mais aussi un renforcement des tensions entre les forces de l’ordre et la population donnant lieu à de nombreux incidents tournant à l’émeute. D’où, troisième aspect, l’efficacité de ces actions répressives reste discutable et discutée. Les saisies effectuées par les services de police, de gendarmerie et des douanes seraient en augmentation en 2010 par rapport aux dernières années, ce qui traduirait une réorientation de l’action des services de police contre les réseaux de vente. Les chiffres cités par la presse sont impressionnants : 7 tonnes à Gonesse en janvier, 3,2 tonnes à Dreux en février, 420 kg de cannabis sur l’autoroute A6, quatre tonnes saisies l’été 2010. Néanmoins, les experts considèrent que les saisies représentent environ un dixième des produits présents sur le marché. En outre, les marchandises saisies ne visaient pas nécessairement les cités, mais étaient en transit, comme le suggère l’interception sur l’autoroute A1, au niveau d’Arras, d’une camionnette qui contenait 2,5 tonnes de cannabis probablement destinés au marché du nord de l’Europe. Enfin, il importe de faire la part entre une logique de saisie centrée sur les marchandises et une logique de démantèlement axée sur les personnes. Les interpellations des dealers restent rares (3,5 % en 2010). Au plan pénal, entre 2002 et 2009, le nombre de condamnations pour usage est passé de 13 649 à 31 108 ; sur la même période, celui pour trafic est passé de 2 241 à 1 506[8].
Ces changements sont en partie liés. Les effets de concurrence entre les acteurs du marché (usagers, revendeurs, semi-grossistes) et l’intensification de la répression policière alimentent un climat de tension dont la gestion passe notamment par la violence, laquelle alimente, avec d’autres facteurs, l’insécurité des habitants. La médiatisation des faits-divers et des réactions qu’ils suscitent parmi la classe politique et les experts bouclent en quelque sorte la boucle lorsqu’elle adopte des catégories de désignation militaires : « guerre des territoires », « guerre des bandes », « guerre des clans pour le contrôle du trafic ». Cette radicalisation du langage indique une mutation des représentations autant qu’un durcissement de la situation. Elle est en cela trompeuse. Elle ne doit pas masquer en effet les « biais » d’un raisonnement qui consiste à inférer de l’accentuation de la répression la hausse de la délinquance liée à l’usage de drogues, et inversement. On le sait, les statistiques administratives mesurent d’abord l’activité de la police avant de décrire la réalité du phénomène. Sur le terrain, on observe les limites des opérations coup de poing de la police. En fait, les trafics illicites en fait se poursuivent, malgré la présence policière, et parfois même sous les caméras de vidéo-protection incapables d’identifier les gamins encapuchonnés. La répression est certes plus musclée mais aussi plus aveugle. Bien souvent, les trafiquants qui gagnent réellement de l’argent ne sont pas inquiétés. Les « grands » contrôlent mieux les quartiers que les policiers, sachant comment parler et à qui. Les « petites mains » du trafic (revendeurs, guetteurs, nourrices, etc.) interpellées sont remplacées très vite. La politique d’ordre s’apparente moins à une éradication des poches de trafics qu’à une stratégie de gestion des risques de populations-cibles et de territoires sensibles[9].
De La Courneuve à Tremblay-en-France
Les événements récents survenus dans les communes de La Courneuve et de Tremblay-en-France illustrent cette situation. La Courneuve est sans doute une des villes de banlieue la plus emblématique des grands ensembles et de la concentration des problèmes sociaux qu’on y observe. Maintes fois étudiée par des sociologues notamment à travers la fameuse cité des 4000, elle a été le théâtre de violents événements en 2005. Suite à un règlement de comptes entre trafiquants, un jeune garçon de 11 ans a été tué d’une balle en pleine tête, le 19 juin 2005. Le lendemain, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, avait promis de « nettoyer la Cité des 4000 au Kärcher » et annoncé des mesures « sans précédent ». Cinq ans plus tard, la fameuse barre Balzac au pied de laquelle a eu lieu le drame est en attente de destruction, quinze familles et une quarantaine de squatteurs y vivent. Elle apparaît comme l’un des hauts lieux du trafic de drogues en Ile-de-France et les armes y circulent. En juin 2010, un homme de 28 ans a été tué de deux balles et aurait été victime d’un règlement de compte entre bandes. Quelques jours plus tard une femme a été touchée d’une balle perdue. Lors d’une intervention, les policiers ont saisis 123 kilogrammes de cannabis, 54 000 euros en espèces, des armes et gilets pare-balles. Mais les gens ont peur. Comme l’expliquera une maman d’élève au journal Le Parisien, « les dealers sont partout, c’est même pire qu’avant. Depuis que la barre s’est vidée, j’interdis à mes enfants de passer par là pour aller à l’école. Moi, je ne prends jamais de sac pour éviter de me faire agresser ». Comme en écho, alors qu’une centaine de policiers interviennent dans la cité armés et vêtus de gilets pare-balles dans le cadre d’une opération anti-drogues, une autre mère de famille explique : « Bizarrement, j’ai encore plus peur quand il y a des policiers. Je crains une balle perdue. Ici personne n’a oublié ce qui est arrivé au petit Sid-Ahmed. » C’est peu dire que la violence du quartier et la violence d’État imprègnent la vie des habitants[10].
À la différence de La Courneuve, Tremblay-en-France est sortie de façon spectaculaire de l’anonymat. Le 30 mars dernier, la police est intervenue et a saisi près d’un million d’euros en petites coupures, des stupéfiants et des armes dans le cadre d’une enquête sur un trafic de drogues quelques heures avant la diffusion d’un reportage réalisé par une équipe de TF1 sur cette même cité du « Grand-Ensemble », intitulé « Mon voisin est un dealer ». Une telle conjonction a suscité une vive émotion, le résultat de l’opération de police apportant la preuve de la gravité de la situation exhibée par le documentaire montrant des jeunes en train de dealer dans les halls et les réactions des voisins. D’autant plus que le lendemain, un bus a été caillassé et un autre incendié par une vingtaine de jeunes. Ces violences urbaines ont été immédiatement perçues comme des « représailles » tant par le ministre de l’Intérieur venu sur place que par les habitants.
Cet épisode a donné lieu à une forte dramatisation dans les médias et sur Internet. Tous les ingrédients étaient présents (l’intervention de la police, la saisie de 980 000 euros, le documentaire de TF1, les bus en feu, les déclarations du ministre déclarant la « guerre » aux crapules). Cette dramatisation a suscité la peur des uns et la colère des autres. Si certains habitants interviewés par les journalistes ont dit avoir peur des représailles, d’autres ont lancé une pétition « citoyenne » et se sont considérés comme victimes de la stigmatisation systématique des banlieues par certains médias, soulignant que le titre du sujet sous-entendait que la moitié du centre ville vit du deal et que le quartier est totalement contrôlé par des dealers. « Cette vision n’est pas objective parce que réductrice et discriminatoire », invoquant les conséquences sur les personnes à la recherche d’emploi, les chauffeurs de bus pris pour cible, les propriétaires qui voient leur bien perdre de sa valeur. Certains habitants comme Jamel, cité dans un article publié sur le site Rue89, ne comprennent pas la fascination médiatique pour ces histoires de drogues : « Le trafic de drogues, ça fait des années qu’il dure, ça ne concerne pas toute la ville. Pourquoi est-ce que c’est si important de parler d’eux ? »[11]. Les importants renforts policiers ont par ailleurs contribué à renforcer la tension. Ainsi, dans une vidéo tournée quelques heures après le caillassage des bus, trois jeunes ont été interpellés de façon musclée. « Sur les images, d’un côté, sept à huit policiers chargent violemment des jeunes. De l’autre, ceux qui assistent à la scène insultent la police, allant même jusqu’à menacer de leur tirer dessus. »
On pourra toujours s’interroger sur les motivations des dealers qui ont accepté d’être filmés dans les halls en train de revendre du cannabis. Instrumentaliser TF1 pour bâtir leur réputation ? Bénéficier d’un quart d’heure de visibilité ? À moins que ce soit un « délire » : « les mecs ont trop regardé Tony Montana ». Mais il convient aussi de s’interroger sur les effets d’une telle affaire. Le gouvernement a beau jeu d’attribuer ce climat à une répression accrue des usagers et revendeurs. Or on pourrait faire l’hypothèse inverse : la répression accroît l’insécurité des habitants. Pour deux raisons : d’une part, la priorité donnée à une police d’intervention multiplie les risques de dérapage et suscite une méfiance des habitants à l’égard des pratiques policières ; d’autre part, démanteler des réseaux nécessite de s’appuyer sur des témoignages, anonymes ou pas, bref de recourir à ce que l’on appelle dans les cités des « balances », de sorte que la suspicion – déjà forte – monte d’un cran : chacun ou presque est supposé trahir le groupe ou la communauté. Dans cette hypothèse, la stratégie du gouvernement qui consiste à s’attaquer en aval aux réseaux de trafics localisés dans les périphéries urbaines n’est pas sans effets pervers, ni limites. Elle semble vouée à l’échec en intensifiant les tensions, et alors que les drogues entrent par tonnes sur le territoire national.
Mondialisation, blanchiment, corruption
Car, plus que jamais, l’économie de la drogue est au cœur de la mondialisation. Les pays producteurs du Sud acheminent par tonnes les substances illicites aux pays consommateurs du Nord. Si ce phénomène correspond à l’entrée des drogues au cours des années 1960 dans l’ère de masse, il connaît une nouvelle vigueur depuis quelques années. On le voit bien à propos de ce que l’on appelle significativement « l’or blanc » (cocaïne, héroïne). D’un côté, la production de la coca s’est intensifiée dans des pays comme la Colombie, la Bolivie et le Pérou ; les cartels colombiens ont cédé les activités les plus risquées – et donc les plus lucratives – aux trafiquants mexicains, y compris la distribution de la cocaïne aux États-Unis, dans des villes frontalières comme Sinaloa-Juarez ou Tijuana. La cocaïne arrive en Europe, via la Hollande, l’Espagne, le Portugal, mais aussi, de plus en plus, par les pays d’Afrique de l’Ouest. D’un autre côté, le « Triangle d’Or » (Laos, Birmanie, Thaïlande) et le « Croissant d’Or » (Afghanistan, Iran, Pakistan) sont les principaux territoires où est produit l’opium depuis la Seconde Guerre mondiale. Après avoir été interdite au moment où les Talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, la production de pavot a décuplé au cours des années 2000. Selon l’Office des Nations unies contre la guerre et le crime, l’Afghanistan produirait actuellement tellement d’héroïne que le marché international ne pourrait pas l’absorber. Si on a assisté à un effondrement du marché dans les pays d’Europe de l’Ouest à partir du milieu des années 1990, d’autres débouchés comme la Russie et le Chine s’offrant aux trafiquants, divers indicateurs suggèrent son « retour ». Quant au cannabis, le Maroc est le principal pays producteur et exportateur mondial[12]. En 2003, on estimait à 134 000 hectares les terres cultivées du pays, soit une production estimée à 3 070 tonnes. Bien que les surfaces cultivées aient baissé en 2005 (72 500 hectares pour 1 076 tonnes de haschich), le cannabis occupe toujours de vastes superficies dans la région du Rif, malgré leur illégalité et le fait que le Maroc soit signataire des diverses conventions des Nations unies sur les stupéfiants[13]. Depuis les années 1980, l’économie du cannabis est en passe de constituer la principale source de revenus de cette région au faible niveau de développement et de d’équipement et serait même l’une des premières sources de devises du Maroc.
La « guerre contre la drogue » déclarée à la Colombie au cours des années 1980 par Ronald Reagan apparaît donc bien comme un échec : nulle barrière ne peut circonscrire ce problème ; quand ce ne sont pas les surfaces cultivées qui augmentent c’est leur rendement ; le nombre de consommateurs n’a pas diminué en particulier aux États-Unis et en Europe ; les chiffres d’affaires et le blanchiment d’argent se comptent par milliards. Les chemins de la drogue se sont diversifiés et les organisations criminelles se sont adaptées à la lutte antidrogue. Depuis les années 1970, l’économie de la drogue était structurée par l’économie de la guerre, et l’est restée en partie dans le cas de l’Afghanistan[14]. Aujourd’hui, elle apparaît moins un moyen qu’un enjeu de pouvoir politique et économique redoutable, au service des « Narco-États » (Afghanistan, Birmanie, Nigéria, Syrie, Iran) ou des économies régionales qui y trouvent des ressources considérables par le biais par exemple de programmes immobiliers. L’exemple du Mexique est en cela très révélateur. Le chiffre d’affaires des cartels mexicains est estimé à 50 milliards de dollars américains, soit plus de 10 % du PIB du Mexique, qui est de 368 milliards. Le blanchiment d’argent au Mexique varie entre 10 et 30 milliards de dollars selon les estimations. Chaque année, ce sont entre 250 tonnes selon les Mexicains et 800 tonnes de cocaïne selon les Américains qui sont introduites aux États-Unis. Le comble, c’est que là où la Colombie écope de sanctions économiques, le Mexique, troisième partenaire commercial des États-Unis, y échappe[15].
Le problème le plus inquiétant est la corruption. En Afghanistan, pour une économie mondiale chiffrée à 64 milliards de dollars, l’Afghanistan ne retirerait que 3 milliards de dollars, dont seulement 700 000 millions aux fermiers afghans qui cultivent le pavot. On se demande où est passé le reste ! Dans un pays comme le Mexique fondé sur le clientélisme et le trafic d’influence, « la narco-corruption n’a eu aucun mal à pénétrer à tous les étages de la société. Le sommet de la hiérarchie militaire n’est pas épargné. Deux généraux ont été récemment arrêtés pour complicité avec la mafia. L’un d’eux, démasqué en février, n’était autre que Jesus Gutierrez Rebollo, le numéro un de la lutte antidrogue ! Réputé incorruptible, ce fils de révolutionnaire zapatiste avaient pourtant d’excellents états de service. Ces derniers mois, il avait porté des coups très rudes au cartel de Tijuana. Et pour cause ! Il était très proche du cartel rival de Juarez, dirigé par Amado Carrillo. C’est ce dernier qui payait le loyer de sa maison de luxe et finançait son train de vie, hors de proportion avec le salaire d’un fonctionnaire »[16]. Dans le cas du Maroc, il paraît assez invraisemblable que la production de cannabis par les paysans Rifiens se fasse sans l’accord tacite du pouvoir central. Mais la corruption aggrave encore cet état de fait. Dans un rapport pour l’OFDT datant de 2001, Alain Labrousse et Lluis Romero rapportent plusieurs affaires témoignant des complicités « haut placées » dont bénéficieraient les trafiquants[17]. Ce n’est pas sans raison que la corruption fait partie des principaux objectifs d’un rapport demandé par Mohammed VI à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’indépendance.
D’où la question : pourquoi la France ferme-t-elle les yeux sur la culture du cannabis au Maroc ? Les auteurs du rapport cité plus haut apportent quelques éléments de réponse. La France et l’Union européenne ne veulent pas déstabiliser un régime qui n’est pas islamiste et est un partenaire essentiel dans la lutte contre le terrorisme. De plus, financer un véritable programme de développement du Rif serait très coûteux. 200 000 familles, soit un million de personnes, y vivent du cannabis. Si elles perdaient cette activité, elles constitueraient une vague d’immigrants sans précédent à destination de l’Europe. Au Maroc, le Rif a toujours été une région marginalisée : on ferme les yeux sur le cannabis qui leur permet de vivre et de se tenir tranquilles. Mais on peut aussi considérer une autre perspective d’analyse qui ne repose plus sur la capacité ou l’incapacité de l’État de contrôler les flux de l’économie criminelle, mais sur une approche des formes qu’elle prend dans les grandes villes à travers le tourisme et l’industrie immobilière. Ainsi, comme au cours de ces trente dernières années, sur les côtés espagnoles, la frénésie immobilière a embrayé sur une frénésie constructive urbaine à Tanger depuis le développement du commerce de cannabis[18].
Les drogues sont donc bel et bien affaire de géopolitique[19]. Elles constituent un modèle original de circulation de la richesse. Flux de marchandises, flux d’argent, flux de passeurs qui se disséminent et se jouent des barrières que leur opposent les institutions – même si on ne peut tout à fait exclure de l’analyse leur capacité sous une forme ou une autre à capter une part de cette richesse. Car c’est évidemment la logique de l’État que de s’efforcer de contrôler ces flux : il est un « appareil de capture », pour reprendre les analyses de Gilles Deleuze et Félix Guattari sur les processus de déterritorialisation et de reterritorialisation. Mais cette fluidité des économies criminelles est aussi celle des « économies vertueuses ». Comme l’a montré Alain Tarrius, les économies souterraines transfrontalières constituent une forme de mondialisation « par le bas » : elles sont le double inversé de la mondialisation « par le haut », néolibérale[20]. Pour le dire autrement, avec Michel Péraldi, elles sont moins régies par des « mécanismes aberrants ou parasites » qu’elles ne s’inscrivent dans le prolongement même des logiques du capitalisme[21].
Le paradoxe, c’est que notre regard sur ces phénomènes est dominé par la localisation. En témoigne la focalisation de l’attention publique sur les villes globales postindustrielles, et plus particulièrement sur ces territoires de marginalité urbaine que sont les ghettos, favelas, villas, inner cities et autres « banlieues sensibles »[22]. On ne pense pas flux mais stocks, réseaux mais territoires, circulation mais cristallisation, structures mais cultures. La rhétorique sécuritaire maintenant bien connue contribue largement à rendre visible la participation de ces zones qualifiées de « non droit » aux activités criminelles imputées aux familles vulnérables et démissionnaires et à leurs enfants supposés « sans repères » ; cela, tout en recouvrant d’un voile pudique tout à la fois la diversité des espaces sociaux de trafics et de consommations, les enjeux sociaux, sanitaires et éducatifs de la prévention des risques, mais aussi les porosités entre les économies légales et illégales et autres collusions entre les mondes du crime, de l’entreprise et de la politique.