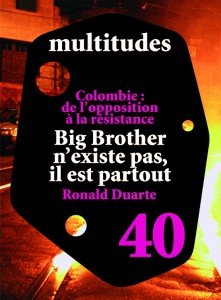Discussion à partir du livre d’Éric Sadin, autour de la surveillance comme prisme d’observation des mutations de l’environnement contemporain
Dominique Quessada & Éric Sadin
Dominique Quessada : La surveillance globale, selon votre livre (puisque c’est son titre), n’obéit à aucun schéma directeur préexistant : sa forme et son ampleur proviennent de l’interconnexion de systèmes techniques hétérogènes. Votre objet d’analyse ne se laisse pas réduire à une interprétation générale : sa complexité vient de la multiplicité de dispositifs – pour reprendre un terme foucaldien – ou d’agencements – pour reprendre un terme deleuzien – à l’œuvre. Il n’y a pas un projet unifié de surveillance dans la surveillance globale, mais un foisonnement de stratégies de développement de techniques très diversifiées. Vous prétendez que la surveillance globale n’est pas la conséquence d’un projet unique et machiavélique dont la finalité serait de prendre le contrôle des esprits. L’hypothèse d’un Big (ou même d’un Small) Brother paraît aux antipodes de ce que vous décrivez. Vous affirmez par ailleurs que le « contrôle » est un concept vide qui renvoie au fantasme d’une manipulation « radicale et définitive des personnes ». L’absence d’intentionnalité (et donc de schéma politique, au sens classique du terme) est-elle ce qui définit ce dispositif ?
Éric Sadin : C’est une illusion de croire à l’unicité du terme de « surveillance », la surveillance en tant que telle n’existe pas, elle est le résultat d’une pluralité de technologies éparses et de finalités très variées qui la plupart ne se recoupent pas. Une analyse précise appelle à la fois d’identifier la nature et la spécificité des multiples dispositifs à l’œuvre, et de décrypter les grandes tendances stratégiques contemporaines. On pourrait identifier cette perception souvent trop massive à l’égard de la surveillance, comme le résultat d’une réaction impulsive manifestée par la dimension paranoïaque constitutive de l’être humain : une méfiance à l’égard de l’autre qui remonte à la nuit des temps et qui aurait subi un glissement à l’ère moderne, initialement à l’œuvre entre les individus entre eux pour se cristalliser plus tardivement des individus vers les instances de pouvoir. L’histoire est certes traversée par des logiques d’observation des populations par les princes et les gouvernements, mais il faut comprendre ces stratégies de pouvoir comme produisant nécessairement une part fantasmatique (notamment entretenue par les phénomènes de conscience de présence de corps ou dispositifs, mais souvent masqués ou invisibles dans les faits, encourageant une intériorisation d’une observation virtuellement continue ; dimension analysée par Foucault à propos du Panopticum de Bentham).
Ce schéma trouble a longtemps inspiré le rapport commun à ce qui est nommé « surveillance », toujours situé entre réalité et fiction, schéma en partie entretenu par l’absence patente « d’yeux manifestes ». Cette relation un peu puérile (au sens d’une relation d’autorité instaurant d’un côté les enfants ignorants et de l’autre les parents informés) a longtemps structuré une perception commune, qui continue assez largement d’inspirer notre rapport contemporain à la surveillance. Mais ce qui aujourd’hui la caractérise est une sorte d’implosion de ce schéma binaire et frontal, désormais fissuré par une prolifération non hiérarchisée, polycentrique, et à objectifs multiples. Il n’existe plus aujourd’hui d’un côté les « surveillants » et d’un autre les « surveillés », mais un foisonnement de faisceaux, qui à la fois confirme l’expansion de logiques d’observation, et révèle l’éclatement des figures duales au profit de logiques protéiformes et mouvantes. C’est l’apparition de cette nouvelle architecture technologique et sociale, cette complexité-là que je me suis efforcé de saisir dans mon livre, qui a de facto nécessité une identification précise et spécifiée des phénomènes.
D. Q. : Votre livre pourrait être la suite de Surveiller et punir, ou plus exactement le Surveiller et punir des sociétés de contrôle. D’ailleurs, le sous-titre de votre livre est « Essai sur les nouvelles formes de contrôle ». « Surveillance » et « contrôle » restent-elles des notions toujours pertinentes pour désigner ce qui se passe dans ce réseau multicouches complexe que vous décrivez où il ne s’agit pas seulement de surveiller et de contrôler ?
É. S. : Il convient d’abord de distinguer les termes de « contrôle » et de « surveillance » non par le souci d’une obsession terminologique, mais parce qu’ils induisent des modalités de perception distinctes. Le contrôle suppose la faculté d’orienter les individus, jusqu’à modeler les consciences (principe caractéristique de 1984 d’Orwell), or cette dimension caractéristique des régimes totalitaires n’a plus cours dans les sociétés démocratiques. En outre, je tiens à critiquer sa pleine réalité entendue comme la possibilité de « façonner » les esprits, qui me semble occulter une fois encore la part irréductible de chacun à pouvoir rejouer singulièrement les situations et à développer des « micro-tactiques » aptes à ouvrir des espaces de liberté (je parle ici de contrôle et non de « répression », qui repousse considérablement cette possibilité). En revanche la « surveillance » relève d’abord d’une dimension informationnelle : recueillir des données en vue de vérifier la conformation à un ordre dessiné. Cette dimension s’est aujourd’hui déplacée vers celle du suivi des personnes, formalisé par la récolte et l’analyse des données, non plus dans l’intention de vérifier le respect des lois, mais de dresser des cartographies précises des personnes et de leurs relations, dans l’objectif de devancer des projets menaçants en préparation ou les potentialités d’achat. Ces glissements de méthode et d’objectifs requièrent nécessairement des termes réactualisés et plus appropriés : pour ma part j’adopte celui de traçage (tracking) – de surcroît, à tendance précognitive.
D. Q. : La surveillance contemporaine traite les corps comme des objets ordinaires, sur le mode de la gestion de flux. Vous parlez d’un corps/interface. En tant qu’ils sont identiquement soumis à une pratique qui pourrait s’apparenter à la gestion automatisée des stocks (avec notamment les projets de puces implantées dans les corps comme le sont déjà les puces RFID sur les objets), ne pensez- vous pas que l’un des effets du maillage intégral de la surveillance contemporaine est de faire disparaître toute différence de traitement (et à terme, de nature ?) entre corps et objets ?
É. S. : La notion que je développe de corps/interface regarde le fait que les organismes seront de plus en plus émetteurs d’informations via les implants, appelés à témoigner en temps réel et en continu de la localisation, des états physiologiques et émotifs, des relations situées à proximité ainsi que de la nature des rapports (à « distance sociale » ou dans une « intimité sexuelle »). Mise en place progressive d’un espace de plus en plus « sensible » et réactif (« intelligent » dit-on), truffé de capteurs destinés à transmettre les informations à des bases de données (ou systèmes d’alerte) capables d’interagir avec les personnes de façons multiples en offrant services (variations de températures, ou chromatiques des environnements ou des habitats par exemple, selon la situation physique et les préférences des individus), ou propositions commerciales évolutives et adaptées, ou encore offres ou interventions d’ordre thérapeutique.
Une des questions regarde celle de l’usage de ce suivi ininterrompu par les instances sécuritaires, autant que par les employeurs ou les proches, susceptibles d’être constamment informés de l’activité et des états des personnes. Cette architecture va englober, à terme les objets marqués par des puces, dévoilant une sorte de nouvel « écosystème artificiel » qui exposera des cartographies à la fois plus élargies et plus approfondies des êtres, de leurs relations, ainsi que des rapports à leurs objets alentours. Structure globale qui rendra possible des principes d’analyse davantage informés et plus précis, non plus seulement adossés aux actes et aux déambulations, mais à la nature des usages des objets (applications adoptées, fréquences d’utilisation, rotations de remplacement…). Informations à haute valeur commerciale, aptes à créer des profils bien plus détaillés et complexifiés des individus, qui instaureront un nouveau seuil dans l’appréhension comportementale et psychologique, non plus repliée à la seule personne, mais ouverte « au milieu environnant », devenu une zone « ultra-sensible » mobile et provisoire.
D. Q. : Dans votre analyse, vous revendiquez à de nombreuses reprises la nécessité de se décaler de modes d’approches organisés par des a priori idéologiques ; ceci de manière générale, mais vous insistez sur le fait que l’objet considéré – la surveillance contemporaine – n’est pas saisissable d’un point de vue idéologique. Vous semblez appréhender l’idéologie comme une pratique de la simplification et de la réduction, par ailleurs touchée par l’obsolescence. N’y a-t-il selon vous aucune dimension idéologique dans le phénomène de la surveillance contemporaine ?
É. S. : Ce sur quoi j’insiste d’emblée, c’est que l’ensemble de ces questions est bien trop enveloppé par des a priori idéologiques qui décident très souvent d’une question avant même de l’avoir sérieusement analysée, dans l’ignorance de l’étendue des phénomènes, et toujours suivant une « posture critique » incapable de saisir la complexité de chaque enjeu (dans leur dimension à la fois négative autant qu’ouverte à des possibles à explorer). Le champ de la surveillance fait partie de ceux parmi les plus orientés par des partis pris idéologiques surdéterminants et au pouvoir nécessairement aveuglant. Je suis sensible à la notion développée par Foucault « d’indicateur tactique », à savoir décrire « quasi-cliniquement » les situations, les rapports de force, les zones de faiblesse…, aptes à être saisies dans un second temps pour des usages conceptuels ou pragmatiques multiples et singularisés. « Je voudrais qu’il soit simplement un impératif conditionnel du genre de celui-ci : si vous voulez lutter, voici quelques points clés, voici quelques lignes de force, voici quelques verrous et quelques blocages. Autrement dit, je voudrais que ces impératifs ne soient rien d’autres que des indicateurs tactiques »[1].
Je me suis efforcé dans mon livre de développer une approche quasi-phénoménologique des procédures de surveillance, « au ras » de chaque technologie singulière, de chaque protocole, et des effets possibles de leur interaction. C’est le préalable, qui ensuite appelle analyses et réflexions, mais le socle « analytico-descriptif » me semble indispensable, pour ne pas manquer la complexité des situations, et ne pas être guidé par mes convictions mais mû par le désir de découverte relativement aux enjeux abyssaux propres à notre période historique. Il faudrait d’abord, d’un point de vue méthodologique, « désidéologiser » ces questions, pour se permettre après un large détour analytique, de les exposer suivant ses propres exigences éthiques ; ce que j’ai essayé de faire, selon une perspective minimale, celle visant à engager vigilance individuelle et collective dans les usages de nos technologies numériques (et des traces qu’elles supposent), autant que de rappeler l’impératif de fixer dans la délibération des limites, par la force concertée de la loi.
En outre, je relève que l’excès idéologique, relativement à ces questions, est presque toujours corrélé à un même type d’excès relativement à la technè, souvent empreint d’une répulsion ou d’une naïveté d’ordre platonicien, rousseauiste, heideggerien, ou d’esprit situationniste. Je rappelle la nécessité de lire ou relire Leroi-Gourhan, Simondon, ou Michel de Certeau, qui chacun selon des problématiques différentes évoquent les effets d’entrelacement indissociables entre outils et constitution humaine, ou la dimension proprement humaine et « noble » de la technique, ou encore les effets d’appropriation absolument singuliers des instruments techniques, à l’opposé de toute perception massive et victimaire, qui constitue aujourd’hui une nouvelle forme de doxa de la bonne conscience « humaniste » contemporaine, tellement emblématique par exemple dans les derniers textes de Bernard Stiegler.
D. Q. : La surveillance globale apparaît comme une nouvelle forme de gouvernement. Pour reprendre un lien foucaldien entre savoir et pouvoir, la surveillance globale permet de développer un savoir sur les comportements afin de dégager une prédictibilité ou une anticipation. Ce savoir d’un type nouveau, reposant sur les bases de données, leur interconnexion et le data mining déploie un nouveau type de pouvoir fondé sur la capture du réel. Là où l’idéologie entend gouverner le réel, le dispositif que vous décrivez semble gouverner à partir du réel, hors de toute intentionnalité, notamment idéologique. Comment décririez vous cette nouvelle gouvernementalité ? En quoi diffère-t-elle à votre sens des pratiques normatives qui l’ont précédée ? Quel est son niveau de rupture le plus grand avec ces pratiques ?
É. S. : Ici il ne s’agit en aucune manière d’idéologie mais d’objectifs. Par exemple, on capte des données comme nous l’avons dit pour pénétrer le psychologie la plus intime de chaque consommateur ; la visée consistant ici à vendre le plus pertinemment « sans perte informationnelle ». Aucune idéologie ici, seulement un souci d’efficacité, au sujet duquel on peut certes dire qu’il est motivé par une « idéologie libérale », mais ce saut trop rapide fait manquer le fait concret du dispositif mis en place pour répondre à ce but, qui avant d’être guidé par une quelconque force idéologique déploie toute une architecture technologique et d’usage qui induit de facto une multiplicité de questions et de réflexions (par exemple doit-on exiger une transparence relativement aux instances qui gèrent ces données, à leur mode de récolte et de fonctionnement ? ; peut-on autoriser la revente et donc des possibilités de croisements « déviés » ? ; ou encore quelle est exactement notre conscience de la destination des traces ?). Évidemment une lecture idéologique peut être développée (je préfère la notion « d’affirmation d’exigences éthiques »), mais elle ne doit constituer qu’une modalité d’approche ultérieure, qui doit libérer au préalable la pluralité des couches en jeu.
Enfin, « le Pouvoir » entendu comme une force décisive et omnipotente n’existe plus. Ce que confirme « l’architecture multipolaire » très éparpillée de la surveillance, c’est que nous vivons un moment historique marqué par une profusion, une atomisation exponentielle des organes de pouvoir, par le développement de « micro-organes », qui orientent la conscience des individus, selon des objectifs divers, découvrant au passage des silhouettes elles-mêmes variables et mouvantes d’une même personne, désormais « multi-appartenante » pour reprendre les termes de François Ascher. La plupart de ces « facettes » sont éclatées et ne sont pas reliées ; si elles étaient appelées à le devenir un jour, sous le vocable « d’agrégation globale de données », alors une forme massive de connaissance des personnes redeviendra possible, mais il s’agit actuellement de l’inverse exact, à savoir un éclatement dans les modes de connaissance des personnes, elles-mêmes composées d’identités multiples.
D. Q. : Vous envisagez l’exploration de la surveillance « comme le prisme d’observation privilégié de notre environnement contemporain. » Votre projet déclaré est de produire « une recherche pluristratifiée, de nature philosophique et à portée anthropologique ». Vous affirmez également qu’une nouvelle dimension anthropologique émerge de l’interconnexion, en tant qu’elle « affecte, selon des mesures sans précédent historique, les conditions de l’expérience : les relations ancestrales à l’espace et au temps ». Quelle figure de l’homme émerge selon vous de cette surveillance globale ? Pouvez-vous développer les principaux aspects de cette nouvelle dimension anthropologique ?
É. S. : Les multiples dimensions, induites par les modalités de la surveillance contemporaine révèlent, pour nombre d’entre elles, la nature de certaines mutations actuelles décisives. Un des faits majeurs, me semble-t-il, regarde le foisonnement de canaux relationnels/communicationnels qui relient les individus entre eux et les relie autant à des instances commerciales, sécuritaires, thérapeutiques… La fin du XXe siècle marque la disparition de schémas restreints et limités au profit de l’apparition du nombre. Que veux-je dire ? Simplement le fait qu’il existe désormais, en vue de réaliser une même action, quantité de modalités possibles qui peuvent varier selon l’humeur, la posture physique, les préférences… Par exemple, si je veux inviter un ami à dîner, outre le fait que je peux lui en parler directement, je peux l’appeler, lui envoyer un SMS ou un email, lui en faire part via Skype ou MSN…
Cette pluralité-là est plus largement emblématique d’une nouvelle forme d’éclatement des identités stabilisées, d’une variabilité comportementale, fondée sur une mobilité des usages, situant chacun comme étant virtuellement un être furtif, capable de modifier sans cesse ses gestes, par l’usage des technologies environnantes et par la quasi-infinité de points de réception et d’émission potentiellement connectés via des accès « multicanaux ». Le paradoxe de cette architecture veut que cette « hyper-volatilité » rende possible en retour le suivi des activités, encouragé par l’angoisse d’une indétermination universelle (symptomatique dans la notion de « nébuleuse terroriste »). Plus l’individu « hyper-connecté » pourrait échapper à une détermination fixée, plus va être perfectionné un traçage continu de ses actes. Corps contemporain qui bénéficie d’un très haut degré d’autonomie néanmoins soumis à des procédures de pénétration de plus en plus sophistiquées, le situant à l’intérieur d’une configuration entremêlée, capable de se déséquilibrer à tout instant. Cette fragilité requiert, dans sa complexité et son incertitude, des travaux de réflexion autant que des décisions, d’ordre politique, éthique, juridique, visant non seulement à ne pas retenir ces « effets de fuite continus », mais à capitaliser individuellement et socialement ce que ces structures propres à notre début de siècle peuvent produire d’absolument singulier.
D. Q. : Le dispositif global que vous décrivez fonctionne sur la mise en question d’un certain nombre de catégories par lesquelles se définissait la gouvernabilité classique : la conscience ou la subjectivité, la responsabilité, l’individu incarné (physique et corporel), le soi.
Cette mise en crise qui pourrait être la toute fin des catégories de l’humanisme peut-elle être porteuse, selon vous, d’un dégagement pouvant être salutaire des systèmes d’illusions qui ont conditionné la vision classique de l’homme et les croyances associées – en gros : rationnel, libre et autonome ?
É. S. : Je pense qu’il faut envisager ces questions et leurs conséquences, non pas à partir de l’individu en tant que tel, mais à partir des nouvelles formes de pouvoir qui apparaissent et qui induisent quantité d’effets sur une nouvelle anthropologie des corps, dont nous ne vivons que la genèse et qui reste entièrement à observer et à analyser dans ses évolutions et ses formes singulières. Les structures actuelles confirment comme jamais dans l’histoire, qu’une part bien plus étendue de chaque citoyen et des peuples, échappe. L’individu humaniste et moderne (celui apparu au XVIIIe siècle) a toujours imaginé, et ce malgré les mouvements d’émancipation, le pouvoir politique comme une forme de maîtrise omnipotente à la faculté quasi-omnisciente, et à l’action surdéterminante dans la totalité des champs du social. L’expression « le Pouvoir » signalerait cette propension marquée par une dimension en grande partie fantasmatique. Or notre période historique est marquée par un afflux de nœuds de pouvoir, dont les gouvernements font partie, mais au sein d’un paysage global mû par d’autres formes d’initiative, de décision, d’action (ONG, associations, groupements de citoyens, presse, blogs – ce qui est nommé ’Web 2.0’ étant caractéristique de l’amplification des faisceaux d’échange, de réflexion et d’actes « horizontaux »).
Il se développe la possibilité d’initiatives et de relations extrêmement élargies qui renvoie le pouvoir politique à sa spécificité, et à ses compétences réelles mais limitées (gestion du budget, rédaction des lois, instance de régulation sociale et économique, sécurité nationale) ; le reste échappant de plus en plus à son champ d’intervention. Cette « conformation globale » ouverte et marquée par des nouvelles formes de gouvernance individuelle et collective, favorisée (mais pas seulement) par les technologies numériques, fait apparaître un nouveau type de « pouvoir », celui-ci atomisé, déterritorialisé, mouvant, sans visage (ne relevant plus du pouvoir politique classique) – mais suivant un principe d’une nouveauté totale – appartenant à ceux disposant des moyens adéquats aptes à pénétrer l’intimité des individus, des structures éclatées, non reliées, entretenues par des acteurs éparpillés, via des procédures multiples, soumettant les personnes à des procédures de suivi variées aux objectifs hétérogènes, imposent une singulière complexité contemporaine, marquée par un foisonnement multipolaire et quasiment non représentable sur une cartographie globale, des nouveaux macro- et micro-foyers de connaissance des personnes. Parallèlement, d’autres types de pouvoir se développent, non plus fondés sur les capacités mais sur celles de pénétration, mais de coopération, ou d’initiatives locales ou globale. Multiples faisceaux multipolaires/multidirectionnels contribuant à complexifier une architecture comportementale, sociale, politique, juridique, en mutation permanente.
D. Q. : Vous démontrez l’indistinction par le computationnel des fonctions sécuritaires, guerrières, commerciales et relationnelles. Or, le fondement d’une société est la distinction des fonctions. Quel type d’espace politique peut s’installer dans un tel « mélange des genres » ?
É. S. : Il existe évidemment une indistinction computationnelle relativement aux données qui ne représentent dans les faits que des codes binaires, mais pas d’indistinction dans les usages et les visées ; ce serait tout le contraire même : une forme d’hyper-spécialisation du traitement des données – de surcroît hyper-individualisé – capable d’offrir des usages multiples selon les objectifs (à l’instar de ce que nous avons évoqué relativement aux effets d’entrelacement entre activités marketing et renseignement sécuritaire). Il n’apparaît pas de « mélange des genres » mais une variabilité dans l’utilisation possible d’une même information disséminée par un même individu, soumettant virtuellement chaque action, déplacement, achat… à une « radiographie » multiusages, confirmant non seulement le continuum de plus en plus étendu des procédures de suivi, mais encore la dimension « pivotante » des données dans ce qu’elles sont capables d’exposer des focus distincts suivant des buts déterminés. On voit encore ici à quel point la question cruciale de « l’agrégation globale des données » constituerait une rupture radicale dans la profondeur de champ de la connaissance de l’intimité des personnes, qui pousse à la nécessité d’instaurer des bornes légales infranchissables, relativement à cette ambition qui constitue le rêve – désormais techniquement réalisable – d’une perfection sécuritaire et marketing absolue.
D. Q. : La surveillance globale consiste en une numérisation de séquences d’expérience humaine, sur un mode de plus en plus continu, sans rupture. Cette véritable digitalisation de la vie ne permet pas d’entrevoir une façon « d’en sortir » (il n’y a plus d’extériorité au dispositif), d’y échapper ou d’y résister. Le droit lui-même semble inopérant en matière de saisie du phénomène (et donc de développement de modalités pertinentes de résistance ou d’évitement) puisqu’il repose sur l’idée d’un sujet du droit, d’un individu responsable, alors que les dispositifs de capture digitale de l’expérience sont bâtis sur l’évacuation fondamentale de cette dimension (ce n’est plus l’homme que l’on surveille, mais une multitude de fragments disséminés de la personne, pouvant être contradictoires et appartenant à des régimes dissociés : les différents « profils » auxquels la personne correspond). Si, comme vous l’avez dit, ce qui caractérise – et distingue – fondamentalement la surveillance globale est l’absence a priori de finalité et d’intentionnalité, comment peut-on (et le peut-on) résister ou échapper à un tel dispositif, dès lors qu’il ne « veut » rien et ne cherche rien ? S’il n’y a rien à quoi s’opposer, à quoi peut-on s’opposer ? Et avec quels outils ?
É. S. : C’est un fait qu’il existe de moins en moins de « rupture de faisceau » dans la connaissance des activités et la localisation des individus, par le fait de l’utilisation de plus en plus intensive d’instruments numériques interconnectés. L’enjeu ne consiste pas à « s’opposer » à cette architecture globale, suivant un angélisme iconoclaste, mais à développer des stratégies individuelles et collectives de conscience et de vigilance à l’égard de nos usages et à rédiger des arsenaux législatifs adéquats. Par exemple, il semble bien tard désormais pour « s’opposer » à la généralisation des passeports biométriques (à moins de refuser tout déplacement hors des frontières de son pays de résidence), en revanche il est encore possible de revendiquer un juste usage des traces (uniquement stockées sur les documents ou mises en relation avec des serveurs centralisés ? ; durée de conservation ; et surtout croisement à d’autres données).
Au risque de me répéter, la grande question actuelle ne regarde plus celle de la dissémination infinie de nos traces qui constitue un fait avéré et sans cesse amplifié, mais celle de la licence légalement accordée ou non à les croiser à des types d’information d’ordre distinct. C’est l’ampleur de la pénétration qui est en jeu ici selon des facilités techniques et des vitesses de traitement, qui rendent possible une cartographie hautement détaillée des personnes. D’ores et déjà la connaissance des individus par des tiers s’est approfondie, mais une forme de « connaissance quasi-globale » surgirait (pour des usages multiples, également de personnes à personnes) si le verrou de l’agrégation globale sautait. Vigilance dans les usages et droit appelé à fixer des bornes ne constituent pas des formes vaines d’opposition, mais des initiatives ouvertes en relation active avec ces enjeux contemporains décisifs.
D. Q. : De façon isomorphe à l’objet que vous tentez de saisir, vous vous refusez à toute formulation d’hypothèse d’ordre général, vous semblez même réticent à l’idée d’émettre un concept. En cela, votre réserve évoque celle de Foucault qui reprochait à beaucoup de philosophes leur aptitude à proférer des hypothèses générales, et voyait dans cette façon de faire une insupportable réduction de la complexité des phénomènes, voire une paresse érigée en méthode d’investigation. Permettez-moi tout de même d’insister sur ce terrain. Par la dissolution de la possibilité de toute distinction entre surveillant et surveillé, entre oppresseur et opprimé, à travers la circularité de positions autrefois antagonistes, entrons-nous dans l’ère taoïste du non agir ? Y a-t-il une « résistance » possible à ce type de dispositif ou celui-ci signe-t-il la fin de l’idée de résistance ? Dans ce cas, par quoi cette dernière peut-elle être remplacée ?
É. S. : La notion de résistance ne me semble pas du tout appropriée à ces enjeux, elle marque une forme de refus radical, une pression contrainte et négative opposée à ces forces. Posture qui caractérise généralement les comités « anti-vidéosurveillance » (qui feraient mieux de s’inquiéter de la puissance des bases de données plutôt que de celles des caméras, qui « focalisent » l’attention par leur visibilité, mais qui occultent le cœur du tracking contemporain, structuré par des flux dits « immatériels » et invisibles). Attitude qui présuppose la persistance de schémas frontaux et binaires (à l’instar de nos rapports physiques aux « yeux électroniques »), mais qui ignore le glissement contemporain des situations, l’atomisation des foyers que nous avons évoqués, incapables d’être « régulés » par le fait d’oppositions systématiques, mais par l’analyse des mouvements (mon livre s’inscrivant en partie conformément à cette exigence), par la nécessité de transparence dans l’usage des traces, une plus grande clarté dans le consentement accordé à l’égard de l’utilisation de nos données, une limite dans la durée de conservation, la restriction des croisements possibles…, bref, par la mise en place de toute une série évolutive de décisions pragmatiques, inspirées par le respect irréductible de l’intégrité des personnes, celui du droit à situer une part de soi-même résolument à l’abri des processeurs computationnels.
Positions qui appellent sans cesse une sorte de « visibilité réduite » des événements à l’intérieur de cette grille globale très indistincte, un ajustement continu, une modestie politique fondée dans son espoir et son éthique, sur la vigilance individuelle et collective et sur une efficacité du droit, seul capable d’indiquer que les événements techniques, les volontés sécuritaire et marketing ne dictent les règles issues de la libre délibération démocratique, mais que le champ possible de leurs activités se déduise des cadres consciemment et délibérément dessinés. Aucun acte de « résistance » ici, mais la volonté de se confronter activement et lucidement (sous des formes elles-mêmes autant diverses) aux foisonnants maillages isolés ou superposés multisources/multifonctions qui enveloppent notre quotidienneté, suivant une densification sans cesse amplifiée mais aux courbes de progression qui peuvent encore (jusqu’à quand ?) être infléchies ou inversées.