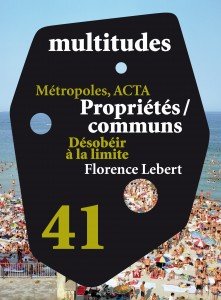S’il y a lieu de rappeler les origines et l’histoire des conduites relevant de la désobéissance civile, de Thoreau à Arendt en passant par Antigone, il peut sembler nécessaire d’analyser la valeur d’usage actuelle du terme, son extension parfois bien au-delà de ce qu’il est appelé à désigner. Entre l’espace politique de la scène électorale, de la police des partis et du gouvernement d’une part, la nudité de l’action clandestine d’autre part, la désobéissance civile occupe une place d’apparent compromis politique au sein de la démocratie. Elle interroge les conditions de possibilité de l’action politique elle-même, dans un paysage où tout passage à l’action est interprété comme passage à l’acte. Récemment, le terrain des luttes a montré l’épuisement des formes traditionnelles de l’action et la nécessité d’en penser l’évolution, la transformation. L’important mouvement de grève du milieu universitaire au printemps 2009 en témoigne : le mouvement n’a pas été entendu, et ce sont davantage les formes radicales, parfois héritées de la mémoire des luttes, qui ont marqué cette séquence. Aussi faudrait-il dire, avec plus de précision, que ce ne sont pas tant les formes traditionnelles qui s’émoussent que leur sécularisation, leur devenir aux conditions du jeu démocratique. Une grève soutenue par une opposition politique vive, reconduite, et le recours aux séquestrations de patrons ont ainsi affirmé la puissance symbolique et la part de violence nécessaire à la conduite d’une telle action. Rien à voir, alors, avec la grande manifestation dominicale fondée sur le fantasme d’une conjonction des luttes. La désobéissance civile occupe ainsi un espace singulier qui répond à la nécessité d’inventer d’autres modalités d’interventions collectives, et de créer une interruption temporelle de l’ordre établi. Et s’il y a lieu d’interroger le caractère spectaculaire donné à certaines de ces manifestations – l’Appel et la Pioche, les Clowns à Responsabilité Sociale, La Barbe – il convient de les inscrire dans un mouvement général où la politique vive est entravée, et en quête d’auteurs.
La désobéissance civile a l’intérêt de désigner des positions très concrètes de refus dans un champ spécifique de la vie publique, civique, et du domaine du droit, mais les repères qu’elle suppose à son action, les référents politiques qu’elle désigne et les valeurs qu’elle se donne sont d’une extrême variété : entre La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la discrimination sexuelle et le péril écologique, tout se noue souvent dans une grande confusion. On voit ainsi qu’elle s’impose, que ses formes s’imposent sous le primat de la mobilisation, de son urgence, et parfois dans l’économie d’une pensée plus articulée sur la cohérence des luttes. Mais c’est aussi son intérêt que de passer outre la cohérence pour avancer par traces, par assauts successifs, dans la création d’une réactivité efficace, et relativement autonome. Le risque, nous l’avons dit, est celui d’une dilution de son effectivité discursive : actrice du jeu démocratique, détectable et gouvernable, ou offensive plus sourde, réseaux d’actions mêlés dans l’ombre qui contribuent à une opération plus globale de détournement. Entre l’expression d’un tort – et son devenir aux conditions du Spectacle, la désobéissance civile se tient sur un fil : elle suppose une déclaration, mais implique aussi une prise de risque qui repose sur une part de confidentialité. Elle se joue ainsi sur un lieu indéfini qui part du dedans de l’espace démocratique pour glisser vers ses bords.
La désobéissance civile – à l’intérieur
Si l’on s’en tient à une définition circonscrite de la désobéissance civile, elle reste dépendante au domaine du droit, et témoigne d’un conflit surgi entre la loi et une cause reconnue commune. Elle parle donc depuis l’intérieur de la communauté politique, entendue ici dans sa relation aux institutions de l’État. Lorsque Hannah Arendt s’intéresse aux cas de désobéissance civile dans le cadre de la Constitution américaine, elle désigne la difficulté conséquente à postuler un droit qui présiderait à toute forme de désobéissance civile, à « justifier par le droit la violation du droit » ; elle montre aussi la fragilité du référent politique et moral – éthique – , qu’engage une telle position. Aussi, ce qui doit singulariser la décision de désobéissance civile réside dans une aptitude collective à s’opposer à partir d’un impératif reconnu par plusieurs, émanant d’une « conscience commune », et donc distincte d’une position individuelle et marginale.
En somme, si la désobéissance civile s’oppose à la majorité impliquée par la perspective politique gouvernementale, elle se tient dans les limites de cette contestation, et implique sa présence dans le principe du droit, face aux prérogatives inconditionnelles de la loi. Plus simplement, si elle conteste une forme d’application de la loi, un certain mode d’exercice du pouvoir, elle ne vise pas la remise en cause du pouvoir lui-même, ni précisément sa constitution. Aussi est-ce toujours partiellement, et au cas par cas que la désobéissance civile apparaît, appelée par des situations singulières dans lesquelles il s’agit de pouvoir prendre position. Les définitions théoriques varient sensiblement, mettant en relief le caractère frontalier de la désobéissance civile, sa relation avec les institutions et son appel à des principes supérieurs, communs, de justice et d’égalité, portés par la revendication collective[1]. Il y a du jeu dans la loi, manifestement, et c’est à cet endroit que la désobéissance civile s’active.
Arendt insiste sur un autre point qui nous intéresse ici, à savoir le partage entre conscience morale individuelle et conscience civique : en raison de quel impératif est-on conduit à désobéir ? Engage-t-on ainsi un rapport à soi, ou un rapport à la communauté ? Là encore pour Arendt, c’est la qualité collective de l’action de désobéissance qui est seule garante de sa légitimité politique. Elle suppose donc une articulation qu’on dirait subjective, par laquelle se trouvent associées la reconnaissance d’un tort à sa manifestation, ou sa démonstration commune, dans un geste qui fait rupture avec le consensus démocratique. Il se peut alors que ce soit le tort fait au tout autre qui demande réparation, et il faudra imaginer le passage par une identification singulière, par l’exposition de la condition de communauté: processus de subjectivation politique qui suppose un décalage, un déplacement d’avec les identités fixées par la logique policière. La politique est une hétérologie (Rancière), et c’est ici que la différence se crée : à ce niveau où la politique intervient par un mouvement de séparation, d’émancipation, une demande supplémentaire au consentement de la communauté autour de la décision démocratique. La question se pose dans l’immédiat : à quel moment ce caractère intrinsèque à la politique elle-même passe-t-il sous l’égide de la désobéissance civile ? Arendt précise que ce rapport au consentement – hérité du contrat social de Rousseau à Tocqueville – est particulièrement en jeu dans la politique américaine et qu’il s’exprime différemment dans d’autres espaces constitutionnels. Mais c’est néanmoins cet accord mutuel dont dépend la représentativité gouvernementale que met en cause le geste de désobéissance civile, par un refus d’en reconnaître la légitimité supposée acquise pour tous.
Du consentement au consensus, on le mesure, la désobéissance civile interroge l’espace de la démocratie lui-même : ce qu’elle autorise comme possibles contestations, ce qu’elle concède, et ce qui tend à s’en éloigner, à projeter la scène politique dans un autre lieu… On notera ainsi l’importance qu’Arendt accorde à la distinction fréquemment établie entre la désobéissance civile et le geste révolutionnaire. Si la désobéissance civile se sépare essentiellement de l’action révolutionnaire par le refus du recours à la violence, on comprend qu’Arendt n’est pas convaincue par cette séparation, et que la non violence ne suffit pas pour elle à écarter les actions de désobéissance d’une projection révolutionnaire : « Comme le révolutionnaire, celui qui fait acte de désobéissance civile éprouve le désir de « changer le monde », et ce sont des changements radicaux qu’il peut désirer accomplir – tels sont ceux que pouvait désirer Gandhi, par exemple, dont l’action est toujours citée comme le grand exemple de non-violence »[2].
Oublier la révolution
N’est-ce pas justement la révolution qu’il s’agit de conjurer par l’adoption du nom de la désobéissance civile? Dans la mesure même où elle reste inintégrable au système juridique, elle agit dans un espace qui la voue à frôler la clandestinité et l’illégalité, elle ne saurait rester entièrement séparée de l’action entendue comme émancipation, avec ce qu’elle suppose, et attend. Si la plupart des actions relevées aujourd’hui comme appartenant au domaine de la désobéissance civile sont sans danger pour la société, beaucoup d’entre elles sont aussi caractérisées par une radicalité politique et un souci d’intervention qui les démarquent du consensus et les rapprochent de l’action directe. Aussi faut-il rester sensible à la valeur d’usage de la désobéissance civile portée par la démocratie d’opinion. La résurgence de la désobéissance civile dans les discours doit rester inscrite dans la mémoire des luttes et des autres noms de l’action et de l’événement : soulèvement, révolution, guerre civile, terrorisme, etc. L’isolation de la désobéissance civile de ces autres noms fait courir le risque d’une dilution de sa spécificité politique, en la précipitant vers sa qualité de compromis modéré, modeste et surtout gouvernable. Il se peut ainsi que l’usage même du syntagme de désobéissance civile en vienne à discipliner la portée plus vaste de l’action, sa part d’excès, et la possibilité qu’elle enchaîne sur ce qui semble ne plus pouvoir exister, l’événement lui-même et sa condition d’exposition. La politique est affaire de réalité, mais elle est aussi affaire d’énoncés qui engagent au-delà du présent des nécessités sociales et économiques. Aussi, sans remettre en cause l’importance des actions menées sous l’identification à la désobéissance civile, il s’agirait d’interroger les moyens par lesquels elle se donne à voir, et se revendique.
Non-violence en démocratie immunitaire
On ne saurait ainsi mettre en question la portée de la désobéissance civile dans les discours et sa revendication à la non-violence sans la situer dans le présent d’un moralisme des conduites. Nous assistons aujourd’hui à l’inflation d’un moralisme anti-violence nourri par le discrédit de tout ce qui, du domaine des conduites individuelles comme des pratiques politiques, relève de la violence. Elle devient le problème de tous, chacun prenant part au refoulement nécessaire, coupable du moindre geste de trop sur la surface lisse de la société immunisée : « Dans les conditions de la démocratie du public contemporaine, toute espèce de violence, politique ou non, doit être vue par tous et chacun avec les yeux de la police. Ce qui suppose, du côté des gouvernants […] une très intense et constante activité portant sur le formatage des discours, une opération de grand style, entreprise de longue date déjà, et s’exerçant sur les enjeux discursifs du mot violence. […] Par le moyen de cette nouvelle codification, il s’agira de jeter les bases d’un consensus durable entre gouvernants et gouvernés, fondé sur la vision sécuritaire et policière de cet enjeu. […] L’enjeu du compactage des subjectivités est ici décisif – il s’agit bien de cela : au prix d’une homogénéisation des points de vue en forme d’écrasement des subjectivités, nous sommes tous conviés à concélébrer ce culte de l’anti-« violence », soit, en clair, à introjecter la vision policière du monde, postulée seule concevable et légitime »[3].
Et c’est par l’expansion discursive d’une confusion entre le scandale des mouvances terroristes, les « jeunes des banlieues », et la fessée coupable que ce processus se tisse, s’appuyant sur les grandes frayeurs contemporaines. Aucune distinction n’est opérée entre le domaine des violences politiques, et la « violence sociale », ou domestique. C’est ainsi qu’ont fleuri en 2005 les discours abrutissants sur les violences des banlieues : parce qu’elles n’étaient pas articulées à une rhétorique politique reconnaissable ou acceptable, et qu’elles sont restées muettes quant à leur revendication – en réalité parce qu’elles s’adressaient à l’État lui-même, ces actions sont passées dans l’économie du « problème social des banlieues »[4]. Il fut assez amusant d’entendre alors les paroles offusquées d’une opinion sidérée qu’on puisse s’en prendre aux symboles de l’État, donc à ceux du service public.
Une autre séquence peut être rappelée dans ce débat, celle qui occupa la France entière autour de Julien Coupat, du Comité Invisible et de l’Affaire Tarnac. On a vu alors se dresser un magnifique consensus à double entrée, dont les deux mouvements ont été épousés sans sourciller par la presse, le premier moment voyant l’opinion rassemblée sous la frayeur du fantasme terroriste, le second autour de la nécessité d’en constituer la défense et l’impunité. Dans les deux cas, la violence des écrits mobilisés se trouvait absorbée : une fois dans l’accusation sans preuve et l’abus de violence policière, une autre dans la défense à tout prix d’une faute qu’il aurait fallu pouvoir endosser, à laquelle il aurait été souhaitable, collectivement, de s’associer[5]. Mais la défense a pris le pas sur la politique alors, dans un mouvement qui vint confirmer, bien malgré lui, le préjugé anti-violent. Certes ces écrits philosophiques étaient intelligents, mais ils ne pouvaient avoir – suivant cette défense anesthésique – aucune portée en termes d’action. Au-delà, il faut souligner le recours à une figure de l’État tutélaire attendue quand la police dérape ; l’État entrevu alors comme figure de Janus, monstre à deux têtes : face – Police / pile – Providence. Il faudrait savoir ce qu’on veut…
Cela va sans dire, le moralisme anti-violence s’appuie sur le monopole de la violence d’État et son caractère arbitraire qui semble ne plus pouvoir être contesté. Aussi faut-il distinguer les mouvements et théories de la non-violence qui ont émergé dans les années 70 du moralisme anti-violence dont nous décrivons ici l’omnipotence : c’est par rapport à la violence d’État, à la guerre nucléaire et aux génocides, qu’il fallait penser l’action politique. Les mouvements d’indépendance, dans les mêmes années, ont montré qu’il était aussi plus complexe de renoncer à la violence (Fanon, Sartre), et qu’il fallait penser les moyens par lesquels se la réapproprier. Dans les deux cas, on voit que la question de la violence est en débat depuis l’intérieur de la pensée politique, intimement liée à la reconnaissance des conflits en jeu, à leur intensité, quand aujourd’hui sa relation avec la politique est interrompue, interceptée, déconnectée.
Les pratiques de désobéissance civile interviennent dans ce paysage, où elles doivent inscrire leur légitimité par distinction d’avec d’autres conduites, plus sauvages, secrètes, et inarticulées. Elles impliquent néanmoins une prise de risque évidente qui les expose à la violence, et elles doivent s’en prémunir. Mais il semble nécessaire de mettre en évidence leur expression dans ce climat de la vie politique, non pour suggérer qu’elles manqueraient de violence, mais pour observer une fois encore leur singulière fragilité – du dedans de la possibilité démocratique, vers le dehors. Ses marges, en somme, l’espace de la politique elle-même, que le nom de désobéissance civile ne saurait entièrement contenir.
Le Spectacle est-il visible ?
Si de nombreuses actions de désobéissance civile se tiennent dans une certaine discrétion de longue haleine, appelée par la nécessité de durer, le Spectacle occupe une place significative qui interroge les conditions de visibilité de l’action elle-même, et le glissement possible d’un régime de visibilité à un régime d’apparence.
Il faut bien que l’action se déclare, se montre, et pour beaucoup aujourd’hui il vaut mieux pour cela proposer des bisous dans le métro aux heures de pointe et porter un nez de clown. Pour exister, il faut apparaître. La logique semble alors être la même pour tous dans l’horizon des sociétés industrielles hyper-médiatisées : la transformation d’une articulation politique en proposition spectaculaire, seule capable de susciter l’adhésion de l’opinion publique. Ces manifestations semblent nous dire que la communauté politique n’existe désormais que sous l’ordre de cette synchronisation. Il s’agit ici de trancher avec les modèles politiques dominants, d’imaginer un scénario bien monté, élaboré par avance, un scénario plus qu’une scène peut-être. Un concept politico-publicitaire prêt-à-porter, une action de communication qui s’organise comme une fête costumée. Il s’agit de se distinguer coûte que coûte des pratiques syndicales et des mouvances autonomes, et avec un peu de mauvaise foi, on pourrait dire que ces expressions du politique s’appuient précisément sur ce que nous dénoncions plus haut, à savoir le moralisme anti-violence d’une part et la débâcle des organisations politiques et syndicales d’autre part. Il faut rendre la politique supportable et accessible à tous, y compris aux enfants peut-être… Des stages sont ainsi proposés aux plus motivés afin qu’ils puissent apprendre à désobéir en toute sécurité.
Ce n’est pas l’action elle-même que nous contestons ici, mais le fait qu’elle pense par avance ses conditions de visibilité : elle se prémunit, elle s’immunise dans et par les effets du Spectacle. Et nous pensons que le Spectacle n’est pas un lieu de subjectivation.
La désobéissance civile recouvre ainsi des actions et des décisions d’une grande diversité, mais précisément elle ne les contient pas, et l’idée d’une communauté politique impliquée par l’appartenance à cette même condition relève d’un fantasme. La désobéissance civile, dans le paysage politique actuel, ne fait pas communauté, et son efficacité tient justement, nous l’avons dit, dans son apparition toujours partielle. S’il est possible de parler de moment de communauté autour d’une action qui rassemble un collectif, les actions de désobéissance civile dans leur diversité ne peuvent être assimilées.
Ainsi, toutes les conduites de désobéissance civile ne relèvent pas du Spectacle : la mobilisation des enseignants désobéissants du réseau RESF, les infirmières, ou les psychiatres de La Nuit sécuritaire, parmi d’autres, interviennent très concrètement, souvent depuis leur espace professionnel, par le refus d’application d’un nouveau programme, d’une nouvelle directive gouvernementale, pour s’opposer à une mesure qu’ils jugent discriminante ou relative à l’expansion des pouvoirs policiers dans le domaine public. Se tissent ainsi des relations entre des positions subjectives partageant le même regard sur la société et la politique du gouvernement, et la désobéissance n’est pas le seul principe de cet accord. La désobéissance civile n’est pas un nom suffisant pour contenir les processus de subjectivation appelés par la nécessité de trouver des armes pour se soustraire à la « société de clairvoyance »[6]. Ainsi, le refus de participer à la prévention de la délinquance dès l’enfance (Zéro de conduite), le refus de collaborer à la dénonciation des demandeurs d’emploi sans papiers par les agents du Pôle Emploi, ou encore le refus de se soumettre à la généralisation des nanotechnologies et du prélèvement ADN peuvent être des exemples de contre-conduites, des modes de résistance réservées, soutenues par le souci commun d’échapper à la « prévoyance » policière.
Signaux faibles
La façade légaliste de la désobéissance civile ne tient pas longtemps quand on intervient à ce niveau de la lutte, quand la politique engage des modifications subjectives, une transformation des formes-de-vie. Aussi sont-ils plusieurs à ne pas vouloir être comptés parmi les désobéissants civils/civiques. Aussi sont-ils plusieurs à s’organiser sans revendiquer, sans déclarer, sans porte-parler. Ceux-ci élaborent dans la durée des pratiques singulières de présence dans l’espace public dont la fonction essentielle pourrait être celle-ci : recréer des zones d’indépendance collectives, des pratiques de mise en commun, de gratuité, et produire de l’ombre, du trouble dans les circuits des Renseignements Généraux. Produire de l’ombre, des court-circuits, se rendre indétectables.
Ces modes d’interventions sont parfois relayées par des médias autonomes, via Internet[7] ; ils sont le plus souvent confidentiels. S’ils s’inventent dans le présent des rencontres sur le terrain politique de la ville, ils rappellent aussi des actions menées dans les années 70, comme l’autoréduction, l’occupation, ou les techniques de blocage. Elles disent quelque chose que la désobéissance civile comme seul discours semble vouloir retenir : qu’à l’impossible, nul n’est tenu. L’action est à portée de main, il suffit de s’organiser.
Ainsi, au-delà d’une définition posée à l’action qui désigne par avance l’espace de sa réalisation, au-delà de l’opposition trop tranchée entre violence ou non-violence, entre légalité et clandestinité, il s’agit d’observer la production d’intensités politiques, des émergences sensibles qui passent souvent davantage par l’anonymat, l’absence de discours, des formes de discrétion puissantes qui court-circuitent les identités attendues. Il faut alors imaginer ces apparitions comme autant de signaux faibles qui circulent et s’échangent dans la nuit, des réseaux de relations nouvelles entre les subjectivités. Quels que soient leur nom.