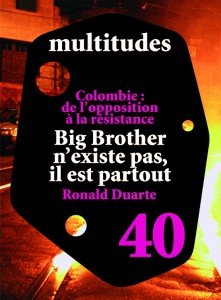Un psychiatre militaire américain fait feu sur quatorze soldats et les tue. Avant c’était des collégiens. Des ingénieurs, techniciens et commerciaux de France Télécom se suicident en série. Des agents du ministère de l’Écologie, d’autres administrations, des salariés d’autres entreprises aussi. La directrice de la Protection judiciaire de la jeunesse de Paris l’a tenté. Chaque mois qui passe apporte de l’eau au moulin de cette triste nouvelle : des gardiens de l’ordre, des subordonnés, des travailleurs n’arrivent plus à faire face. Heureusement, l’envie de tuer reste presque toujours virtuelle, refoulée ou fantasmée. Comme l’a dit André Breton, tirer dans le tas est un acte essentiellement surréaliste. Heureusement l’envie de se tuer est le plus souvent contrecarrée par l’entourage, avec l’aide des médicaments. Mais l’actualité de ces derniers mois signale un accroissement de la pression sur les barrières morales tendues par la civilisation contre la pulsion de mort. Même s’il s’agit d’une illusion médiatique, l’effet de désorientation est réel. Une nouvelle dimension s’ajoute aux peurs qui nous gouvernent : la folie dans les relations sociales.
La gestion civile du quotidien
Toutes les tensions affectives, tous les désarrois, toutes les rancœurs et toutes les haines ne débouchent pas sur une fusillade ou sur un suicide. Le plus souvent elles arrivent à s’agencer dans un fonctionnement possible. Dans l’intensification et la complexification des interactions sociales, tout le monde est amené à jouer plusieurs fois par jour, alternativement, le rôle du bureaucrate obtus, celui du patron exigeant, celui de l’employé qui fait le nécessaire, celui du requérant exaspéré, pour qui il est inconcevable de ne pas admettre qu’une exception s’impose dans ce cas particulier… Tous, en même temps qu’ils sont sources de demandes et de contraintes multiples, développent une endurance qui, même triste, fait obstacle aux passions mortuaires.
Les conditions de vie imposées aux populations palestiniennes ne légitiment pas les fusillades dirigées contre ceux qui peuvent, de près ou de loin, à tort ou à raison, sembler avoir une part de responsabilité dans ce qui écrase les Palestiniens, pas plus qu’elles ne légitiment les attentats-suicides en Israël ou les tirs de roquettes. Mais ces conditions sont insupportables, et doivent obtenir pour leur abolition des moyens politiques difficiles à trouver. Les inner cities américaines ou les banlieues hexagonales n’explosent pas malgré l’ensemble impressionnant de conditions réunies chaque jour pour pousser à leur explosion, malgré la rage accumulée par des pressions existentielles exaspérantes (même si un incident change parfois la donne) ; les voyageurs des RER A ou B, sous-équipés, surpeuplés, se contiennent et se supportent chaque soir et chaque matin, malgré le traitement de sardines en boîte auquel ils se trouvent soumis ; les employés, exposés à un stress entretenu par des stratégies managériales savamment modélisées, résistent en silence et prennent la tangente dans les loisirs et les hobbies : tout autant que les rares explosions qui défraient la chronique médiatique, n’est-ce pas l’innombrable multitude de gestes silencieux de tolérance, de patience, d’endurance, de déflexion, de « compréhension », de « maîtrise de soi », qui mériteraient d’apparaître comme extra-ordinaires, même s’ils forment le tissu du quotidien ?
La fuite statistique
Les suicides de France Télécom n’ont pas besoin d’être expliqués, nous apprend un expert, dûment relayé par Le Monde et par La Croix, pour la bonne raison qu’ils sont « quelque chose qui n’est pas ». René Padieu, inspecteur général honoraire de l’Insee, président de la commission de déontologie de la société française de statistique, donne en effet sa leçon aux ignorants sensationnalistes : avec 15 suicides par an pour environ 100 000 employés, France Télécom est en dessous de la moyenne française de suicides relatifs aux 20-60 ans, qui est de 19,6 pour 100 000. « On regrettera que les drames humains que sont ces suicides – peu nombreux, certes, mais bien réels – soient instrumentalisés dans l’affrontement entre une direction et ses salariés : c’est indigne ». À l’indignation morale fait suite l’appel à un autre discours d’expertise, celui du psychiatre : « croire en l’existence de quelque chose qui n’est pas constitue ce qu’en psychiatrie on appelle un délire »[1].
Merci pour la leçon de sobriété rationnelle : entre le Statisticien qui nous apprend qu’« on se suicide plutôt moins à France Télécom qu’ailleurs » et le Psychiatre qui inscrit au registre du « délire » l’attention portée à ces « drames » pourtant « bien réels », nous voilà rassurés. Même ce qui nous sautait aux yeux au Journal de 20 heures ou à la première page des quotidiens ne relève que des frictions normales de la vie en société. Étant donné les milliards de milliards de connexions synaptiques mobilisées par une population de 300 000 000 d’individus, connaissant le nombre d’armes à feu en circulation et la date de naissance de Charlton Heston, chacun pourra calculer qu’il est statistiquement normal – donc insignifiant – que, tous les deux ou trois mois, quelques courts-circuits cérébraux arrosent au fusil mitrailleur leur dizaine d’Américains. Y trouver du sens relèverait du délire. Il n’y a rien à voir : circulons.
Quelque chose de très puissant
Si les dépressions et les ulcères sont plus nombreux que les suicides, et si les suicides sont plus nombreux que les conseils d’administration arrosés de mitrailles, c’est que « quelque chose de très puissant » parvient à neutraliser ce que tant de situations concrètes ont de réellement révoltant -à défléchir l’immense majorité (statistique) des sentiments de révolte en gestes d’autodestruction. Quelques jours avant que René Padieu ne vienne effacer la signification des suicides de France Télécom, un article publié par The Economist resituait la France dans le haut du classement des taux de suicides, avec un quart de victimes en moins que le Japon, mais 40% en plus que les USA, et presque trois fois plus qu’en Italie[2].
Ce « quelque chose de très puissant » n’est bien entendu pas sans rapport avec ce qu’étudie la majeure de ce numéro de Multitudes : le maillage serré des différents niveaux de surveillance globale risque de nous faire sentir la traçabilité incriminante, non seulement de tout « acte » de révolte, mais aussi de toute parole publique, voire de toute pensée privée (telle qu’elle se manifeste dans nos mails Googlisés ou sur les traits de nos visages télédécryptés), ce « quelque chose de très puissant » relèverait alors du vieux fantôme de la politique hobbesienne, la peur, même si c’est une peur d’un nouveau type (la peur d’être tracé par des logiciels détecteurs d’écarts verbaux, la peur de ne pas pouvoir rembourser ses dettes, la peur de perdre son employabilité). Une peur en fait très archaïque, celle immortalisée par Victor Hugo : « l’œil était dans la tombe et regardait Caïn ».
Le tournant éthique
Le désespoir des suicidés, l’endurance des stressés, la consommation record de psychotropes, le passage à l’acte, ne sont pas les constituants d’une « résilience » des opprimés mais les signes de sa recherche brouillonne, et déçue. Le désir de résistance n’est pas tout puissant, et peut lâcher face à la pression sur les lieux de travail, dans les salles de classe et dans la rue. Alors que, comme le formulait Michel Foucault, la Souveraineté se réservait le droit « de laisser vivre et de faire mourir », le Biopouvoir prétend insérer tout le monde dans la normalité productiviste, y compris celle des « services à la personne ».
« Prendre sur soi » les tensions du milieu, plutôt que de les extérioriser dans un geste de haine destructrice ou autodestructrice, ce serait mettre en acte « un tournant éthique », mettre en œuvre un gouvernement de soi en phase avec le gouvernement sur tous. C’est ce qu’ont théorisé tant de philosophes des dernières décennies. Serait-ce là le « quelque chose de très puissant » qui neutraliserait les réactions de révolte face à des situations révoltantes ? Une bio-éthique : un certain culte de la vie d’autrui, jusqu’au prix de sa propre existence ? Les héros en seraient les soldats américains qui mènent les guerres lointaines de l’Oncle Sam. Sur la base de Fort Hood la « folie meurtrière » d’un psychiatre palestinien le 5 novembre dernier a dit non brutalement. Le taux de suicides sur cette base, depuis le début des opérations en Irak, était deux fois plus haut que dans le reste de la population américaine. La femme d’un soldat traumatisé par le stress a pu y ouvrir un lieu de parole, toléré par les autorités militaires.
Imaginer et mettre en œuvre le virtuel
Malgré son évidente « rationalité », le discours normalisateur du Statisticien énonce la norme contre laquelle doit se construire tout effort de compréhension de la réalité biopolitique. Il suffit en effet de renverser le propos pour voir apparaître deux principes capables d’éclairer non tant ces « drames bien réels »[3] que leur contexte producteur, deux principes résistant à la double tentation d’effacer ces drames et d’héroïser le comportement de leurs auteurs.
Premier principe : « croire en l’existence de quelque chose qui n’est pas » ne constitue nullement un « délire », mais bien le premier pas de toute réaction politique à une situation apparemment désespérée. Le virtuel pourrait être un autre nom pour ce « quelque chose qui n’est pas » – un virtuel qui inscrirait de façon processuelle des gestes de révoltes dans le réel au lieu de se faire arrêter immédiatement pour avoir cédé aux conseils de la pulsion de mort. Ce virtuel n’est jamais « donné » par qui que ce soit : il émerge à travers un processus (collectif) qui nous permet d’abord de le ressentir, puis de l’imaginer et enfin de le mettre en œuvre avec autrui. Prendre la mesure du virtuel, ça commence par parler avec d’autres du caractère révoltant de la normalité des relations bureaucratiques, des relations de travail soumises à d’absurdes calculs de rendement, de l’appareil militaire qui envoie sa chair à canon dans des conflits néocoloniaux.
La création individuelle du virtuel, cela débouche rapidement sur le type de revendications « délirantes » que mettait en scène Jean-Luc Godard dans Passion, où une employée licenciée déclare ne vouloir accepter qu’un travail « qui soit calme et agréable ». Lorsque le Journal télévisé se contente de nous frapper d’horreur à la vue d’un mitraillage « délirant », lorsque le Statisticien nous démontre qu’il n’y a rien à voir dans les méthodes managériales de France Télécom, ils se font la voix de ce « quelque chose de très puissant » qui transforme le virtuel en excès et lui interdit d’être imaginé, parlé ou imagé, et mis en œuvre.
L’instrumentalisation politique
Second principe : c’est en restituant les gestes de désespoir dans le cadre d’affrontements politiques entre une direction et ses salariés, entre des instances de pression et des opprimés, mais aussi en installant ces dualismes dans des situations plus ouvertes, qu’on peut espérer rendre leur sens à des actes apparemment absurdes. Introduire de nouvelles références pour tenter de traduire en « prises de parole », si possible avec humour, des comportements qui relèvent de la « fuite », tenter de les restituer dans leur contexte producteur, tenter de mettre en lumière leur dimension sociopolitique (au-delà de leurs drames humains privés), évitera de les noyer dans la normalité.
Les rapports politiques entre directions et salariés, dans la plupart des entreprises et au sein de la société, rendent « irréaliste » la demande d’avoir un travail « qui soit calme et agréable ». C’est pourtant une demande humaine normale. C’est bien sous la pression constante d’augmenter les taux de rentabilité que l’oppression capitaliste devient suicidaire puisqu’elle tend à annihiler la force de travail dont elle dépend. C’est seulement à l’émergence périodique de nouveaux virtuels contre cette logique suicidaire que le capitalisme doit sa longévité, et à la répression de cette émergence que le socialisme réel doit sa défaite.
Revendiquer le droit à un travail calme et agréable est aussi « délirant » aujourd’hui que demander l’abolition de l’esclavage en 1700 ou les congés payés en 1840 : c’est croire en l’existence possible de quelque chose qui n’est pas (encore), c’est aller contre l’inertie de quelque chose de très puissant qui neutralise le sentiment, l’imagination et la réalisation du virtuel.
De nouveaux comptes
À quoi pourrait ressembler une politique de l’espoir, dans la conjoncture ambiante ? À tout ce qui cultive la construction de formes de vie dressant des faits de réseau et d’énonciation collective contre les pressions individualisantes et suicidantes. Le soin du virtuel invite à ne pas compter ce qui ne compte pas : les taux de profits, les minutes de présence pointées par la machine, les articles publiés dans des revues de rang A, les sous-échelons des barèmes d’ancienneté, les classements des universités, les primes. Mais cela appelle aussi à compter ceux qui ne comptent pas : les métiers du care, les sans-papiers, les sans-titres, les sans-gloire – et à dégonfler l’orgueil de ceux qui comptent : les managers, les ministres, les directeurs, les économistes, les professeurs et surtout les clients. Cela devrait pousser à faire compter ce qui échappe à tout compte – comme tenter de rendre tout environnement de travail aussi calme et agréable que possible, comme tenter de respecter l’environnement.
Privatiser La Poste, « postaliser » la société ?
Entre 1986 et 1993, aux USA, dans la vague de la révolution néolibérale reaganienne, une série de mitraillages s’est caractérisée par le fait d’impliquer des employés postaux. Ils manifestaient contre la rentabilisation de leur service. En est résultée une expression populaire pour désigner ce type d’actes « délirants » : going postal : « des meurtres commis par des employés dans des actes de rage sur leur lieu de travail, indépendamment de l’entreprise pour laquelle ils travaillent » (cf. Wikipedia).
On parle depuis des années de privatiser La Poste, après avoir privatisé France Télécom. Malgré son statut d’entreprise « publique », La Poste parvient actuellement à cumuler l’inflexibilité d’une bureaucratie tatillonne, avec la pression managériale d’une quête éperdue de rentabilité, dans une perspective de compétition européenne dénationalisée. Il s’ensuit une désorientation morale qui pèse sur employés et usagers, conseillers et clients. Cette désorientation produit de la haine et de l’inefficacité, un mélange détonnant, auquel on souhaite de ne pas devenir « postal » au sens américain du terme. Le destin de cette « entreprise » apparaît dès lors comme emblématique d’un danger bien plus large, qui menace notre avenir à tous : autant qu’à la privatisation de La Poste, c’est à un risque de postalisation de la société d’abandon qu’il faut aujourd’hui s’opposer.
Faire multitude
Entre foyers de haine et attracteurs mortels, comment naviguer en s’aidant des moyens disponibles, moyens de pensée, moyens d’information, moyens d’observation ? Comment construire confrontations, débats, agencements collectifs d’énonciation[4] ? Dans la dispersion syndicale, partisane, associative, ces agencements ne peuvent plus être monocentrés. Seules les entreprises monopolistes cherchent toujours à faire figures de centres, et doivent être contournées. Ce n’est pas à la concurrence-compétition qu’il faut en appeler (pour La Poste ou pour le reste de la société), mais au concours de voix et d’efforts enrichis par leur pluralisme. La pluralité des possibles est à construire, par lignes de fuite et par assemblages, en résistant aux dérives vers l’autocentration, sur la ligne de plus grande pente, dans l’attrait des figures d’abolition. Faire multitude, commercer avec les autres, imaginer ensemble des virtuels communs, inventer des dispositifs, imaginer des altérités : la méthodologie nécessaire à cet effort est balbutiante.