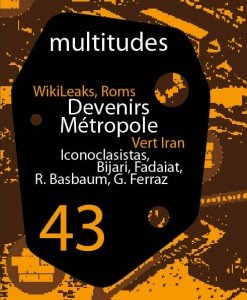L’ambiguïté du mot « investir », dans ses significations à la fois économique et subjective, condense bien l’ambivalence que représente aujourd’hui la métropole pour les citadins. Cet article se propose de détailler en quoi cet espace effectivement aux mains du capital global est en même temps le territoire le plus propice aux innovations dès lors que les citadins se l’approprient.
D’un point de vue économique, la ville commence maintenant à être considérée comme un nouvel espace productif essentiel de l’ère post industrielle. Toutes les disciplines utilisent à présent abondamment les concepts de système productif local, cluster, district, ville-pays, city region ou encore de pôle et métropole pour mettre en évidence ce rôle déterminant des villes dans le procès de circulation globale. Ces villes ne peuvent définitivement plus être réduites aux seuls aménagements d’un urbanisme dédié à la reproduction de la force de travail des entreprises comme le voulait la doxa fordienne. On parle à leur propos de gouvernance, de mobilisation et de coopérations de compétences autour de projets multiples qu’elles initient. Le libéralisme décrète lui directement l’assimilation de la ville à une entreprise pour mettre particulièrement en évidence les conséquences d’une telle mutation en termes de démultiplication de la rente foncière et autre architecture spectaculaire. À gauche, la ville continue d’être délaissée. Toni Negri analyse à contrario un passage de l’usine à la ville[1] où l’antagonisme des banlieues contre les métropoles succéderait à celui des ouvriers contre les patrons.
La ville productive[2]
L’hypothèse ici développée est précisément que les villes sont bien plus qu’une entreprise ou une usine. Tant les richesses qu’elles produisent que les modes de travail nécessaires représentent aujourd’hui d’énormes potentialités de puissance des citadins, c’est-à-dire des habitants, citoyens et travailleurs qui y vivent ensemble. Les qualifications hiérarchiques et concentrées dans l’entreprise de l’ère industrielle ont dû s’élargir à des compétences aléatoires en fonction des projets que seuls des territoires productifs beaucoup plus vastes comme la ville peuvent rassembler. L’antagonisme entre capital et travail se complexifie très considérablement lorsque se connectent les dimensions matérielle, immatérielle, cognitive et biopolique que Multitudes analyse constamment dans ses numéros. Au fur et à mesure que le capital pénètre l’ensemble de la sphère sociale, celle-ci se renforce en même temps de capacités. Non seulement les villes doivent donc être analysées comme des acteurs de l’économie, au grand dam de l’urbanisme d’État, mais elles doivent aussi être appréhendées à travers l’interscience des points de vue de l’histoire, la sociologie et les sciences politiques. Et d’abord replacées dans les territorialisations du rapport capital/travail, simple continuation de leur inscription par Braudel ou Pirenne dans l’histoire longue. Si les villes deviennent un cadre essentiel de coopérations des compétences pour l’accomplissement des projets et stratégies au-delà de la seule entreprise, cela implique ensuite, d’un point de vue cette fois sociologique, que ces cités représentent des cadres d’actions permettant des stratégies communes pour leurs citoyens. Enfin le point de vue politique, le plus important, voit les villes redevenir un territoire démocratique prééminent en permettant à leurs citoyens, pour la première fois dans l’ère moderne, de lier le local au global au-delà de l’État-nation ; soit l’opportunité de déborder ce cadre qui monopolise depuis si longtemps toute souveraineté, et d’abord les nôtres.
C’est pour cette dernière raison que le concept de ville doit d’abord être systématiquement mis dorénavant au pluriel. L’ancien regard d’en haut sur la ville, celui de l’État imposant des règles d’urbanisme à ses collectivités locales ou celui du capital s’appropriant leur « ambiance » (Marshall), n’est simplement plus acceptable. Dès lors que chacune de ces villes devient en effet productive à sa façon spécifique, selon son histoire et ses compétences, les appréhensions sociologiques de la vie quotidienne qui s’y déroule, initiées par Michel de Certeau[3] ou Henri Lefebvre[4] ainsi que de leurs relations faibles découvertes par Mark Granovetter[5] sont à présent à privilégier. Il est logique que l’État, ses notables et ses urbanistes veuillent préserver leurs anciens monopoles sur l’objet des collectivités locales. Mais, pendant ce temps, les innovations de la puissance productive nées des coopérations de multiples subjectivités dans les villes, en même temps qu’entre ces dernières, polarisent désormais les innovations de toute la société.
Les villes comme territoires
Le rôle des villes dans le capitalisme post-industriel doit pour cela être appréhendé du point de vue des pratiques permanentes de territorialisation − déterritorialisation qui ponctuent toute l’histoire des phases successives du rapport capital/travail[6]. La mobilité des flux comme des hommes n’est pas plus un monopole du capital qu’elle n’est née ex abrupto de la mondialisation, quoiqu’en pense l’idéologie souverainiste de droite et de gauche. Cette mobilité innerve historiquement chaque moment de la relation capital/travail en fonction de ses appropriations différentes par travailleurs et patronats pour instaurer rigidité ou mobilité des facteurs, de sorte que les villes y jouent toujours un rôle majeur. Sans retracer l’ensemble de cette histoire, il faut néanmoins souligner ici la longue stratégie fondatrice du capital industriel d’un attachement durable de l’ouvrier à son travail[7]. Le syndicat ouvrier institutionnalise alors durant le taylorisme sa stratégie d’une forte rigidité ouvrière au sein des banlieues rouges. Après guerre, le capital fordien contourne alors cette rigidité en innovant un ouvrier dit déqualifié, c’est-à-dire flexible et polyvalent sur les chaînes de nouvelles usines qui constituent une premier délocalisation dans les villes dites de la décentralisation industrielle. C’est là, à l’apogée même du fordisme durant les années 1960 et 70, que ces OS – jeunes, femmes ou immigrés – retournent à leur tour cette mobilité forcée par l’invention d’une nouvelle pratique du refus du travail[8]. Dans une période de plein emploi, cet ouvrier masse proclame sa volonté de « vivre et travailler au pays » en y pratiquant d’incessantes grèves pour un revenu égal et un turn over parmi les entreprises locales en fonction des salaires et du travail offerts. In fine, la hausse continue de leurs revenus condamne l’ère de l’Occident fordien[9].
Cette conflictualité dans et hors l’usine est une des occurrences qui a largement contraint le capital à innover la mondialisation, c’est-à-dire un élargissement à une échelle jusqu’ici inimaginable de l’offre de travail industriel en même temps que de la réduction de son coût. Les délocalisations concernent cette fois des centaines de millions de ruraux attirés dans les mégapoles du Sud.
Les dimensions territoriales des rapports entre le capital et le travail, et notamment les villes, sont ainsi toujours essentielles dans la longue succession d’innovations et de contre-pieds de ses acteurs. La globalisation n’a donc rien à voir avec le simple continuum d’un fordisme mondialisé tel que le fantasment les souverainistes regrettant un Occident centre d’un monde industriel. Cette délocalisation des usines et des services fordiens représente en effet d’abord une globalisation du rapport capital/travail, c’est-à-dire du fondement du mouvement individuel d’émancipation qu’explicitait Marx il y a 150 ans dans les Grundrisse. D’où la frénésie des Chinois, Brésiliens ou Marocains à venir travailler dans les usines à bas coût des villes qui leur permettent de déserter les campagnes où ils subissaient depuis des siècles les dictatures de la faim et des potentats. C’est très exactement, comme l’avaient déjà fait nos arrière-grands-parents dans les usines de Zola, l’apprentissage de la conflictualité permettant à tous ces nouveaux travailleurs d’enclencher progressivement dans les villes leurs propres usages du capitalisme. D’ores et déjà, les multinationales sont d’ailleurs contraintes à de nouvelles délocalisations car « les conflits ne sont plus l’apanage des pays riches » comme Le Monde le découvre en 2010 (titre du 20/8).
Tout pareillement du côté des pays riches, à mesure que la production postindustrielle lie de plus en plus étroitement le matériel et l’immatériel, le prolétariat se transforme également en cognitariat, et tout autant reterritorialisé non plus dans la seule entreprise mais au sein de la métropole. Là non plus, la dénonciation du chômage et de la précarité ne doit pas masquer les opportunités offertes par le développement de l’immatériel dans le travail, c’est-à-dire en même temps des capacités cognitives des travailleurs pour le réaliser et le produire. Ce bouleversement du travail ne concerne en effet plus la seule entreprise pour prendre une dimension sociétale puisque les projets doivent impérativement s’échafauder désormais entre des compétences multiples, de nuit comme de jour, au travail ou ailleurs. Chacun saisit dans son propre mode de vie cette dimension biopolitique de la productivité postindustrielle où les césures entre production et reproduction s’avèrent obsolètes. S’affirment alors les villes comme les lieux majeurs où ces compétences peuvent le mieux se rencontrer et s’organiser.
Nous examinerons ici les deux aspects économiques et sociaux de la ville comme lieu productif et de mobilisation. La dimension politique, essentielle, de la ville comme lieu nouveau des conflits ne sera jamais absente, même si elle sera plus au centre de l’analyse de Michèle Collin dans ce même dossier.
Territoires productifs
On passe donc de la ville comme espace bâti soumis à des normes d’État à des villes plurielles en tant que territoires spécifiques où sont projetées des stratégies multiples, diverses, mais qui ont toutes besoin du développement de la ville où elles s’inscrivent. Ce mouvement reste donc moins apparent pour les citoyens de certaines collectivités locales restées dépendantes d’une logique d’État, en France par exemple où avait même encore été créé en 2009 un « secrétaire d’État à la région capitale » ! Et d’autant peu apparent que ce point de vue souverainiste est largement partagé par une gauche instituée qui peut ainsi se contenter de maudire la mondialisation et ses conséquences désastreuses sur l’ancien ordre fordien. La gauche gère très humainement les collectivités locales, mais en délaissant autant que la droite ce nouveau rôle productif de la ville. La dénonciation de la dimension précaire de l’emploi et des liens faibles du travailleur postindustriel avec l’entreprise n’investit pas par exemple la multiplication concordante des relations socioéconomiques de l’intermittent dans sa ville[10]. Toujours dominant, l’ancien point de vue fordien du marché national du travail amène alors beaucoup plus les villes à accepter de se substituer à l’État pour secourir les chômeurs qu’à se sentir directement concernées par le développement des activités. Chacune de leurs structures, administrative, consulaire, syndicale, associative, politique a beaucoup de difficultés à même envisager de se déprendre de la logique centralisée. Les deux échelles globale et locale sont refusées comme cause du démantèlement d’un fordisme national encore souvent considéré comme une sorte de paradis perdu par la vieille gauche des pays riches, et de surcroît conçues comme antagoniques entre elles. Le niveau local est notamment encore considéré comme un ancien terroir préindustriel, inégalitaire par nature et soumis à la domination de notables.
Pendant ce temps-là, les firmes globales ont mis en avant une topique du glocal dans une double stratégie, à la fois d’externalisation de leurs unités au moindre coût, le point toujours dénoncé, mais aussi, et surtout, de contextualisation de leurs productions à l’échelle de marchés transnationaux. C’est la combinaison de ces deux stratégies, productive et commerciale, qui fait de la globalisation tout autre chose qu’un fordisme à l’échelle mondiale. Il y a certes, dans les usines des pays émergents, une massification de la fabrication de toutes les pièces constitutives des flux matériels, mais dans l’objectif de réaliser d’innombrables marchandisations spécifiques à d’innombrables marchés. Des marchés désormais transnationaux où les multinationales tentent de cibler, bien en deçà des fameuses customisations individuelles, les goûts communs de consommateurs regroupés à l’échelle la plus vaste d’un marché « régional ». Soit la substitution d’une dimension culturelle aux anciens clivages nationaux des marchés. Multitudes no 36 (2009) a décrit comment Google vise à apprendre désormais très précisément aux firmes qui consomment quoi, comment et où.
Mais la numérisation de tous les goûts du monde, avec tous ses dangers policiers, n’est qu’un aspect de la mutation. Une mauvaise lecture de Rifkin au début des années 90 avait conduit beaucoup d’intellectuels et de politiciens, notamment en France, à privilégier cette seule sphère de l’immatériel au point de reléguer l’industrie au rang d’activité secondaire pour sous développés.
L’industrie change pourtant tout autant en se connectant étroitement aux services. En s’intégrant dans un procès de circulation global, elle confie aux villes une activité logistique de distribution tout aussi importante que le domaine financier toujours mis en avant. Cette distribution fondée sur le procès de circulation demande un important travail concret sur la marchandise, très différent de celui de l’ancien fordisme national, que seules les villes peuvent réaliser. La globalisation n’a rien d’ubiquitaire parce qu’elle vise, tout au contraire, à distribuer just in time & place des marchandises constituées de pièces fabriquées certes n’importe où, mais précisément assemblées spécifiquement pour chaque marché et consommateur. C’est cette contextualisation du travail logistique incluant d’énormes quantités d’informations qui recèle la part de plus-value la plus importante du procès de circulation. On connaît déjà les effets catastrophiques de la négation de ce travail matériel depuis trente ans sur l’emploi des grandes villes françaises, aussi pleines d’activités administratives que leurs banlieues le sont de chômeurs sans formation. Et ceux qui espèrent la fin de la mondialisation et le retour des frontières pour pouvoir remettre tous ces casseurs à l’ancien travail industriel sont beaucoup plus nombreux dans tous les grands partis qu’on ne le croit.
C’est là que les villes deviennent des acteurs essentiels parce qu’elles seules peuvent nouer ces deux stratégies complémentaires de production et de distribution. Il y a dans toute ville de l’ère postindustrielle une dimension matérielle, une relation très concrète à la marchandise, qui est toujours essentielle. Évidente pour celles du Sud qui fabriquent (encore) pour pas cher, cette relation est peut être moins apparente au Nord, mais pourtant encore plus essentielle. Les villes globales sont ainsi de grands centres non pas seulement financiers mais aussi logistiques parce qu’elles connectent étroitement marchandises et services. D’où la part majeure parmi ces métropoles globales des grandes cités portuaires où nous puiserons plus loin plusieurs exemples. Cette connexion qui fonde le capitalisme cognitif rend d’une part concrètement obsolète, en termes de productivité, les anciennes césures spatiales entre centre et périphéries de l’ère industrielle, même si ses coupures sont maintenues par l’énorme accroissement de la rente immobilière.
D’autre part, toutes les villes sont concernées, et pas seulement les mégapoles mises en avant pas les analyses tant financières qu’académiques dont les classements, toujours à peu près concordants, laisseraient croire à une marginalisation des autres. Le processus de contextualisation démultiplie au contraire, bien au-delà des anciennes capitales, les villes capables de s’imposer comme le nœud d’un flux glocal, quoiqu’en disent les idéologies nationales fordiennes en déconfiture.
Après avoir considéré d’un point de vue purement capitaliste pourquoi les villes sont productives, l’important est à présent de considérer de notre point de vue leur dimension de territoire porteur de nouvelles opportunités démocratiques.
Territoires de coopérations
Les villes dans la mondialisation doivent en effet aussi être appréhendées comme les nouveaux lieux principaux de la longue conflictualité territoriale générée par l’antagonisme de la relation capital/travail. Deleuze et Guattari (1980) permettent le mieux de mettre en évidence leur place actuelle dans les longs enchaînements spatio-temporels en termes de déterritorialisation − reterritorialisation. Nous nous servons ici essentiellement de nos propres recherches portant sur les villes portuaires.
Les villes sont donc instrumentalisées en centres de distribution de services et de marchandises au sein du procès de circulation. Du point de vue des citadins, ce simple déterminisme doit être dépassé tant cette mutation leur offre d’opportunités. D’abord, l’obligation dans laquelle elles sont mises de se contextualiser elles-mêmes au sein des vastes ensembles culturels institués en marchés du type UE, Naphta, Asean ou Mercosur leur permet de s’émanciper en même temps de la logique de l’État-nation. Leur mise en concurrence, généralement à cette échelle régionale, implique qu’elles appréhendent les autres échelles spatiales de l’économie postindustrielle et, surtout, d’entreprendre des choix. L’aménagement étatique de l’espace national est en effet caduc, et sélectionner quelles compétences pour quelles plus-values chaque cité peut apporter aux flux de la globalisation ne se trouve pas dans les statistiques traditionnelles de l’État.
L’observation montre que ces options impliquent des débats intenses entre les divers acteurs de la cité pour qu’ils trouvent les indispensables accords minimum. La mondialisation efface l’autorité de l’État, mais implique ainsi également au sein des villes l’innovation de formes démocratiques aptes à déterminer les activités et les outils économiques qu’elles choisissent de mettre en avant. Quand l’intérêt général n’est plus imposé par une technocratie d’État, les coopérations des citoyens dans la cité deviennent indispensables. Patrons ou travailleurs, élus ou habitants des quartiers doivent s’accorder pour faire ces choix et les mettre en œuvre.
On a déjà dit combien ces innovations de débats démocratiques du point de vue de la ville étaient particulièrement difficiles pour les « collectivités locales » des États centralisés. En France, la connaissance même des valeurs ajoutées apportées par une ville est encore difficile à appréhender d’après les chiffres de l’INSEE, toujours centré sur l’emploi et le chômage des branches économiques nationales, ou encore de la région qui ne fait que déconcentrer ces chiffres sous la houlette du préfet régional. Se redéfinir comme acteur économique, au-delà de l’ancien rôle d’espace urbain de reproduction du travail, représente donc un ensemble de mutations extrêmement complexes pour la ville. On en précise ici deux parmi les principales : la mobilisation des acteurs et les relations au savoir et à la culture qui sont tout autant contextualisées.
Mobilisations des acteurs
Au-delà des rôles convenus d’électeur et de contribuable d’une instance publique locale, le citadin acquiert de nouvelles opportunités d’action à travers l’instrumentalisation de sa ville par le capital. L’ingérence constante de l’économie comme condition du développement de la cité amène en même temps les habitants à relier progressivement leurs deux statuts professionnel et citadin. Tout lecteur a saisi à travers son propre mode de vie que production et reproduction ne sont plus des sphères distinctes. Mais la qualification biopolitique de cette mutation ne suffit pas puisqu’il faut aussi préciser sa dimension territoriale que la ville est particulièrement à même de constituer. La mise en concurrence capitaliste des villes génère de nouvelles coopérations entre les acteurs de chacune d’entre elles. Nous reverrons plus loin cette réappropriation des pratiques de coopération par les acteurs, liée à la mise en concurrence globale, du point de vue cette fois des relations entre les villes. Mais, d’ores et déjà au niveau endogène, la contextualisation de chacune de ces villes comme nœud économique de flux globaux constitue une forte opportunité pour ses acteurs d’innover des relations communes, longtemps délaissées ou marginales dans l’ancienne souveraineté régalienne du l’État pour tous et chacun pour soi. On peut critiquer la notion de gouvernance exprimant les nombreuses formes démocratiques inventées dans les grandes cités, mais elle a l’avantage de se distinguer clairement du mode de gouvernement centralisé.
Caractéristique du rôle des villes dans la mondialisation, le domaine du commerce maritime international montre ainsi le dynamisme économique et social des villes portuaires dont les ports sont gérés par leur municipalité telles Anvers, Rotterdam, Hambourg, ou Hong-Kong…, précisément parce que toutes les plus-values et valeurs ajoutées engrangées par ces « places » se traduisent d’abord en termes de revenus et d’activités de leur population. Le devenir des compétences individuelles dépend par exemple de plus en plus largement de la cité où elles s’exercent et leur promotion dépend alors non seulement du cadre traditionnel de l’entreprise ou de la branche mais aussi, et de plus en plus, de la place, ce vieux terme financier repris aujourd’hui par toutes les villes qui s’affirment. Ce terme exprime de nouveau un patrimoine économique territorial commun à des acteurs qui le font savoir et valoir ensemble. Il ne s’agit pas d’un espace collectif ou d’une firme mais plutôt de la claire nécessité pour les stratégies de chacun de se développer pour partie en commun dans leur cité. Le glocal ne représente pas ainsi seulement le point de vue des multinationales mais aussi la manière dont les villes s’approprient une part des valeurs ajoutées des flux, deux visions différentes exigeant des deals dont l’issue dépend de la mobilisation des citadins.
D’où des rapports sociaux également en mutation à ce niveau de la cité où l’antagonisme de classe s’hybride de coopérations ponctuelles autour de projets précis lorsque les parties estiment profitable leur alliance commune. Les dockers d’Anvers, Rotterdam ou Hambourg sont tout autant combatifs et de gauche qu’ailleurs, mais pourtant pleinement intégrés au sein de chaque communauté portuaire locale où ils débattent constamment, et très âprement, avec les patrons des opportunités d’accroître les activités. Comme partout ailleurs, les salaires et conditions de travail priment dans les rapports de force, mais le point de vue économique des échanges captés par la place ne s’efface néanmoins jamais. Et ceci d’autant que c’est auprès de la ville que tout projet doit aussi faire avaliser ses investissements. Quand les dockers font grève, les patrons annoncent donc à leurs clients de par le monde que beaucoup de brouillard a ralenti les trafics ! Ce point de vue, cette présence constante de la ville comme cadre des relations, semble s’imposer aussi plus largement entre ouvriers et patrons de telle ou telle firme, habitants de tel ou tel quartier, partis et associations de la cité. Lorsque chacun vise ou, au moins, prend en compte le devenir commun de la cité, des accords peuvent déborder les antagonismes institués. De toujours très longues négociations des dissensus débouchent sur des accords autour de projets et dans des durées très précisément définis. Il n’y a jamais de consensus imposé d’en haut et ces dépassements ponctuels des rapports antagonistes traditionnels échappent tout autant aux genres de l’union sacrée nationale que de la collaboration de classe dans l’entreprise.
C’est que les villes productives dépassent ces deux échelles de l’État et de la firme qui monopolisaient l’ère industrielle. Nous sommes plutôt ici en présence de la coexistence analysée par Deleuze du modèle majoritaire avec celui d’exploitation, mis en évidence par Mauricio Lazzarato[11] mais, à présent, réalisée par des multitudes qui se singularisent aussi par une identification commune au sein d’une ville. Nous avons déjà abordé dans Multitudes les difficultés concrètes de son émergence en France, à Dunkerque et Saint Nazaire, où des institutions privilégiant l’échelle de l’État-nation comme la CGT et le corps des Ponts veillent de concert à préserver le vieux centralisme démocratique[12]. Les villes y restent en effet délaissées par une idéologie étatiste toujours mise en avant par l’ensemble des institutions et partis, aussi bien à droite qu’à gauche. Même les Verts privilégient le niveau national de sorte que leur mise en avant quasiment systématique au niveau local d’un nimby refusant tout projet les rend pareillement impuissants à appréhender la ville productive. Qu’elle soit jugée inférieure à l’idéal cadre régalien ou suspecte de volonté de croissance, la ville est en tout cas entièrement laissée aux seules initiatives du capital par l’ensemble des institutions. La gauche peut ainsi se contenter de la dénonciation des excès de la spéculation immobilière, en termes de gated communities des riches ou de communautarisme des pauvres, sans investir les potentialités biopolitiques de la ville. Or la ville devient prioritairement le territoire des plus intenses coopérations intermittentes et ciblées qui représentent un devenir essentiel des relations sociales. Au-delà du cadre contraint du travail salarié traditionnel, une démocratie productive s’inscrit beaucoup plus largement dans la ville. Nous sélectionnons ici l’une de ces relations de dimension communautaire caractéristiques des nouvelles exigences productives qui s’instaurent en son sein : les relations aux savoirs.
Les villes se mettent aujourd’hui à développer des interactions multiples avec l’école et la formation. Il s’agit prioritairement pour elles d’attirer et conserver les compétences cognitives dont chacune estime avoir besoin prioritairement. Les anciennes capitales concentraient par définition le meilleur des grandes écoles et universités, mais à présent, toutes les villes visent plutôt à s’affirmer comme un pôle spécifique de compétences. Chaque communauté, professionnelle ou de quartier, exerce donc bien évidemment un intense lobbying au sein de l’instance municipale pour privilégier ses propres compétences. Le cadre d’une ville peut rendre productifs, utilisables, ces intérêts divergents très loin en tout cas de leurs dénis vus plus haut de la part des technocrates d’État. Les dissensus sont tout au contraire considérés comme profitables aux gouvernances des villes.
De sorte que dans les villes dites portuaires par exemple, c’est-à-dire les cités où le rôle primordial du procès de circulation dans la société globalisée a dû être le plus rapidement appréhendé, les classes primaires et secondaires sont amenées à fréquenter le port tout au long de la scolarité, avec aussi tout le matériel pédagogique nécessaire pour comprendre, c’est-à-dire prendre avec soi, cette activité mise en avant comme essentielle par la cité. De même les universités y ont d’entrée une certaine autonomie dans le sens où elles consacrent également beaucoup aux disciplines commerciales, logistiques internationales ou linguistiques, et en utilisant aussi au maximum des professionnels de la place pour l’enseignement. C’est qu’on y vise moins « l’excellence » en soi que la productivité de la place, ce qui fait que les meilleures spécialistes académiques sur ces sujets sont aussi toujours issus de ces places où savoirs et pratiques se mélangent. S’ajoutent à cette polarisation cognitive de très forts investissements dans la culture du négoce maritime et portuaire. Spectacles et centres culturels sont destinés plus largement à l’ensemble des citoyens qui estiment essentielles ces compétences pour la valorisation de leur cité.
Au-delà de l’État-nation
Comme acteurs essentiels de la mondialisation, les villes sont les premières concernées par le bouleversement des échelles que le débordement des fordismes nationaux a entraîné. Ce qu’on appelle désormais des marchés « régionaux » exigent des infrastructures et compétences adaptées non seulement à leur nouvelle taille de nature continentale mais, plus encore, au contexte global dans lequel ces marchés s’insèrent à présent. Pour la plupart des villes, les anciens arrières pays étaient d’échelle nationale. Seules quelques-unes pouvaient aborder des contextes culturels et cognitifs autres, la plupart d’entre elles désignées par leur État comme ports internationaux et coloniaux. Encore plus rares, quelques places portuaires disposant d’un marché national de dimension restreinte avaient une stratégie de débordement de cette topique, comme Anvers et Rotterdam par exemple, pour desservir déjà des zones culturelles proches, germanique ou francophone en l’occurrence. Celles-ci sont aujourd’hui les plus dynamiques pour capter des flux mondiaux quand la mondialisation implique pour toutes les villes de compter dorénavant sur leurs propres initiatives sans plus pouvoir considérer le marché national comme une chasse gardée, une niche en anglais.
Cette mutation a des conséquences graves pour des collectivités locales habituées depuis deux siècles à s’en remettre à l’État. Dès l’époque de la Révolution, les villes ont été constamment accusées en France d’être des instruments de polarisation inégalitaire de la richesse : « Prenez garde que la France à présent étant un royaume commerçant, navigateur, industrieux, toute sa richesse s’est portée sur ses frontières, toutes ses grandes villes opulentes sont sur les bords ; l’intérieur est d’une maigreur affreuse[13] ». D’où l’instauration par l’État républicain d’une parfaite substituabilité des collectivités locales où il distribuait autoritairement industries et services pour un « intérêt général » sans considération des compétences spécifiques des territoires[14]. Ce sont ces compétences, progressivement concentrées de surcroît dans « la capitale », qu’elles soient professionnelles, universitaires ou artistiques, qui manquent aujourd’hui gravement aux villes pour concourir avec les autres en Europe et dans le monde. Une doxa souverainiste toujours largement plébiscitée en France continue pourtant de dénoncer toute concurrence comme inutile puisque l’État central serait censé conserver son monopole pour définir et assurer l’intérêt général.
Il s’avère pourtant que la mise en concurrence des villes, déclenchée par la mondialisation, libère de nombreuses opportunités pour leurs citoyens. L’émancipation d’un cadre national désormais de toute évidence insuffisant, tant au niveau économique que social, implique en effet que les compétences se mobilisent et coopèrent dans la ville au-delà des divisions et hiérarchies sociales instituées par l’État. Les nombreuses innovations de la part d’acteurs visant à développer leurs activités dans leur ville sont considérées aujourd’hui comme beaucoup plus importantes pour la cité que les injonctions du représentant de l’État, un préfet d’ailleurs en uniforme. La conjonction de ces deux possessifs économiques et territoriales est générée de toute évidence par la mise en concurrence de ces villes qui favorise des processus innovants de coopérations entre des acteurs en leur sein. Même les plus étatistes doivent déroger un tant soit peu à leurs principes de hiérarchies fonctionnelles devenues inefficaces.
J’ai développé depuis plus de dix ans[15] plusieurs analyses de ces processus de mobilisations dans les villes qui font apparaître un renforcement des relations sociales dès lors que le point de vue de la cité s’impose en tant que système commun aux acteurs. Cette nouvelle dimension territoriale, précisément contextualisée, d’une démocratie que je qualifie de productive me paraît essentielle dans le développement de tous les processus délibératifs ou participatifs abondamment décrit. J’en précise donc plutôt ici une autre dimension territoriale, beaucoup moins connue mais tout aussi importante, qui concerne des coopérations de villes proches dans l’objectif de pouvoir s’affirmer dans les nouvelles échelles de la globalisation.
Faire métropole par les coopérations entre villes
Pas assez puissantes pour exister seules, des cités mettent à profit leur proximité géographique pour affirmer de concert un pôle global. Il ne s’agit pas d’un espace géographique administratif déterminé par un commandement et des frontières mais d’un territoire relativement informel agissant de nombreuses coopérations en son sein. En Europe, on discerne ainsi l’émergence de deux pôles logistiques d’échelon global créés par les coopérations de plusieurs villes. C’est le cas par exemple d’Anvers et Rotterdam qui font valoir partout dans le monde qu’elles constituent la meilleure voie de pénétration en Europe, la porte rhénane. De même pour Hambourg et Brème qui font valoir en Asie, mais aussi en Amérique, leur Deutsche Bucht (baie allemande) comme la meilleure porte pour échanger avec l’Europe.
Plusieurs choses sont à retenir de ces coopérations innovantes. D’abord qu’elles riment, là encore, avec la concurrence qui a toujours dominé les rapports de chacun de ces couples jusqu’à pouvoir dégénérer dans l’histoire en une rivalité tournant parfois à l’extermination de l’autre. Il est donc hors de question de se réunir ni de s’unifier en aucune façon mais bien de coopérer sur des objectifs limités aux profits conjoints des deux parties qui, pour le reste, sont toujours concurrentes. Ensuite, on constate que ces coopérations transpercent autant les divisions spatiales administratives − nationales ou de Landers − que celles des langues ou des cultures. L’élargissement économique de la mondialisation libère ainsi de beaucoup d’assujettissements historiques sans pour autant remettre en cause les identités de chacun. L’opposition aujourd’hui courante des deux termes dans les analyses alternatives ne semble pas opératoire, comme l’avaient déjà suggéré Deleuze et Guattari. Pour pouvoir s’affirmer dans les évènements globaux en cours, ces villes revendiquent en effet très fortement leur patrimoine historique, culturel et commercial en même temps qu’elles en débordent les limites. C’est la conjonction des deux phénomènes identitaires et subjectifs qui apparaît productive comme le montrent à contrario les échecs actuels d’autres affirmations territorialisées.
En Méditerranée, deux autres villes, Barcelone et Gènes ont en effet également proposé à Marseille un même type de coopération pour pouvoir offrir aussi aux asiatiques et américains une porte méditerranéenne pour entrer marchandises et services en Europe. La domination très ancienne (Braudel) des places d’Europe du Nord en la matière se trouve en effet également remise en cause par la mondialisation qui fait passer aujourd’hui l’essentiel des échanges Asie – Europe − Amérique par le canal de Suez. Mais pour que ces flux ne fassent précisément pas que passer, les coopérations des trois cités voisines sont indispensables. Or la logique jacobine du port de Marseille lui interdit de se concerter avec des « étrangers » pour une stratégie transnationale.
De même, notre contribution dans « Seine métropole » au projet de Grand Paris met en avant la nécessaire coopération des villes fluviomaritimes de Rouen et du Havre avec Paris pour brancher la métropole sur les flux à la fois de la mondialisation et du marché européen[16]. Mais, là encore, les difficultés de concertation des institutions d’État, dont les ports, avec les villes et Régions rendent jusqu’ici impossible l’innovation de toute subjectivité territoriale et donc tout projet d’affirmation d’un pôle portuaire dans la mondialisation. Faire métropole n’est pas un élargissement quantitatif de collectivités territoriales, mais une polarisation des coopérations des villes au plan économique et culturel. La Randstad est faiblement instituée mais doit sa puissance économique et urbaine aux coopérations de ses acteurs sur certaines stratégies précisément définies sur des concertations.
En conclusion, l’émancipation du cadre de l’État-nation instaurée par la mondialisation libère donc les villes de l’autisme dans lequel l’intérêt régalien dit général avait pu les enfermer. En s’émancipant de leur statut de collectivités locales qui les soumettaient au jeu à somme nulle d’une rivalité entre elles circonscrite aux financements budgétaires de l’État, elles peuvent s’affirmer désormais cette fois comme sujet dans une relation véritable de concurrence avec d’autres pour apporter leurs plus-values aux flux globaux. C’est ce qui explique l’avance considérable des villes dites portuaires dont la démocratie délibérative s’alimente constamment des conflits entre leurs différents acteurs sur des choix à prendre nécessairement en commun. La concurrence des villes développe deux types de coopérations nouvelles. Au sein de chacune, d’une part, les citoyens innovent des relations au-delà des divisions fonctionnelles et hiérarchiques de l’ère industrielle. Par ailleurs, des villes proches recouvrent aussi des intérêts communs au-delà, cette fois, des querelles picrocholines imposées également par l’immanence étatique. Le dépassement du souverainisme est donc aussi celui des doxas ubiquitaires dominantes qui changent simplement d’échelle pour soumettre encore les anciens terroirs, cette fois à la vitesse des flux globaux.
La mondialisation est accusée de marginaliser le citoyen alors que les villes s’affirment tout au contraire comme les territoires de toutes les innovations démocratiques actuelles. On a vu en effet que les pratiques économiques territorialisées des villes constituent, du point de vue de leurs citadins cette fois, des opportunités essentielles d’interventions novatrices comme le montrent tous les mouvements actuels dans les villes françaises et à Londres, Copenhague, Athènes ou ailleurs. La dimension économique sur laquelle nous nous sommes volontairement centré transforme la dimension conflictuelle antagonique des relations capital/travail dans l’entreprise en dissensus entre citadins sur leur territoire productif d’alternatives et de choix. Au tournant du XIXe et XXe siècle déjà, de très longues hésitations avaient retardé la nécessaire intervention des ouvriers dans les nouvelles usines tayloriennes[17]. Quant à nous c’est dès à présent, pour ne pas abandonner ces nouveaux instruments productifs que sont les villes à l’économie capitaliste globalisée, que nous devons en investir de notre point de vue les formidables opportunités d’un devenir démocratique reterritorialisé.