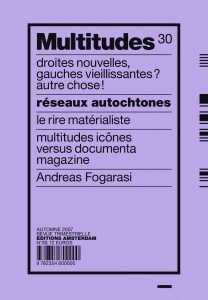En 2002, Cummings et Lewandowska lancent un projet d’abord intitulé Enthusiasts, puis Enthusiasm en 2005, qui consiste à localiser, restaurer, et diffuser des films produits par des clubs de cinéma amateur polonais, dont les membres étaient pour la plupart employés par des usines d’État. Ces clubs jouèrent un rôle important durant la période socialiste, entre les années 1950 et la fin des années 1980, et tout particulièrement de 1970 à 1980, décennie marquée par une relative ouverture vers l’« Ouest ». En Pologne, pays reconnu pour ses écoles de cinéma prestigieuses, le dense réseau de clubs — Cummings et Lewandowska en ont recensé plus de 300 — formaient une économie culturelle foisonnante, en marge de la culture officielle qui la tolérait bon gré mal gré.
À l’instar de Filip Mosz, le protagoniste du film Amator de Krzysztof Kieslowski (1979), les réalisateurs des centaines de courts, moyens, et longs métrages répertoriés par Cummings et Lewandowska ne sont pas à strictement parler des « autodidactes » puisque, même sans avoir reçu d’enseignement spécialisé, ils n’ont pas appris tout seuls à produire des films. L’apprentissage s’est fait au sein des clubs et lors des nombreux festivals qui réunissaient des réalisateurs, du plus novice au plus confirmé, venus de toute la Pologne et parfois d’Europe. Cummings et Lewandowska ont bien vu que les clubs pouvaient fournir plus que des artefacts à exposer : en prenant pour sujet principal les destinées des ouvriers-cinéastes amateurs, largement oubliés aujourd’hui — même en Pologne où leurs films s’inscrivent dans un épisode de l’histoire nationale dont peu veulent se souvenir —, les deux artistes interrogent le devenir historique du cinéma, et la possibilité qu’aurait le septième art, dès lors qu’il remet en cause son statut d’« art », de décrire une histoire qui serait celle de sa propre historicité.
Il sera donc question ici, à partir d’Enthusiasm de Cummings et Lewandowska, de la généalogie de cet art que Jean-Luc Godard déclare privé d’avenir, non pas parce que le cinéma n’aurait plus longtemps à vivre (déclaration désuète s’il en est) mais parce que son devenir historique même, son historicité, ne peut prétendre à une présentation historique autonome et linéaire face aux « nouveaux » moyens de communication qui n’ont cessé d’offrir au cinéma les moyens de se remémorer, mais au prix de son intégrité artistique, et à plus forte raison technique. Ceux qui ont pris tour à tour l’historicité du cinéma pour projet ont dû la traduire à l’aide des technologies mêmes qui menaçaient son existence : la télévision et la vidéo dans le cas de Godard au tournant des années 1970 ; l’image numérique pour Chris Marker à partir des années 1980 ; et pour Cummings et Lewandowska, l’Internet et son potentiel d’archive mnémotechnique.
Si j’invoque Godard et Marker au sujet d’Enthusiasm ce n’est nullement pour en identifier les « origines » historiques. Les deux noms représenteraient plutôt des scansions dans une entreprise d’inspiration cinématographique qui affecte nombre d’artistes contemporains — entreprise qui s’interroge sur l’historicité de l’image filmique, c’est-à-dire sa production et sa distribution dans des contextes historiques précis, ainsi que la capacité qu’a cette image de faire histoire, d’engendrer des histoires historiques. Sauf que l’homogénéité de telles histoires, dont l’archive aura valeur de mémoire collective, sera nécessairement déstabilisée par une des caractéristiques principales de l’historicité propre au cinéma, à savoir l’incapacité à faire sens (unique), à narrer une quelconque histoire véridique autrement qu’au pluriel, spasmodiquement, par le biais de technologies de l’image plus récentes. Cette dynamique cinématographique peut aisément faire sienne la description de l’œuvre de Mallarmé par Blanchot dans le Livre à venir : « tantôt figée dans une virtualité blanche, immobile ; tantôt — et c’est le plus significatif — animée d’une extrême discontinuité temporelle, livrée à des changements de temps et à des accélérations, des ralentissements, des “arrêts fragmentaires”, signe d’une essence toute nouvelle de la mobilité, où c’est comme un autre temps qui s’annonce, aussi étranger à la permanence éternelle qu’à la durée quotidienne »[2]. Autrement dit, l’histoire, la « nôtre », vue par ou à travers le cinéma, subira l’« échec » qu’a essuyé le cinéma lui-même, aux prises avec ses concurrents techniques au fil de son histoire — télévision, vidéo, image de synthèse, désormais accessible par Internet — que le cinéma a depuis toujours tenté, en vain, de rattraper[3].
Il est remarquable que l’« échec » du cinéma à projeter une image unifiée et unifiante de soi, à narrer l’histoire qui est (ou était — mais la question ne perd rien de son urgence lorsqu’elle est posée au passé) la sienne aussi bien que la « nôtre », c’est-à-dire celle de la modernité, soit aujourd’hui abordée avec plus de rigueur dans les espaces voués à l’art que dans les salles dites obscures. On a vu ainsi, en 2006, Godard mettre en scène son parcours cinématographique au Centre Pompidou, mais on a vu aussi cette institution reconfigurer entièrement la présentation d’œuvres issues des collections permanentes selon un schéma articulé autour des « données fondamentales de l’expérience filmique — “défilement”, “projection”, “récit”, “montage”. » Le Museum of Modern Art de New York a vite fait d’emboîter le pas, en intitulant Hors du temps le nouvel accrochage de sa collection permanente, organisé lui aussi selon des expressions empruntées au vocabulaire cinématographique. En 2006 toujours, le même MoMA accordait une rétrospective à Douglas Gordon, auteur avec Philippe Parreno du film Zidane, un portrait du XXIe siècle. Et le Musée d’art moderne de la ville de Paris et la Tate Modern de Londres se sont associés en 2006 pour accueillir une grande exposition de Pierre Huyghe, artiste qui mène depuis plus de dix ans une réflexion sur la narration cinématographique.
Les raisons de cette récupération de l’historicité du cinéma par les plus grands musées d’art moderne sont à chercher d’une part dans l’incapacité dont fait preuve le cinéma à narrer l’histoire, à commencer par la sienne : histoire du vingtième siècle et histoire du cinéma étant, on l’a dit, plus que contemporaines, indissociables. D’autre part, les musées d’art moderne ne se sont pas trompés en reconnaissant dans l’historicité du cinéma un moyen qui leur permettait de continuer à déployer leurs propres histoires de l’histoire du vingtième siècle. Au moment où le regard porté sur l’histoire est plus que jamais assujetti à l’événementiel, le cinéma critique d’un Godard ou d’un Huyghe répond à point nommé au besoin de l’institution emblématique de la modernité — le musée — d’afficher sa bonne foi, sa political correctness, sa mauvaise foi pour ainsi dire envers son devoir de mémoire, devenu obsolète. Désavoués comme sites de production de narrations d’histoires communes, le musée et le cinéma se retrouvent désormais sur un pied d’apparente égalité, en proie tous le deux à des doutes sur leur avenir : l’exhibition (hystérique) de ce doute est devenu le garant de leur survie.
Cette alliance stratégique entre le musée et le cinéma échoue cependant à masquer une différence essentielle : le premier n’a d’autre possibilité que d’émaner d’un centre de pouvoir, il est agent d’idéologie, alors que le cinéma peut (doit, dirait Godard) s’avouer tel qu’il a toujours été : impuissant à restituer de l’histoire (au singulier) une image fidèle et transhistorique. Sur la base de ce constat d’impuissance, un cinéma critique débouchera inévitablement sur une remise en question de sa dépendance à l’image comme mode privilégié de saisie de l’histoire (« Ce n’est pas une image juste, c’est juste une image », disait Jean-Pierre Gorin[4]) ; et qu’à regarder ce qu’il ne peut retranscrire en d’autres termes que techniques (montage, éclairage, bande son, générique), il n’a de choix qu’entre s’immobiliser et se reproduire, raconter des histoires vraies pour les renier ensuite comme autant de fictions improbables. Le pire, le mieux, c’est que cette ambivalence est la condition même de possibilité d’un tel cinéma critique. Qu’on le réduise à une « différance » ou une « hainamoration » (Serge Daney) ; une « agitation qui peut toujours être suspendue » (Jacques Rancière) ; à « ces deux conditions transcendantales » que sont la répétition et l’arrêt (Giorgio Agamben) ; ou encore à l’intervalle entre l’historique et le poétique (Youssef Ishaghpour), ce cinéma se meut dans une contrariété insoluble qui ne peut se reconduire affectivement que par une reconnaissance d’un non-avenu, par une motion de censure scopique échappant au regard autant qu’à une quelconque tutelle idéologique. Étranger à tout effort de représentation, le cinéma critique se déplace au fur et à mesure qu’il se repère dans les divers flux (de pellicule, d’histoire(s)) qui le déterminent et qu’il détermine en retour.
Le terme d’enthousiasme, dans l’acception de Kant, convient justement à cet état d’agitation spéculaire / spectaculaie, car contrairement au beau qui est symbole du bien, l’enthousiasme s’apparente au sublime, sentiment hybride mêlé de plaisir et de peine. Face à un événement historique tel que la Révolution française, écrit Kant, le spectateur ne peut s’empêcher de ressentir un sentiment sublime d’enthousiasme, signe extérieur partagé par tous les spectateurs au-delà de leurs réactions individuelles, et qui « révèle, au moins à titre de disposition, un caractère commun au genre humain tout entier (en raison de son universalité), et un caractère moral (en raison de son désintéressement), et ce caractère ne permet pas seulement d’espérer un progrès vers le mieux, mais il l’est déjà »[5]. En même temps l’enthousiasme s’accompagne d’une réalisation pénible, causée par l’impossibilité pour l’imagination, devant ce qui l’excède, de présenter un objet commensurable à l’Idée, ici l’appartenance au tout du genre humain. De fait, la limitation de l’imagination, dont l’enthousiasme provoqué par un événement historique fait symptôme, risque de se transformer en état de démence où l’imagination se croit à la hauteur de la présentation de l’objet démesuré. Mais c’est justement à ce prix que l’enthousiasme se rédime puisque son impuissance prouve sa valeur esthétique, sinon éthique. « Une sorte d’agitation sur place, dans l’impasse de l’incommensurabilité, au-dessus de l’abîme », dit Jean-François Lyotard au sujet du paradoxe sentimental soulevé par l’enthousiasme historico-politique[6].
Le cinéma critique dont j’aimerais esquisser la généalogie s’arrête précisément sur le paradoxe de l’enthousiasme suscité par l’événement historique. J’ai déjà cité Godard et Marker comme les noms saillants de cette mouvance à laquelle j’associerais les pratiques d’artistes contemporains tels que Huyghe, Gordon, Cummings et Lewandowska. Mais Godard et Marker n’en sont pourtant que des avatars relativement récents sur l’axe historico-politique du cinéma qui va de l’Est à l’Ouest, « de Moscou à Hollywood »[7]. Par conséquent ce n’est pas « avant » mais « plus à l’Est » de Marker et de Godard que se situent les premières expériences d’enthousiasme cinématographique à la fin des années 1920, signées Dziga Vertov et Alexandre Medvedkine.
Ces premières tentatives de propagation de l’enthousiasme de la Révolution d’octobre furent immédiatement exposées à la répression de Staline qui voyait dans le cinéma un risque pour le monopole du réalisme socialiste prôné par le parti. C’est pourquoi il aura fallu plus de trente ans pour que les noms de Vertov et de Medvedkine circulent à nouveau, cette fois dans l’engouement politique de la France de la fin des années 60. Lors des luttes de mai, Godard et Gorin formeront le groupe Dziga Vertov en honneur des théories de « ciné-vérité » du réalisateur russe, auteur en 1930 d’un des premiers films sonores en Union soviétique intitulé — cela ne devrait plus nous surprendre — Enthousiasme[8]. Quant à Medvedkine — initiateur du « ciné-train » qui traversa la Russie au début des années 30 pour produire des films didactiques par et pour des paysans et des ouvriers — il prêtera son nom aux groupes de production cinématographique fondés dans des usines de Besançon et de Sochaux dans la foulée de mai 1968, sous l’impulsion de Chris Marker[9].
Entre le cinéma soviétique du début des années 1930 et la fin des années 1960 en France ; entre ce qu’on voit à l’écran et ce que le public peut / pourra en faire, s’étend la distance nécessaire à la propagation de l’enthousiasme historico-politique et cinématographique. Car d’une part la révolution se donnant en spectacle agit comme exemple sur des spectateurs présents ou à venir, à proximité du foyer révolutionnaire ou à des milliers de kilomètres de là. Mais d’autre part l’enthousiasme rend toute tentative d’exemplarité caduque, puisque ce qu’il y a à voir n’est pas l’événement historique en soi mais son signe, ce qui déclenchera, indirectement, l’enthousiasme chez les spectateurs[10. « Circulez, y a rien à voir » pourrait bien résumer l’ordre lancé par un cinéma mis en échec par sa disparité, dont les fragments formeront comme les restes de l’éclatement de l’histoire du cinéma — dans les archives aporétiques soviétiques pour les quelques films qui nous sont parvenus du « ciné-train ». Enthousiasme fut « estropié », faute d’équipement adéquat, de l’aveu de Vertov[11], et dans le cas d’Enthusiasm de Cummings et Lewandowksa, les films d’ouvriers polonais ne réussiront jamais à eux seuls à rapiécer une période de l’histoire vouée à l’effacement et au travestissement de l’enthousiasme révolutionnaire.
Et pourtant, comme la récurrence des noms de Medvedkine et de Vertov le démontre, l’enthousiasme cinématographique parvient malgré tout à se communiquer, les films devenant les vecteurs historico-politiques d’affects capables d’inverser les positions supposées fixes et antithétiques du réalisateur et du spectateur[12]. Sous l’emprise de l’enthousiasme, les limites entre la représentation du travail et le travail de représentation se brouillent, de même que la force de travail passe d’une mesure quantitative universelle à une question de jugement individuel au sein de collectivités toujours à redéfinir, comme dans ce cas retenu par Gilles Deleuze : « Un ouvrier d’horlogerie spécialisé veut être payé pour sa force horlogière, mais refuse de l’être pour son travail de cinéaste amateur, son “hobby” dit-il : or les images montrent que dans les deux cas les gestes, dans la chaîne d’horlogerie et dans la chaîne de montage, sont singulièrement semblables, à s’y méprendre. Non, dit l’horloger, il y a une grande différence d’amour et de générosité dans ces gestes, je ne veux pas être payé pour mon cinéma. »[13]
Afin de relever cette différence, indétectable à l’œil nu, entre rémunération et générosité, Cummings et Lewandowska s’attachent aux histoires historiques que le cinéma produit sur lui-même plutôt qu’aux histoires cinématographiques fabriquées par l’industrie du cinéma, comme le feraient Huyghe et Gordon[14]. Ces derniers explorent la structure « interne » du cinéma — ses genres et ses codes narratifs —, alors que l’archivage de Cummings et Lewandowska opère sur son extériorité, qui n’en reste pas moins une intériorité par rapport à « son avenir infiniment problématique » (expression de Blanchot)[15]. L’archive de cinéma amateur présentée dans Enthusiasm est bien un « dehors » du cinéma commercial (opposé en ce sens au cinéma dit « expérimental », simple sous-catégorie dans la grande histoire du cinéma), non pas parce qu’elle se trouve exclue du « système » mais parce qu’elle crée le sien selon un processus mimétique propre à l’enthousiasme historico-politique. Ce décentrement constant du cinéma s’effectue, je l’ai dit, par transmission esthétique et non éthique ; ou, pour reprendre la distinction de Rancière, selon une logique documentaire apte à traduire « la pensée du devenir sensible qui rend les idées communes, qui donne à une communauté la possession des formes sensibles de son idée »[16]. Les artistes qui interviennent dans le cinéma produisent des objets poétiques à consistance narrative ; Cummings et Lewandowska, quant à eux, appréhendent le cinéma comme un produit impur qui ne serait que devenir commun (en commun, du commun) irreprésentable en tant que tel. Prendre pour objet non pas l’objet mais son historicité, sa fonction historique, tel est le mot d’ordre de leur vision du cinéma critique.
Aussi la « valeur » esthétique ou historique des films individuels projetés dans le cadre d’Enthusiasm ne me semble pas toucher le fond de la démarche de Cummings et Lewandowska : c’est toute l’archive, dans son utopique totalité, et la multiplicité d’histoires qu’elle génère, qui autorise son potentiel esthétique. Mais celui-ci ne peut se réduire non plus à un simple effort de catalogage. Pour mieux cerner la fonction d’Enthusiasm, il faut s’attarder sur la manière dont Cummings et Lewandowska ont choisi d’articuler les résultats de leur enquête. Chacune des installations en date — à Varsovie, Londres, Berlin, et Barcelone — comportait cinq parties : un mur sur lequel étaient projetés des spots publicitaires de la télévision officielle polonaise ; une reconstitution d’une salle typique de club de cinéma ; une série d’affiches de festivals de films amateurs ; la projection en continu des films eux-mêmes ; et une borne où le visiteur, muni d’une télécommande, pouvait les revoir sur DVD. L’espace dévolu à la projection des films était lui-même divisé en trois salles intitulées « love », « longing », « labour » (amour, désir, travail). Il n’est pas besoin d’avoir vu les films pour se douter que cette subdivision autorisait, au mieux, un tri très approximatif. Certes, Cummings et Lewandowska ont généralement respecté le sens des titres, en regroupant par exemple les films à caractère érotique dans l’espace « désir », et les documents filmés sur les lieux de travail dans le troisième espace. Néanmoins, ce qui l’emporte sur cette organisation précaire, c’est la liberté des réalisateurs amateurs de mélanger librement les genres : chaque film se lit comme un patchwork plus ou moins subtil de citations des grands noms de l’histoire du cinéma (Warhol, Godard, Wajda, Kieslowski) aussi bien qu’au style home movie. Délestés d’un devoir d’adhésion aux codes de l’industrie cinématographique, tant socialiste qu’hollywoodienne, et réfléchis par le processus de contagion historique déclenché par l’enthousiasme, les films inventoriés par Cummings et Lewandowska deviennent les promoteurs d’une esthétique qui cherche à atteindre l’universalité de l’être en commun (du cinéma).
Parmi les influences détectables sur les films répertoriés dans Enthusiasm, Kieslowski se distingue pour avoir tenté l’impossible : vouloir porter l’enthousiasme cinématographique à l’écran. Amator, film basé sur ses propres souvenirs de la vie des clubs ouvriers, suit le parcours de l’employé d’usine Filip Mosz, qui se dote d’une caméra super-8 à la naissance de sa fille. Très vite, Mosz élargit le champ de ses investigations au-delà de la sphère privée. Il se met à filmer ses collègues et devient bientôt le documentariste officieux de son usine en y fondant un club amateur. Mais quand un de ses documentaires, où figure un employé handicapé, gagne un prix et passe à la télévision, l’idylle tourne court : la direction voit d’un mauvais œil cet excès de réalisme et renvoie le supérieur qui soutenait Mosz ; sa femme s’en va avec leur enfant. Ne reste pour Mosz à la fin du film qu’un seul objet à scruter, son propre visage, reflété dans l’objectif de sa caméra.
Amator serait en dernière analyse l’antithèse absolue d’Enthusiasm, puisque le film signifie l’apogée de la visibilité en soi et pour soi, la caméra condamnée à se perpétuer à l’infini[17]. Les deux topographies s’opposent : d’un côté la connaissance de soi acquise par Mosz au cours de sa lente dégradation, dans son hallucination tautologique vers le cinéma sans fin ; de l’autre les réseaux parcourant la surface de l’archive filmique qui ne mènent le sujet nulle part mais le relient à d’autres, essaimant des systèmes capables d’engendrer à leur tour l’enthousiasme cinématographique. Foucault nous rappelle qu’« il ne nous est pas possible de décrire notre propre archive, puisque c’est à l’intérieur de ses règles que nous parlons »[18]. Godard écrit de même qu’« on peut tout faire excepté l’histoire de ce que l’on fait »[19]. Le regard de Mosz serait alors l’illusion de pouvoir (se) voir (par) le cinéma, au lieu de laisser l’œil sombrer dans l’accumulation d’histoires dont l’archive laisserait entrevoir la possibilité d’un à-venir « infiniment problématique ».
S’il fallait identifier un film qui pourrait entrer en résonance avec l’histoire plurielle racontée par Enthusiasm, il faudrait se référer à la généalogie du cinéma critique brossée ici et citer, parmi d’autres, Charnière, de 1968, où, face à un écran noir, on entend les ouvriers d’une usine de Besançon réagir à un film de Chris Marker et Mario Marret. Dans ce dernier, les ouvriers « jouaient » leurs propres rôles de grévistes ; dans Charnière, la caméra « professionnelle » se met à l’écoute, sans l’apport d’images, pour faire sentir la concrétisation d’une multitude qui décide de la forme que prendra sa représentation historique. Cet écran noir d’une durée de treize minutes est à la fois origine et fin, puisqu’il sera le point de départ d’une série de films réalisés par des ouvriers de Besançon et de Sochaux. L’histoire du cinéma (re)prend essor précisément en ces cas extrêmes d’enthousiasme cinématographique, en ces « blancs » noirs de la représentation de la réalité, lorsque le sujet décide non point de monter sur la scène de l’histoire (du cinéma), mais de refuser de jouer le rôle de témoin dans une histoire qui le dépasse, pour en devenir le réalisateur : coïncident à ces moments exceptionnels de devenir l’historicité du cinéma et son inévitable dissolution.
De même que la notion de multitude n’est pas synonyme de résolution mais de débat autour d’un programme politique commun[20], le « succès » d’Enthusiasm dépendra sur le long terme de l’intensité des différends que le projet saura provoquer entre les nombreux passages qu’il met en scène — entre les films, leurs modalités d’exposition, et les histoires des lieux où ils sont présentés. Enthusiasm se devait à l’évidence de prendre une autre forme qu’une simple exposition dans un musée, pour que, à l’image des clubs amateurs, l’enthousiasme cinématographique se relaie entre les diverses institutions d’accueil : après quatre haltes entre 2002 et 2006 en Europe (de l’Est et de l’Ouest), Enthusiasm poursuivra sa route en 2007 en ex-Yougoslavie et en Amérique du Nord[21]. De plus, pour actualiser l’histoire de cette historicité ponctuelle et éphémère, Cummings et Lewandowska ont dû tester de nouvelles configurations curatoriales (en juxtaposant publicités télévisées, postes de visionnement de DVD et projections de films). Enfin, et surtout, il fallait qu’Enthusiasm contemple ses histoires cinématographiques à la lumière du dernier des « nouveaux médias », l’Internet, multipliant ainsi les points de contact possibles entre futurs spectateurs / réalisateurs. Une fois la totalité des films amateurs d’Enthusiasm mis en ligne sous licence « Creative Commons », l’Internaute pourra reproduire, distribuer, et remonter les fragments filmiques à volonté, effectuant ainsi le transition de spectateur à producteur affectif, selon les termes de l’enthousiasme cinématographique et historico-politique[22].
L’histoire de ce cinéma en dérive aura failli être, s’effritant à mesure que l’enthousiasme qu’il suscite se répand. « On a inventé, dit Godard à propos du cinéma, quelque chose et on ne s’en est pas servi, quelque chose dont (on) n’a pas su et dont on n’a pas voulu se servir »[23]. S’il a bien existé, contre toute attente, dans des usines de Chybie ou de Besançon, c’était sous une forme qui lui était extérieure, de dissemblance si radicale qu’elle devait forcément entraîner sa méconnaissance historique. Car en obéissant à une historicité qui se contracte (dans les deux sens du terme), ce cinéma « toujours en mouvement, toujours à la limite de l’épars, sera aussi toujours rassemblé dans toutes les directions, de par la dispersion même et selon la division qui lui est essentielle, qu’il ne fait pas disparaître, mais apparaître en la maintenant pour s’y accomplir »[24].
Notes
[ 1] Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, t. 1, Gallimard / Gaumont, 1998, p. 230.
[ 2] Maurice Blanchot, Le Livre à venir (1959), Gallimard, 1986, p. 311.
[ 3] Serge Daney, « Godard fait des histoires », in Libération, 26 décembre 1988, p. 25.
[ 4] David Faroult, « Du vertovisme du groupe Dziga Vertov », in Jean-Luc Godard : documents, Centre Georges Pompidou, 2006, p. 134.
[ 5] Emmanuel Kant, cité par Jean-François Lyotard, in Le Différend, Minuit, 1983, p. 237.
[ 6] Ibid., p. 240.
[ 7] « Godard fait des histoires », op. cit., p. 26.
[ 8] Alain Bergala (dir.), Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Éd. de l’Étoile / Cahiers du cinéma, 1985, p. 343. Enthousiasme porte aussi le titre Symphonie du Doubass, contre la volonté de Vertov. (Peter Kubelka, « Restoring Enthusiasm, », in Film Quarterly, vol. 31, n° 2, hiver 1977-78, p. 36.)
[ 9] Alexandre Ivanovitch Medvedkine / Chris Marker : œuvres croisées, Éd. Arte France développement, 2005, p. 3 ; Iskra / Bernard Benoliel, Chris Marker, Bruno Muel, Inger Servolin, Donald Sturbelle, Les Groupes Medvedkine : le film est une arme, Éd. Montparnasse, 2006.
[ 10] Jacques Rancière, « L’Image fraternelle », Cahiers du cinéma n° 268-269, juillet-août 1976, p. 9-10 ; voir aussi Serge Daney, « Apprendre, retenir », Cahiers du cinéma n° 271, novembre 1976, p. 34.
[ 11] Annette Michelson (dir.), Kino-Eye : the Writings of Dziga Vertov, University of California Press, 1984, p. 114.
[ 12] Jean-Christophe Royoux, « Les travailleurs du temps libre et la reconfiguration de l’espace public », in Multitudes, n° 5, mai 2001, § 8.
[ 13] Gilles Deleuze, « Trois Questions sur Six fois deux », Cahiers du cinéma, n° 271, novembre 1976, p. 7.
[ 14] Jean-Christophe Royoux, « Remaking Cinema », in Marente Bloemheuvel, Jaap Guldemond (dirs.), Cinema, Cinema : Contemporary Art and the Cinematic Experience, Stedelijk Van Abbe Museum, 1999, p. 24.
[ 15] Maurice Blanchot, op. cit., p. 319.
[ 16] Jacques Rancière, « L’Historicité du cinéma », in Antoine de Baecque, Christian Delage (dir.), De l’histoire au cinéma, Complexes, 1998, p. 55.
[ 17] Voir Mikolaj Jazdon, « Camera Buff : Reckoning with Reality » ; Marysia Lewandowska, Neil Cummings, Entuzjasci : z amatorskich klubów filmowych, Centrum Sztuki Wspólczesnej Zamek Ujazdowski, 2004 ; et Tadeusz Sobolewski, « Between Two Realms », Enthusiasm : Films of Love, Longing and Labour, Whitechapel, KW Institute for Contemporary Art, Fundació Antoni Tàpies, 2005 / 2006.
[ 18] Michel Foucault, L’Archéologie du savoir (1969), Gallimard, 2005, p. 171-172.
[ 19] Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, t. 4, op. cit., p. 276.
[ 20] Voir l’article de Toni Negri, « Réponse à Pierre Macherey », in Multitudes, n° 22, automne 2005, p. 116.
[ 21] Centre Sadie Bronfman, Montréal, 8 février — 1er avril 2007 ; Musée d’art contemporain, Belgrade, 25 mars — 25 juin 2007.
[ 22] Voir : www.enthusiastsarchive.net
[ 23] Jean-Luc Godard, Youssef Ishaghpour, Archéologie du cinéma et mémoire du siècle. Dialogue, Farrago, 2000, p. 79-80.
[ 24] Maurice Blanchot, op. cit., p. 320.