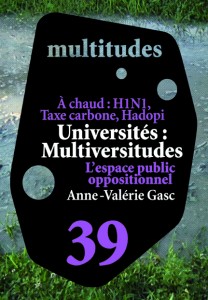l’université néolibérale, lieu d’élaboration d’un nouveau putonghua (langue commune)
En Asie de l’Est et dans ses environs[1], la restructuration néolibérale de l’Université s’est trouvée associée à l’institutionnalisation de l’anglais en tant que langue officielle des savoirs innovants et moyen de réalisation de la segmentation sociale[2]. À l’évidence, les aspects linguistiques de la privatisation ont soumis les systèmes universitaires nationaux à une division globale du travail qui donne un avantage substantiel au « complexe médiatique-éducatif » anglophone. En conséquence, à longue échéance, il semble prévisible que les institutions nationales d’enseignement supérieur seront incapables de préserver leur autonomie face à l’expansion agressive et à grande échelle des universités anglophones. Elles seront réduites à jouer le rôle de niche pourvoyeuses de connaissances en aval (à l’exception des institutions constituées sur le modèle des joint-ventures ou de celui de la franchise) alors que l’innovation intellectuelle se situe toujours en amont. Témoins de l’émergence de réseaux transnationaux de l’enseignement supérieur, nous sommes de plus en plus nombreux à mener une réflexion afin d’identifier les possibilités de transformation créative de la situation.
En réponse au sentiment d’urgence créée par les nouvelles formes issues de la mondialisation et du capitalisme cognitif, la tentation est grande de reconnaître le caractère normatif des formations sociales et des institutions qui soutenaient l’ancienne hégémonie de la modernité impériale/coloniale à l’ère du capitalisme industriel. Les débats sur la domination de l’anglais global ont surtout concerné la sphère éducative et culturelle où ils tendent à se partager entre ceux qui défendent les marchés linguistiques nationaux et ceux qui célèbrent l’internationalisme de manière vague et calculée. Pour ces deux camps, l’hypothèse de la persistance de formes nationales d’organisation continue de sous-entendre ces critiques, parmi les plus brillantes, de la domination de l’anglais et des universités néolibérales. L’impasse théorique peut être révélée par une comparaison entre le récent compte-rendu d’Andrew Ross[3] sur l’expansion globale agressive des universités anglophones et la critique de la domination de l’anglais dans l’enseignement supérieur à Taiwan lancée en 2003 par un groupe d’intellectuels gravitant autour de la revue en chinois : « Taiwan : Un trimestriel radical dans les sciences sociales[4] ». Dans une certaine mesure, la critique de l’expansion des universités anglophones de Ross s’accorde avec celle des intellectuels de Taiwan dans un front commun contre le soutien institutionnel à un néo-impérialisme de l’anglais, notamment autour de leur proposition de se servir des formes nationales d’organisation contre le néolibéralisme (une critique qui vise les « délocalisations » chez Ross et la défense de la langue nationale comme lieu de la mémoire collective et de l’expérience locale). Il faut alors se demander si cet argument conjoint de défense des formes nationales d’organisation ne s’explique pas par les limites d’une critique qui ne vise que la précaution plutôt que la création ? C’est à l’ évidence le problème dans les sciences sociales qui s’appuient sur l’implicite modèle ethno-national de différences linguistiques en tant qu’indicateur de la « diversité bioculturelle[5] ». Dans la perspective d’une préservation des langues, l’utilité d’un tel modèle ne souffre aucune contestation, il serait cependant déraisonnable d’espérer en faire un indicateur fiable de nouvelles formes émergentes d’innovation et de développement linguistique. Si nous souhaitons vivre en accord avec l’adage foucaldien de « résister, c’est créer », il nous faudra auparavant admettre que la réorganisation de la vie quotidienne à partir de la logique de la langue nationale a pénétré beaucoup plus profondément l’espace social que les théories de la souveraineté ou de l’économie politique ne l’imaginent habituellement.
Le manque d’espace m’amène ici à prendre la liberté de renvoyer les lecteurs à la critique de la culture comme idéologie du capital et au cadre de référence alternatif à une compréhension géoculturelle de l’histoire mondiale moderne proposés dans l’article publié dans Multitudes no 29 et co-écrit avec Naoki Sakai : « traduction, biopolitique et différence coloniale[6] ». Nous affirmons qu’à la suite de la déterritorialisation massive provoquée par la relation coloniale et l’échange marchand, la traduction est devenue une technique biopolitique centrale dans le processus de reterritorialisation autour de l’État-nation. Le prix de cette reterritorialisation, cristallisé par la violence fondatrice de l’État-nation, fut l’élimination des variations sociales et linguistiques grâce à un dispositif d’une langue nationale standardisée. De notre point de vue, la formation des langues nationales ne précède pas la relation de traduction, au contraire, elle est le produit même de cette relation. D’après la figure homolingue de la langue nationale, la traduction nomme l’expérience d’un échange entre l’intérieur d’un médium homogène et son extérieur. Cependant, dans la pratique, cette intériorité homogène n’apparaît comme figure de représentation qu’après le processus réel de traduction. Dans sa totalité, la langue nationale se trouve ainsi réduite à une simple figure, ou une idée régulatrice, l’objet de l’expérience ayant disparu. Plus encore que n’importe quelle situation linguistique, à l’exception des histoires drôles (toujours considérées comme une difficulté pour la traduction), la traduction symbolise l’expérience du langage en général car elle révèle à la fois l’indétermination essentielle de la communication et la division originaire entre le fait qu’il y a du langage et la réalité de la diversité linguistique. « [E]n principe », note Sakai, « il y a traduction à chaque fois que le récepteur accepte la livraison de celui qui adresse le message [7] ».
Les implications de ces thèses sont fondamentales pour la théorie sociale contemporaine, je souhaite cependant insister ici sur les aspects institutionnels de la situation postcoloniale contemporaine et de sa relation au développement capitaliste. Si la défense d’une langue nationale contre l’empiétement de la domination actuelle de l’anglais s’inscrit dans une continuité avec les luttes coloniales pour l’indépendance, ce combat est aussi l’héritier de l’histoire des recompositions de classes et de la répression des minorités à l’intérieur même de la nation. Le régime de traduction postcolonial s’applique à articuler la relation systémique entre des populations souveraines et la relation structurelle entre les classes sociales. Il en résulte une série d’institutions et de corpus de connaissances constitués selon le principe de la traduction homolingue. Il ne s’agit cependant pas d’une relation uniquement culturelle. Comme Sandra Mezzadra l’affirme : « la traduction est l’un des modes opératoires dominant du capital global.
Le capital comme traduction construit sa propre dimension globale : le langage de la valeur (la valeur d’échange dans sa forme logique pure) est la structure sémantique, et finalement la grammaire, de cette dimension [8] ».
Aucune institution moderne n’incarne avec autant de force que l’université le gradient scalaire constitué par cette articulation. La naissance du système national d’éducation, culminant avec les institutions d’enseignement supérieur, joua un rôle crucial non seulement dans la création d’une population nationale homogène, stratifiée et faisant usage d’une langue standardisée, mais aussi en tant qu’instrument de diffusion et d’organisation des connaissances sur ce que devaient être les différences anthropologiques. « L’Université de la Culture[9] », décrite par Bill Readings comme faisant partie des deux grands modèles de l’université moderne, n’était pas tant une Institution de l’Universel qu’une Institution Nationale de Traduction dont la fonction consistait à « traduire » toutes les connaissances vers et depuis les idiomes nationalisés. Ce fut seulement dans le contexte du Nationalisme Impérial que les INT purent être considérées comme ayant des aspirations à l’universel ; la réalité de l’époque correspondait cependant plutôt à une expropriation des particularités (locales) afin de pouvoir se revendiquer de l’universel. Tandis qu’aujourd’hui les critiques sont finalement arrivés à la conclusion que le concept de « culture est une formation coloniale[10] », la prochaine étape consiste à comprendre comment l’émergence et la persistance contemporaine de cette catégorie est intimement associée par la technique de la traduction au processus de valorisation et de subsumption des subjectivités. Lors d’une brillante intervention appelant à une re-contextualisation mutuelle entre l’économie politique et la pratique déconstructioniste, Gayatri Spivak avait proposé un élément de compréhension important : « je rappellerai que toutes les relations entre l’Ouest et l’Est aujourd’hui sont écrites en termes de possibilité de production d’un plus de plus-value absolue et d’un moins de plus-value relative[11] ». L’extension de la « différence culturelle » à toutes les formes de subjectivité postcoloniale est la forme biopolitique analogue à l’extension du temps-travail qui produit la plus-value absolue. Ainsi s’installe la confusion entre le fait de l’énonciation et la formation d’un sujet collectif au service de la culture comme catégorie anthropologique transcendentale. Certes, il existe toujours des relations axées sur la production de la plus-value relative qui nous permettent de dessiner une cartographie des relations de traduction qui font des langues impériales des lieux d’accumulation. Suivant en cela la logique coloniale du centre et de la périphérie, les flux de traduction, comme ceux du travail migrant et du capital, ont pendant longtemps été essentiellement asymétriques. Les déséquilibres quantitatifs des flux de traductions entre le centre et la périphérie et les écarts qualitatifs entre les flux de données anthropologiques provenant de la périphérie et ceux de la « théorie » universalisante issues du centre révèlent la réalisation d’une logique d’expropriation originelle entre les langues du centre et de la périphérie. Mais les relations traductives entre le centre et la périphérie vont bien au-delà de cette économie de la plus-value relative. Lorsqu’Althusser mentionnait l’école comme un Appareil Idéologique d’État, il n’avait sans doute pas imaginé de considérer la possibilité que la langue, devenue « langue nationale » à travers le « schéma de la co-figuration[12] » avec une autre langue, puisse devenir intrinsèquement idéologique, au-delà même de tout sens déterminé. C’est cependant la situation auquel nous devons faire face aujourd’hui dans le contexte d’un héritage colonial de la traduction.
Il s’agit maintenant de se confronter à la situation contemporaine à partir de ces prolégomènes. La domination des INT pendant le stade précédent de développement du capitalisme a transformé les questions politiques posées par la formation culturelle sous les anciennes conditions d’exception souveraine ou coloniale, les savoirs comme propriété des élites et l’accumulation initiale en des réponses et des dispositifs adaptés aux conditions biopolitiques contemporaines : des oppositions normalisées et des identités codifiées constituant le substrat historique du monde postcolonial et imposant aux corps comment vivre, travailler et parler. Lorsque Foucault mentionne le racisme dans un contexte biopolitique, il ne se réfère pas à des préjugés contre des traits ou des caractéristiques communes mais pointe plutôt la normalisation d’éléments hétérogènes dans une figure unique. Si le marché mondial a modifié les relations hiérarchiques entre le Nord et le Sud, entrainant ce dernier dans la crise, la « différence culturelle » reste un procédé dominant pour imposer une mesure cognitive au sein de la production postfordiste. Ce constat étant particulièrement valable dans le cas des universités de second et troisième rang, situées à la périphérie géographique des centres d’innovations. Dans ces universités, les Humanités se trouvent reconfigurées autour d’une série de compétences linguistico-culturelles considérées comme nécessaires aux Industries Créatives dans un environnement mondial. Brian Holmes note que « les identités sont aujourd’hui encouragées en tant que ressources stylistiques pour la production culturelle marchande, avec pour effet de détourner l’attention des antagonismes sociaux…Utilisant les ressources gigantesques concentrées entre les mains des principaux médias – télévision, cinéma, pop musique – les cultures régionales et les cultures underground sont assemblées et recodées sous la forme d’un produit et renvoyées à leurs créateurs originaux à travers l’immense et profitable marché mondial[13] ». L’université préserve sa compétence comme INT, mais l’opération de traduction se trouve déplacée du sujet national (masculin) des droits du citoyen vers le sujet culturel des Droits de la Propriété Intellectuelle. L’INT postfordiste devient alors une iPRINT (Intellectual Property Right Institution of National Translation – une INT dédiée à l’IPR).
L’impact de la montée en puissance de l’anglais global sur les relations sociales s’étend bien au-delà de l’université et se traduit notamment par la réorganisation de la dichotomie public/privé en relation avec la propriété. L’association de l’anglais avec l’« international » et des autres langues avec des contextes « locaux » impose un nouveau mode de distinction entre le « public » et le « privé » selon une bifurcation entre le « global » et le « local » (même si les significations de « global » et « local » sont aussi en phase de transformation profonde) donnant implicitement un statut « privatisé » aux langues associées avec le « local ». Nous constatons avec ironie que des langues nationalisées – elles-mêmes historiquement construites comme des formes imposées d’échanges « public » – se « privatisent » au fur et à mesure que l’anglais global se trouve inscrit dans un usage « public ». Le cas récent de la République de Corée qui est parvenue à faire reconnaître par l’UNESCO le Festival des Bateaux Dragons en tant qu’héritage national exclusif dans le cadre de la Convention pour la Sauvegarde des Héritages Culturels Intangibles (2003) – alors même que cette tradition est commune aussi à la Chine et à d’autres parties de l’Asie de l’Est, illustre la transformation de la culture nationale en propriété privée assujettie au régime spécifique des Droits de la Propriété Intellectuelle. Depuis sa conception, l’État-nation avait évidemment pour fonction de codifier les conditions d’appropriation des « ressources » sur des territoires géographiques définis, il est cependant fascinant de constater que le régime du travail immatériel typique de la production postfordiste s’étend au-delà de la définition conventionnelle, propre au XIXe siècle, de la définition des ressources (humaines, animales et naturelles) pour intégrer les formes variées de la propriété immatérielle et intangible, incluant la connaissance, la formation et le langage (déjà nationalisé). C’est sur ce dernier aspect que je souhaite insister dans cet essai. À la propension qu’ont les gouvernements néolibéraux pour se mettre au service d’intérêts corporatistes transnationaux complexes, érodant ainsi la notion de citoyen, correspond, dans une même logique, la demande collective implicite pour ces ressources immatérielles. La privatisation du langage sous l’influence de l’anglais global se produit au moment même où la langue devient une source de valeur, et finalement de propriété intellectuelle, dans le mode de production postfordiste.
Le maintien de la rareté se produit quand la division du travail sur les frontières linguistico-anthropologiques et celle du régime de la traduction sur des lignes nationalisées se rejoignent dans une logique contre-intuitive avec les objectifs de la gouvernementalité néolibérale. Il est courant d’entendre dire que dans le régime postfordiste la communication est immédiatement productive. Cette affirmation se vérifie aisément dans les universités où sont établies des bureaucraties élaborées d’« audit en assurance qualité », requérant une main-d’œuvre permanente – généralement fournie par des étudiants non ou (sous)-payés – afin de remporter des points permettant d’obtenir une hausse du chiffre d’affaire pour l’université. C’est le cas aussi dans l’usage de l’anglais global qui, comme les biotechnologies et l’informatique, contribue directement à la valorisation du travail au cours des divers processus de la production. Une des plus importantes manifestations de cette rareté, souvent négligée, se manifeste dans l’asymétrie instituée par le régime de traduction hérité du colonialisme. Dans un mode biopolitique qui s’est traduit par le transfert de la logique de la souveraineté au sein même de la vie[14], la division coloniale entre les langues nationales du centre et de la périphérie se trouve maintenant projetée dans les corps et les voix. Tandis que les travailleurs des universités de l’Asie de l’Est se trouvent pratiquement obligés d’avoir la maîtrise de l’anglais, ces exigences n’existent pas pour ceux des institutions anglophones, alors qu’ils sont pourtant généralement mieux payés et jouissent d’un prestige international plus important du fait de l’amplification technologique de l’anglais. Cette asymétrie produit deux types de rareté institutionnelle dans cette accablante abondance de l’anglais global. D’une part, l’accessibilité aux connaissances produites par les INT non anglophones se trouve sérieusement restreinte par la nécessité de la traduction[15] ; d’autre part, cette opération de traduction ne peut être réalisée que par deux types d’universitaires – les natifs locaux et les « spécialistes d’aires [culturelles] » globaux. Il en résulte que des champs entiers du savoir encodés dans les INT particulières peuvent se trouver sous-représentées en anglais, tandis que la rareté de ces corpus abstraits est faite pour correspondre à une division des langues corporelles et concrètes. Il faut ici se souvenir que sous le régime mondialisé/globalisé de la traduction, ce n’est qu’à partir du moment où il devient un objet d’échange, ou de traduction, que le savoir acquière une valeur véritable. La valeur du savoir s’accroit à mesure que grandit sa faculté à s’échanger, ou à être traduit (ceci s’expliquant par la capacité d’un savoir à conquérir une part de marché plus large). Dans cette logique,
« la rareté », c’est-à-dire la difficulté de traduction, diminue au lieu d’augmenter la valeur du savoir-marchandise. De plus, la plus-value réalisée par le travailleur qui possède cette faculté relativement rare de traduction ne se matérialise pas comme on pourrait s’y attendre, car il se trouve piégé dans un champ du savoir particulier directement assigné à la différence anthropologique. En conséquence, ce système contribue à protéger la valeur des chercheurs unilingues anglophones, dont le travail se trouverait sinon dévalué. On retrouve ici un schéma familier propre à d’autres aspects de l’économie postfordiste : la valeur se trouve assujettie à une mesure cognitive imposée depuis l’extérieur du mode de production (c’est notamment le cas dans le système d’évaluation des INT d’Asie de l’Est qui accorde des points supplémentaires pour les articles publiés en anglais).
C’est précisément parce que l’anglais fonctionne comme une « machine de traduction universelle » qu’il devient un lieu d’intense accumulation. Le problème auquel nous faisons face aujourd’hui ne se résume pas tant au devenir dominant de l’anglais sur le marché de l’enseignement supérieur dans un processus de mondialisation, il réside plutôt dans le fait que l’Anglais global s’est insidieusement positionné comme un modèle social de traduction qui produit un différend interne aux corps et aux langues[16]. Cette appropriation de la traduction en tant que principe interne par l’anglais global et les discontinuités entre les corps (en travail ou savants) et les langues (parlées ou silencieuses) doivent être interrogées, utilisées et transformées. Renverser la hiérarchie des langues ne serait pas aussi libérateur que de transformer et de se réapproprier l’opération, c’est-à-dire la traduction, qui se trouve à l’origine des langues distinctes, dans le but d’inventer une nouvelle base non-anthropologique et non-coloniale pour les relations sociales et le savoir humaniste. Plutôt que de lancer des actions défensives d’arrière-gardes contre la domination de l’anglais global et pour la défense des langues nationalisées issues de la modernité impériale/coloniale grâce au régime de la traduction-en-tant-qu’exception, nous pourrions essayer non pas de mobiliser telle ou telle langue mais d’assumer le fait que le différend linguistique a été incorporé à l’intérieur du système universitaire mondial émergeant en tant que principe d’organisation et structure de subjectivité. En d’autres termes, nous devrions exploiter l’internalisation du différend linguistique au sein du système universitaire mondial émergeant dans l’intention de forger de nouveaux sujets capables de s’engager dans un nouveau contrat social (dans l’attente d’une révision complète du concept de contrat allant au-delà du modèle évidemment défaillant du consensus rationnel).
Cette contre-pratique nécessite finalement une composante pédagogique. De récentes théories sur l’anglais-en-tant-que-Lingua-Franca (English as Lingua Franca, ELF) tendent à effacer dans l’étude de l’anglais les anciennes oppositions qui ont structuré la notion moderne de langue telles que natale/non-natale, grammatical/non-grammatical, authentique/non-authentique, etc. Comme l’écrit un des plus brillants défenseurs de l’ELF : « Dans un contexte mondial où le nombre des utilisateurs de l’ELF dépasse maintenant celui des ENL [anglais-comme-langue-de-naissance], l’authenticité du locuteur natif n’est plus pertinente, et se trouve être incompatible, au regard des réalités d’une communication à partir de la lingua franca[17] ». Le modèle de l’ELF ne propose rien moins que de prendre pour objet une entité culturelle indéfinie et un peuple indéterminé. Et la langue qui se trouve ainsi choisie correspond à la conception de Giorgio Agamben quand il note que « toutes les langues sont jargons et argot[18] ». Rien ne nous empêche maintenant d’aller plus loin en soulignant l’importance centrale de la traduction dans la notion de lingua franca. Dans aucune situation le factum loquendi – que Agamben considère comme « une sorte d’affranchissement…poétique et politique[19] » des limites de la confusion politique moderne entre la langue et le peuple – n’est plus évident que lors de l’échange de traduction. L’analyse de Sakai montre comment l’hybridité essentielle de la position du traducteur permet de mettre en évidence la différence entre « communication » et « adresse », entre la représentation imaginaire d’un contenu informationnel et d’identités pronominales dans la communication et la relation sociale indéterminée (incluant la possibilité de l’échec) de l’adresse[20]. En développant les implications de cette distinction fondamentale, Sakai peut alors démontrer que chaque forme d’adresse constitue en faite une forme de traduction. Cette brève mise au point concernant le sens du « jargon » d’Agamben en relation avec la notion de traduction de Sakai doit maintenant nous permettre d’apprécier pleinement la signification d’une pédagogie de l’ELF. En contestant le lien entre nativité et langue comme le noyau central de la machine de traduction implicite qu’est devenu l’anglais global, l’ELF offre une nouvelle possibilité pour la « praxis sociale ».
En l’état actuel de la réflexion, le Commun traductif rendu inactif par l’ELF pourrait aisément être récupéré par l’accélération de la privatisation de toutes les autres formations ethnico-linguistique. Dans la littérature sur l’ELF, cette tendance se matérialise par l’exclusion des « locuteurs natifs » de la participation aux études empiriques sur les usages de l’ELF[21]. De nouveau, la linguistique se trouve contrainte d’identifier un phénomène indéfini (le locuteur de l’ELF) à l’aide d’une catégorie prédéterminée (le locuteur natif). La première étape dans le processus de réappropriation des possibilités historiques offertes par l’ELF consiste à éviter de faire de l’ELF une catégorie pour séparer les locuteurs natifs des non-natifs. L’EFL devrait plutôt être conçu comme un outil du refus de cette distinction, un « non » productif comme la négation inclusive dans l’expression d’une « géométrie non-euclidienne ». Afin de distinguer cette conception de celle de la littérature courante sur l’ELF, nous proposons l’expression anglais-en-tant-que-langue-commune (ECL). Ce terme est inspiré du concept de « langue commune » (putonghua) développé en opposition avec les langues impériales et nationales par Qu Qiubai (1899-1935), leader temporaire et théoricien du Parti communiste chinois pendant la phase pré-maoïste de luttes basées sur les travailleurs migrants des villes[22]. Le concept de « langue commune », de Qu (dont l’État communiste s’est emparé dans l’intention de créer une langue nationale, réalisant ainsi l’inverse du projet initial de Qu) fut élaboré en synergie avec l’idée que la traduction constituait un élément fondamental de la linguistique et, ainsi, de la « praxis sociale ». En développant la perspective initiale de Qu, cet essai insiste sur le fait qu’une lingua franca « commune » (dans le sens de putonghua en mandarin) doit se concevoir en considérant les aspects biopolitiques de la traduction.
Au cours des années 1930, peu nombreux furent les écrivains familiers d’une situation coloniale qui pensèrent la possibilité d’un peuple nouveau – contre la reproduction de communautés de natifs à travers le modèle de l’ethnicité nationale – dans une perspective aussi innovante et avec une passion révolutionnaire aussi intense que Qu Qiubai. L’hétérogénéité de la population de travailleurs migrants résidant à Shanghai dans des conditions d’extraterritorialité et d’accumulation primitive permis à Qu Qiubai d’avoir un modèle pour articuler une pensée étonnamment créative autour des questions de la culture et de la communication. Sur cet aspect, il faut insister sur les propositions singulières de l’auteur au sujet de la formation d’une « langue commune » qui ne soit ni nationale ni impériale, mais imaginer à partir d’une société future se construisant à travers les migrations, la traduction et la réappropriation des moyens de productions.
Qu se présente à nous avec une pensée qui s’amorce à partir de l’anomalie qui tente d’arracher les corps à leur emprisonnement par les codes émergents de la grammaire, de la loi et de la valeur d’échange. Une pensée qui ne prend pas cette anomalie comme son objet, mais s’articule autour d’elle pour imaginer un futur qui dépasse à la fois les stratégies disciplinaires de l’accumulation primitive et de la production industrielle, et les techniques subjectives de normalisation sociale inhérentes à l’État-nation moderne. Cette anomalie est le résultat de la conjoncture révolutionnaire du Shanghai du début des années 1930 : un « état d’exception permanent » formalisé par les protocoles de l’extraterritorialité ; une population émergente de Shanghai composée à 80% de migrants[23] ; l’absence d’une langue commune ; une force de police se substituant à la souveraineté ; une gouvernance politique articulée avec une logique policière dans le souci de discipliner la vie elle-même. Qu aborda cette conjoncture particulière à partir de l’ex-position d’un sujet révolutionnaire à venir plutôt qu’en supposant une souveraineté dérivée de la recomposition capitaliste de la gouvernementalité coloniale. Face au mélange très singulier des espaces, des populations, des grammaires et des valeurs qui caractérise la transition d’une entité impériale multiculturelle et multilinguistique (« la dynastie Qing », 1644-1911) vers une nation moderne inscrite dans un monde d’État-nations (« la Chine », 1911- ), Qu Qiubai avait compris que si ce processus était appréhendé par la figure du retour, il ne servirait alors qu’à soutenir la misérable domination du présent dans le futur. Au contraire, Qu s’est emparé de cette situation shanghaienne où dominait une population migrante comme une ouverture pour envisager une nouvelle situation. Dès lors, l’anomalie n’est plus l’exception qui rétablit la règle, mais le point de départ pour casser, en diagonale[24], cette relation étouffante. À partir de cette perspective, la seule anomalie réelle consiste en une oscillation entre la règle et l’exception qui voile le système capitaliste d’accumulation-à-travers-l’expropriation derrière une idéologie de la culture nationale.
Qu Qiubai a compris très tôt que si la culture nationale est l’idéologie du capital, la traduction-en-tant-que-langue-nationale constitue une de ses techniques subjectives dominantes. Il n’avait cependant pas envisagé la capacité des INT et d’autres institutions (comme les partis politiques) à façonner les corpus de connaissances et les formes d’expression. Si les élaborations théoriques de Qu sont encore peu connues aujourd’hui (elles sont loin d’être aussi populaires que celles de la ligne souverainiste de Mao Zedong[25]), la raison en incombe certainement dans l’articulation entre valeur, connaissance et langue constituée par les INT. J’ai justement essayé ici d’esquisser la manière dont l’université mondialisée – la postfordiste IPRINT – a remplacé le modèle de la langue nationale-en-tant-que-forme-de-traduction grâce à l’infiltration de l’anglais global à l’intérieur même de son système dans l’optique de manipuler les décisions biopolitiques concernant la différence entre les corps en travail et les langues parlées. Ma solution fut une proposition d’intervention à visée pédagogique dans le débat sur l’ELF afin de renverser l’identification moderne entre langue et peuple à travers l’économie générale de la traduction.
En guise de conclusion, il pourrait être utile d’esquisser quelques propositions pour une réorganisation de l’université. L’élément principal de ce projet réside dans l’idée que la transformation linguistique est intimement associée à une réorganisation des disciplines et aux mouvements sociaux (tel que la réorganisation de l’université). Soyons clairs : la transformation linguistique que représente l’anglais global ne saurait être légiférée d’en haut ; il s’agit de la situation réelle se développant à la base de la société. L’anglais global pourrait devenir le précurseur d’une langue correspondant à la forme étatique émergeante d’organisation sociale identifiée alternativement par Bidet comme État-global ou Negri et Hardt comme Empire[26]. Mais les processus de transformation offrent toujours des possibilités de résistance créative. Il s’agit d’admettre, comme préalable indispensable à nos actions, le caractère central et fondamental de la traduction à notre époque dans le champ des savoirs et, ainsi, de réorganiser les Sciences Humaines le long des lignes de l’hybridité essentielle inhérente à la position du traducteur qui, au lieu d’être considéré comme une exception secondaire à ignorer, deviendra un indice de la situation socio-linguistique générale.
Traduit de l’anglais par Florent Villard