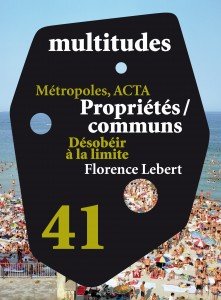Les deux grands traités internationaux ratifiés à la fin du XXe siècle, la Convention sur la Diversité Biologique (1992) et l’Accord de Marrakech fondant l’OMC (1994), ont considérablement redéfini le cadre légal régissant la relation de l’humain à la nature. Alors que la Convention sur la Biodiversité instituait des droits de propriété privés sur la nature sauvage afin de prévenir la bio-piraterie (c’est-à-dire l’exploitation illimitée des riches ressources génétiques dont disposent les pays pauvres), l’Accord de Marrakech a rendu obligatoire pour tous les pays signataires la reconnaissance des brevets concernant la découverte de micro-organismes et de composants génétiques isolés au sein des plantes et des animaux. La question de savoir qui peut profiter comment de la nature est passée au premier plan des préoccupations des sciences de la vie, des multinationales, des gouvernements, des communautés territoriales et des ONG. Comment en est-on arrivé à la marchandisation accélérée de la nature, qui va de pair avec le pillage et la spoliation des ressources naturelles, grâce à de nouveaux régimes institutionnels de droits de propriété ?
La marchandisation de la nature érigée en paradigme dominant
Les rapports de possession, de maîtrise et d’assujettissement que le monde occidental entretient avec la nature remontent bien entendu non seulement aux philosophies de Bacon et de Descartes, mais au texte de la Genèse, qui accorde aux humains un pouvoir de domination sur la Terre où ils sont appelés à croître et à multiplier. Pour s’en tenir à notre passé proche, avec la chute des régimes se réclamant du « socialisme réel », l’appropriation privative est devenue, dès le début des années 1990, le paradigme dominant, le seul remède envisageable aux problèmes de société et d’environnement. Le Sommet de la Terre de 1992, avec son Agenda 21 et avec la Convention sur la Diversité Biologique, a constitué un moment crucial dans l’encadrement légal des attitudes humaines envers la nature. Face au changement climatique, au déclin des ressources en eau potable, à la déforestation, à l’extinction de nombreuses espèces animales et à l’extrême pauvreté de plus d’un milliard d’êtres humains, le principe libéral de la régulation par le marché libre fut promu comme apportant les solutions les plus prometteuses. L’efficacité écologique, l’obtention d’une production accrue mobilisant moins d’intrants, la dématérialisation de l’économie grâce au progrès technologique, la privatisation des ressources naturelles et leur gestion par les forces du marché étaient censées garantir une croissance économique soutenable[1].
Au sein de la notion de « développement durable » mise par les Nations Unies au centre de la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement, l’instrument mobilisé pour mieux prendre en compte la valeur des ressources naturelles affectées de rareté fut la généralisation du principe d’appropriation privée de la nature (eau, forêts, ressources biologiques). En tant qu’elle constituait le résultat le plus visible de la Conférence de Rio, la Convention sur la Biodiversité reflétait cette tendance idéologique. Elle stipulait que des systèmes de droits de propriété exclusive encourageraient la préservation de la biodiversité, la protection des plantes rares et des espèces animales menacées, ainsi qu’une utilisation durable et renouvelable des ressources.
Le motif de la tragédie des communs promu par Hardin[2] servait d’argument à l’introduction des droits de propriété dans cette convention internationale qui avait pour fonction de protéger la nature des dommages occasionnés par les humains. Il est rationnel, prétendait Hardin, pour chaque berger conduisant ses bêtes sur des terres communes d’ajouter des animaux supplémentaires à son troupeau, même si cela doit résulter en une sur-utilisation collective du pâturage. De façon plus générale : là où les intérêts individuels pousseraient les membres d’une collectivité à l’exploitation illimitée des ressources communes, la propriété privée tendrait à préserver les ressources privatisées. La Convention considère la maximisation du profit comme la force motrice de l’action et des choix économiques. Elle affirme la nécessité d’établir des réglementations concernant l’accès aux ressources et le partage des bénéfices qu’on peut en tirer, afin de permettre aux habitants de pays économiquement pauvres, mais riches en biodiversité, de tirer bénéfice des profits que les multinationales de la biotechnologie font en exploitant leurs ressources génétiques.
La même Convention reconnaît toutefois qu’il faut protéger et encourager un « usage coutumier des ressources biologiques » (article 10) – à savoir un usage relevant de pratiques sociales, de croyances religieuses ou de convictions politiques ancrées de longue date dans les coutumes locales. On admet que « les communautés indigènes et locales se conformant à des modes de vie traditionnels » ont développé des connaissances et des pratiques à même de conserver la diversité biologique. Cette vision holiste de la symbiose entre l’humanité et la nature est toutefois projetée exclusivement sur les sociétés prétendument « traditionnelles », qu’un discours idéalisant érige au statut de préservatrices de la nature. Par contraste, le rôle des sociétés industrialisées occidentales est de réaliser des développements technologiques et des « investissements susceptibles de conserver la biodiversité », apportant du coup une « vaste gamme d’avantages environnementaux, économiques et sociaux » (préambule). La question est toutefois : avantages pour qui ?
Protections et détournements
Selon la Convention, les pays en voie de développement devraient avoir part aux bénéfices tirés de l’usage de leurs ressources génétiques. 80% des ressources génétiques sont en effet situées dans les pays pauvres du Sud, mais après 500 ans de colonisation, des spécimens d’environ 80% des plantes ont déjà été transférés ou acclimatés dans les jardins botaniques du Nord, où ils sont conservés loin de leur habitat naturel, ex situ. La Convention affirme que les États ont des droits souverains sur leurs propres ressources biologiques, sans toutefois spécifier si cela concerne les espèces in situ ou ex situ. Cette ambiguïté convient bien aux pays riches peu dotés en biodiversité naturelle, puisque cela leur permet de légitimer une appropriation qui a déjà eu lieu de facto.
Les connaissances portant sur les qualités curatives et nutritionnelles de nombreuses plantes se trouvent toutefois encore souvent situées dans des communautés considérées comme « traditionnelles », sans relever de la propriété exclusive d’aucune d’entre elles. Cela donne lieu à une grande variété de revendications, de luttes et de redéfinitions de droits légaux touchant aux connaissances environnementales indigènes[3]. Des plantes semblables sont souvent utilisées par différentes communautés dans un ou plusieurs pays, qui ont des droits égaux à en revendiquer la propriété. Des matériaux génétiques utilisés par une culture peuvent aussi être tirés d’autres espèces (parentes ou distantes) dans d’autres parties du monde. Des connaissances indigènes acquises auprès d’une certaine communauté pourraient permettre à une firme d’exploiter ces matériaux biologiques en les obtenant de jardins botaniques, de parcs zoologiques, de collections d’échantillons ou de bibliothèques cellulaires cultivées ex situ.
Dans de pareils cas, les obligations contractuelles de partage des bénéfices avec les populations indigènes peuvent être contournées[4]. Les firmes négocient leur accès aux ressources génétiques par l’entremise d’États qui ont souvent une relation conflictuelle avec leurs populations indigènes et qui cherchent surtout à extraire un maximum de profits financiers de ces contrats. Le résultat de ces procédures est que toutes les parties en présence, compagnies de biotechnologie, gouvernements et communautés indigènes, considèrent les plantes et les animaux surtout comme des sources de revenus et de profits intriqués dans des relations humaines potentiellement conflictuelles.
Dans tous ces conflits, le concept sur lequel se concentrent les controverses concernant l’accès aux connaissances sur les plantes et les animaux est celui de propriété, plus spécifiquement de propriété intellectuelle. Marilyn Strathern nous invite à faire une distinction entre propriété « culturelle » et propriété « intellectuelle ». La propriété culturelle est transmise d’une génération à l’autre : « elle est authentique lorsqu’on peut montrer qu’elle a été transmise »[5]. Les variétés de semences transmises et améliorées au fil des générations sont un exemple d’une telle propriété culturelle. Au contraire, la propriété intellectuelle peut faire l’objet d’une revendication précisément parce qu’elle n’a pas été transmise ni partagée avec qui que ce soit.
Les nouvelles appropriations des « découvertes »
Au cours des trente dernières années, toutes les règles du jeu concernant les droits de propriété intellectuelle et leur application ont radicalement changé, et ces changements ont profondément affecté le brevetage des formes de vie. Alors qu’elles visaient originellement à protéger les inventions pour une certaine durée, la législation des brevets s’est transformée pour permettre l’appropriation privée de simples découvertes. On peut désormais breveter des gènes isolés dans des plantes ou des animaux naturellement produits, des éléments actifs synthétisés dans des plantes médicinales, ou les processus par lesquels des composants génétiques sont isolés. Avec la signature en 1994 de l’accord de l’ADPIC (l’Aspect des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce) par les membres de l’OMC, des régimes de propriété intellectuelle compatibles avec ceux qui ont évolué dans les pays du Nord au cours des 100 dernières années doivent désormais être introduits auprès de tous les pays signataires, y compris auprès des pays non-industrialisés du Sud. L’accord, dans son article 27,3 b, rend possible l’application des droits de propriété intellectuelle sur des organismes vivants et sur des formes de vie, autorisant ainsi le brevetage sur toute la surface de la Terre de micro-organismes et d’organismes génétiquement modifiés.
Cet article 27,3 b oblige donc tous les signataires de l’ADPIC à prévoir des mécanismes de protection des droits de propriété intellectuelle sur les variétés de plantes, même s’il leur laisse le choix du régime de protection qu’ils préfèrent (selon les options sui generis). Dès lors que l’OMC exige de ses membres qu’ils accordent des brevets sur des micro-organismes produits par la nature et dès lors que la plupart des pays industrialisés demandent que cela soit étendu au matériel génétique tirés de plantes et d’animaux, l’accord de l’ADPIC étend en réalité le domaine du brevetable largement au-delà des pratiques en vigueur dans la plupart des pays[6].
On revit ici un mouvement comparable à celui des « découvertes » coloniales qui se sont déroulées du XVe au XIXe siècle, quand des continents entiers, qui avaient été habités par des populations indigènes pendant des millénaires, ont été soudainement « découverts » par des Européens, et appropriés par la violence et la tromperie. D’une façon similaire, les réglementations de l’OMC ouvrent la possibilité pour les firmes privées de s’assurer un accès légal et exclusif à des organismes naturels, à des semences issues de transmissions traditionnelles ainsi qu’aux connaissances qui ont été accumulées à leur propos durant des siècles par populations indigènes et des traditions d’agriculteurs.
Une fois qu’ils ont acquis un droit de propriété intellectuelle sur un gène ou sur une séquence de gènes qu’ils ont « découvert », les propriétaires sont autorisés à exercer un contrôle inédit sur tout organisme qui contient ce gène ou cette séquence de gènes, même si l’organisme se reproduit et se répand de façon naturelle. Même si des découvertes d’ingrédients potentiellement lucratifs sont faites par de petits laboratoires dans des pays en voie de développement, les brevets finissent souvent dans les mains des grandes firmes à la suite de fusions ou d’acquisitions capitalistiques. Les chercheurs des institutions publiques sont encouragés à s’associer et à se mettre au service d’entreprises privées qui gardent souvent secrets les résultats de leurs travaux ou qui les protègent par des brevets.
Se servir des droits de propriété ou rejeter le principe de l’appropriation ?
Afin de résister à l’appropriation des ressources naturelles de pays pauvres dotés d’une grande richesse en biodiversité, par les pays riches dont la biodiversité est en déclin, quelques dirigeants politiques et quelques ONG ont placé leurs espoirs dans les procédures sui generis visant à protéger les variétés végétales. D’autres ont commencé à dénoncer toute forme de légalisation autorisant l’appropriation de ressources génétiques comme relevant d’une forme légalisée de biopiraterie. Les pays industrialisés exercent toutefois des pressions énormes sur les gouvernements de pays en voie de développement pour s’ouvrir l’accès aux ressources génétiques. Face à de telles pressions, et attirés par la perspective de gains financiers promis par la possibilité de revendiquer certaines ressources biologiques comme faisant partie de leurs savoirs traditionnels, de plus en plus de leaders des « communautés indigènes » participent à des forums internationaux comme la Conférence réunissant les signataires de la Convention sur la Biodiversité. Ils ne contestent plus le principe du partage de l’accès et des profits générés par leurs ressources biologiques avec les grandes multinationales. Ils essaient seulement de négocier des accords dont les conditions leur soient les plus favorables.
Dans de tels forums, revendiquer légitimement un « point de vue indigène » s’inscrit dans un positionnement stratégique sur un terrain de contestation. Différentes versions du « point de vue indigène » sont construites comme des discours cohérents, susceptibles de se détacher de la diversité réelle des sociétés indigènes, de leurs variétés de conditions socio-économiques et de leurs relations à leur environnement naturel. Même si certaines de ces versions sont clairement opposées à l’idée de partager l’accès et les profits avec les multinationales, et se revendiquent de modes de vie indigènes dans lesquels l’indigène « fait partie du monde naturel », dont les ressources ne sauraient en aucun cas être privatisées ou négociées[7], ces attitudes semblent perdre du terrain dans les négociations internationales.
Dans le même temps, les « modes de vie indigènes » sont dorénavant érigés par l’écologie radicale et par des agences intergouvernementales en charge de problèmes environnementaux comme représentant une alternative réelle à la marchandisation de la nature, à laquelle la plupart des signataires des accords internationaux semblaient s’être résignés. En réalité, toutefois, cette idéalisation des « modes de vies indigènes » conduit à construire l’image d’une Altérité de pacotille, désintéressée et non-matérialiste, dont on attend qu’elle préserve des îlots de nature vierge pour le reste de l’humanité qui, pour sa part, se contente de continuer à faire ses affaires comme si de rien n’était.
Inventer des alternatives
à la marchandisation de la nature
Comment concevoir des alternatives à l’appropriation privée des ressources naturelles ? Dans toutes les sociétés, le contrôle sur l’accès aux choses, aux idées et aux ressources est réglementé – quoique pas forcément en termes de systèmes légaux ni de propriété privée. Cela peut passer par des rituels, des conventions coutumières ou des formes de pouvoir politique – qui se trouvent parfois être extrêmement contraignantes, inégalitaires et à la source de gaspillages considérables. Si l’on considère la propriété comme un nœud de pouvoir (« bundle of power »), ainsi que nous invite à le faire Verdery[8], alors toutes les autres formes de contrôle sur les choses, les idées et les ressources peuvent être analysées d’une façon similaire à l’égard de l’exercice du pouvoir. Cela nous permet aussi d’envisager l’idée d’un commun global à partir d’une position critique, non pas comme une solution toute faite au problème actuel de la marchandisation, mais comme le début d’un nouveau défi qu’il nous faut apprendre à affronter.
Une alternative radicale aux tentatives éparpillées de formuler des législations sui generis s’inscrivant dans le cadre des réglementations de l’OMC est proposée par l’Initiative de Traité pour le Partage du Patrimoine Génétique Commun, qui s’oppose à l’extension des droits de propriété intellectuelle à toute forme d’être vivant ainsi qu’à tout élément composant d’un être vivant. Cette proposition de traité vise à ce que chaque gouvernement et chaque peuple indigène devienne un « intendant » chargé de « prendre soin » de son domaine géographique (caretaking, stewarding), au sein d’un « commun génétique global ». Il appartiendrait à chacun d’eux de s’assurer que le patrimoine génétique demeure une ressource commune, qui ne peut être vendue à aucune institution ni à aucun individu sous la forme d’information génétique. Citons le texte de cette Initiative de Traité (2002) :
« Toutes les Nations déclarent que le patrimoine génétique de la Terre, sous toutes ses formes et manifestations biologiques, est un patrimoine mondial que tous les peuples doivent protéger et sustenter ensemble ; elles déclarent de plus que les gènes et les produits dont ils constituent la codification, sous leur formes naturelle, purifiée ou synthétisée, ainsi que les chromosomes, les cellules, les tissus, les organes et les organismes y compris les organismes transgéniques et chimériques, ne pourront être revendiqués par les Gouvernements, les entreprises commerciales ou par d’autres institutions ou particuliers, en tant qu’information génétique négociable commercialement ni en tant que propriété intellectuelle.
Les parties du Traité – qui devront inclure les États-nations signataires ainsi que les peuples indigènes – s’accordent par ailleurs à gérer le patrimoine génétique en tant que trust. Les signataires reconnaissent le droit souverain et la responsabilité de chaque nation et territoire de veiller sur les ressources biologiques à l’intérieur de leurs frontières et de définir la façon dont elles seront gérées et partagées. Cependant, étant donné que le patrimoine génétique, sous toutes ses formes et manifestations biologiques, est un patrimoine mondial, il ne peut être vendu par aucune institution ni par aucun particulier comme information génétique. Aucune institution ni aucun particulier ne peuvent à leur tour réclamer cette information génétique comme leur propriété intellectuelle. »
Ce texte constitue un effort pour contrecarrer la généralisation du principe de privatisation à partir d’une approche radicalement différente, articulée en termes de bien commun. Les ressources naturelles – en l’occurrence les ressources génétiques, mais aussi bien, dans d’autres cas, l’eau – doivent rester un bien commun de l’humanité. Les humains doivent préserver ces ressources pour eux-mêmes et pour les générations à venir. Le principe en charge d’assurer cette préservation est la réglementation, et non la médiation par le marché. Une conséquence importante d’un tel traité serait par exemple l’abolition de tous les brevets portant sur des formes de vie (génétiquement modifiées ou non), ainsi que l’abolition de tout droit exclusif concernant les semences.
Cette Initiative de Traité a été signée par 200 organisations et a été présentée à un public plus large au cours du Sommet Social Mondial de Porto Alegre en 2002. Son soutien est toutefois loin d’être unanime auprès des ONG qui se sont battues durant les dix dernières années pour un partage plus équitable des bénéfices liés à l’utilisation des ressources génétiques. Elles craignent que la notion d’un « commun génétique global » profite surtout (et une nouvelle fois) aux grandes multinationales en privant les groupes indigènes de tout contrôle, ainsi que de leurs nouvelles sources de revenus à peine acquises. La Convention sur la Biodiversité est perçue comme une étape majeure dans le développement des traités environnementaux, et de nombreux activistes sont peu disposés à la remettre en question. Les groupes indigènes revendiquent des droits ainsi qu’une protection pour les « variétés territoriales » qu’ils ont développées au cours des siècles passés, et qui se trouvent dorénavant exploitées par les grandes multinationales afin de mettre au point des variétés génétiquement modifiées, comme c’est le cas avec le riz GM Texmati tiré de la variété traditionnelle de riz Basmati. L’Initiative de Traité rencontre donc de fortes résistances dans les rangs des peuples indigènes et des mouvements écologiques, qui craignent de voir s’évanouir la possibilité de partage des profits, sans perspective d’obtenir aucune compensation.
L’exemple du cactus Hoodia
Les conflits d’intérêts que pourrait entraîner un Traité pour le Partage du Patrimoine Génétique Commun apparaissent clairement à l’examen des controverses suscitées par l’exploitation commerciale de composants génétiques du cactus Hoodia, une plante d’origine sud-africaine utilisée pour la production d’une pilule amincissante qui a fait la Une des journaux au printemps 2002. Les populations San (pygmées, Bushmen) ont consommé ce cactus depuis des générations dans leurs expéditions de chasse dans le désert du Kalahari. En consommant sa chair, ils trouvaient de quoi obtenir un précieux apport en fluide ainsi qu’un effet de réduction d’appétit. Cette propriété a été repérée par un laboratoire sud-africain du Conseil de la Recherche Scientifique et Industrielle (CSIR), qui a isolé le composant assurant la diminution de l’appétit, et qui l’a breveté sous le nom de P57. Une petite entreprise pharmaceutique britannique, Phytopharm, a obtenu les droits de développement du laboratoire sud-africain, et a revendu peu après les droits de licence du médicament pour 21 millions de dollars à Pfizer, la grande compagnie pharmaceutique américaine (fameuse, entre autres, pour sa commercialisation du Viagra). Pfizer espère développer une pilule amaigrissante pour des millions d’Américains souffrant d’obésité, ce qui constitue un marché potentiel de plusieurs milliards de dollars.
Ce cas est devenu célèbre lorsque des représentants des peuples San ont réclamé une compensation pour l’utilisation à des fins commerciales de leur savoir traditionnel concernant la plante Hoodia. Après des mois d’âpres négociations, le CSIR et les représentants des San sont parvenus à un accord, qui a reconnu aux San le statut de porteurs de savoirs traditionnels et qui a attribué au CSIR les droits de propriété intellectuelle sur l’ingrédient P57, isolé par ses laboratoires. Le CSIR et les San ont aussi convenu de coopérer à l’avenir dans l’identification de plantes qui pourraient contenir des composants dotés d’un potentiel de commercialisation (Guardian Weekly, 4-10 avril 2002). Le montant des transactions financières impliquées par cet accord n’a pas été divulgué.
Si le Traité pour le Partage du Patrimoine Génétique Commun avait été en vigueur, ni les San, ni Pfizer, ni aucune autre firme pharmaceutique n’auraient pu profiter financièrement de leur connaissance exclusive du cactus Hoodia. En tant qu’intendants (stewards) en charge de prendre soin du patrimoine végétal de leur région, les San auraient pu refuser aux laboratoires pharmaceutiques l’accès à ces plantes. S’ils avaient autorisé le laboratoire à isoler la substance réductrice d’appétit, celle-ci aurait relevé du domaine public. Elle aurait pu donc être utilisée par des petites entreprises pharmaceutiques sur toute la planète, par exemple en Inde, pour produire des pilules amincissantes à vendre sur le marché américain. Les partisans de l’Initiative de Traité fondent leurs espoirs sur le fait que les grandes multinationales perdraient tout intérêt envers les ressources génétiques, dès lors qu’elles ne pourraient pas obtenir de droits de propriété exclusifs leur assurant des profits commerciaux substantiels.
Être (une partie de la nature)
ou avoir (des propriétés exclusives)
Certains anthropologistes environnementaux rejettent toutefois l’idée d’une telle « intendance » (stewardship), pour la raison qu’elle établirait encore une fois une hiérarchie entre les humains et les autres êtres vivants. Au lieu de chercher à protéger l’environnement des dommages causés par les humains, ceux-ci, et plus particulièrement ceux qui vivent dans des sociétés industrialisées, doivent redécouvrir qu’ils vivent et pensent avec, au sein et au travers de la nature. Ils ne sont qu’une partie de leur environnement, comme le précise Ingold : « les humains adviennent à l’existence comme des personnes-organismes au sein d’un monde habité par une variété d’êtres, à la fois humains et non-humains »[9].
Il n’y a pas d’alternative simple aux processus de marchandisation et de privatisation de la nature. Ces derniers sont liés non seulement aux cadres légaux et aux pratiques de pouvoir et d’exploitation prévalant au niveau global, mais aussi à des visions du monde, à des coutumes et à des convictions. Si l’on entend résister à ces processus de marchandisation, il convient de commencer, au niveau de la vie quotidienne, par percevoir la place (toujours locale) des humains dans la nature, tout en s’attaquant simultanément aux règles de l’économie de marché globale gravées dans le marbre des traités internationaux. Il ne suffit pas de créer des espaces d’exception où des règles particulières s’appliquent à certaines catégories de populations, sans être respectées dans les jeux de pouvoir, d’argent et de contrôle qui se déroulent à l’échelle globale. Les parcs naturels, réserves environnementales et autres bio-corridors que la communauté internationale crée pour préserver la biodiversité, peuvent sauver quelques plantes de l’extinction totale, mais ne sauraient compenser la destruction continue de notre environnement naturel effectuée hors de ces enclaves au nom du progrès et de la croissance. La notion d’intendance sur la nature (stewardship) s’avère des plus ambiguës si elle est utilisée pour contraindre des peuples indigènes, vivant dans des régions ayant reçu le statut de parcs naturels, à se conformer à des pratiques prétendument « durables », que les administrations gouvernementales et les multinationales de la biotechnologie ne sont pas prêtes à respecter elles-mêmes.
Le défi consiste à articuler la participation intime des humains à leur environnement naturel et social avec un certain degré d’autonomie locale. Cela ne suffit pas à écarter la possibilité d’une marchandisation de la nature, mais cela peut ralentir les processus de destruction et d’exploitation. Sur le plan des idées, au lieu de faire de la nature un concept métaphysique ou une ressource à exploiter, les humains doivent réacquérir la capacité de se penser comme faisant partie intégrante d’un monde naturel qu’ils ne sauraient contrôler totalement. Abandonner l’illusion que l’appropriation de la nature équivaut à son contrôle, et reconnaître la complexité intriquée des systèmes naturels, voilà le premier pas à faire pour quiconque veut agir en leur sein. Cela est particulièrement vrai des ressources génétiques, qui peuvent se reproduire naturellement, muter, et qui ne tombent donc jamais sous le contrôle total des humains. Le deuxième pas en direction d’une capacité à résister à la marchandisation de la nature consiste à comprendre que l’appropriation des ressources génétiques n’accroîtra pas notre contrôle sur la nature, mais seulement la domination et l’exploitation des humains par les humains eux-mêmes.
Traduction de l’anglais et abréviation par Yves Citton