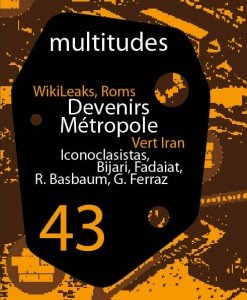« Ce sont des amours particulières que l’on a avec une ville. »
Albert Camus, Noces
Si la ville métropole est le territoire où se joue l’ensemble du nouveau rapport capital/travail, c’est alors aussi le lieu central des conflits et rapports de force qui change dans le passage du fordisme à la globalisation. On essaie ici d’en repérer quelques enjeux à partir de travaux de recherche sur de grands projets urbains en France et en Europe.
Affirmer que la création de valeur se fait dorénavant dans la ville, et non plus dans la seule entreprise, ne désigne tout d’abord pas un simple déplacement des lieux et du sujet dans un antagonisme inchangé, un passage des luttes de la classe ouvrière contre l’usine à celles des multitudes contre la métropole. Les rapports de force se complexifient aujourd’hui en même temps que les richesses créées et les formes d’exploitation mettent en action une nouvelle force productive biopolitique au sens où c’est la vie elle-même qui est mise en productivité. Toni Negri a parfaitement analysé cette ère de subsomption réelle de l’ensemble de la vie, capturée par le nouveau capitalisme et désormais sans plus de dehors, où tout un chacun est emporté dans une imbrication du travail au sein de son existence, dans un espace de flexibilité, d’intermittence et de flux migratoires qui instituent la métropole[1]. Mais ce rapport à la métropole n’est nullement celui de l’usine, ni pour le précaire intermittent mobile ni pour l’auto-entrepreneur ni pour les multitudes d’hommes et de femmes mis en situation de produire de la richesse à chaque moment de leur vie et en de multiples lieux sur cet autre territoire. Et ceci parce qu’ils acquièrent aussi dans cette métropole une nouvelle puissance sans relation avec le simple pouvoir de contestation ouvrière dans l’entreprise. La ville n’a plus rien à voir avec l’usine, tout comme celle-ci était radicalement différente de la fabrique. Le capital change, le travail aussi, et tant pis pour les gens fatigués comme le titre justement Jacques Rancière.
Le libéralisme assimile aussi la métropole à une entreprise où l’espace d’accumulation, d’investissement et de valorisation pourrait désormais s’externaliser dans la culture, l’évènementiel et le spectaculaire de l’architecture. Les maires se posent en entrepreneurs d’un partenariat public-privé qui changerait tout… sauf pour les habitants qui restent usagers ou consommateurs. Les urbanistes ont particulièrement focalisé depuis vingt ans l’analyse de la ville post-fordiste sur le processus d’individuation où seules existent des subjectivités purement individuelles dont la métropole doit gérer au mieux les pratiques. Répondre à « l’individualisme de la demande » qui génère des choix permanents et complexes de formes de consommation démultipliées et imprévisibles devient l’enjeu principal de tout élu dans cette vision. D’où par exemple une constante polarisation sur la mobilité, essentielle à la circulation dans la ville des individus au gré des demandes du marché. Circuler notamment en voiture dans les métropoles du monde devient un véritable droit, une pratique à respecter, comme le proclame l’Institut pour la Ville en Mouvement, créée par feu François Ascher et financée par Peugeot, selon les nouveaux principes de la gestion de la recherche urbaine en France. On retrouve la même focalisation sur la métropole comme espace de mobilité dans les débats autour du Grand Paris qui se trouvent réduits à des batailles financières sur de grands et juteux systèmes de transport, durables bien évidemment ! Là aussi, les désirs citoyens en faveur d’une diminution du transport domicile-travail ou d’un ticket unique sont évacués de ces débats concernant toujours un urbain pour une reproduction de la force de travail tel qu’il a fonctionné pendant la période industrielle. La bataille aujourd’hui est bien d’appréhender les potentialités pour les citoyens du nouveau rapport capital/travail biopolitique sur tout le territoire de la ville où la vie et l’activité productive sont désormais totalement imbriquées.
De l’habitant usager/consommateur
au sujet citoyen
La ville n’est précisément pas l’usine ou l’entreprise parce qu’elle jouit d’un affect, un investissement, une appropriation de chacun sur un territoire de vie qu’il estime sien, celui de sa naissance ou adopté. Ce territoire subjectivé est tout à fait différent du rapport d’extériorité que montrait l’ouvrier d’usine par rapport à la ville. L’ouvrier s’intéressait si peu à l’environnement de la firme qu’il n’accordait pas la moindre importance aux effets de ses productions dans la cité, en termes de pollution par exemple, ni sur les consommateurs en général puisqu’aucun syndicat n’a jamais critiqué le moindre produit. L’emploi primait sur tout et seul un attachement national est proclamé en temps de crise par des organisations ouvrières structurées en branches[2]. L’aménagement du territoire par l’État français qui répartissait à son gré les usines instituait cette négation d’une quelconque contextualisation des compétences. Aujourd’hui, la nouvelle économie de production de connaissance et du vivant basée sur les immatériels qui investit prioritairement coopérations, affects et travail de réseau dans une flexibilité générale, brise totalement ces dichotomies de l’ère industrielle entre production dans la firme et reproduction dans la cité qui fondent malgré tout encore l’institué. Les multitudes d’hommes et de femmes sont tout au contraire intégrées d’emblée (embedded le dit mieux) dans l’environnement et le contexte même de leur ville, dans toutes les dimensions de travail et de vie, c’est-à-dire aussi de transport, de pollution ou de bruit…
Si le salarié d’entreprise était dans la ville un simple usager de services urbains et sociaux, ou un consommateur, aujourd’hui il redevient pleinement sujet de son territoire, dans un rapport d’affect à sa ville. Ce qui n’empêche pas les institutions de continuer leur processus de désubjectivation, analysé par Michel Foucault. Nombre de projets urbains français sont agis par les seuls urbanistes, architectes et experts consultants dont l’énorme production immobilière est souvent une nouvelle forme de désubjectivation autour de non-lieux où la gestion des flux de personnes exclue tout projet ou toute innovation portés par les citoyens du territoire. Ils redéfinissent de nouvelles formes de contrôle − dont la sécurité − au fondement même des projets. Ainsi le projet des Halles de Paris a bien comme base un contrôle biopolitique du quartier, avec objectif affirmé d’y faire revenir les « Parisiens », de « requalifier » le commerce et la clientèle pour contrer « la mauvaise image » des Halles. Mais qui est alors implicitement visé, si ce ne sont les multitudes des banlieues[3] ?.
Les failles de la conception française de la démocratie participative résident dans le maintien à priori des acteurs au rang d’usagers, bons ou mauvais, ignorant les citoyens porteurs de pratiques et de projets innovants pour leur territoire. Car si la Mairie de Paris se vante d’avoir organisé quelques 250 réunions de concertation autour des Halles, il s’agit d’une démocratie « Powerpoint » nullement participative. Simple mise en scène d’un projet avalisé par des cohortes d’experts consultants en urbanisme, elle ne laisse percer aucune des propositions des habitants qui tentent la difficile conciliation de la vie des quartiers avec les pratiques des Parisiens de la métropole. Cette organisation par en haut d’un consensus forcé est en réalité antidémocratique, c’est-à-dire privée des innovations citoyennes et inadaptée aux nouvelles pratiques métropolitaines.
Moit-moit, un concept métropolitain en action
Ainsi, quand la mairie de Paris affirme avec force et conviction en tête de notre travail d’enquête sur les « Jeunes métropolitains aux Halles »[4], que « le projet des Halles s’inscrit résolument dans une politique de mixité sociale et d’ouverture à la banlieue », elle n’a en réalité pas une fois parlé des banlieues dans aucune des nombreuses commissions durant les trois premières années de la concertation pour un projet au cœur même de la métropole.
Pourtant l’analyse des pratiques de ces jeunes montre combien ils sont déjà dans le dépassement du rapport centre/périphéries. Ils privilégient les Halles parce qu’elles sont situées « moit-moit » (moitié-moitié) de leurs divers lieux d’habitat, très fractionnés et éloignés les uns des autres. Moit-moit est bien autre chose que la centralité ou l’équidistance de la fonction transport pour désigner d’abord la qualité d’un lieu dans toutes ses dimensions de rencontre, de capacité festive et de chalandise. Ce concept métropolitain en action dépassant l’ancienne dichotomie centre/périphéries devrait être un point d’alimentation de toute politique publique. Le problème est que ce passage du statut de centre de la capitale à celui de territoire investi des affects de multitudes métropolitaines n’est pas pris en compte par l’ancien centre et par ses institutions. Il exigerait en effet aux Halles des équipements, des espaces communs, que le partenariat public-privé avec la multinationale Unibail refuse de financer. À noter que la plupart des municipalités communistes de l’ancienne « banlieue rouge » sont toutes aussi réticentes à dépasser une coupure qu’elles pensent déterminée politiquement. Élus, bobos et multinationales se retrouvent néanmoins bien minoritaires pour défendre l’institué contre l’ensemble des jeunes métropolitains.
Déficit de démocratie déplorent tous les séminaires et livres sur la démocratie participative en France qui ne considèrent que des usagers d’un espace public désubjectivé, des consommateurs de l’aménagement, en ignorant des sujets riches de leurs différences, capables de nourrir et/ou s’investir dans les projets de leur métropole. Rem Khoolass a souvent souligné cette conception française du contrôle démocratique de l’espace public[5] croisant l’évolution de l’urbanisme mondial pour finir par « une perte terrifiante, renforçant l’évacuation du potentiel de l’aléatoire et de toutes les potentialités de la société pour aller même jusqu’à l’exclusion, la non prise en compte du multiculturel ». Ce constat de la négation de la puissance créative de la société est celui d’un architecte habité par l’esprit du modèle rhénan nord européen. Un regard sur ces villes nordiques nous fait entrer dans d’autres modalités de gestion des conflictualités qui ouvrent sur des approches du devenir métropole.
Faire laboratoire avec les habitants à Hambourg
Notre analyse dans le long terme des villes nordiques d’Anvers, Hambourg, Amsterdam ou Rotterdam montre que les projets n’y sont pas seulement définis comme urbains, mais centrés sur des problématiques de développement de l’ensemble de la ville dans la durée qui permet seule d’intégrer l’urbain à l’économie. Divers types de procédure de diagnostics et de projets mettent ainsi en place des débats citoyens sur les enjeux économiques et urbains certes, mais également sociaux.
Ainsi les dispositifs allemands des IBA (Exposition internationale d’urbanisme qui, malgré leur nom, débattent des projets dans leur ensemble) font travailler de grands noms de l’architecture avec des aménageurs locaux sur des quartiers à recomposer en organisant des bauforum, ateliers ouverts au public. Pour répondre aux questions d’avenir de la métropole, l’IBA de Hambourg développe par exemple l’opération dite Le saut de l’Elbe pour le réaménagement de friches portuaires industrielles sur des îles du fleuve comprenant des quartiers délaissés pauvres ainsi que des espaces verts. Le nom même d’un des projets, Kosmopolis, traduit la volonté de considérer comme se situant au cœur même de la ville la quarantaine de nationalités de 55 000 personnes y vivant. L’idée de penser la métropole de demain comme une ville cosmopolite en posant explicitement la question : « comment faire de la diversité une force ? »[6] tente de casser les frontières dans la ville par une réarticulation des mondes actuellement isolés du centre et des périphéries. Une valorisation des différentes cultures est au centre des actions pour le redéveloppement des quartiers. Les questions sont abordées avec les habitants, tant pour faire un « projet exemplaire de vie interculturelle » pour des lotissements dans le Weltquartier (quartier du monde) que pour monter des projets de formation par « Die neue Weltclasse – Bildungsoffensive Elbinseln » (la nouvelle classe du monde – une offensive de formation sur les îles de l’Elbe) pour intégrer les enfants.
Cette démarche d’intégration urbaine, économique et sociale est cohérente du contexte de la mondialisation avec la forte présence d’étrangers, tant cadres qu’immigrés pauvres, dans ces villes portuaires, villes monde qui attirent des gens de partout. Si Kosmopolis a un sens c’est bien dans la tentative de dépassement des frontières dans la ville (cf l’article de Saskia Sassen) entre les différentes populations à l’occasion des nouveaux projets. Sans cela, la montée de la xénophobie ne peut que s’affirmer aux élections de Hambourg comme d’Anvers qui sont aux avant-postes des questions de la mobilité dans la mondialisation en tant que villes portuaires. L’objectif est ici posé et intégré dans le dispositif de débat, c’est déjà beaucoup, et participe de l’affirmation des intérêts des acteurs locaux face aux multinationales présentes dans tous les projets de ville et face aux mécanismes de la rente foncière. L’objectif général de ces dispositifs est bien de faire la métropole du XXIe siècle, de faire de l’immobilier, comme partout, mais dans une perspective de construction d’un commun intégrant la dimension des affects, représentations et cultures mais aussi des tensions existantes.
On est en présence d’un processus démocratique plus délibératif que simplement participatif qui mixe la discussion des projets entre concepteurs et population avec des interventions d’experts internationaux, d’élus et de représentants d’entreprises et organismes de la ville dans ces « ateliers d’idées ». La dimension festive de ces bauforum avec interventions d’artistes qui prévoient toujours des agapes autour des débats et présentations de maquettes est caractéristique du sentiment d’appartenance à un même territoire commun voulu par ces processus. Le long terme est aussi central dans ces processus évolutifs puisque l’expression des conflits s’affirme dans de multiples débats, notamment dans la presse locale, où se redéfinissent les enjeux. Contrairement aux dispositifs participatifs contraints sur un temps court, ils ne sont pas considérés comme des coûts mais, tout au contraire, comme directement productifs pour la gouvernance locale.
Anvers s’est aussi imposée le temps de la réflexion et du débat pour réinvestir ses friches industrielles et portuaires au cœur de la cité, alors que la plupart des villes portuaires d’Europe se précipitaient dans la logique libérale des opérations immobilières des années 90 qui recréaient de nouveaux zonages et frontières sociales. La ville portuaire d’Anvers attend 2006 pour engager l’ensemble de la ville dans un master plan[7] intervenant sur plusieurs quartiers, avec consultation des habitants. Un nouveau musée du fleuve à l’interface ville/port des anciens quartiers portuaires présente la ville portuaire ouverte sur le monde dans toutes ses dimensions économique, culturelle, polyglotte aux yeux de monde et de ses propres citoyens, les enfants des écoles en premier, qui sont tous mobilisés pour comprendre Anvers dans la mondialisation, depuis les imprimeurs Plantin de la Renaissance jusqu’aux actuels manutentionnaires d’Asie. Les conflits sont vifs sur les espaces concédés à la promotion immobilière ou au portuaire. Les nouvelles tours d’habitation de luxe de l’ancien quartier portuaire de Montevideo semblent ainsi ignorer ses anciens habitants des milieux populaires. Mais ceux de Doel sur la rive gauche résistent depuis longtemps aux nouveaux bassins qui devraient les remplacer, en invoquant d’abord la question environnementale puis, directement, la question économique des activités et du type de développement. Les dissensus toujours exprimés par les citoyens de ce port municipal concernent à présent le développement de leur territoire de vie et de travail. Dans le même type de démarche, l’exemple de Berlin montre aussi que les grandes architectures spectaculaires ne suffisent pas pour instituer une ville monde ou européenne, lorsque le processus de démocratie reste bloqué par l’emprise immobilière des multinationales, ainsi que lorsque ses objectifs de fonder un noyau historique ne correspondent à aucune réalité[8].
Barcelone est en ce sens significative d’un enjeu démocratique toujours à réinventer.
Barcelone et la question du modèle
Le processus de planification stratégique mis en place dès la fin des années 1980, dans le contexte de la transition démocratique de la fin du franquisme et de l’entrée dans la Communauté européenne, à la faveur des Jeux Olympiques, a représenté pour la ville un moment de mobilisation et de mise en valeur de ses forces locales. Outil de réflexion et d’action sur l’avenir de la ville[9], la planification se fonde tout au long des années 90 sur une affirmation de la primauté de la dynamique publique, en réaction à la conception immobilière spéculative anglo-saxonne dominante du moment. Les maîtres mots de la démarche sont mobilisation et débat. Mobilisation d’une multiplicité de groupes et commissions sur la question du nouveau développement de l’ensemble de la métropole. Débat sur le long terme entre tout un ensemble d’acteurs, architectes, urbanistes, mais aussi universitaires, artistes, responsables d’associations…, sur les orientations stratégiques avec les responsables des principales institutions économiques et politiques. On doit aussi souligner que la plupart de ces interventions des citoyens catalans pour les plans stratégiques ont été à titre gratuit. Cela aboutit à une recomposition de quartiers populaires comme la Barceloneta mixant population locale liée traditionnellement au port et nouveaux habitants de la classe moyenne. La création de longues plages publiques et le maintien de beaucoup des occupants dans les habitats rénovés brisent la logique des expropriations massives des villes américaines ou des Docklands de Londres qui avait dominé toute la décennie, et montrent la possibilité de garder une mixité sociale dans le centre par une maîtrise foncière donnant priorité aux espaces publics. En même temps, cette dynamique de recomposition urbaine a été conjuguée avec une ouverture économique liant le développement régional à la mondialisation avec notamment un fort investissement logistique autour du nouveau port et de l’aéroport. Bien au-delà des analyses dominantes en termes de communication, Barcelone nous semble surtout représenter un exemple privilégié de la ville productive post-fordiste dans ses capacités de mobilisation de toutes les forces et les affects de la cité pour composer une métropole du sud de l’Europe.
Mais Barcelone montre bien également que ce processus constituant d’ordre démocratique en évolution constante est toujours sur la brèche jusqu’à pouvoir être remis en cause quand l’Espagne toute entière est prise par la fureur immobilière des années 2000 libérant projets spéculatifs et corruption. Barcelone démontre aussi le rôle central du moteur démocratique inventé en permanence selon chaque métropole qui remet en cause son idée de modèle exportable[10]. Quand la ville a voulu vendre son modèle en Amérique latine comme alternatif aux waterfronts des anglo-saxons, sa dynamique démocratique constituante, difficilement reproductible, est bien apparue essentielle. Depuis 1995, la société carioca s’est ainsi révélée incapable d’utiliser le modèle barcelonais chèrement acquis pour restructurer des friches industrialo-portuaires en plein centre ville. Ne sont encore prévus en 2010 que quelques aménagements ponctuels financés par de grands évènements mondiaux à venir, mais sans planification publique d’ensemble. C’est que les processus complexes de mobilisation des acteurs locaux débattant des projets stratégiques sont impossibles dans une ville où une minorité blanche monopolise brutalement les rentes de l’État central.
Il n’y a pas pour les villes de modèle démocratique type ; quoiqu’en disent tous les experts de best practices, les IBA/bauforums de Hambourg ou le plan stratégique de Barcelone ne sont pas reproductibles ailleurs tels quels. Dans chaque ville doit se construire un processus démocratique, avec ses dissensus (Jacques Rancière), ses modes de gouvernance très divers et spécifiques de la subjectivité locale, c’est-à-dire de son histoire et de ses pratiques.
La gouvernance est ainsi un processus permanent d’invention et de transformation, très au-delà des normes des sciences politiques. Comment rendre productifs, pour un territoire agi comme commun, les dissensus exprimés par des points de vue différents est un processus long et complexe au sein de chaque cité.
Territoire commun et développement durable
Au-delà de la réduction de la démocratie à une participation informative aux décisions du pouvoir local, un nouveau type de rapports sociaux se joue dans la métropole, fait à la fois de nouvelles formes d’exclusions et en même temps d’inclusions citoyennes revendiquées. Se met ainsi aujourd’hui au centre de tous les débats la question de la durabilité des projets.
Si le développement durable apparaît bien comme un nouveau récit de légitimation politique de tout projet, c’est en même temps un outil d’intervention sur la question de la production d’un territoire que les habitants vivent comme un commun, avec ses représentations, ses imaginaires. Le verni vert de tout projet, obligé tant par les lois que par l’idéologie dominante, présente l’intérêt réel de légitimer l’intervention de tout citoyen quel qu’il soit, rompant avec l’institutionnalisation antérieure des rapports entre syndicats et patronat dans l’usine ou entre associations de quartiers et municipalité. On sait depuis longtemps l’importance du débordement des formes de négociations traditionnelles, et plus récemment celui des coordinations et mouvements associatifs, mais ce dépassement se généralise désormais dans l’ensemble du territoire de la ville.
La fameuse classe dite créative, motrice désignée d’interventions sur les quartiers, ne peut à elle seule être porteuse d’innovations qui ne s’agrègent concrètement qu’à travers les interactions, les « pollinisations » diront certains, de toute une chaîne d’acteurs. C’est l’ensemble de la classe moyenne qui se trouve en situation de parler directement de sa ville, ainsi que les gens moins intégrés, précaires et mobiles qui trouvent là ensemble non pas un espace, mais bien un territoire investi d’interventions. Un mélange de populations de milieux sociaux différents, ayant souvent des intérêts différents voire divergents, mais mobilisées sur leur territoire commun. Le changement est dans cette territorialisation où s’intriquent intérêts et affects au-delà de tout intérêt général transcendant.
Face à cette émergence, les imposants dispositifs participatifs d’État ne font guère que prolonger les antagonismes de l’époque fordiste. Mes contributions à deux processus de concertation dit de Grand Débat Public au Havre − Port 2000 et projet de canal fluvial (2010) − m’ont révélé ce dispositif comme un instrument de promotion grand public de projets entièrement contrôlés par le maître d’ouvrage qui ne laisse pas la moindre place à des solutions alternatives portées par d’autres acteurs. Ceux-ci se retrouvent toujours placés dans un rapport antagonique. Des « écolos » voulant préserver « des petits oiseaux » et d’autres sites « dits naturels » ou encore des « nimby » toujours contre tout changement s’affrontent sans la moindre utilité à des ingénieurs « bétonneurs » promouvant l’intérêt général. L’affluence aux nombreuses réunions révèle pourtant un fort désir de démocratie pour débattre de l’avenir de la ville. Le processus de participation au projet de rénovation des Halles montre la même minoration des citoyens quand une multinationale s’implique dans le partenariat[11].
La question est bien aujourd’hui de dépasser l’approche hard ingénieuriale qui accepte dorénavant de discuter des effets des infrastructures mais pas de leurs bien fondé ou de leurs formes. Or c’est toute cette logique massive de l’époque industrielle qui est aujourd’hui interrogée par les citadins. Repenser les logistiques routières qui tuent toute urbanité dans certains quartiers, innover des modes plus doux, penser des densités plus stratégiques que quantitatives (Saskia Sassen), penser des localisations plus décentrées rendues possibles par le numérique…, tout cela permet de transformer le rapport centre/périphéries dans la ville. D’où le glissement des luttes sur un front économique et sociétal, en termes d’écologie politique qui aborde la ville. Il ne s’agit plus d’un choix entre infrastructures et environnementalisme mais du type de développement même de la métropole et de ses territoires. On est ici à l’opposé des nouvelles méthodes de modélisation numérique de planification urbaine, y compris des écosystèmes, adoptés aujourd’hui par les grandes agences de construction et d’architecture, particulièrement dans les villes chinoises. Ce passage direct de la planification étatique à la numérisation globale écarte toujours la ville en tant que territoire créatif.
Dans toute l’Europe, des citoyens ont prétention à intervenir sur les projets d’aménagement de leurs villes et construisent alors des dispositifs de contre-expertise pour débattre de tous les projets sur leur territoire commun. Ce sont ces affirmations et interventions citoyennes qui engendrent des innovations et des synergies autour de la durabilité de la ville. De nouveaux rapports entre les acteurs transforment ainsi le traditionnel affrontement de classes en le transposant dans un territoire commun émergent qui génère des alliances, des coopérations, autour de projets territorialisés. C’est cette nécessité de partager un territoire qui n’est pas un simple lieu pour produire mais aussi, surtout, un espace commun de vie, qui, suscite une dimension bio-politique d’affects vis-à-vis d’une métropole commune qui renouvelle considérablement les rapports sociaux. Ces nouvelles actions pour une ville durable sont la partie la plus visible d’une nouvelle conflictualité qui vise alors directement l’émergence d’une gouvernance démocratique dans la métropole.
Dans l’optique du devenir métropole, « Il faut défendre la société » implique donc d’investir tout le territoire métropolitain comme un commun politique, économique et écologique, du plus petit interstice à ses grands pôles. Pour ne pas laisser un nouveau capitalisme vert s’instaurer seul, envers et contre la société, c’est la manière privilégiée de permettre la concrétisation des visions alternatives des créativités citoyennes.