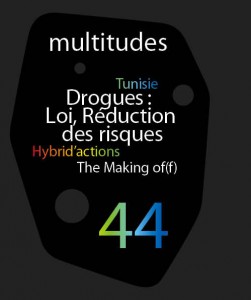Depuis 30 ans, l’Anitea (Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie et Addictologie) met au cœur de sa réflexion l’usager de drogues en tant que citoyen. Elle associe une prise en compte de l’individu et sa reconnaissance comme sujet social.
Pour s’imposer, la Réduction des risques s’est appuyée sur des éléments de santé publique, sur des enjeux de population. Cette complémentarité entre une approche globale et une approche centrée sur la personne a d’abord été source de difficulté avant qu’un réel travail de partenariat ne permette d’atteindre une conceptualisation commune.
Une culture addictogène
La société addictogène n’est-elle pas une évidence ? De la perte des repères collectifs à l’exacerbation du sensoriel et du pulsionnel, elle démultiplie les opportunités de pratiques addictives, notamment à l’adolescence. Le passage d’un individualisme de la liberté à un individualisme de la marchandise (Le Breton) recoupe la désagrégation des encadrements collectifs et la démultiplication des modèles d’existence qu’évoque Gilles Lipovetsky. Cette mutation a détruit les repères, les ancrages communautaires, atomisé le social et le contrôle collectif, accentuant un sentiment d’insécurité identitaire et le besoin de recréer l’appartenance perdue en s’identifiant à des communautés, des groupes.
Ce mouvement a été accentué par une culture de l’hyper, de l’hédonisme, du surchoix consommatoire et la promotion de la réponse « technique » jusqu’à aboutir à l’actuel paradoxe qui voit cette société du dérèglement de soi faire du sujet contrôlé, autonome et responsable, le personnage central des politiques de santé publique, sensé être capable d’user sans abuser, de jouer de façon raisonnable, de manger sans hypermanger ou de boire avec modération.
Ce paradoxe est au centre de la réorganisation des réponses aux pratiques addictives qui impliquent des compétences à l’autocontrôle, acquises ou non par l’éducation. Il explique pour beaucoup l’actuelle spirale d’une politique pénale sanctionnant de plus en plus sévèrement un sujet de moins en moins apte à résister aux sollicitations externes et impulsions internes, et procédant à une judiciarisation de l’intime pour compenser, en vain, la dissolution symbolique et collective ! Il justifie l’évolution des approches en prévention et la rénovation de stratégies de soins qui développent l’aspect de modelage du comportement et organisent un accompagnement de l’individu associant les acquis de la réduction des risques aux pratiques des acteurs pour redonner à la personne les compétences nécessaires.
L’affaiblissement des cadres collectifs est exemplaire d’un mouvement qui valorise l’individu et le pousse hors du chemin balisé par les normes et interdits. Ce changement du rapport entre contraintes sociales et autocontraintes individuelles met en péril le vivre ensemble.
Le moteur avait su alléger l’effort musculaire, les nouvelles technologies, tout en ouvrant de nouvelles opportunités, désirs et envies, se substituent, pour tout ou partie, aux compétences psychiques : les ordinateurs à la mémoire, le GPS au sens de l’orientation, les alertes et alarmes diverses à l’attention et le contrôle ne se fait plus par un regard réciproque, mais par bracelets, puces et autres caméras… Cette évolution simplifie les activités humaines, mais elle efface les repères et limites du « connais-toi toi-même », affaiblissant encore plus la maîtrise des expériences chez un sujet qui ne supporte plus la frustration de la limite. La société de l’hyperconsommation donne aux individus l’envie et la possibilité de consommer des objets, des pratiques, des produits : drogues licites et illicites, jeux d’argent, alimentation… Elle interroge la question d’un « sujet désirant » à qui on vient proposer le modèle du « je consomme donc je suis ».
Le « marketing-désir » provoque une sur-sollicitation consommatoire qui éloigne l’acte d’achat de la satisfaction du besoin fonctionnel, le « dématérialise » au profit d’un accès à un stade supérieur d’équipement. Par exemple, le paradigme du jetable et de l’usure de l’objet par obsolescence « technique » induit son renouvellement rapide. Pour Serge Bauman, ce « consumérisme ne concerne pas la satisfaction des désirs, mais l’excitation du désir, de toujours plus de désir». L’enveloppement audio-visuel par des objets nomades, casques et autres MP3, la démultiplication des sources sonores et visuelles, insuffle une énergie destinée à positiver le réel. C’est un adjuvant de l’activité cérébrale, une sorte de « camisole des sons et d’images », un « antidépresseur » par stimulation permanente. Il favorise des conduites « d’évitement », en créant des bulles a-conflictuelles : le casque sur les oreilles évite d’entendre les parents mais aussi le public, les critiques etc.. Les écrans allumés captent les regards mais évitent de voir. De même, l’excès sensoriel se décline de multiples façons : la vitesse, devenue banale, comme l’intensité des univers « hyper-sensoriels » des jeux sur consoles, celle des attractions des parcs du même nom, les effets sonores et effets spéciaux, leur effet de saturation sensorielle d’un nouveau spectateur devenu hyper-consommateur, ne supportant ni temps morts ni attente ni « descriptions ». Il demande toujours plus d’émotions, de sensations pour ressentir sans cesse, il devient « un néo-spectateur qui a besoin de s’éclater, qui cherche à se défoncer en images, à éprouver l’ivresse dionysiaque de s’arracher à soi et à la banalité des jours » (Gilles Lipovetsky). Et les études (Bajos et Bozon) qui montrent les liens établis chez les garçons entre un usage de l’alcool supérieur à la moyenne et une consommation régulière d’images pornographiques vont dans le même sens : l’intensité appelle l’intensité.
L’humain rencontre donc un environnement plus addictogène que les précédents. Il ne s’agit pas de lui opposer un refus, de condamner le progrès au nom de la nostalgie d’une société autrefois idéale et d’une posture morale abstraite. Alors que tout concours à instaurer cette culture de l’excès et du sans limite, il convient de souligner la fuite en avant qui consisterait à confier au seul progrès technologique et/ou chimique la responsabilité de contenir les excès qu’il provoque et les nécessaires adaptations des réponses éducatives et thérapeutiques. La réponse centrée sur la technique (radars, bracelets, vidéosurveillance mais aussi automate, médicament…), quand elle se substitue à l’éducation au lieu de l’étayer, risque d’en augmenter la déqualification. D’autant qu’en symétrie, d’autres « techniques » peuvent servir à « justifier » les pratiques d’excès, comme les boissons antifatigues ou celles qui diminueraient les effets de l’alcool, dans une course absurde effet/contre-effet dont les poly consommations illustrent l’actualité.
De même, la réponse basée sur la morale, écartant par exemple le préservatif au nom de l’abstinence et/ou de la fidélité, refusant le traitement de la douleur et le médicament au nom d’une vision « naturelle » de l’humain, récusant l’éducation sexuelle et la contraception est inacceptable et inadaptée. L’expérience des sevrages sans médicaments a conduit à l’enfermement sectaire et aux pires expériences collectives[1] !
C’est la capacité à articuler une éducation préventive, respectueuse du sujet dont elle cherche à augmenter les compétences tout en contenant le pulsionnel, et une utilisation adaptée des techniques qui est au centre des réponses d’accompagnement.
La Réduction des risques, une histoire singulière
Explorer « un autre monde… », refuser une culture de la consommation étaient au cœur de la révolte de 68, générant un contexte de panique qui fut à l’origine de la loi du 31 décembre 1970 : l’usager de drogues sera malade et/ou délinquant. Face à une tentation réductrice de la question de la toxicomanie, Claude Olievenstein va proposer une approche multidimensionnelle, popularisant la conceptualisation d’une rencontre entre un produit, une personnalité et un contexte socioculturel. L’ordonnancement du soin se construit autour de la reconnaissance de la personne du toxicomane, en tant que sujet, mais reste centré sur l’objectif du sevrage et de l’abstinence induit par la loi de 70.
Les années 80 et l’épidémie du virus du SIDA vont mettre au premier plan la question de la contamination, notamment entre les personnes toxicomanes. Elles vont faire sortir du standard unique du sevrage et de l’abstinence et entraîner une nécessaire médicalisation du système de soin (prise en charge de la maladie, substitution). Mais plus spectaculairement, elles vont placer les usagers, en tant que citoyens, aux côtés des médecins pour parler et agir. Cette politique se déploie sur fond d’une évolution parallèle de la santé publique. Née du souci des épidémies, elle va s’intéresser aux risques des styles de vie (manque d’exercice physique, obésité, exposition au soleil et donc usage de substances). La santé « n’est plus un droit individuel, elle devient un devoir » qui nécessite de faire les « bons choix » (Bergeron, 2010) et donc d’éclairer les décisions des personnes.
Concernant les questions d’addiction, deux facteurs sont le plus souvent évoqués : la souffrance psychique et la délinquance.
Deux facteurs essentiels sont souvent négligés : le plaisir qui motive et/ou résulte de l’expérience d’usage ; l’impact du sociétal et des inégalités sociales. Les inégalités de santé, les conditions socio-économiques et solidarités collectives orientent les croyances et motivations des comportements, expliquant que les populations défavorisées privilégient plus l’acquisition de biens matériels ou symboliques que la préservation du capital santé. Le contexte sociétal de la société addictogène, plaisir/bonheur par surconsommation et sacralisation de la réalisation immédiate des désirs, disqualifie les valeurs qui fondent les campagnes de prévention et d’informations. Cet individu, prétendument autonome, n’est bien souvent que le jouet de la marchandise et d’une consommation de masse. Il n’est pas plus en harmonie avec les notions de responsabilité et de modération que la culture du jetable ne l’est avec celle du durable.
La logique de la santé publique et la prise en compte de l’usager en tant qu’expert vont guider les grandes étapes aujourd’hui bien connues d’une mise en œuvre de la Réduction des risques qui va considérablement rénover les pratiques de soins, ouvrant à de multiples pistes : l’outreach (aller vers l’usager) à la place de l’attente de la demande, la sortie du standard unique du sevrage etc.
Ainsi, le récent projet « Un chez soi d’abord » (Housing First) repose en priorité sur le rétablissement de la personne, au plan social, citoyen et existentiel et pas seulement biologique. Il s’agit de permettre à des personnes durablement sans abri, présentant des pathologies mentales et des problématiques d’addiction de pouvoir se sentir à nouveau pleinement inclus dans la société. Les problèmes sociaux sont le premier niveau d’intervention, et la première résolution (celle du logement) doit permettre à un sujet de se rétablir, en étant considéré là où il est, là où il en est.
La Réduction des risques a initié ce type d’approche, fondée sur un empowerment : les usagers se montrent capables de mobiliser leurs ressources pourvu qu’on les pense fondés à les mobiliser. Il s’agit donc de faire le pari sur la capacité de la personne à évoluer, à changer, à agir.
Le sujet devient acteur de son propre rétablissement, qu’il s’agisse de soins psychiatriques, de prise en charge des addictions, ou de l’insertion dans le tissu social.
Cette approche est le fondement de la politique de Réduction des risques et des dommages, qui a montré son efficience au plan national sur les problématiques de santé et de délinquance liées aux usagers de drogues. Elle a aussi un impact sur les pratiques en psychiatrie et sur les actions dans le champ de la précarité.
La mise en vente libre des seringues, sujet tabou auparavant sera la première mesure phare. Elle attise les oppositions, et ce n’est qu’en 1987 que Michelle Barzach obtient par décret cette possibilité. Le principe qui vise à réduire les risques liés aux usages de drogues est ainsi admis, mais il est surveillé comme un possible cheval de Troie de la dépénalisation. Et chacune des mesures suivantes devra être « arrachée » à cette même hostilité de principe. Un autre axe que celui la loi de 70 et sa pénalisation de l’usage va expliquer d’autres résistances et critiques, notamment pour certains intervenants en toxicomanie : ils y voient une tentation de nier le toxicomane en tant que sujet. La Réduction des risques pouvait apparaître comme une « technè », avec ses matériels (seringues, kits…), un outil hygiéniste, privilégiant l’usage face à l’usager. La logique pragmatique, praticable et mesurable de la Réduction des risques fait qu’elle privilégie le travail sur des risques quantifiables et physiques, sur les axes de la santé et de la sécurité publique : préservation des corps, gestion des usages, pacification des espaces publics. Ses résultats positifs sont connus : baisse des overdoses, des contaminations VIH-VHC, meilleur accès aux soins.
En 1995-1996, la généralisation des Traitements de Substitution aux Opiacés (TSO), avec le déploiement de la méthadone et de la buprénorphine va donner lieu au même débat, avec les mêmes interrogations et hésitations, mais d’une part encore plus réduite des acteurs. Très vite chacun peut constater qu’il s’agit d’une action qui s’adresse au sujet, en prenant en compte ses différentes dimensions, dont celle de ses pratiques, de ses usages. La création de lieux d’accueil à seuil adapté pour les usagers de drogues, « les boutiques », dès 1993, avait montré qu’elle était aussi l’occasion d’une rencontre, d’un lien, d’un échange dans lequel le sujet est reconnu, pris en compte.
Lorsque la Réduction des risques va être inscrite dans la loi de Santé Publique de 2004 qui maintient la pénalisation de l’usage, elle y gagne une légitimité « sanitaire », mais avec le risque d’être enfermée dans une approche hygiéniste restrictive. Ainsi réduite à une approche mécanique, qui éviterait de rencontrer l’intime de l’usager et de le confronter au changement possible, elle se voit alors accusée de créer des ghettos, d’être un abandon de l’intentionnalité de soin, parfois par ceux-là même qui l’ont ainsi limitée…
Puis l’addictologie s’installe…
Si l’on reconnaît que les addictions sont partout autour de nous, et pas seulement dans les drogues, lancer la réflexion sur comment vivre et grandir parmi les addictions devient une priorité. Entre soigner et punir, on comprend aisément qu’une troisième voie est indispensable, associant réduire les risques et éduquer, intégrant la dimension citoyenne et la dimension d’experts des usagers. Elle illustre ces réponses tout à la fois diversifiées et graduées que recommande la récente expertise collective de l’INSERM et marque un aboutissement de la notion « d’accompagnement » centrale dans l’action des CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) et des CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues).
La période récente a été marquée par la mise en avant du concept d’addictologie qui rend poreuses les frontières entre drogues licites et illicites et suscite une forte rénovation des pratiques. Des thématiques comme le repérage précoce et l’intervention brève vont s’ajouter à celles du sevrage et du soin résidentiel, des dispositifs nouveaux vont voir le jour à l’hôpital, notamment les équipes de liaison qui vont développer une réponse transversale. D’autres réponses seront proposées : l’intervention précoce, qui adapte à la prévention la notion de seuil adapté qu’avaient élaborée les pionniers de la Réduction des risques avec les Bus méthadone. L’éducation expérientielle va pour sa part intégrer une large part de la reconnaissance de l’expertise de l’usager et de la prise en compte de l’expérience d’usage. Ainsi, ce qui fut à un moment une opposition frontale Réduction des risques /soins, CSAPA /CAARUD devient un laboratoire des pratiques nouvelles, avec la même volonté d’accompagner l’usager, de lui permettre d’avancer.
Mais dans ce contexte addictologique, la Réduction des risques se trouve confrontée à de nouveaux enjeux pour ne pas perdre son originalité. D’abord préserver le droit d’expérimenter, de faire évoluer ses pratiques à partir de l’expertise et de la réalité du terrain. La période récente invite les acteurs à se poser de nouvelles questions dans un contexte en évolution. Mais la politique publique tend à imposer un modèle descendant d’élaboration des réponses. Des arbitrages sont rendus et des choix sont effectués en fonction « d’indicateurs sensibles » et bien visibles, dans un contexte de contrainte budgétaire. Les actions sont décidées puis évaluées sur le registre de la performance et de l’efficience, c’est-à-dire un rapport coût-efficacité. Comme le montre l’exemple des Centres d’injection supervisée, expérimenter n’est pas acquis ! Ensuite, développer l’éducation thérapeutique concernant les comportements à risque, comme avec les programmes d’éducation au risque infectieux. L’éducation thérapeutique regroupe des pratiques favorisant l’acquisition de compétences permettant de prendre en charge activement la maladie, les soins et leur mise en œuvre au quotidien, en partenariat avec ses soignants. Elle prend donc place dans l’accompagnement des personnes dépendantes dont elle partage de nombreux principes et valeurs : responsabilité (partage de la responsabilité thérapeutique soignant/soigné), respect, autonomie, équité, accessibilité. Elle reconnaît l’importance d’un support social de qualité dans la gestion d’une affection « chronique ». Elle connaît un début d’application dans le cadre des traitements de substitution des opiacés et des traitements de l’hépatite C. Il s’agit d’une co-éducation patient-soignant qui doit intégrer le savoir acquis par le patient dans son contexte psychosocial et répondre aux difficultés qu’il rencontre avec son traitement dans sa vie quotidienne qui ne devrait pas être réduite à une simple « éducation du patient ». Les associations de patients tels AIDES, SOS-hépatite ou ASUD sont particulièrement actives et impliquées dans la diffusion de ces compétences.
Dans les années 80, les usagers aidés par des acteurs nouveaux ont bouleversé les politiques publiques instaurant une approche transversale dans laquelle la parole, la singularité et la trajectoire étaient entendues, reconnues et prises en compte par le médical et le politique. De nouveaux besoins, de nouvelles approches, de nouvelles pratiques ont été ainsi élaborées pour endiguer l’épidémie du SIDA. L’usager était reconnu au titre d’expert dans un formidable progrès en termes de santé publique. Aujourd’hui cette parole est circonscrite dans un espace institutionnalisé, organisé et contrôlé. Dès lors, ne risque-t-elle pas de perdre sa capacité à faire valoir des besoins « invisibles et pourtant bien réels » ?
Il restera à rénover la loi de 70. À la veille de la 18e conférence internationale sur le SIDA de Vienne, l’International AIDS Society, soutenue par les principaux centres de recherche et de lutte contre le SIDA, lançait un appel pour que soit reconsidérée l’approche répressive de la politique mondiale sur la drogue, qui concourt de manière dramatique à la propagation du virus du SIDA.
Pour l’Anitéa, c’est dès 1996 que nous nous sommes battus pour sortir de la logique de la loi de 70, et aujourd’hui, la mise en commun des apports des différents acteurs concernés permet que s’élaborent ces pratiques transdisciplinaires, adaptées à la complexité humaine. L’accessibilité aux TSO, au matériel de Réduction des risques, pour tous les usagers, en tous les lieux, doit nécessairement continuer d’être améliorée, sans pour autant réduire l’usager à son seul statut de consommateur de traitement et de matériel de Réduction des risques, dépossédé de la responsabilité de ses choix. Substituer un traitement à une substance ne doit plus faire question, substituer l’éducation par un traitement ne doit pas plus faire illusion ! Si le dispositif de soin doit répondre aux besoins des populations, l’intervenant, qu’il soit médecin, psychothérapeute, travailleur social ou un pair, agit aussi dans le singulier de la rencontre. C’est donc avec cette double volonté, de promouvoir les compétences humaines et les outils nouveaux que les premières objections faites à la Réduction des risques ont pu être dépassées, intégrant le « step by step » dans l’accompagnement d’un usager vers une reconstruction de son autonomie.