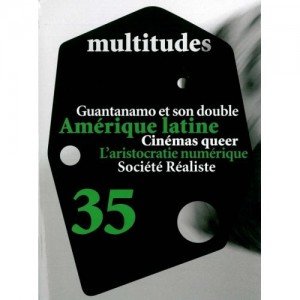Nous publions ici la communication donnée par Juliane Rebentisch à l’occasion d’une conférence internationale intitulée « Aesthetics and Contemporary Art » (13-14 mars 2008), organisée par le Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP) de l’université Middlesex en collaboration avec le centre de recherche « Aesthetic Experience and the Dissolution of Artistic Limits » (SFB 626) de l’Université Libre de Berlin.
Au cours de la lecture récente d’un petit manifeste esthétique d’Alain Badiou (1) qui a reçu une reconnaissance importante dans la scène intellectuelle berlinoise, je me suis surprise à en rejeter chaque argument, ou presque, mais cela m’a néanmoins inspirée à présenter ce que je veux dire aujourd’hui comme une réponse à cet essai, et sous la forme, en quelque sorte, d’un contre-manifeste. Un contre-manifeste non seulement parce qu’il est en général plus ludique d’articuler des thèses possibles sur l’« Esthétique et l’art contemporain » de façon apodictique et machiste (2), mais aussi parce qu’il est stimulant d’essayer de mettre cela en œuvre de façon à contrer ces revendications érudites à l’universalisme, à la vérité, et à l’abstraction redevenues si désirables par la tendance d’aujourd’hui et (de façon peu surprenante) surtout au sein des jeunes intellectuels de sexe masculin. Il y a maintenant des lustres, s’approprier un style pour contrer les contenus qu’il semblait originellement supporter relevait d’une compétence nécessaire pour rédiger des manifestes féministes. Peut-être est-il temps de mobiliser à nouveau cette tradition, cette fois-ci dans le champ de l’esthétique.
Le manifeste dont il m’importe de réfuter les thèses se prononçant pour un mouvement que Badiou nomme l’« affirmationnisme », le mien prendra la forme de sept négations programmatiques (ce geste marquant bien évidemment ce qui suit comme développement secondaire, comme réponse – ce qui en soi est un peu moins machiste mais, comme je l’espère, non moins apodictique). Il apparaîtra que les négations en question s’adressent aux idées maîtresses de l’esthétique moderniste et de la théorie de l’art. Badiou met en effet en œuvre la répétition d’idées paradigmatiques pour la théorie dudit high modernism, qui a connu ses plus grandes heures dans les années 1950. En conséquence, Badiou veut affirmer ce qu’il appelle le « grand XXe siècle », et tous ses héros artistiques sont des icônes modernistes : Picasso, Schönberg, Brecht, etc. Tout cela fait de Badiou un adversaire intéressant dans le contexte de cette conférence, et spécialement à l’égard des conférenciers présents ici même, qui considèrent les conceptions esthétiques à l’horizon de la dissolution des limites artistiques, et donc d’un développement qui depuis les années 1960 est devenu critique au sens où l’esthétique moderniste et la théorie de l’art n’arrivaient plus à prendre en charge ses différentes manifestations artistiques, sauf à les considérer comme symptômes d’un déclin. Si l’on voulait formuler cela en termes badiousiens, on pourrait dire que les champions du modernisme ont manqué de saisir l’importance des « événements » en question pour toute la « situation » de l’art. Loin de se ranger dans le camp de ceux dont la théorie se développe en une « fidélité » à ces événements, Badiou est quoi qu’il en soit du côté des modernistes. Mais il n’y a pourtant rien à y redire, Badiou nous faisant la faveur de mettre à jour le paradigme moderniste, rendant visible en une forme actualisée ce que je tiens pour être en jeu dans les dissolutions mêmes des limites artistiques, sur un plan esthétique et politique.
1. L’art n’est pas circonscrit par les catégories traditionnelles de l’art
En rejetant les productions multimédia comme « la projection de l’obscène uniformité du commerce dans l’art », et en optant pour la diversité relative des formes traditionnelles de l’art, Badiou réhabilite un motif de la théorie moderniste de l’art présent de Greenberg à Fried et Adorno. Fondés sur la présupposition que la production d’art autonome dépend de l’exploration de la spécificité des médiums propre aux arts individuels, tous ont insisté, selon des orientations bien sûr différentes, sur le fait que l’art ne pouvait obtenir son entière signification qu’au sein même des arts individuels. En conséquence, tous ont critiqué les productions intermédiaires en tant qu’elles auraient engendré la perte de l’idée de spécificité du médium – et cela a bien sûr mené aux reproches d’une prostitution de la différence de chaque forme individuelle d’art, mais aussi de la différence de l’art en tant que tel, ou en d’autres termes son autonomie.
Dès lors, en premier lieu, l’accusation portée aux productions « intermédiaires » au titre d’une perte de l’idée de spécificité du médium est fondée sur une identification erronée de la spécificité du médium avec celle des catégories traditionnelles de l’art. Les premières manifestations d’une pratique « intermédiaire » montrent cependant avant toute chose que la réflexion sur la spécificité du médium mène par elle-même à un point où une forme particulière d’art s’indistingue avec une autre. Pensons aux qualités graphiques du mot imprimé, comme l’expose la poésie concrète, ou à la musicalité des mots mise en œuvre dans les travaux de James Joyce ou de Gertrude Stein, ou encore la qualité sculpturale de la toile comme la mettent en lumière les Shaped Canvases de Frank Stella. Ce que démontrent ces exemples, c’est que la transgression des conventions qui gouvernent l’identité des catégories traditionnelles de l’art ne mène pas forcément à l’abolition de l’idée de spécificité du medium, mais au contraire à l’émancipation de l’idée de spécificité catégorielle. À cet égard, le développement d’une transgression des frontières qui existent entre les catégories traditionnelles de l’art peut être perçu comme une radicalisation de l’exigence moderniste de spécificité du médium. C’est également le cas, non seulement pour les premières formes d’art « intermédiaire » mais aussi pour différents médias esthétiques issus des nouveaux genres hybrides ou encore pour la confrontation des différentes variations esthétiques sur le thème mcluhanien de l’identification du « contenu » d’un nouveau médium comme reprise de modèles plus anciens.
En second lieu, la transgression des frontières entre les catégories traditionnelles de l’art constitue aussi la preuve d’une différence entre les valeurs esthétique et technique dans l’art, du reste éludée par la théorie moderniste de l’art. En ce sens que la différence entre l’esthétique et le technique se répercute dans l’œuvre d’art comme tension entre le général et le particulier. Le succès artistique requiert non seulement une dimension vouée à être généralisée en un concept, une idée, un principe mais également une caractéristique qui transcende ces dimensions. C’est en seule vertu de cette dernière caractéristique qu’un objet artistique gagne la singularité qui détermine son statut esthétique : une beauté dont la dignité émerge de son rejet constitutif de toutes les tentatives de l’objectiver et donc de le normaliser. C’est pourquoi l’art est incompatible avec la convention. Étant donné que la subdivision de l’art dans les arts constitue l’une des conventions les plus tenaces, sa transgression doit procéder non comme une liquidation mais comme un sauvetage de l’esthétique, non comme une abolition de la différence pour le bien de l’uniformité, mais comme sa radicalisation pour le bien de la singularité. En ce sens, les travaux hybrides, créant et transcendant également de nouveaux genres, manifestent une condition fondamentale de l’art.
2. L’art n’est pas voué à la froideur
Avec son idéal de froideur pour l’art, ses louanges à la pratique du géomètre, ses polémiques contre tout ce qui embrasse la corporéité ou la psychologie, Badiou semble incarner la caricature d’une tendance moderniste orientée vers l’anti-expressionnisme abstrait. Évidemment, il ne s’agit pas de nier que la réserve moderne à l’égard de l’expression ait été à un certain degré justifiée par la critique du subjectivisme. Toutefois, quand cette réserve s’étend à une inimitié globale dénonçant toute expression comme humaine-trop-humaine, elle s’allie implicitement à une aversion à l’égard de toute ambivalence, toute incommensurabilité et toute ouverture, aversion qui combat moins l’idéologie subjectiviste que la possibilité de l’expérience subjective en tant que telle. Symptomatiquement, ce furent les femmes qui affichèrent le plus de scepticisme au sein même du minimalisme, et offrirent les vues les plus tranchées à l’égard de l’anti-expressionnisme abstrait du modernisme : pensons par exemple à Yvonne Rainer ou Isa Genzken (3). Bien qu’elles partagent toutes deux la réserve moderniste à l’égard de l’immédiateté présumée de l’expression subjective, elles ne l’ont jamais soutenue jusqu’à l’exagération d’une hostilité à l’égard de l’expression comme telle. Cette position a servi non seulement leurs propres travaux mais également ceux de l’art minimal produits sous l’égide des « signes froids » du positivisme et de la géométrie. Car la simplicité trompeuse de la forme minimaliste peut dès lors dévoiler une qualité devant laquelle les tenants du subjectivisme de l’expression immédiate et le positivisme anti-expressif de la forme stérile ne peuvent se voiler la face : son abyssale profondeur sémantique, son potentiel expressif.
3. L’œuvre d’art ne saurait s’objectiver comme quasi-sujet
La subjectivité dans l’art est, pour Badiou, irréductible à celle des sujets empiriques : ni à celle des artistes ni à celle du spectateur ; Badiou envisage plutôt une subjectivité universelle présente dans l’œuvre d’art même. La production artistique d’après Badiou implique quelque chose qui ne relève ni de la production subjective ni de la simple objectivité, mais de ce qu’il nomme une « œuvre-sujet ». Cette idée de l’œuvre d’art comme quasi-sujet est particulièrement paradigmatique pour le discours esthétique du modernisme. Car c’est cette idée qui a été cruciale pour la définition moderne de l’art en opposition aux simples objets ou aux marchandises : les marchandises sont des objets destinés aux sujets, elle sont vouées à être consommées ; les œuvres d’art sont censées être semblables aux sujets – elles sont supposées se présenter comme non consommables mais enclines à une reconnaissance. Dès lors il semble important de mesurer comment cette idée d’œuvre-sujet se fonde sur une idée de l’autonomie esthétique identique à celle selon laquelle l’œuvre est essentiellement indépendante du spectateur « concret ». Et c’est spécifiquement cette idée d’autonomie esthétique comme indépendance de l’œuvre par rapport au spectateur qui s’est vue attaquée au cours des quatre ou cinq dernières décennies par diverses tendances prônant la dissolution des limites disciplinaires artistiques.
Mais l’extension de l’œuvre au spectateur ne rompt pas avec l’idée moderne de l’autonomie esthétique, et y adhère même plutôt avec une certaine consistance. L’engagement envers cette idée dans l’art contemporain demeure toutefois cadré comme critique de la mécompréhension moderniste pour laquelle l’autonomie de l’art consiste en son indépendance par rapport au spectateur « concret ». Il demeure vrai que l’autonomie de l’œuvre s’accroît quand elle n’est plus réductible à l’intention expressive, à la virtuosité technique ou au programme conférés par le sujet artistique. Il ne s’agit pas ici, comme pourrait l’envisager l’esthétique moderniste, d’une autonomie gagnée par une universalité qui rend l’œuvre indépendante du spectateur. Bien au contraire, l’autonomie ne se réalise ici, et toujours de façon renouvelée, que dans le processus réel qui tient lieu entre sujet et objet, entre le spectateur et l’œuvre. C’est par les processus de l’expérience esthétique, par la chaîne d’associations engagée par chaque œuvre spécifique, que l’œuvre même naît comme telle dans le champ de l’art. Au sein du minimalisme, on peut observer que ce processus engagerait en effet potentiellement l’enregistrement d’une quasi-subjectivité dans l’objectité de ces œuvres, qui se laisse précisément percevoir dans le discours qui les soutient comme objets purgés de toute subjectivité. En effet, ces objets semblent enregistrer la subjectivité en tant que site de son absence. Mais l’expérience d’une expression quasi subjective correspond néanmoins ici avec l’opinion selon laquelle l’expression demeure une qualité qui ne saurait être attribuée à la seule œuvre d’art – bien au contraire, cette qualité semble n’apparaître que par et au sein de la singularité de la rencontre entre œuvre et spectateur.
4. La qualité esthétique de l’art n’est pas réductible à l’évidence d’une forme inédite
Badiou se montre très moderniste dans sa volonté de lier l’idée de l’art à une « évidence improbable » de la forme artistique (comme pourrait le formuler Luhmann (4)). Mais cette idée n’est problématique qu’en tant qu’elle est liée (comme c’est le cas chez Badiou et dans d’autres travaux d’esthétique sur l’œuvre moderne) à l’idée d’une autosuffisance présumée et d’une forme indifférente au contexte, impartiale (et ainsi universelle). Il est donc peu surprenant que Badiou pense que la production artistique doive consister en la « purification » de formes improbables. Notons que les œuvres d’art les plus intéressantes de ces dernières décennies sont précisément celles que nous pourrions caractériser comme la manifestation de farouches réserves à l’égard de tout positivisme et de tout objectivisme de la forme artistique. Les œuvres en question expriment une percée explicite des limites qui séparent la supposée forme artistique pure de ses contextes spatiaux, et leur contenu de ses contextes sociaux et culturels. Mais ce mouvement précis de délimitation ne peut en aucun cas se voir qualifié de propriété objective de ces œuvres. En laissant ouverte de façon très distincte ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient plus, les installations « spécifiques au site » font davantage émerger le fait qu’une telle dynamisation délimitante ne peut se produire que dans le cours de l’expérience esthétique, dans la réflexion sur la question ouverte sur ce qu’inclut effectivement une œuvre, ce qu’elle intègre et ce qu’elle comprend – de par son contenu et de par sa forme.
Dans un commentaire sur la Critique du jugement de Kant, Jacques Derrida a montré que la question concernant les limites d’un objet esthétique devait être considérée comme l’une des questions centrales de l’esthétique traditionnelle (5). Néanmoins, toujours selon Derrida (et je le rejoins sur ce point), c’est précisément l’impossibilité de répondre à cette question qui doit être considérée comme caractéristique structurale déterminante de l’esthétique comme telle. Mais un processus de compréhension réflexif est ainsi instancié, de sorte que l’œuvre d’art ne se réalise comme œuvre d’art que par ce même processus. Par ce seul processus – au sein duquel toute sorte de compréhension immédiate, tout accès direct à l’œuvre est infirmé pour les fins d’un moment réflexif – un objet esthétique se constitue en tant que relevant de l’esthétique. La logique « parergonale », ainsi que la nomme Derrida, par laquelle quelque détail de l’espace environnant, par exemple, peut s’introduire au centre de la signification esthétique à un moment précis, pour ensuite se retirer au simple rang de l’accessoire – cette dynamisation spécifiquement esthétique de la limite ou du cadre de l’œuvre se manifeste donc dans tout le champ artistique, et pas uniquement dans des installations spécifiques au site, qui pour leur part rendent explicite ce dynamisme de façon quasi littérale. La forme est forme esthétique au seul degré d’une telle dynamisation essentiellement impure.
5. L’art n’est pas voué à l’abstraction
Il semble quasi superflu de remarquer que la prescription badiousienne de l’abstraction dans l’art est également d’essence moderniste. Pour Badiou, l’abstraction semble compter comme le principal moyen de convertir un objet artistique à la médiation de la vérité universelle. De récents développements dans le champ artistique rejettent l’idée selon laquelle l’art serait médiateur de l’apparition d’une vérité universelle, en insistant, contre la tendance moderniste à confondre l’autonomie de l’art avec sa pauvreté en monde, sur la richesse de mondes propre à l’art. Ils s’expriment ainsi contre toute prohibition greenbergienne relative à la représentationnalité, mais également contre les tentatives adorniennes de reléguer l’art à une position polémique à l’égard de la réalité comme outre-monde, comme monde utopique. L’art contemporain est trop souvent étonnamment concret, et cette concrétude est à son tour trop complexe pour être définie par de telles hypothèses généralisées. En transposant des fragments de réalité empirique dans l’art, de telle œuvres ne traduisent néanmoins en rien la volonté de niveler la différence entre art et réalité. Dans ces dispositions artistiques, les choses ne demeurent pas les objets monotones que reconnaît la perception ordinaire. Mais une telle transformation ne s’accomplit pas, ainsi que Badiou pourrait le figurer, en « transformant le sensible en l’événement d’une idée », mais plutôt en engageant les choses dans un processus au sein duquel elles réalisent une double présence comme objet et comme signe qui ne peut être réduite à un pôle ou à l’autre. Nous avons plutôt affaire, dans son devenir esthétique, à un passage constant de l’objet entre ces deux pôles : entre forme et contenu, ou plus précisément entre matériau et sens, ou encore entre chose et signe. Il est important de noter que ce passage impliqué dans l’expérience esthétique fonctionne dans les deux sens : de la chose au signe et du signe à la chose. Le fait que la dimension matérielle, sensuelle, de l’objet d’art, que sa « choséité » ne puisse être totalement transformée en signe au service de l’apparence d’une idée, qu’elle revienne au contraire sans cesse au premier plan, contrant par surprise les sens possibles que l’on peut lui assigner, constitue une qualité matérialiste de l’expérience esthétique que nous devons défendre contre l’esthétique moderniste de la vérité.
6. L’art n’est pas censé s’adresser à un public universel au sens littéral
Badiou relie son réquisit d’abstraction pour l’art à une demande d’abstraction de tout particularisme. Mais de façon assez claire, toute forme artistique qui se charge d’une investigation sur les sujets concrets de l’expérience esthétique et leur situation sociale, comme c’est le cas pour l’art contemporain, s’oppose à un tel universalisme.
Car une grande part de la production artistique à laquelle nous avons affaire aujourd’hui implique des problématiques politiques. En conséquence, les travaux en question divisent leur public selon les champs de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, de l’ethnicité et/ou de classe. Selon leur position au sein de ce réseau d’identités, les spectateurs expérimenteront les œuvres de façon hétérogène. Pour cette raison, l’art contemporain forme à l’évidence une contrepartie extrême à l’idéal schillérien d’une unité esthétique implicite du genre humain si caractéristique pour une grande part de l’esthétique moderniste. Si l’on veut aborder ici la question de l’expérience esthétique, il faudra la caractériser comme expérience essentiellement individuelle. Cela est vrai aussi bien pour les horizons sémantiques de l’art contemporain que pour la structure même de cette expérience. Alors que l’esthétique moderniste maintenait la croyance selon laquelle le sujet de l’expérience esthétique se voyait transcendé en s’abandonnant à la structure de l’œuvre, une grande part de la production artistique contemporaine provoque manifestement une expérience dans laquelle les spectateurs sont renvoyés à eux-mêmes. Au lieu de se voir absorbés par l’objectivité de l’œuvre, nous sommes confrontés à notre propre activité de production de sens.
Cela est plus évident, je pense, si l’on considère les œuvres politiquement engagées qui ont dominé le monde de l’art au cours de la dernière décennie. Car vis-à-vis de ces œuvres, le sujet ne reçoit pas simplement des messages politiques – ainsi qu’une mécompréhension esthétiquement flegmatique de l’art contemporain pourrait le formuler – mais se voit plutôt confronté à ses propres préjugés, ancrés dans son propre background social et culturel, à l’égard de ce qui semble lui apparaître comme une caractéristique de l’œuvre « en-soi ». Toutefois, et précisément parce que les significations qui font leur apparition sous l’égide du semblant esthétique ne peuvent à aucun moment se voir authentifiées par l’œuvre elle-même, le sujet est renvoyé à sa propre dimension performative. Au contraire de la conception moderniste de l’expérience esthétique, le rapport esthétique à l’objet ne transcende évidemment pas la subjectivité située du sujet empirique mais opère en activant une distanciation réflexive par rapport à ses préjugés respectifs. Dire cela implique néanmoins que le terme d’expérience ne renvoie pas qu’au sujet, car cela ne relève en rien de ce qui peut « arriver » au sujet seul. Il faut davantage envisager de le lier à un processus entre sujet et objet qui transforme également chaque partie : l’objet, comme je l’ai déjà mentionné, en tant qu’il ne « fonctionne » comme œuvre d’art que dans et par le processus de son « expérience » ; et le sujet dans la mesure où il assume une forme autoréflexive, dont la production de sens fait retour d’une façon structuralement dérangeante sous le mode de l’apparence de l’objet. Nous ne nous expérimentons dans l’abstraction ni par nos facultés cognitives (si nous suivions Kant), ni dans le potentiel de notre subjectivité à la réconciliation éthique (si nous souscrivions au motif schillérien de l’universalisme si prégnant dans l’esthétique moderniste). Notre subjectivité devient plutôt le site d’une opération spécifiquement esthétique qui ne peut plus être comprise comme un modèle pour une subjectivité non esthétique, que cela soit dans des dimensions théorétiques ou éthiques, mais davantage comme mode de leur réflexion.
7. L’art ne doit pas être antidémocratique
Lorsque Badiou affirme que le seul principe de l’art d’aujourd’hui est de ne pas être occidental – ce qui, ainsi qu’il le précise, veut également dire : ne pas être démocratique selon l’idée occidentale de la liberté politique –, il appelle de ses vœux un art qui se dédouane de ce qu’il appelle les impératifs occidentaux de communication et de circulation. L’art, conclut-il, doit ainsi demeurer absolument immobile et incommunicable. Ici Badiou mêle à l’évidence une argumentation anticapitaliste avec une argumentation antidémocratique. Tout comme l’idée d’un art immobile supposé résister à la circulation marchande, le destin de la première vague d’œuvres spécifiques au site a démontré à quel point l’immobilité ne saurait constituer une condition suffisante pour surmonter le caractère marchand de l’art. Les installations spécifiques au site jouissant aujourd’hui d’un grand soutien institutionnel, diverses institutions artistiques de par le monde possèdent aujourd’hui des répliques de telles œuvres datant des premiers jours de la « spécificité au site » – œuvres qui, à l’époque, étaient considérées comme non reproductibles, non transportables, et non marchandisables. Mais le fait que les objets d’art puissent être vendus comme n’importe quel autre objet est « la simple conséquence de leur participation aux rapports de production » (Adorno). Il semble évident qu’aucun art ne peut échapper à cela en devenant immobile. L’idée simpliste selon laquelle l’art pourrait se libérer de sa condition est plutôt d’ordre idéologique. Il semble presque à cet égard que Badiou ne réponde plus aux standards du modernisme, l’on pense par exemple à l’insistance d’Adorno sur le fait que l’art ne pourrait accomplir son autonomie que par l’expérience de la forme-marchandise – soit ni en les ignorant ni en déclarant naïvement les avoir dépassés.
S’agissant de l’idée d’un art incommunicable, il est évidemment déterminant de mesurer comment l’on conceptualise ici cette incommunicabilité. Alors que Badiou semble penser une rupture radicale de l’art avec le sens pour devenir véritablement universel, je pense que nous avons ici affaire à une description erronée de la façon dont une interruption de sens opère sur le plan esthétique. Car il ne s’agit pas ici d’une rupture radicale mais d’une distanciation réflexive par rapport à notre production de sens et aux divers préjugés culturels et sociaux qui y opèrent. L’art effectue ainsi un changement de conscience qui peut se métamorphoser en action politique, et cela sans rompre avec les basses fondations de nos mondes finis du point de vue d’une « haute étoile montante ». Il s’agit en fait, à cause de la structure expérientielle de l’art, d’une altération potentielle de la conscience par une distanciation réflexive du familier.
S’agissant de la critique bon teint de la démocratie et des particularismes qu’elle rencontre, critique que Badiou réitère au nom de l’universalisme, mon problème est ici de l’ordre de la mécompréhension grossière de la politique démocratique ainsi engagée. Parce que le mouvement contre une conception universaliste du spectateur, par un soi-disant art féministe par exemple, ne vise pas l’universalisme en tant que tel mais en prône une compréhension dynamique. Parce que le mouvement contre une conception universaliste du spectateur a également d’importantes implications pour la notion d’un public de l’art. Si l’art a des effets sur la société, comme je l’ai déjà dit, alors ce n’est pas parce que son expérience constituerait quelque chose comme une subjectivité universelle mais parce que le sujet expérimentant y est potentiellement confronté à ses propres dimensions sociale et culturelle – ceci impliquant que des sujets différemment situés expérimenteront des œuvres politiquement engagées de façon différente. De telles œuvres, en tant qu’œuvres d’art, maintiennent leur adresse au public, tout en posant la question, comme c’est le cas pour des œuvres politiquement engagées, de l’homogénéité de ce public. Cela veut également dire qu’un tel art est conscient que le « Nous » esthétique, auquel tout jugement esthétique est adressé, est nécessairement controversé. L’adresse de l’art contemporain au public est donc liée à une adresse sur ce public précis, de façon à émanciper l’idée selon laquelle « l’art est pour tous » de sa conception distordue par les clichés de la vulgate bourgeoise. Badiou fait toutefois cette idée sienne de façon acritique. Le fait qu’il tente de nous la revendre sous l’égide d’un « aristocratisme prolétarien » ne rend pas la chose plus aisée. C’est contre les revendications à l’universalisme que le féminisme, entre autres, a un jour été inventé. Une politique démocratique, à l’inverse de la caricature que Badiou en produit, ne consiste pas dans la réification de particularismes mais dans une remise à l’épreuve constante, par le conflit, de ce qui compte comme universel. Insister sur la relation intrinsèque de l’universalisme et du conflit est ainsi un accomplissement non moindre des développements projetant une dissolution des limites artistiques.
Traduit de l’anglais par Kosumi Abgrall