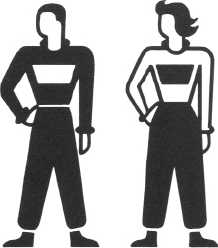De Thoreau à Malick

« [Ce romantisme] réaffirme que, dans quelque lieu que je me trouve, je dois me situer. Il me parle de terreur, mais suggère l’enthousiasme – car le tremblement du sentiment ne nous a jamais menés à bon port, ni le frisson du pittoresque. Le credo de ce romantisme, triomphant de l’ancien, est que l’émotion peut encore nous mouvoir, que, si nous le voulons, nous sommes libres d’aller plus loin. »
(Cavell, La projection du monde, p. 138)
Stanley Cavell s’est donné pour but de « réintroduire la voix humaine en philosophie » et d’en tirer toutes les conséquences éthiques et politiques. L’enjeu pour lui de la philosophie du langage ordinaire – celle de Wittgenstein surtout – est d’abord de comprendre que le langage est dit, prononcé par une voix humaine au sein d’une forme de vie ; ensuite de déplacer la question de l’usage commun du langage vers la question, plus inédite, du rapport du locuteur individuel à la communauté : ce qui conduit pour Cavell à une redéfinition de la subjectivité dans le langage à partir du rapport de la voix individuelle à la communauté linguistique – de la justesse à l’accord « dans » le langage. Il y a dans la voix l’idée de claim, de revendication : la voix individuelle ré-clame une validité universelle et y cherche sa juste tonalité. La recherche de la justesse, de l’expression absolue comme mise en adéquation entre l’intérieur et l’extérieur, conjugue alors langage, politique, et éthique. Elle définit aussi le romantisme, en tout cas pour Cavell, Emerson, Thoreau, les façons dont on peut en hériter en Amérique : un romantisme de la démocratie, qui va jusqu’au bout d’une aspiration du romantisme, la réappropriation du monde ordinaire par l’expression individuelle.
« Parler de notre subjectivité comme chemin du retour à notre conviction de la réalité, c’est parler du romantisme. Peut-être peut-on comprendre le romantisme comme le combat naturel entre la représentation et la reconnaissance de notre subjectivité. D’où Kant, et Hegel ; d’où Wordsworth qui entre en concurrence avec l’histoire de la poésie en s’exprimant lui-même entièrement par l’écriture, en se ramenant au monde par l’écriture ».
Le politique comme continuation du romantisme
L’intérêt philosophique du recours à « ce que nous disons » apparaît lorsque nous nous demandons, non seulement ce qu’est dire, mais ce qu’est ce nous. Comment moi, sais-je ce que nous disons dans telle ou telle circonstance ? En quoi le langage, hérité des autres, que je parle est-il le mien ? C’est l’écho de ces questions qu’entend Cavell dans l’ouverture des Recherches Philosophiques (qui commencent avec la citation d’Augustin : parce que « tous mes mots sont ceux d’un autre »). Dans ce premier paragraphe, on trouve tous les thèmes classiques des Recherches philosophiques : l’apprentissage du langage, la communauté, la signification. Se met en place alors une conception du langage comme accord de communauté, signification héritée, apprentissage par ostension. Mais on découvre aussi dans ce début une autre thématique, tout aussi sociale et moins évidente dans les Recherches : celle du sujet, de la voix et de l’expression. L’écart de ces deux thématiques a conduit longtemps à ignorer la seconde chez Wittgenstein – voire à lire dans la première une réfutation de la seconde, la communauté comme réfutation de la voix individuelle. L’apport de la lecture opérée par Cavell dans Les Voix de la Raison est d’arriver à les mettre ensemble, et à montrer que la question de l’accord dans le langage commun était, précisément, celle – sceptique – de la voix, celle de savoir comment ma voix peut être « la nôtre ». La question de la description, et de son adéquation à son objet, réglée dans le Tractatus logico-philosophicus par la voie représentationaliste (la proposition image de l’état de choses), se révèle celle de la vérité de la confession, de la justesse expressive. Ce déplacement de la vérité dans l’expressivité est bien une thématique romantique, celle de la réappropriation du monde par l’exploration subjective, devenue ici recherche de la voix. Ce romantisme de l’expression apparaît dans les Voix de la raison, ouvrage où Cavell reprend la question de l’expression dans une perspective sceptique. Supporter l’expression juste, « c’est également reconnaître que vos expressions vous expriment, qu’elles sont à vous, et que vous êtes en elles. Cela signifie que vous vous autorisez à être compris, chose que vous pouvez toujours refuser. J’aimerais souligner que ne pas vous y refuser, c’est reconnaître que votre corps, le corps de vos expressions, est à vous, qu’il est vous sur la terre, tout ce que de vous il y aura jamais ».
Une telle reconnaissance est l’acceptation de l’expression comme identiquement intérieure (elle m’exprime) et extérieure (elle m’expose). La subjectivité se définit alors dans ce mouvement de réappropriation de sa voix, qui est aussi une façon d’approcher la réalité. Le scepticisme, dans la lecture de Cavell, est le symptôme d’une impossibilité plus générale, l’incapacité d’entendre le langage ordinaire, et donc de le parler, de vouloir dire. L’incapacité à être sujet de sa parole, qui est celle de parler le langage commun, est la forme politique et romantique que prend le scepticisme wittgensteinien, qui trouve une réponse dans la réappropriation du monde ordinaire par nos pratiques du langage. Cavell montre la fragilité et la profondeur de nos accords de langage, et de nos formes de vie. C’est aussi la dimension romantique de la philosophie du langage ordinaire. Que notre langage ordinaire ne se fonde que sur lui-même, ce n’est pas seulement source d’inquiétude quant à la validité de ce que nous faisons et disons : c’est la révélation d’une vérité sur nous-mêmes, le fait que « je » suis la seule source possible d’une telle validité. Et dans la recherche constante de la voix, de la juste tonalité, il y a l’exigence à la fois subjective et commune dont on trouve l’expression la plus aiguë chez Thoreau et Emerson.
« Croire votre pensée, croire que ce qui est vrai pour vous dans l’intimité de votre cœur est vrai pour tous les hommes – c’est là le génie. Exprimez votre conviction latente, et elle sera le sentiment universel ; car ce qui est le plus intime finit toujours par devenir le plus public. »
Cela conduit Emerson à une autre apostrophe célèbre : « Quiconque veut être un homme doit être un non-conformiste », et une critique du conformisme et du moralisme, conçus comme incapacité à prendre la parole, à vouloir dire ce qu’on dit (Dire et vouloir dire, dit le titre d’un ouvrage de Cavell), la vraie morale étant dans ce que Cavell appelle « trouver sa voix » : l’atteinte du ton juste, de l’expression adéquate à la situation. Il s’agit à la fois de constitution singulière – « suivre sa constitution » dit Emerson – et commune : trouver une Constitution politique qui permette à chacun de trouver expression, d’être exprimé par le commun, et d’accepter alors de l’exprimer. La démocratie est à la fois ce qui me donne une voix politique, et qui peut aussi bien me la retirer, ou me décevoir, me trahir au point que je ne veuille plus parler pour elle, ou la laisser parler pour moi, en mon nom. Ma participation est ce qui est constamment en question, en discussion – en conversation – dans mon rapport à la communauté.
« Puisque l’octroi du consentement implique la reconnaissance des autres, le retrait du consentement implique la même reconnaissance : je dois dire à la fois “cela n’est plus à moi” (je n’en suis plus responsable, rien là ne parle plus en mon nom), et “cela n’est plus à nous” (le “nous” initial n’est plus maintenu ensemble par notre consentement ; il n’existe donc plus). »
Mais en refusant mon accord, je ne me retire pas de la communauté : le retrait ou la dissonance, le départ dans l’inconnu sont inhérents à mon appartenance ou au désir de communauté.
« Les êtres humains ne désirent pas par nature l’isolement et l’incompréhension, leur désir les porte à s’unir, ou à se réunir – il les porte à ce que nous appellerons vivre en communauté. Et si quelqu’un se déclare inconnu, ce sera par fidélité à ce même désir. (Naturellement, fidélité, désir, déclaration sont toujours susceptibles de se fonder sur une illusion. La connexion conceptuelle n’en demeurera pas moins tout à fait réelle.) »
La communauté est donc, par définition, revendiquée, pas fondatrice. C’est moi – ma voix – qui détermine l’accord, pas l’inverse et c’est cela qui détermine l’assentiment (ou non) à la société, en fait le potentiel révolutionnaire.
« Je suppose que je ne veux pas accepter ma société “une fois pour toutes”, comme j’accepte les principes de la justice : jugée à l’aune de ces principes, il se pourrait que la société en arrive à ne plus mériter ma loyauté. Mais comment ces principes porteraient-ils le potentiel révolutionnaire du consentement, ou du consentement résilié, si je ne donnais pas en même temps mon consentement à la société ? »
C’est ici et maintenant, quotidiennement, ordinairement, que se règle mon assentiment à ma société. Non que mon assentiment soit mesuré ou conditionnel : mais il est, constamment, en conversation et en conversion – il est traversé par le dissentiment exactement comme mon rapport au monde ordinaire est traversé par le scepticisme. Ce que Cavell veut montrer en faisant appel en politique à Wittgenstein, Emerson et Thoreau, c’est qu’il n’y a pas de règles qui disent comment suivre les règles du social – de règles qui limitent ou régulent l’acceptabilité des revendications et leur expression. La démocratie doit intégrer les actions et expressions qui mettent en cause de façon radicale les institutions du jeu social, non par quelque tolérance ou « ouverture » mais par perfectionnisme.
Démocratie de l’ordinaire
On retrouve l’enjeu de la démocratie : retrouver une expression juste. Pour Wittgenstein et Emerson, le privé est seulement refus de l’expression, inexpressivité, conformité. Faire en sorte que ma voix privée soit réellement expressive : Cavell définit ainsi un accord qui n’est fondé sur rien d’autre que purement la validité d’une voix : ma voix individuelle prétend à être (claim), est « voix universelle » (claim). Claim est donc ce que fait une voix lorsqu’elle ne se fonde que sur elle-même pour établir simultanément un assentiment universel et le rapport au réel – prétention que Cavell et Emerson nous demandent de formuler comme principe de nos pratiques démocratiques. Cette réinscription du subjectif au cœur du politique est aussi la forme présente du romantisme politique, qui définit le principe de la démocratie comme le droit de chacun à évaluer ses besoins et son bonheur.
« On supposera qu’il y eut dans le romantisme la découverte, ou une redécouverte, du subjectif ; du subjectif comme exceptionnel ; ou encore la découverte de la liberté comme état dans lequel chaque sujet proclame (claim) qu’il a droit à la récognition, à la reconnaissance ; droit à nommer et à évaluer sa propre satisfaction. »
Cette expression démocratique du romantisme n’est certes pas un nouveau fondement politique, mais une exigence et insatisfaction permanente. Ce qui est bien le sens du perfectionnisme moral, qui n’est pas tant du moralisme (une recherche d’une perfection déterminée) que la projection toujours au-delà et hors de soi vers un modèle qui se crée dans cette projection même et n’est jamais fixé. La recherche de la voix, de la justesse, est ainsi le rejet constant de la conformité, y compris à des principes moraux ou politiques auxquels on tient, y compris à soi-même. Ce qui est une des dimensions du principe de la démocratie, la poursuite du bonheur (Pursuit of Happiness, titre repris par Cavell), recherche autant politique que romantique (comme le note amèrement Will Smith dans le film qui porte à peu près ce titre : « je comprends maintenant pourquoi les pères fondateurs disaient “poursuite du bonheur” »).
C’est pourquoi, en définissant le langage ordinaire par la voix, la voix du moi qui parle, au nom de tous, dans cette arrogance de la voix qui est la marque de l’humain – on ne reconstitue pas un nouveau sujet comme sujet de la parole. Vouloir dire (mean) ce que je dis serait connaître simultanément soi-même, les autres et le monde – c’est-à-dire, précisons-le, le monde ordinaire, celui où se retrouve le romantisme.

« Ce dont ils ne s’étaient pas rendu compte, c’est de ce qu’ils étaient en train de dire, ou de ce qu’ils étaient vraiment en train de dire, et ainsi ils ne savaient pas ce qu’ils voulaient dire. En ce sens, ils ne s’étaient pas connus eux-mêmes, et n’avaient pas connu le monde.
Je veux dire, bien sûr, le monde ordinaire. Peut-être n’est-ce pas là tout ce qui existe, mais c’est déjà si important : la morale est dans ce monde, ainsi que la force et l’amour ; l’art, aussi, et une partie de la connaissance (la partie qui concerne ce monde-là) ; et aussi la religion (où que se trouve Dieu). »
La critique du conformisme définit la condition de la morale démocratique ordinaire et la nécessité du dissensus pour celui qui veut savoir ce qu’il veut dire. L’idéal d’une conversation politique – de la démocratie – serait non pas celui de la discussion rationnelle, mais celui d’une circulation de la parole où personne ne serait mineur, sans voix. La revendication et le dissensus ne sont pas des excès, ni des confins ou limites de la démocratie, mais définissent la nature même d’une véritable conversation démocratique. Cette tradition du dissent s’enracine dans la tradition étasunienne et s’est développée lors de nombreux mouvements contemporains en Amérique. Elle articule consentement et désobéissance : comme si le rêve initial de l’Amérique, les principes des pères fondateurs, pouvaient se continuer dans le dissensus interne.
Cette découverte de l’individualité dans l’expression définit aussi le romantisme ordinaire, et Thoreau et Emerson héritent de Coleridge et Wordsworth en même temps que de l’esprit de la révolution américaine. Comprenons bien que ce romantisme est (mais comme tout romantisme véritable, revenu de tout) un postromantisme (tout comme le moderne, pour Cavell, est toujours postmoderne, visant son au-delà). Cavell, comme Emerson, comme Thoreau et comme les occupiers du monde entier ne renvoient pas au pittoresque, au tremblement affectif, à l’exaltation du moi propres à la « vieille Europe ». Emerson, dans The American Scholar, disait explicitement : « Je ne demande pas le grand, le lointain, le romantique ; […] j’embrasse le commun, je suis assis aux pieds du familier, du bas ». Son romantisme est un romanesque de l’ordinaire : « De quoi voudrions-nous vraiment connaître le sens ? De la farine dans le quartant ; du lait dans la casserole ; de la balade dans la rue ; de la forme et de l’allure du corps ». Le refus du romanesque hérité de l’Europe conduit à un romantisme nouveau et sceptique, par lequel l’éloignement du monde se résout dans l’appropriation du commun. Si l’on reprend le passage suivant, toujours tiré de The American Scholar,
« Cette révolution (dans l’aspiration humaine) doit être forgée par la domestication progressive de l’idée de Culture. La plus grande entreprise du monde, en splendeur, en étendue, c’est l’édification d’un homme. Voici les matériaux, épars sur le sol ».
On comprend que cette révolution, l’édification d’un humain nouveau, doit d’abord renoncer au romantisme « européen » de l’exaltation du moi et de l’affect, pour lui substituer un nouvel individualisme, celui de la confiance en soi : tout comme ce sol (ground) avec ses matériaux répandus, comme échoués sur un rivage, est destiné à remplacer ou détruire l’idée philosophique de fondement ou de principe.
Le scepticisme et l’humanisation du monde
On retrouve le principe des mouvements de désobéissance ou d’occupation actuels ; pour progresser vers l’humain, retrouver le monde ordinaire, retrouver une expression adéquate, la self-reliance nous engage non pas à trouver une confiance subjective ou le contact avec le moi, mais la capacité à être expressifs – publics. C’est en me revendiquant moi-même que je pourrai faire que mon obscurité, mon opacité à moi-même (parce que je me donne à entendre aux autres) devienne politique et que la confiance en moi devienne confiance en nous, en un self au pluriel – selves. Il nous reste alors à nous découvrir, c’est-à-dire à nous rendre d’abord obscurs à nous-mêmes. Thoreau cherche à accomplir « l’exploit de l’obscurité » pour atteindre la véritable clarté :
« Je ne prétends pas avoir atteint à l’obscurité, mais je serais fier si l’on ne trouvait pas dans mes pages à cet égard de défaut plus fatal qu’on n’en trouve dans la glace de Walden. » (Walden ch. xvi)
Thoreau prône l’acceptation de l’obscurité à soi. On peut alors, dans cette obscure revendication de soi, qui est reprise permanente de la révolution, trouver cette voix commune des selves y compris au prix de la dissonance, de l’isolement et de l’inconnu. C’est ce claim que Thoreau voit comme solution aux « vies de tranquille désespoir ». On retrouve encore une fois la visée de la politique ; repérer chez soi et les autres ces « paroles qui nous chagrinent » au sens fort et nous dépossèdent de nos voix et du monde. Revendication perfectionniste, immanente et inhérente à la vie démocratique.
De Walden, Cavell écrit :
« Nous avons encore à “get our living together” à être un tout, à être une communauté. Nous ne nous sommes pas posés, nous ne nous sommes pas clarifiés ; notre caractère, et le caractère de la nation, n’est pas transparent à lui-même (IX, 34). »
Il y a là une dimension romantique – un romantisme démocratique, un romantisme du banal en quelque sorte, qui récuserait l’accusation d’irréalisme souvent associée au terme. Car ce romantisme est profondément réaliste et pratique. Emerson tout à la fin d’Experience annonce « la transformation du génie en pouvoir pratique », lui donnant le nom de true romance à réaliser. L’ordinaire est une fin, pas un point d’origine. Cavell, tout à la fin des Voix de la raison, identifie la quête romantique à la quête de l’ordinaire.
« Le désir d’être extraordinaire, exceptionnel, unique, révèle ainsi le désir d’être ordinaire, banal. (On ne souhaite pas devenir un monstre, même s’il se peut que l’accomplissement du désir d’être unique fasse de soi un monstre.) Ce désir simultané pour l’exceptionnel et pour l’ordinaire se trouve au cœur du romantisme. Le romantisme pourrait en effet être vu comme la découverte qu’il existe un exceptionnel accomplissement dans le banal. Dont un autre nom serait l’accomplissement de l’humain. »
Évidemment l’espoir éperdu d’être ordinaire peut avoir quelque chose d’agaçant et c’est cela le risque majeur de tout romantisme politique. « Imaginez le spectacle des émules de Rousseau, Thoreau, Kierkegaard, Tolstoï et Wittgenstein, guidés dans leur vie par l’espoir de devenir ordinaires, et prônant la banalité comme localisation du sublime ! ». Pour Cavell le romantisme a découvert le fait de l’adolescence (comme le scepticisme en est, selon Kant, une version philosophique en attendant l’âge du « jugement mûr et viril ») : « la tâche que représentent la volonté et le choix de devenir adulte, en même temps que l’impossibilité de cette tâche. » Le choix de la finitude, « ce qui veut dire pour nous la reconnaissance de l’existence d’autres êtres finis, c’est-à-dire le choix de la communauté » (id.) L’impossibilité, c’est le fait que ces options en matière de communauté nous ont été léguées par le passé, et demandent la conformité.
« Les romantiques rêvent alors de révolution, et ont le cœur brisé » (id.).
Le romantisme en politique, au-delà de tout sentimentalisme et exaltation, est alors dans la revendication de l’humain devant/dans sa perte. Le claim des révoltes actuelles est un nouveau cogito, exigeant et produisant une preuve de l’existence de l’humain.
«… une manifestation de l’appréhension que la subjectivité humaine, le concept d’un moi humain se révèlent menacés ; la peur qu’il faille les découvrir, et qu’ils puissent être perdus ; que, s’agissant de prouver sa propre existence, on ne puisse lui trouver de preuve qu’en soi-même ; et que de cette preuve dépende à son tour toute preuve puisée dans l’existence continue de l’humain comme tel. » (id.)
La nouvelle confiance en soi/nous romantique permet de trouver en chacun, dans l’ordinaire les ressources pour la redécouverte de l’humain. Très significatif alors est le retour à l’ordinaire qu’effectue Emerson lors de son voyage en Europe, où il redécouvre les splendeurs antiques tout en dénonçant l’illusion romantique et la grandiosité d’un art lointain et authentique. La réappropriation romantique de l’Antiquité ne peut se faire que dans le fragmentaire, la reproduction. Dans un fragment du journal tenu pendant son séjour à Rome au printemps 1833, Emerson, dans un « désert de marbres », repère le Torse du Belvédère, célébré par Michel-Ange et Winckelmann, et le compare à… un vétéran de la Guerre d’Indépendance. « Here too was the Torso Hercules, as familiar to the eyes as some old revolutionary cripple. » L’usage romantique des citations et la reprise permanente et fragmentée de l’héritage européen, chez Emerson et Thoreau, relèvent ainsi et inséparablement d’une revendication romantique ET réaliste parce que révolutionnaire.
« Certes, on peut voir là une expression du rejet du pittoresque qui trouvera si nettement sa formulation vers la fin de “The American Scholar”. Il faut cependant noter que la remarque révèle avant tout une pratique profonde et ancienne des grands chefs-d’œuvre de la sculpture antique, par le moulage ou la gravure, bref par la reproduction, seul canal ouvert à ce Lettré américain dont Emerson appelle l’avènement. À la fois comme naturalisation du fragment artistique et comme rappel de la présence insistante, impossible à oublier dans les petites communautés de la Nouvelle-Angleterre vers 1825-1830, des survivants de la période fondatrice, colossaux jusque dans leur amoindrissement ».
Ce qui nous renvoie encore à la « révolution » (passée et à venir) qu’appelle Emerson à la fin d’Experience : « Voici les matériaux, épars sur le sol ».
À condition de se rendre compte que le « sol » d’Emerson doit avoir la place ou la capacité de déplacer l’idée philosophique de base ou de fondement. On note chez Emerson le redoublement et la naturalisation de « sol » par « matériaux », le sol n’étant plus une base sur laquelle construire la philosophie ou la Culture ou la révolution, mais la matière même du sol. Ce qui évoque la capacité d’occupation du sol, de réappropriation de la terre (celle qui est sous nos pieds) qui est exercée dans les mouvements actuels ; dans le romantisme politique qui a ainsi trouvé une nouvelle forme dans les luttes écologistes, et dans l’idée du « global », d’une terre démocratisée définie par son occupation – y compris sous forme mobile, de circulation.
« L’idée même de “sol” est l’un des matériaux d’où il nous faut partir, dans notre travail de Culture, pour progresser encore, vers l’humain. J’irais plus loin en lisant, dans ce que dit Emerson de “matériaux épars sur le sol”, une référence à ces hommes et femmes qui sont dispersés (c’est-à-dire, non socialisés) sur le sol, et à partir desquels il faut édifier des hommes et des femmes. »
On trouve dans le récent film de Terrence Malick, To the Wonder (2012) symétrique ultracontemporain de The New World (2005), film déroutant mais aussi son film le plus explicitement romantique, qui permet de placer l’ensemble de l’œuvre de Malick sous le signe du romantisme américain – ce retour au sol et à la vie ordinaire comme possibilité révolutionnaire. Sol américain présent déjà de façon écrasante dans les premiers films de Malick ; mais alors que par exemple Days of Heaven, The Thin Red Line et The New World présentaient une nature sauvage, native – une wilderness où les humains se révélaient soit perdus, soit intrus, To the Wonder nous ramène « sur terre », pour reprendre l’expression de Wittgenstein, vers le sol et l’habitation de l’ordinaire. (Wittgenstein et Heidegger étant les deux figures que Malick, ancien étudiant de Cavell à Harvard et traducteur de Heidegger, investit explicitement dans son cinéma.) To the Wonder nous reconduit au lyrisme de la vie ordinaire, à cet étonnement/émerveillement devant le monde, le monde de la nature comme celui de l’art, comme le monde désolé et vague (« bleak ») de la vie quotidienne dans la petite ville américaine où échouent les deux héros. To the Wonder, loin d’opposer le sauvage et la civilisation, le romantique et l’ordinaire, le Nouveau Monde et la vieille Europe… organise alors la circulation de ces visions du monde. L’abbaye du Mont-Saint-Michel est naturalisée, émergeant à l’horizon telle une montagne, les plaines ondulantes de l’Oklahoma sont urbanisées et anthropisées, l’humain est sublimé dans la beauté (celle d’Olga Kurylenko) comme dans la dégradation et le handicap. Dans The New World, on assistait à la dégradation du monde des Américains natifs par leurs civilisateurs européens ; To the Wonder accomplit un pas de plus dans la désillusion et le scepticisme, nous fait comprendre qu’il n’y a jamais eu d’Amérique première, de terre sauvage et intouchée, de wilderness romantique. Thoreau le disait déjà à Walden : « Le premier homme, la première femme ne sont plus là. Walden n’a jamais été là, depuis les premiers mots de Walden ». La nostalgie d’une pureté originelle, de la nature, de l’humain est la dernière illusion dont le cinéma doit alors nous déprendre, tout en nous enseignant le miracle de ce monde dégradé qui nous porte par son imperfection même et sa finitude (« Nous voulons marcher ; alors nous avons besoin de friction », Wittgenstein, Recherches § 107). Car il n’y a qu’un seul monde, comme le disent certains slogans (There is No Planet B). C’est pourquoi le romantisme est aujourd’hui postromantisme, l’a toujours été, ce qui fait encore sa force anticipante et révolutionnaire. « Heaven is under our feet as well as over our heads. »