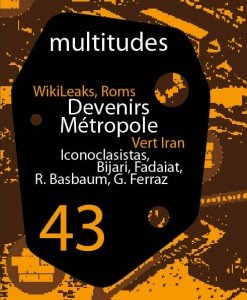Pour ceux qui s’intéressent aux interstices urbains, ce qui s’y passe à Inchéon, Séoul et Osaka montre des mécanismes partout à l’œuvre dans le monde globalisé depuis que la crise du Sud-Est asiatique en 1997 a fourni un précédent utile pour comprendre les interactions en cours actuellement en Europe. La métropolisation s’y dévoile explicitement comme une stratégie néo-mercantiliste de forte insertion dans le commerce international. On investit aussi pour attirer de nouveaux habitants et lancer des processus d’innovations technologiques, mais ces programmes suscitent de nouvelles catégories d’exclus.
La Corée, d’abord, est maintenant mieux connue par le cinéma Coréen dont la diffusion internationale a suivi la crise financière de 1997. Une visite la nuit dans le métro de Séoul, déconseillée par les habitants intégrés, nous apprend beaucoup d’une ville qui a connu une très grande croissance peu planifiée parce que les mécanismes de marché jouent de façon dominante. Mais depuis une quinzaine d’année, la municipalité de Séoul[1] intervient pour améliorer la qualité de la vie et surtout la « productivité » de la ville, tout en voulant remédier à une sorte de crise de la culture urbaine en Corée. La présence de sans-abris, phénomène quasi inconnu avant 1997[2] est néanmoins manifeste aujourd’hui. Ce n’est pas seulement la conjoncture instaurée par la crise de la fin des années quatre-vingt-dix (appelée ici crise du FMI), puis par celle des subprimes (2008-9) qui ont fait apparaître une population de travailleurs sans-abris. Elle résulte d’une montée du chômage mais aussi de la disparition des logements à bas prix visée par la municipalité pour la gentrification et l’installation de commerces luxueux dans le centre ville. La politique urbaine aggrave donc les conséquences sociales de la crise financière. Certes les travailleurs journaliers et le logement « non ordinaire » existaient auparavant en Corée, mais ce qui était vu comme « résiduel » redevient, après 1997, incontournable. La crise transforme les représentations et ce qui était appelé à disparaître avec la croissance devient un problème structurel. L’économie de Séoul a toujours besoin d’une main d’œuvre journalière qui a par contre de plus en plus de mal à se loger dans le centre. Pour un occidental, la logistique urbaine de la métropole coréenne est un curieux mélange de fordisme pur (aucune utilisation de la voie d’eau, des embouteillages records) et de manutention à dos d’hommes dans chacun des marchés de la ville, c’est-à-dire des emplois peu qualifiés, journaliers, usants. Le retour de la croissance à partir de 1998 n’a résolu en rien le problème qui continue de s’aggraver. À la limite même, le e-commerce qui a ajouté des nuées de camionnettes à demi vides à la congestion routière rend le besoin de portefaix et de charretiers à bras encore plus pressant pour compenser la circulation automobile. De même, tout un secteur de très petites entreprises industrielles, de la chaudronnerie au recyclage des métaux, demeure actif dans le centre de la métropole derrière le marché de Yeung-Po. En fait, les salariés « irréguliers » représentent la moitié de la main d’œuvre totale, alors que la politique immobilière pour générer une ville attractive restreint toujours plus les quartiers bon marché. Une nouvelle catégorie des sans-abris apparaît donc et ces nouveaux prolétaires sont alors priés de se « prendre en main », de retrouver leurs dignités pour reprendre leur place dans la cité, extension mondiale d’un discours sur les travailleurs pauvres dont Hélène Thomas a montré la genèse[3].
Cette production d’un groupe nouveau est cohérente des nouveaux principes de la politique sociale à une échelle mondiale avec le passage de l’égalité à l’équité qui engendre une multiplicité de statuts. Il en est la traduction spatiale, la multiplicité de statuts des pauvres accompagnant la fragmentation des espaces, en même temps que cette fragmentation soutient aussi la multiplication des catégories. Le choc macroéconomique, la politique urbaine et les préférences individuelles, jouent dans le même sens, plutôt que de développer des rétroactions correctrices.
Ces salariés du secteur informel ne sont pas mobiles au-delà de la ville, voire du quartier et leur habitat de fortune ne l’est pas non plus. Ils sont coincés au mieux dans des baraques, au pire dans le métro de Séoul où, chaque nuit, une multitude de gens dorment. Penser la mondialisation et ses espaces impliquent les travailleurs pauvres et la façon dont ils y trouvent leurs places, leurs niches, dans ces espaces à la fois morcelés et connectés. Cela semble être le cas aussi pour les journaliers des métropoles de San Francisco ou de LA, ainsi que du Japon où encore du Brésil où les favelas sont aussi en plein coeur de la cité. L’habitat non ordinaire métropolitain en Corée est l’envers nécessaire des gigantesques projets immobiliers, financés à crédit, dont on ne sait pas s’ils sont l’expression d’une bulle ou la nouvelle frontière de l’économie. Cette incertitude suit comme une ombre l’émergence d’un paysage urbain constitué quasi exclusivement de grands ensembles gigantesques, structures immobilières préparant une crise culturelle urbaine qui se fait déjà sentir. Le passage à l’immatériel, la route vers le capitalisme cognitif pour se substituer à la croissance industrielle vise d’ailleurs aussi à trouver des solutions pour pallier les problèmes de circulation. Comme à Paris, des projets de firmes pour réutiliser la voie d’eau, ici la rivière Han, émergent. Il s’agit aussi de retrouver une mémoire de la métropole coréenne. Cette mémoire douloureuse, voire monstrueuse, hante les films de Park Chan-Wook (Old Boy) où un homme cherche à savoir pourquoi on l’a enfermé pendant quinze ans, et de ceux de Bong Joon-Ho (Memories of Murder, The Host) sur les périphéries coréennes et les berges du fleuve de la métropole où l’on croise les fantômes de la dictature.
On ne voit pas en quoi ce développement métropolitain peut contrecarrer la crise sociale, mais néanmoins, l’implication des associations de citoyens, l’émergence lente d’un espace public oppositionnel depuis 1997, est la bonne conséquence des deux crises financières en Corée. Comme l’émergence du cinéma coréen.
L’intégration régionale en Asie[4] n’empêche pas cet habitat non ordinaire métropolitain coréen de se distinguer du modèle du quartier japonais, regroupant les journaliers dans les « Yosebas » en suivant les lignes des infrastructures, voies de chemin de fer, autoroutes etc. : la proximité géographique et l’histoire n’impliquent pas similarité des formes urbaines. Or, la crise financière de 1997 continue aussi de laisser des traces au Japon, en rencontrant celle des subprimes et modifie aussi les formes du logement précaire.
Elle semble avoir paradoxalement condamné Kamagasaki, le plus grand district hôtelier pour journaliers de l’archipel, une conséquence micropolitique notable. Le Yoseba, quartier d’hôtels et de bidonvilles où sont relégués les ouvriers précaires de l’industrie et du bâtiment, est une institution politique construite autour d’une place d’embauche[5] que divers militants chrétiens, autonomes et sociaux-démocrates, ont arraché au contrôle des Yakusas. Le parcourir avec des universitaires critiques, puis avec des militants rencontrés via le réseau No-Vox, mène à voir se superposer deux lectures de l’histoire du lieu et du Japon qui convergent sur la centralité cachée de ces zones « spéciales ». Mais cette forme est en déclin, l’industrie s’est délocalisée et a réduit ses effectifs, même à Osaka où Kamagasaki avait rassemblé prés de 30 000 personnes dans les années 90. Or ce déclin s’opère alors même que la précarité augmente au Japon : 34 % de salariés précaires en 2008 contre 20 % en 1990 (le taux officiel en France n’étant que de 13%), en attendant que les conséquences de la crise des subprimes prennent toutes leurs dimensions. On assiste donc à une dispersion spatiale et sectorielle des travailleurs intermittents. Ne restent au Yoseba que de plus en plus de travailleurs âgés d’où le tournant des associations « officielles » vers une politique du care et la création d’hôtels pour loger et soigner les plus de soixante ans. Un phénomène similaire s’observe dans le quartier des Burakumins, la caste des anciens parias ségréguée du Japon, tout proche de Kamagasaki. Ces deux quartiers avaient pourtant des fonctions différentes. Kama était un marché du travail et un réservoir de main d’œuvre pour les grandes industries, mais personne ne travaillait sur place. Nishinari. Le quartier des Burakumins était lui un lieu de production avec de petites entreprises, dont il reste quelques-unes, pour le travail du cuir, prétexte au statut de paria. Comme quoi un « quartier industrieux » peut très bien être un ghetto. Ces deux quartiers très liés aux activités du port d’Osaka en étaient aussi très éloignés, le spatial mismatch ne datant pas d’hier.
La forme nouvelle d’habitat, c’est le campement dans un parc public (à Osaka, il s’agit du parc Ogimachi), ainsi que les « refuges Internet ». Cette occupation de tentes ou de cafés semble tolérée alors que le squat d’habitation semble quasi-inexistant : l’habitat précaire se coule toujours dans des formes institutionnelles spécifiques. La plus surprenante au Japon, la plus immédiatement liée au capitalisme cognitif, ce sont les cafés Internet où dorment nombre de jeunes précaires qui y trouvent douches, couvertures et thé gratuit. Ces cybercafés ne seraient en fait que l’adaptation d’auberges de la jeunesse aux nouvelles technologies de communication et aux nouvelles formes d’embauche intermittente, via Internet et le téléphone mobile. Le recrutement des travailleurs précaires au moyen d’outils immatériels élimine les places d’embauches traditionnelles autour desquels s’était constituée l’institution du Yoseba. Cette embauche se déterritorialise, les « réfugiés » des cafés Internet n’ont d’autres adresses que leurs e-mails pour trouver du travail, mais ils s’organisent aussi en réseau via des forums. Cette forme spécifique au Japon (pour le moment?) est une innovation qui implique des circulations à une échelle relativement locale. De fait, il n’y aurait pas d’habitat mobile dans des caravanes ou des fourgons à la différence de l’Europe. Ce qu’on peut relier peut-être à la faiblesse du camping au Japon (3 000 terrains contre 11 000 au moins en France). Il n’y a pas non plus d’habitat en conteneurs et je n’ai pas non plus entendu parler de yourtes.
Ce changement induit des conséquences en partie contradictoires. D’une part, il s’agit d’une offensive des précaires qui abandonnent les quartiers de relégation et investissent d’autres territoires dans la ville. Mais, de façon paradoxale, cette sortie rend aussi leur situation plus invisible. Kamagasaki était une concentration connue dans le monde entier, alors que ces formes nouvelles sont dispersées et furtives, d’ailleurs non mesurées statistiquement. Dans les villages de tentes, le discours sur les «TAZ », les zones d’autonomie temporaires, est très présent. Beaucoup de militants cherchent ainsi un renouvellement de la démocratie dans une multiplicité de lieux où des forums s’organisent. On peut en avoir une vision plus pessimiste en observant que la tolérance d’interstices, sans relais politiques, est une pratique classique des États en Asie[6]. Ce qui revient à une explosion/dispersion du Yoseba, non à sa disparition. On ne peut faire cependant une lecture des Yosebas en termes de règles instituées, ce sont aussi des territoires de lutte. En se dispersant, ils peuvent essaimer conflits et nouvelles subjectivités dans toute la ville. En Asie aussi, le réveil des précaires peut changer la donne urbaine et le devenir métropolitain.