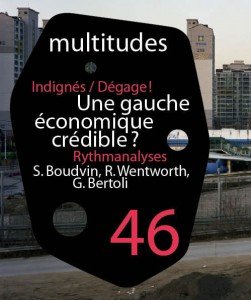Anna Cruz passe dans la rue au bruit de ses chaussures. Telle une sorte d’aura sonore, le martèlement sur l’asphalte est une puissance. Anna enfonce en cadence ses talons dans la conscience comme les aiguilles d’un vaudou quotidien. Le rythme prend son pied. Il n’est pas seulement la carrure objective des pas, mais est inséparable de l’auto-affection des jambes et de tout le corps dans la répétition du choc de métal. On l’a dans la peau. Dans une cage d’escalier ou dans un hall, la ligne des pas se réfléchit dans son écho qui l’amplifie, la redouble, la déphase. Même sans réflexion, la cadence des talons n’est pas seule, elle est prise dans le corps avec le balancement de la queue de cheval, du bras souple et du poignet qui se casse sur le sac à main.
Mais la puissance rythmique de la démarche est ambiguë : elle épouse en même temps la cadence d’un pouvoir qui la met au pas d’une féminité spectaculaire et stéréotypée, qui la synchronise avec les phases d’une vie pulsée. Elle passe à flux tendu, une pendule dans le derrière. Le rythme linéaire des pas pressés est enveloppé dans le rythme cyclique de la semaine et de la journée qui détermine les variations de son tempo, métro, bureau, restau. L’individuation d’Anna est produite dans un jeu de forces cadentielles. Femme cristalline, on voit à travers elle les périodicités sociales. Métronomique, elle est prise par le pouvoir jusque dans les poses et les saccades spasmodiques du sexe dont la norme virile l’assujettit de cinq à sept. Comment se libérer ? Il suffit parfois d’un doigt distingué qui contrecarre la plus dure pulsation, d’un solécisme dans le geste érotique de la main.
Anna Cruz n’est pas comme les infirmières observées par Marcel Mauss de son lit d’hôpital à New York, sa démarche n’est pas seulement une idiosyncrasie sociale. Une individuation rythmique plie les forces cadentielles sur elles-mêmes, les affecte d’un soi irrationnel. Chaque rythme a ses petites singularités. Un raclement soudain du talon sur l’asphalte introduit un déphasage dans la répétition, une syncope. Un arrêt de flamant rose pour réajuster la lanière de cuir laisse fluer une anacrouse dans la marche à la reprise. Une discordance interne dans le style de la démarche, un contraste anachronique ou une inégalité d’appui entre les deux pieds, une gaucherie ou une pudeur mal surmontée affranchissent Anna de la discipline métrique qui produit à la chaîne le corps féminin comme spectacle. Elle chevauche le temps. Ainsi marche Anna Cruz.
Le Rythme comme répétition et comme différence
Anna Cruz est un personnage conceptuel, une personnification du concept de Rythme. Décrivant ce qu’il appelle les « masses rythmiques », Elias Canetti écrit : « Le rythme est à l’origine un rythme des pieds. Tout homme marche, et comme il marche sur deux jambes et qu’il frappe alternativement le sol de ses pieds, qu’il ne peut avancer qu’en faisant chaque fois ce même mouvement des pieds, il se produit, intentionnellement ou non, un bruit rythmique. Les deux pieds ne se posent jamais avec la même force. La différence peut être plus ou moins grande entre eux, selon les dispositions ou l’humeur personnelles[1] ». La répétition rythmique n’est pas une répétition mécanique, elle est dédiée à une différence de potentiel constituante qu’elle déploie continûment. La différence rythmique est la différence entre un temps fort et un temps faible. Mais un temps fort ne se réduit pas au battement isochrone de la mesure, il est la pointe créatrice d’un événement. La force est une intensité. L’intensité rythmique de la Gradiva – « celle qui marche » – est dans la position étrange du pied de la jambe qui reste en arrière, dont la plante se relève verticalement à chaque pas. Contrairement à l’interprétation freudienne, ce motif obsessionnel n’est pas répété à l’identique à travers le temps, de l’enfance de Norbert Hanold jusqu’à Pompéi. On ne répète pas parce qu’on refoule[2]. Comme dans le film de Raymonde Carasco, le rythme vif du pied soutire au contraire au motif de marbre une série différentielle de poses et de détails intensifs, aux vitesses inégales. Il le répète à chaque fois comme différent. Même dans les masses les plus organiques, la différence s’instille toujours entre les pas et dérègle la marche du dedans. Le rythme est par essence boiteux, aksak.
Notre vie est faite de rythmes. Ce ne sont pas seulement les cycles cosmiques et biologiques. Nous vivons à cheval sur des périodicités incommensurables. Notre concept de Rythme n’est plus le concept romantique qui a connu une vogue intellectuelle au début du XXe siècle, à un moment de l’histoire européenne où la mutation sociale en cours conditionnait des réactions communautaires néo-pythagoriciennes (chez Matila C. Ghyka) ou irrationalistes (notamment en Allemagne, chez Ludwig Klages, Wilhelm Fliess ou Rudolf Bode[3]) contre le capitalisme. Nos fêtes se sont désancrées du solstice. Même dans les clichés publicitaires, nous ne pouvons aujourd’hui plus sérieusement voir le Rythme comme une eurythmie collective avec les cycles de la terre, du cosmos et avec la pulsation universelle de la Vie. Au cours de son histoire, l’émancipation de la différence au cœur du concept de Rythme l’a peu à peu rapproché de sa plus grande intensité, en libérant la répétition de sa soumission à l’identité. Anna Cruz est de notre temps, elle passe à contretemps du pouvoir. Son talon haut rationalise la bizarrerie aristocratique du pied de Gradiva, dressé sur la pointe de ses orteils, mais elle devient en même temps par là androgyne et d’autant plus martiale, Mars gradivus, son pied d’autant plus érectile, comme dans le tableau d’André Masson. Par ses singularités, elle fait régner l’inégal dans la mesure ; anacrousique, elle instaure le suspens du temps comme premier, donne sa force rythmique au temps faible. Paradoxalement, l’arythmie apparaît désormais comme la source du rythme : « le rythme est l’Inégal ou l’Incommensurable[4] ».
Il ne fait pas école comme en 1900, par des institutions de danse, de gymnastique ou de « rythmique » qui le mettent en application. Mais il y a néanmoins une présence diffuse et erratique du rythme dans la théorie des sciences et des arts de notre temps[5]. Gaston Bachelard puis Henri Lefebvre ont fixé le cadre général de la rythmanalyse, à la frontière de la science et de la poésie[6]. Quelle peut être la fécondité de cette méthode transdisciplinaire pour l’intelligibilité du fait politique contemporain ?
Dans notre modernité avancée, le fait rythmique du pouvoir ne consiste pas seulement dans une accélération uniforme du temps social, comme on a tendance à le dire trop facilement. L’accelerando est une variation du tempo, non du rythme. Dans les cultes de possession, par exemple dans le motif adarum du candomblé de Bahia, le rythme qui accompagne la transe ne se réduit ni au profil heurté du motif en lui-même, ni à l’accélération des tambours qui l’actualisent. Il faut qu’en cours d’accélération, la répétition soit tout à coup entrecoupée de « brisures rythmiques », « feintes » du tambourinaire, « cassés » qui « interrompent le mouvement de la danse et suscitent un état de paroxysme propice aux crises de loa[7] ». D’une manière analogue, Hartmut Rosa montre que chaque accélération du tempo social s’accompagne nécessairement pour nous de décélérations immanentes (slow food, slow travel, slow sex, slow living, etc.) et de « contrecoups dysfonctionnels[8] ». Le rythme n’est jamais simple, il consiste dans un écheveau de tempi inégaux. C’est précisément dans les interstices du pouvoir que peuvent battre à contretemps les intensités existentielles.
Par une ambivalence tactique, le rythme est donc à la fois instrument du pouvoir et vecteur des élans qui lui résistent. Ce sont ces deux traits du Rythme que je voudrais successivement esquisser.
Polyrythmie
I. La répétition rythmique n’est ni métronomique (linéaire), ni périodique (cyclique). Mesure et périodicité ne sont que les enveloppes extérieures d’une polyrythmie fondamentale.
Un métronome peut très bien ne mesurer aucun rythme. Le fonctionnement à vide des feux de circulation la nuit, quand il n’y a aucune voiture pour s’arrêter au rouge, constitue une mesure sans rythme, une répétition tournant sur elle-même. Dans l’administration de nos vies, une répétition ainsi mécanisée perd sa vitalité. Pour autant, le rythme ne s’oppose pas à la mesure, elle lui sert au contraire de point d’appui matériel pour investir son énergie. La mesure mécanique des feux est le pivot par où se croisent les flux automobiles. Une intempérie, une irrégularité (brûler le feu rouge) introduisent dans le rythme l’aléa essentiel qui le déphase de la mesure, comme Charlot de la cadence de la chaîne de montage. Les flux rythmiques ont-ils leur raison dans la périodicité, par exemple l’alternance jour/nuit ou travail/repos ? Les phénomènes de masse sont prévisibles, les heures d’embouteillage sont déterminées par les cycles sociaux. Mais la périodicité collective est une abstraction, elle émerge d’un brouillard de rythmes disparates qui frottent les uns contre les autres.
Par exemple une ville est traversée de forces géophysiques, historiques, politiques, économiques. Un corps social se constitue dans le rapport conflictuel de ces forces pulsatiles – ou pulsions – qui le traversent. Henri Lefebvre oppose ainsi les villes océaniques, pulsées par le cycle lunaire des marées, et les villes méditerranéennes où domine le cycle solaire. Mais ce contraste entre deux types de périodicités n’est pas à lui seul déterminant, car les déterminations physiques se redoublent d’un investissement politique de l’espace. Dans les villes méditerranéennes solaires, l’État n’a pu pénétrer au cœur de la cité que par des interventions discontinues, en s’intercalant dans le rythme traditionnel des échanges commerciaux et symboliques. Elles contrastent ainsi avec les villes océaniques du Nord, moins rituelles, plus civiques, où les relations plus abstraites ont permis au pouvoir public de se séparer réellement du domaine privé et de structurer la vie sociale de manière plus régulière, plus métrique. Le temps social d’une ville est scandé par le type d’alliance – plus rituelle au Sud, plus contractuelle au Nord – qui passe dans le quotidien pour organiser les relations humaines. Mais le contraste pénètre ainsi à l’intérieur même des villes méditerranéennes, par exemple Venise, qui théâtralise sa lutte intérieure entre l’État qui cherche à marquer l’espace, et les citoyens qui se l’approprient par toute une série de libres pratiques temporelles[9]. D’une manière générale, le rythme d’une ville est hétérogène, à cheval sur les pulsations d’un corps physique et politique. La monorythmie tue la vie. Ainsi quand une ville traditionnelle ne conserve plus assez de vitalité pour absorber le tourisme moderne en le moulant sur ses propres rythmes, c’est le tourisme qui désormais défait sa polyrythmie fondamentale en lui imposant une mesure homogène, transformant peu à peu la ville en une série de sites sclérosés, comme à Paris la Tour Eiffel[10].
Même si la chronobiologie maintient la norme de l’eurythmie par sa recherche de synchronisateurs exogènes (le cycle circadien, la photopériode) ou d’oscillateurs endogènes (les horloges biologiques), les rythmes du monde ne se présentent plus pour nous en bouquets, mais en paquets[11], enchevêtrés, épinglés les uns sur les autres, parfois contradictoires entre eux, dénués de toute finalité ou harmonie préétablies. La durée est toujours plurielle, à plusieurs vitesses. Le temps ne passe jamais brutalement d’un rythme à un autre, sans chevauchement entre eux. On continue à vivre sur des habitudes rythmiques longtemps après que le contexte où elles ont été contractées est révolu. Notre vie pulsionnelle oscille entre la tension projective et la compulsion de répétition qui interdit la détente, dans ce que Freud appelle un « rythme-hésitation » douloureux. L’angoisse est le symptôme de notre impuissance commune à réinvestir dans le présent la pulsation des pulsions fixées. Mais ces rythmes-fantômes ne sont pas seulement des mécanismes inertes, ils peuvent servir de support à un nouvel élan qui se les réapproprie pour une autre finalité. Historiquement, il y a ainsi toujours recouvrement et interférence entre des rapports politiques et sociaux qui ne s’ajustent pas. Il appartient certes à l’essence même du pouvoir capitaliste que de mécaniser le temps social au « rythme » de la production, soumettant la force de travail à une alternance périodique anabolisme/catabolisme. Mais le temps social ne coïncide pas exactement avec la pulsation économique. Dès la préface du Capital, Marx note : « outre les maux de l’époque actuelle, nous avons à supporter une longue série de maux héréditaires provenant de la végétation continue des modes de production qui ont vécu, avec la suite des rapports politiques et sociaux à contretemps qu’ils engendrent[12] ». Le temps social introduit toujours un décalage entre les infrastructures et les superstructures, qui interdit de voir le progrès comme linéaire et univoque. Il est du même coup hâtif de considérer que le pouvoir néolibéral casserait nécessairement les héritages sociaux, les traiterait comme des archaïsmes ; il utilise au contraire les contretemps et les anachronismes à ses fins, n’accélère ses flux qu’en prenant appui sur les conservatismes et les principes juridiques inertes du passé. Par exemple le contrôle légal du téléchargement, déphasé de l’actuelle production musicale immatérielle, est cautionné par le vieux principe libéral de la propriété, qui sert d’alibi théorique à la circulation du capital dans le réseau de l’industrie culturelle.
Dans nos sociétés, le primat de l’économique sur le social a substitué au rythme inégal du don et du contre-don la commune mesure capitaliste de l’échange. Cela ne détruit pas pour autant la polyrythmie. La montée de la biopolitique a superposé à la cadence capitaliste tout un éventail de procédures rythmiques qui à la fois l’ont renforcée et diffractée. La naissance des milieux d’enfermement dans les sociétés modernes (collège, puis caserne, usine, hôpital) ne s’est pas seulement faite par l’organisation panoptique de l’espace, mais aussi par une rationalisation métrique du temps, dont les sonneries et les horloges de pointage sont les instruments. L’anatomo-politique elle-même est rythmique : c’est toujours par la répétition qu’on plie un corps à une norme, rester assis sur sa chaise, se tenir droit, etc. La production rythmique de l’individu assure depuis le XVIIIe siècle son oscillation métronomique à travers la discontinuité du réseau disciplinaire, de l’école à l’usine et à l’atelier. Mais à mesure que le contrôle a pu s’étendre technologiquement hors les murs, de nouvelles procédures, plus continues, plus fluides, se sont greffées sur les mécanismes de gestion isorythmique, sans les remplacer. Un « temps liquide » passe dans le temps solide des institutions. Par exemple à l’école, les élèves continuent d’être soumis au vieux découpage métrique du temps discontinu, tout en se connectant d’une heure à l’autre à un temps public et perpétuellement présent grâce à leurs i-phones, « surfant » sur un flux continu d’informations et de savoirs parcellaires. Il est réactionnaire de dénoncer ce parasitage du temps scolaire par une temporalité venue du dehors, en souhaitant un retour à la discipline. Avant même d’être d’ordre symbolique, le malaise du corps enseignant s’explique d’abord rythmiquement, par une discordance temporelle entre la polyrythmie réelle de la vie scolaire et la représentation disciplinaire anachronique qui continue de l’encadrer. Pédagogiquement, il s’agit plutôt d’expérimenter les manières dont le temps fluide peut prendre appui sur le temps solide, se rythmer avec lui en étant structuré par sa division métrique, le traverser sans le liquider.
Suivant le mot de Marx et Engels, le capitalisme volatilise certes tout ce qui est solide, mais il ne renonce pas pour autant aux choses. La marchandise comme objet fétiche masque la réalité des rapports sociaux de production en les réifiant. Plus profondément encore, la rythmanalyse révèle que la production elle-même est un processus. La matière de nos rapports sociaux n’est pas dotée d’une solidité substantielle ou structurelle (la lutte des classes), elle est métastable. Il y a toujours un autre rapport potentiel qui couve sous l’état solide des rapports sociaux. Le pouvoir, loin d’être monolithique, est la gestion différentielle de la multiplicité des tempi sociaux. Le biopouvoir ne se contente pas de nous aligner sur des rythmes isochrones. Il peut tout autant nous fluidifier que nous cristalliser, détruire les périodicités culturelles ou traditionnelles, nous déstructurer dans un temps non pulsé. Toutes ces procédures rythmiques, d’abord essaimées dans la société réticulaire, s’articulent peu à peu entre elles suivant des visées stratégiques qui les codent rétroactivement : les structures institutionnelles cristallisées, par exemple étatiques, servent de support tactique à la fluidification sociale, et les flexibilisations rendent possibles les cristallisations juridiques et structurelles qui les normalisent. Mais le cristal est toujours apériodique : l’unité stratégique du pouvoir étant toujours a posteriori, elle n’est du coup jamais close, jamais parfaitement cohérente. Le pouvoir ne connaît pas l’homogénéité. Il comporte toujours des porosités et des plis. En même temps que le pouvoir, une théorie processuelle et pluraliste modifie la forme des pratiques de liberté.
Microrythmie
II. Le Rythme n’est pas une structure transcendante, il coule dans une microrythmie, en nouant les uns aux autres des « instants critiques » qui sont les points de passage d’un devenir.
Par exemple le cœur est constitué de nœuds qui conduisent l’influx nerveux, nœud sinusal, nœud d’Atchoff Tawara qui le reprennent et le relancent. Le rythme cardiaque est en outre constitué par les points d’irrégularité, ectopiques, extrasystoliques, qu’il raccorde les uns aux autres à l’intérieur de fractions de durée métriquement égales.
Mais ces points singuliers de fluxion ne prennent sens que dans une émotion qui fait soudain battre le cœur autrement, qui transfigure le quotidien. Non seulement les repères métriques (les « temps » de la mesure) sont des coupes immobiles du mouvement rythmé, mais les motifs rythmés sont eux-mêmes des coupes mobiles dans une transformation qualitative. Une accélération de tempo n’est qu’une variation quantitative mesurable en battements. Elle ne devient rythmique qu’à condition que la différence de degré atteigne un point critique où elle coïncide à une différence de nature entre deux états que le rythme raccorde l’un à l’autre. Tout rythme a ses échangeurs ou ses tourniquets, comme les escaliers dans les villes escarpées du Sud, qui, rythmant la marche dans la cité, font la transition entre les espaces hétérogènes de la ville haute et de la ville basse, du privé et du public. Le rythme nous transforme. L’individuation est rythmique. Le rythme n’est pas seulement assujettissement, mais appropriation subjective des cadences qu’il fait frotter les unes sur les autres.
La vie des sociétés primitives est rythmée par les « rites de passage ». Mais que veut dire ici « rythmée » ? Le retour périodique du rite n’est que l’extérieur du rythme. Arnold Van Gennep a montré que le processus d’un rite de passage s’analyse en trois phases : une phase préliminaire de séparation de l’individu, puis une phase liminale où il se tient à la marge ou sur le seuil d’une renaissance, et enfin une phase post-liminaire d’agrégation[13]. L’individu est d’abord séparé de son état antérieur, avant d’être agrégé à son état nouveau, qualitativement distinct du premier état. Mais le point intense du rite est la phase liminaire pendant laquelle l’individu est en suspens entre deux états, à cheval entre deux phases. Le rite donne ainsi une consistance à la transition en elle-même : le passage n’est pas seulement le néant qui sépare deux états, il est l’être même du devenir. Un rite de passage est un processus rythmique d’individuation, non seulement parce qu’il se divise en trois phases, mais parce qu’il ne se divise pas sans changer de nature, c’est-à-dire sans se transformer à chaque coupure. De même, les rites cycliques, par exemple saisonniers, enveloppent des rites transitifs ; ils ne célèbrent pas le retour du Même, mais la jouvence du monde.
Comment nos sociétés peuvent-elles réinventer la puissance rituelle de subjectivation du rythme ? Les rythmes libres ou « idiorrythmies », comme les appelle Roland Barthes, ne sont pas hors-pouvoir. La décélération ne doit pas seulement fonctionner en « îlots », comme dit Rosa, c’est-à-dire en érigeant des forteresses de lenteur dans l’empire social de la vitesse. On n’échappe pas à la tachypsychie de la « grande ville » moderne en la fuyant à la campagne, dans des « niches territoriales » où les pendules se seraient arrêtées depuis un siècle. La lenteur n’est pas intemporelle comme le bon vieux temps, elle est intempestive : elle doit être réinventée en rapport avec le temps actuel, à contretemps. On lutte en creusant des « oasis de décélération » à l’intérieur même de l’espace urbain, comme autant de pores et de plis dans l’architecture de la vitesse. Les rythmes libres ne sont pas seulement des marginalités, mais sont noués avec le pouvoir contre lequel ils luttent. Par exemple la fluidification du temps de travail (on travaille le dimanche et les jours fériés), renforcée par le dispositif technologique (on travaille de chez soi), a détruit l’alternance périodique qui sépare travail et vacance. On ne sort plus du travail. Il n’y a plus de Sabbat. Mais, en même temps, c’est l’occasion de faire entrer la vacance dans le travail lui-même, par une sorte de suspens, de temps flottant ou gazeux qui se répand dans le temps liquide. On transporte le privé au bureau, on crée des espaces interstitiels entre les heures, entre deux portes, dans les couloirs, entre collègues, entre soi. La consistance de ces rythmes quotidiens est la matière même de nos résistances au pouvoir.
Le rythme n’est certes pas l’élément des ruptures brutales ou des révolutions violentes, mais plutôt de ce que la langue chinoise appelle les « transformations silencieuses », c’est-à-dire immanentes à la mesure et au tempo qui les encadrent, larvées, lentement infusées. Illusion des tables rases : en fait de lendemains, elles reproduisent le noyau dur de ce avec quoi elles désirent rompre. Si le rythme n’échappe à l’anesthésie qu’en se laissant animer par l’imprévisibilité du chaos qu’il organise, réciproquement, les crises et les ruptures n’échappent à la catastrophe qu’à condition de pouvoir être ressaisies dans un rythme. Les devenirs les plus puissants se font dans la répétition. Au lieu des révolutions, la liberté rythmique se conquiert par les petites différences qui émergent au sein de la répétition qu’elle investit. Anna Cruz se transforme insensiblement à travers la répétition de ses pas, devient femme d’une manière farouche et vaporeuse. Elle n’est pas d’un genre aliéné ou d’une classe dominée sans en même temps les troubler d’un style parodique. Il y a toujours un autre rythme, symbolique, qui se déguise derrière la figure actuelle qui le simule : le symbolisme pompéien du bas-relief de la Gradiva derrière le pas de Zoé Bertgang, ou les actrices américaines des années 30 derrière les femmes françaises qui marchent comme les infirmières de New York. Jeune fille empruntée, toujours au milieu entre deux catégories, elle ne fait que passer. Ainsi marche Anna Cruz.