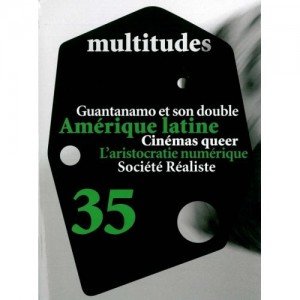Toni Negri : de la fin du socialisme à la nouvelle grammaire du politique« Que signifie construire de la démocratie et de la liberté, de l’égalité et de la richesse dans un monde que le capitalisme se croit désormais capable d’asphyxier en réduisant en cendres toute possibilité de résistance( ) ? ». Comment pouvons-nous, dans le cadre fixé par la mondialisation politique et économique, inventer des nouvelles formes de vie et d’émancipation – des espaces réels de subjectivité ? En essayant de répondre à ces questions, Toni Negri nous oblige d’abord à nous confronter au passé pour tenter de construire un autre avenir. Dans ses deux derniers ouvrages, Goodbye Mister Socialism (Paris, Seuil, 2007) et Fabrique de porcelaine. Pour une nouvelle grammaire du politique (Paris, Stock, 2006), il présente en effet une double cartographie conceptuelle, incluant en même temps une analyse de la modernité et une construction alternative de la postmodernité. Le point de départ de l’argumentation de Negri est radical : « Le monde de la subsomption réelle de la société sous le capital qui est le nôtre n’a plus aucun dehors. Nous vivons à l’intérieur – mais il n’y a pas d’extérieur ; nous sommes plongés dans le fétichisme de la marchandise – mais il n’y a pas de possibilité d’avoir recours à quelque chose qui puisse en représenter la transcendance. La nature et l’homme ont été changés par le capital( ). »
L’horizon de la subsomption réelle permet selon Negri de mettre en lumière la différence constitutive entre la modernité et la postmodernité, à partir précisément de la possibilité d’envisager une transcendance politique ou une extériorité normative par rapport aux modes de production capitalistes. Quel a été en effet le projet politique de la modernité « socialiste » ? Construire un « dehors » à partir de la nécessité d’une révolution étatique et d’un gouvernement planifié du capitalisme. L’expérience soviétique synthétise en ce sens la dynamique puissante de la modernité – le sens visible et structurel de son histoire. L’édification du socialisme réel a représenté une nécessité terrible et une épreuve extrême, à laquelle le mouvement ouvrier européen ne pouvait en aucune façon se soustraire. Le « dehors » de la révolution passait impérativement par la détermination systémique et régalienne d’une économie planifiée. On peut ainsi affirmer que le stalinisme est un phénomène interne et immanent à la modernité européenne et il ne constitue pas dans cette perspective une exception ou une erreur tragique de l’histoire. Il exprime au contraire la rationalité – dure et lucide – de la pratique révolutionnaire. Or, pourquoi cette expérience politique, totale et unique, n’a-t-elle pas produit les effets espérés ? Parce que : « Voici ce qu’édictait le système dans son illusion et sa folie : il n’y avait que sans liberté qu’on pouvait défendre la révolution. [… les dirigeants soviétiques ne sont évidemment pas tombés à cause du rideau de fer, mais parce qu’ils avaient construit une énorme intelligence collective à laquelle ils n’étaient pas en mesure d’offrir des moyens d’expression libres (j’insiste lourdement sur ce terme)( ). »
La nécessité de la révolution moderne – c’est-à-dire de la constitution d’un « dehors » capable de transformer en profondeur la réalité de l’exploitation capitaliste – a laissé passer la possibilité de définir également des pratiques innovantes de liberté. Avec la chute du mur de Berlin et la fin du « siècle bref », nous sommes à nouveau confrontés à la nécessité/possibilité de « faire de l’histoire » – de créer d’autres événements et d’inventer des nouvelles formes d’émancipation et de résistance. Quel est précisément le contexte de notre histoire présente ? Il est celui de la « biopolitique », c’est-à-dire de la postmodernité et de ses modes de production mondialisés. Nous ne pouvons plus rêver d’une « limite » externe du monde donnant un sens à la pratique révolutionnaire d’État, mais nous pouvons en revanche, dans l’immanence dense et pleine de la postmodernité, construire des formes d’action conduisant à la constitution effective d’une liberté commune et partagée. En effet, « le monde défini par la subsomption réelle de la société sous le capital coagule et neutralise sans doute les possibilités de relation, mais non pas la résistance, la liberté comme puissance ou la constitution d’un être nouveau »( ).
En s’appuyant à cet égard sur les derniers travaux de Deleuze et de Foucault, Negri opère un véritable changement de paradigme épistémologique dans la définition de l’action politique. Il s’agit en effet au préalable de faire apparaître l’implication constructive entre la biopolitique et la postmodernité. L’affirmation de la subsomption réelle déterminant les champs de lisibilité et de compréhension de la postmodernité va de pair avec le déploiement de la stratégie complexe de la biopolitique, remplaçant les procédures disciplinaires et régulatrices de l’État moderne (y compris révolutionnaire et socialiste). La stratégie biopolitique, constituée par l’entrecroisement et l’agencement des pratiques, des savoirs et des institutions, permet de retrouver, au sein même de la postmodernité, les nouveaux outils nécessaires à la définition d’une nouvelle pratique révolutionnaire. « Pour nous, la biopolitique [… est la tentative de construire de la pensée à partir des modes de vie – que ceux-ci soient individuels et collectifs –, de faire partir la pensée (et la réflexion sur le monde) de l’artificialité – entendue comme refus de tout fondement naturel – et de la puissance de la subjectivation. La biopolitique [… est le terrain retrouvé de toute pensée politique, dans la mesure où elle est traversée par la puissance des processus de subjectivation […. Si la vie n’a pas de
Cette puissance biopolitique de subjectivation est celle du travail immatériel. Negri souligne à ce propos la « réversibilité » de la biopolitique ; en effet, « le biopolitique est un contexte contradictoire dans/de la vie ; par sa définition même, il représente l’extension de la contradiction économique et politique sur tout le tissu social ; mais il représente aussi l’émergence de la singularisation des résistances dont il est en permanence traversé »( ). L’activité productive des sujets se déploie dans le contexte riche et articulé de la subsomption réelle, et c’est précisément dans ce contexte d’activité biopolitique que la puissance s’affirme et s’exprime comme travail immatériel – c’est-à-dire comme constitution de réseaux d’affectivité et de coopération. Les nouvelles formes de vie produites par la mondialisation économique sont inséparables de nouveaux modes de production : la dynamique d’implication entre ces deux facteurs détermine la possibilité d’envisager « un dispositif virtuellement antagoniste et capable de contrecarrer toute synthèse capitaliste »( ).
La puissance du travail immatériel et vivant ne représente pas en ce sens un autre « dehors » de la mondialisation capitaliste : la possibilité de son affirmation n’instaure pas une « limite » ou une fixité normatives mais au contraire une tendance « ontologique » interne à la subsomption réelle brisant à chaque instant son hégémonie. La notion de résistance acquiert tout son sens justement à partir de ce présupposé : la construction singulière et collective de la liberté dépasse sans cesse les modalités de l’exploitation capitaliste, en instaurant une stratégie de « différence créative » qui déplace de l’intérieur sa logique et sa cohérence économiques.
Comment la puissance du travail immatériel s’affirme-t-elle, quelles sont les subjectivités incarnant les formes vivantes de sa constitution ? La réponse fournie par Negri à cette question fait intervenir une double thématique : celle de la multitude et celle du commun. « La multitude n’est pas seulement un concept, mais une réalité nouvelle. La question de savoir si elle est anticapitaliste ou pas trouve une réponse non dans l’analyse du concept mais dans celle de son mouvement même […. Ce qui rend la multitude subjectivement efficace et objectivement antagoniste, c’est l’émergence en son sein du commun (aussi bien du point de vue productif que du point de vue politique) […. Le commun représente aujourd’hui la condition de toutes les valorisations sociales et, du point de vue politique, il est la forme même à travers laquelle la subjectivité s’organise. Il ne s’agit plus de rechercher l’affirmation d’une unité d’action mais de montrer à l’œuvre la cohérence d’un agencement( ) ».
L’articulation entre la multitude et le commun permet ainsi de définir ce qu’on pourrait appeler une nouvelle théorie de la puissance antagoniste. La coopération multiple du travail immatériel détermine la base objective nécessaire à l’expression constituante de la multitude – à l’affirmation de sa subjectivité. Mais cette subjectivité ne présente pas comme un « sujet » abstrait ou un universel englobant – une « classe » ou un « ensemble ». La subjectivité de la multitude traverse toutes les singularités qui la composent – dans un processus infini de variation continue. La puissance de la multitude ne peut être que commune et biopolitique : c’est dans l’extension illimitée de la subsomption réelle que la multitude invente ses formes de liberté – en prenant appui sur la coopération produite par le travail immatériel et vivant. « Le concept de multitude est celui d’un ensemble de singularités, d’un tissu coopératif entrelaçant ensemble une infinité d’activités singulières. C’est sur ce terrain qu’il s’agit précisément de reconstruire – mieux : d’élaborer – de manière ouverte le concept de commun( ). »
Les formes de la vie de la multitude ne déterminent pas une séparation entre sa puissance effective et ses modes de constitution – son travail. Le travail vivant est la puissance de la multitude – sa liberté immanente au capital, capable de produire et de créer des nouveaux espaces antagonistes. En effet, « le capital variable – c’est-à-dire la force de travail – a acquis une certaine autonomie […. Le commun, c’est la somme de tout ce qui est produit par la force de travail (Kv) indépendamment du Kc (capital constant, capital total) et contre ce dernier »( ).
Deux conséquences fondamentales s’ensuivent. Premièrement, le « commun » biopolitique de la multitude remplace désormais l’alternative moderne du public et du privé. La puissance commune de la multitude est la preuve de la crise définitive et irréversible de la forme-État moderne, fondée sur l’appropriation parallèle, privée et publique, de la richesse produite par le travail vivant. La « discipline institutionnelle » de l’Etat formalise les modalités de cette double exploitation : d’une part, par le biais du droit privé réglant les rapports entre les citoyens-producteurs, de l’autre, en instaurant une fracture superstructurelle entre leur subjectivité productive et le pouvoir du capital – le droit public. La dialectique entre le droit privé et le droit public synthétise la spécificité politique de la modernité, en tant que pouvoir étatique de médiation s’appropriant l’activité immédiate des subjectivités. Le problème qui se pose à cet égard concerne ainsi l’invention d’un droit commun de la multitude. Quels sont les nouveaux droits de la multitude ? Quelles sont les formes juridiques appropriées à la puissance commune du travail vivant et coopératif ? En effet, « le droit public se présente toujours comme une expression du biopouvoir ; inversement, le droit commun se présente toujours comme une expression biopolitique de la multitude » ; c’est pourquoi, « le droit commun n’est pensable qu’à partir de la destruction de l’exploitation – que celle-ci soit privée ou publique – et de la démocratisation radicale de la production »( ).
Les nouveaux droits communs de la multitude ne représentent pas une tentative de médiation juridique entre le privé et le public de l’État– ils s’affirment au contraire comme l’irruption de la puissance créatrice du travail vivant dans la sphère mondialisée du pouvoir impérial. Liberté de circulation, revenu garanti, accès gratuit aux nouvelles technologies, mobilité professionnelle – tels sont les droits communs qu’il s’agit de conquérir et d’inventer à travers la constitution de pratiques de résistance et d’antagonisme. Dans cette perspective, Negri insiste particulièrement sur la possibilité d’utiliser les pratiques de la gouvernance, en en renversant l’idée traditionnelle. « Il nous semble en effet que le concept de gouvernance doit s’établir totalement – et sans exception – à partir d’une pragmatique de l’exercice du commun( ). » La gouvernance peut effectivement se transformer en stratégie biopolitique antagoniste, en occupant les espaces et les domaines socio-économiques que la crise de la forme-État abandonne à la gestion capitaliste. Les formes de vie de la multitude peuvent s’approprier ces pratiques afin d’en faire des outils puissants de démocratie et de justice.
Deuxièmement, les métamorphoses de l’activité productive permettent de définir les formes d’invention du commun. Il s’agit de l’aspect sans doute le plus novateur et radical de la réflexion de Negri. « Aux transformations fétichistes du capital s’opposent les métamorphoses biopolitiques (techniques, politiques, ontologiques) de la force de travail. Si vous voulez trouver la valeur d’usage, ne la cherchez pas dans la naturalité mais plutôt dans l’histoire, dans les luttes, dans la transformation continuelle des modes de vie( ). » Negri parle à ce propos d’une « nouvelle anthropologie » de la métamorphose. En effet, « le problème d’un
Peut-on dès lors envisager une « démocratie de la métamorphose », autrement dit une démocratie absolue capable de prendre en compte, dans la constitution réelle de ses institutions, les transformations biopolitiques de la multitude ? Le pari proposé par Negri est passionnant et audacieux : il ne s’agit plus de retrouver, dans et par la pratique politique, une naturalité ou une anthropologie originaires – synonymes de « justice » – mais de traverser et de s’approprier l’artificialité et la coopération du travail vivant pour en faire la pratique démocratique de la multitude. C’est ce que Negri appelle l’« exode » : la démocratie de la multitude comme puissance constituante de la métamorphose, comme transformation incessante des « corps-affects » du travail immatériel. Il s’agit ainsi de construire un nouveau rapport entre l’affirmation des corps singuliers et leur expression multitudinaire – comme biopolitique de l’activité commune. La matérialité des formes de vie rencontre ici l’artificialité des nouveaux modes de production – pour construire une nouvelle nature humaine, biopolitique et puissante, libre et commune. Une nature humaine comme « machine de guerre » désirante et antagoniste, capable de se métamorphoser dans ses pratiques et dans ses connaissances, toujours en mesure d’inventer – contre la gestion capitaliste de la vie – des espaces communs de subjectivation. « La subjectivité politique se présente comme un corps parce qu’elle est une métamorphose permanente des corps : elle est précisément un faire. [… La subjectivité qui se fait corps politique et le corps qui se fait subjectivité politique s’immergent l’un et l’autre dans la progression du faire-multitude( ). »
Cette « nouvelle alliance » entre le social et le politique fait appel à la nécessité d’une nouvelle définition de la « décision » instituant les métamorphoses démocratiques de la multitude. Negri souligne à ce propos l’aspect novateur et anticipateur des luttes et des mouvements dans l’horizon de l’Empire. De Seattle à Paris en passant par Gênes et Davos, les multitudes produisent des « événements » d’antagonisme biopolitique brisant l’hégémonie du développement capitaliste et de ses forces de contrôle. Les décisions de la multitude instaurent la démocratie du commun, c’est-à-dire la création d’institutions reflétant les droits de la puissance constituante de la métamorphose. « Nous croyons en effet que les institutions peuvent être différentes de celles du capitalisme : elles doivent être inventées par le pouvoir constituant lui-même et en représenter le premier élément d’organisation multitudinaire […. Il nous est donc possible de formuler à partir de tous ces éléments une nouvelle définition du concept de
La nouvelle grammaire du politique proposée par Negri dans ces deux ouvrages représente un approfondissement et un développement décisifs par rapport aux thèses exposées dans Empire et Multitude. L’affirmation des formes de vie de la multitude, comme biopolitique du travail vivant, s’enrichit en effet d’une réflexion originale et profonde sur le rapport déterminant entre le concept de « métamorphose » et celui de « droit commun ». La fin définitive du socialisme moderne ouvre ainsi de nouvelles possibilités de transformation politique, liées à la définition d’une anthropologie de la puissance et d’une économie de la production coopérative.
Disponible sur le site de notre partenaire CAIRN