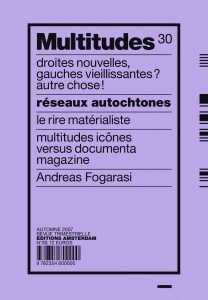Parmi les Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie, on ne discerne aucune tendance à un exode rural massif vers les villes importantes, qu’elles soient ou non sur les îles. Si une part conséquente de la population kanak urbaine réside à Nouméa, la capitale politique et commerciale, ou à sa périphérie, il y a un intense va-et-vient. De récentes études ont confirmé que les anciens modèles de mobilité persistent dans les migrations et la circulation qui relient le village de la tribu à la ville (Hamelin 2000, Naeppels 2000). Lorsque j’ai pour la première fois remarqué cette mobilité, j’ai été frappé par l’homologie d’échelle de ces déplacements pré et postcoloniaux qui régissent les modes de vie. Les gens marchaient de village en village, d’un bout à l’autre d’une vallée, pour différentes raisons sociales, économiques et politiques. Cela prenait un jour ou deux. Aujourd’hui, grâce à l’infrastructure automobile, cela prend un jour ou deux pour traverser l’île entière, rendre visite et revenir. Les gens continuent de voyager, de circuler et de s’arranger pour être à la maison quand il le faut. Plus ça change[2] …
Tout cela soulève un ensemble de questions :
Tout d’abord, comment l’« indigénité »[3] est-elle à la fois enracinée dans des lieux particuliers et acheminée de lieu en lieu ? De quelle façon pourrions nous commencer à penser la dynamique complexe du lien entre le sentiment local d’être-de-la-terre-comme se-sentir-chez-soi (local landedness) et l’expansion des espaces sociaux ? Devrions-nous penser ces situations indigènes au regard des phénomènes de diaspora ? Ou bien existe-t-il des formes spécifiquement indigènes de constituer une diaspora, de vivre la dialectique entre urbanité et ruralité, d’être simultanément en et hors du point d’ancrage, ou encore d’expérimenter des origines insulaires et continentales ? Il y a bien sûr de réelles tensions dans les rapports reliant les différentes localisations indigènes. Mais comme le suggère la recherche de Murray Chapman sur la « circulation » dans les îles Salomon et au-delà, nous devrions nous méfier des oppositions binaires entre la maison et l’ailleurs, ou de la succession entre un avant — la vie villageoise — et un après — la modernité cosmopolite[4] . À mesure que nous tentons de saisir tout l’éventail des manières indigènes d’être « moderne », il est essentiel de considérer la récurrence des modèles de visite et de retour, de désir et de nostalgie, et de connexions conçues dans des rapports de distance et de différence.
De nombreuses questions concernent également les relations entre l’« extrémité » et le « centre ». Comment devons-nous concevoir l’étendue d’une région autochtone, d’un « Pacifique autochtone » ? Quelles sont les traditions et pratiques qui permettent de se sentir ancré sans être localisé, sans être restreint ? Je pense toujours à Black Elk, le chaman sioux et catéchiste catholique, voyageant dans sa jeunesse avec Buffalo Bill à Paris (un arrêt que Tjibaou fera plus tard à l’occasion d’un autre détour indigène). Black Elk dit quelque chose comme : « Harvey Peak[5] est le centre du monde. Où que vous soyez peut être le centre du monde. » Dès lors, comment les gens en mouvement emportent-ils leurs racines avec eux en « cosmopolites ancrés », comme les nomme Kwame Anthony Appiah[6] ? Et en l’absence d’une maison, y a-t-il des manières spécifiquement indigènes de percevoir les maisons ?
Enfin, toutes ces questions en soulèvent une autre : jusqu’à quel point les notions d’indigénité et d’affiliation à une origine peuvent-elles être développées, avant de perdre de leur spécificité et de tomber dans les formes les plus généralisantes des discours « postcoloniaux » sur le déplacement ? Dans cet article, nous allons nous trouver parfois sur la frontière fertile (qui ne constitue pas, selon moi, une ligne clairement définie) entre des affiliations « indigènes » et « diasporiques » et des identités. J’espère que nous fixerons et explorerons activement, sans faux-fuyant, la tension mutuellement constitutive des vues et des expériences des indigènes et de la diaspora. Nous avons besoin de nous frayer un chemin tortueux entre les séductions d’un pluralisme postmoderne et immature, et les dangereux conforts offerts par l’exclusivisme des définitions soi-autre.
En considérant les « études culturelles du Pacifique autochtone sur l’extrémité », nous devons nécessairement tourner notre attention vers le dynamisme indigène, l’interaction, les manières de résider-dans-le-voyage. Mais il est tout aussi important de se rappeler qu’être « autochtone », dans un sens plus que local, ne signifie pas sacrifier ses attachements à un ou plusieurs lieux — l’ancrage permet de se sentir chez soi dans un monde d’interdépendances complexes. Black Elk, d’une manière ou d’une autre, parvint à emmener Harvey Peak avec lui quand il vint à Paris. David Welchman Gegeo[7] a souligné les attachements profondément ressentis pour les milieux insulaires par les Océaniens qui, comme lui, vivent à l’étranger. L’exemple des « oscillations kanak »[8] peut aussi nous rappeler que l’« extrémité » du « Pacifique autochtone » n’est pas l’enjeu d’un dialogue toujours situé « là-bas », à des milliers de kilomètres des centres insulaires. En Nouvelle-Calédonie, Nouméa marque une puissante « limite » d’un certain type de Pacifique autochtone. La ville a longtemps été une enclave blanche. Mais cette limite a fini par entrer en contact, dans un mouvement de va-et-vient, avec la tribu[9] (les sites physiques de la coutume[10] , la vie coutumière). Pour Tjibaou et nombre de ses compatriotes, il n’a jamais été question de choisir l’un ou l’autre, la ville ou la tribu, la tradition ou la modernité, mais de maintenir une interaction supportable au sein d’une lutte continue pour le pouvoir.
Être à l’aise[11] dans le monde contemporain, en tant que Kanak, signifiait vivre et travailler à la fois au village et en ville. Les politiques culturelles indigènes que Tjibaou avait adoptées prirent un forme décisive en 1975 lors de l’événement du festival Mélanésie 2000 — dont le nom appelait à s’engager activement dans la construction du futur. Le festival agit à de nombreux niveaux : un renouveau des échanges intertribaux d’histoires traditionnelles, de danses et d’alliances qui se font en public ; l’émergence d’une articulation de l’identité « kanak » au niveau de la Nouvelle-Calédonie et des îles Loyauté ; la démonstration de l’étendue de la culture « mélanésienne » pour les spectateurs de la Nouvelle-Calédonie européenne, de la France néocoloniale, des autres nations du Pacifique et des institutions internationales telles que les Nations unies. Tjibaou insista sur le fait que le centre culturel qu’il envisageait (qui aujourd’hui, après son tragique assassinat, porte son nom) devait être situé à Nouméa, la ville coloniale hostile. Les politiques d’identité culturelle et politique, telles qu’il les voyait, travaillaient toujours sur les frontières. Et, comme Alban Bensa l’a montré, le Centre culturel Jean-Marie Tjibaou est, dans son design spatial même, un ensemble articulé, juxtaposant et connectant, non sans tensions, la coutume[12] avec le monde transnational de l’art et de la culture[13].
Alors que nous pouvons observer les vies du Pacifique autochtone dans leur « extrémité », en des lieux tels qu’Auckland, Oakland, Los Angeles, etc., il faut nous rappeler que les limites, soit les frontières gardées et traversées dans le mouvement de ces vies autochtones, ne sont pas uniquement là-bas dans ces lieux comme la Californie (chevauchant le rebord du Pacifique, comme Vincent Diaz nous le rappelle toujours). Les limites et les frontières sillonnent la région, définissant différentes conjonctures : locales, nationales et régionales ; urbaines, rurales et l’entre-deux ; coloniales, néocoloniales, postcoloniales.
Cela m’amène à mon point central à propos de l’« indigénité » contemporaine — sa nature « articulée ». Je vais explorer quelques-uns des avantages et des limites de la théorie de l’articulation pour les « études culturelles du Pacifique autochtone » émergentes, soupesant la possibilité de translater des notions comme articulation et diaspora depuis leur localisation dans l’Atlantique Nord vers les espaces et les histoires du Pacifique. Dans un souci de clarté, nous devons pour commencer faire des distinctions claires, des oppositions que j’aurai besoin de brouiller par la suite. La notion de sites articulés de l’indigénité conteste deux argumentations souvent faites aujourd’hui à propos des mouvements tribaux contemporains :
D’un côté, les approches de l’articulation remettent en cause le présupposé qui veut que l’indigénité soit essentiellement fondée sur des attachement primordiaux, transhistoriques (les « lois » ancestrales, les traditions continues, la spiritualité, le respect pour la Terre-Mère, etc.). De telles conceptions ont tendance à masquer le pragmatisme et l’entremêlement des expressions contemporaines des politiques culturelles indigènes. D’un autre côté, la théorie de l’articulation trouve tout aussi réducteur de voir les revendications indigènes, ou des Premières Nations, comme le résultat d’une politique de l’identité « postmoderne » apparue après les années 1960, (les appels à l’ethnicité et à l’« héritage » de groupes fragmentés fonctionnant comme « traditions inventées » à l’intérieur du capitalisme tardif et du multiculturalisme marchandisé). Ce point de vue écarte les longues histoires de survie et de résistances indigènes, les liens transformatifs avec des racines antérieures et extérieures au système-monde. Nous devons, je pense, rejeter fermement ces explications simplistes — tout en examinant la part de vérité contenue dans chacune d’elles. Penser l’« indigénité » comme « articulée », c’est avant tout reconnaître la diversité des cultures et des histoires qui aujourd’hui expriment leurs revendications sous cette bannière. Au juste, qu’est-ce qui unit les Hawaïens (dont l’histoire inclut un État monarchique) aux groupes bien plus petits d’Amazonie ou de Nouvelle-Guinée ? Qu’est-ce qui relie les activistes pan-mayas aux Amérindiens étatsuniens qui gèrent les casinos ? Qu’est-ce qui unit la nouvelle province inuit autonome du Nunavut aux revendications territoriales des Aborigènes et Insulaires du Detroit de Torres (plutôt, par exemple, qu’au tout aussi fort régionalisme catalan, ou peut-être à ces formes d’autonomie qui émergent en Écosse ou au Pays de Galles) ? Qu’est-ce que les peuples « tribaux » d’Inde ont en commun avec le Grand Conseil des chefs de Fidji ?
Je ne pense pas que nous puissions arriver à dresser la liste des caractéristiques essentielles des articulations « indigènes ». Historiquement, la fabrique du commun est plus contingente, mais non moins réelle. Les mouvements indigènes se sont édifiés par un ensemble enchevêtré d’expériences le plus souvent reliées aux relations avec les impérialismes euro-américain, russe, japonais, etc. Tous contestent le pouvoir assimilationniste des États-nations, et revendiquent intensivement l’autonomie ou d’autres formes de souveraineté. Au cours des dernières décennies, des discours positifs sur les alliances indigènes ont émergé, les plaçant sous un ensemble de catégorisations conjoncturelles comme les différents mouvements pan-indiens, pan-aborigènes, pan-mayas, ou de l’« Arctique indigène », mais aussi comme le réseau étendu des coalitions du quatrième monde. Ces discours se propagent aussi à travers d’autres réseaux comme ceux des Nations unies, des organisations non gouvernementales ou encore relevant du tourisme. Aujourd’hui, un quantité d’idéologies en vogue expriment des notions positives de l’« indigénité », idées qui en retour nourrissent les traditions locales.
Voir de telles chaînes d’équivalence (qui doivent toujours minimiser ou taire les différences saillantes) comme un phénomène articulé ne revient pas à les voir comme inauthentiques ou « seulement » politiques, inventées ou opportunistes. L’articulation, telle que je la comprends, évoque un sens plus profond du « politique » en tant que processus producteurs de consensus, d’exclusion, d’alliance et d’antagonisme, processus inhérents à l’organisation de la vie dans toutes les sociétés.
Traduit de l’anglais par Martin Préaud
Futurs traditionnels
Comme l’évoque l’historienne hawaïenne Lilikala Kame’eleihiwa, « il est intéressant de noter qu’en hawaïen, le passé se dit Ka wa mamua, ou “le temps devant ou avant”. Tandis que le futur, quand jamais on y pense, se dit Ka wa mahope, ou bien “le temps qui vient après ou derrière”. C’est comme si le Hawaïen s’inscrivait solidement dans le présent, le dos au futur et les yeux fixés sur le passé, en quête de réponses historiques aux dilemmes du présent. Une telle orientation est d’ordre éminemment pratique pour le Hawaïen, car le futur est toujours inconnu alors que le passé est riche en gloire et en savoir »[15].
L’image du recul vers le futur rappelle le fameux « Ange de l’Histoire » de Walter Benjamin[16] . Mais les différences sont parlantes. Contrairement à l’ange de Benjamin, le Hawaïen de Kame’eleihiwa ne fait pas face à un passé fait de ruines. L’image engage plutôt une tradition socio-mythique génératrice, « riche en gloire et en savoir ». Plus significatif encore peut-être, il n’y a pas l’implacable « vent » du Progrès qui pousse l’ange à reculons vers le futur. Le temps n’a pas de direction unique ; violent, il ondule assez ingénieusement entre les dilemmes du présent et les réponses remémorées : une orientation pragmatique et non pas messianique.
Pour le mouvement hawaïen moderne, une tradition dynamique implique de nombreuses activités : l’intensification de la culture du taro dans les enclaves rurales, le rétablissement et l’adaptation du hula, le renouvellement du savoir et de la langue autochtone dans les écoles charter[17] (où l’on enseigne aussi les mathématiques et la chimie), la mobilisation des médias pour les actions politiques, l’affirmation d’un espace dédié aux « épistémologies indigènes » dans les universités séculaires, la connexion de rythmes de reggae à des paroles souverainistes… La tradition n’est pas un retour systématique sur les façons de faire du passé, mais une sélection pratique et un retissage critique des racines. Les rôles changeants des genres le démontrent clairement, ainsi que les engagements dans le christianisme, la politique nationale et les coalitions indigènes transnationales. Ces stratégies, ainsi que de nombreuses autres, trouvent leur unité grâce au recours à la généalogie et sont enracinées à travers leur attachement à la terre. Au sein des mouvements indigènes contemporains, certains essentialismes sont adoptés tandis que d’autres sont rejetés. Les pratiques de revendications culturelle / politique médiatisent les différences de région, de génération, de genre, de location urbaine / rurale, et de stratégie. Ce qui est en jeu, c’est le pouvoir de définir la tradition et l’authenticité, de déterminer les relations à travers lesquelles l’identité autochtone est négociée dans un monde changeant.
Les mouvements indigènes contemporains ont dramatiquement renversé le dualisme moderniste binaire, insufflant un nouveau dynamisme à sa partie « arrière ». À terme, peut-être que les mots de modernité / tradition pourront être abandonnés. Mais afin qu’une telle transcendance devienne plus que théorique, il faudrait une altération radicale des relations de pouvoir matérielles qui sous-tendent le pôle « moderne » dominant et globalisant. Les gens pensent et agissent dans des situations post / néocoloniales ambiguës, dans la tension — à la fois contradictoire et synergique — entre décolonisation et globalisation. Il est crucial de rouvrir la problématique vécue de la tradition pour comprendre ce malaise : un monde en désordre où les fondamentalismes, les chauvinismes ethniques et les étalages touristiques se multiplient parallèlement au renouveau des Premières Nations et à la mobilisation des communautés locales, sur fond de dévastation environnementale ou de développement intrusif.
Comme le montre l’histoire des mouvements sociaux, les gens sont plus prompts à s’organiser en défense des droits coutumiers et des traditions locales que pour des solidarités de classe plus universelles ou pour les droits de l’homme. À une autre échelle, les idéologies nationales manifestent une certaine loyauté envers une communauté plus large. L’articulation de liens locaux à une mobilisation nationale est bien entendu complexe et toujours, à un certain degré, instable. Alors que les prophéties sur la chute des États-nations face à la globalisation sont clairement prématurées, les hiérarchies implicites de la période de « construction de la nation » vacillent : le nationalisme par opposition au tribalisme, les traditions « inventées » contre des coutumes locales prétendument répétitives. La fabrication, la contestation, la destruction et la refonte des traditions apparaissent maintenant comme des sources permanentes d’innovation et d’instabilité à tous les niveaux politiques et toutes les échelles spatiales. La réouverture du « problème de la tradition » répond à la désarticulation partielle (et non pas la disparition) des projets de modernisation de l’État-nation aux échelles globale, régionale et locale.
J’ai déjà montré que le langage de l’« articulation » s’attaque aux activités pratiques déconstructives et reconstructives des traditionalismes indigènes mieux que le discours démystifiant de l’« invention ». Les mouvements indigènes ne peuvent simplement se réduire à un (micro)nationalisme supplémentaire. En d’autres termes, comme les nationalismes prolifèrent, à l’intérieur et en dehors des frontières étatiques, le terme de « nation » échappe à son ancrage européen. Ceci est apparent dans les invocations contemporaines multiples et diverses du terme occidental de « souveraineté » par les groupes tribaux et les Premières Nations. La « souveraineté appliquée »[18] — pour le « pays » d’un groupe d’Aborigènes australiens, pour le casino d’une tribu de Californie, pour un nouveau territoire immense tel que le Nunavut — implique un contrôle pragmatique sur les éléments clés de la culture et de l’économie, et non l’établissement d’un État sur le modèle de la France de Bonaparte. Les sites articulés de l’indigénité forment un continuum, des déclarations d’indépendance « nationale » (ce qui est toujours un terme relatif) au contrôle des réserves, en passant par les autonomies régionales négociées et les formes de « citoyenneté culturelle » au sein de politiques pluralistes[19] .
Les traditions indigènes articulées incluent des institutions comme le novateur powwow nord-américain, un circuit pan-indien qui retravaille et hybride les danses et l’apparat des Indiens des Plaines dans divers contextes locaux : réserves tribales, rodéos, campus universitaires. Participants et spectateurs de différents horizons se réunissent lors de telles performances, et il est important de distinguer, entre les différents niveaux qui sont en jeu, des « intérieurs » et des « extérieurs » toujours relatifs. Il en va de même avec les nouveaux musées et centres culturels tribaux qui prolifèrent aujourd’hui de par le monde, à la fois par l’expression de la fierté et du patrimoine locaux, par des sites dédiés à des projets d’histoire orale et de réaffirmation de la langue, et par des destinations dans le réseau en développement du tourisme culturel. Les formes renouvelées, adaptées, de l’art indigène, montrent les mêmes complexités multidimensionnelles. D’ailleurs, le terme « art » est le fruit de traductions et d’articulations perpétuelles (y compris de désarticulations, comme nous allons le voir bientôt ; car tous les masques ou images tribaux ne peuvent être librement promus dans ce contexte esthétique). Les artistes autochtones exploitent, et sont exploités, par les nouveaux marchés de l’art, tout en créant des œuvres pour des contextes familiaux et cérémoniels. Et au vu de la valeur croissante qui est accordée à leurs productions culturelles dans les contextes nationaux et internationaux, les autorités tribales doivent lutter contre les détournements, affirmant leur « souveraineté » sur des éléments de leur patrimoine détenus par d’autres. Cela implique souvent un processus d’arrachement et de rattachement de ces objets et de leur sens, projets d’une tradition dynamique qui retravaille son histoire coloniale de façon critique.
Dans cette perspective, Andrea Laforet s’intéresse aux négociations contemporaines entre les Premières Nations canadiennes et les musées, qui portent sur la propriété, la préservation et l’exposition des objets tribaux. Elle montre comment les appréhensions indigènes du rapport entre les histoires et les objets diffèrent des conceptions qui gouvernent la collecte, la conservation et l’interprétation scientifiques occidentales. Il ne s’agit pas tant des histoires racontées à propos des objets, que du fait que les objets sont des instances performatives de ces histoires. D’après cette ontologie, les histoires (recadrées et redites) sont permanentes, les objets éphémères. Ainsi, pour les peuples comme les Nisga’a du nord de la Colombie-Britannique, l’idée qu’une collection d’objets puisse représenter, de manière fixe ou permanente, une culture passée ou sa tradition, n’a que peu de sens. Les objets n’ont de signification que pour les sociétés dynamiques, changeantes.
La tradition, d’après Laforet, est ainsi redéfinie en tant que « pratique historique ». Le mot « historique » tel qu’elle l’emploie libère la tradition Nisga’a de toute association avec un passé mythique et ritualisé, la plaçant dans le cadre ontologique de « ce qui s’est réellement passé et qui continue de se passer » — ce que les Occidentaux nomment « la réalité historique ». Mais comme elle le montre avec finesse, la traduction en question est elle-même historique, le résultat de négociations et de conflits pratiques et interculturels. Que cela soit dans les salles d’audience des revendications foncières, au cours des négociations de rapatriement, ou lors de discussions collaboratives sur les façons dont les objets des collections muséales peuvent être interprétés, un processus d’apprentissage et de désapprentissage est en cours. Des mots comme Tradition et Histoire perdent leur sens et leur fonction de « termes de traduction »[20] . Preuve en est le jugement crucial de Delgamuuku par la Cour suprême du Canada, qui donne aux histoires orales indigènes le même statut qu’aux autres sources documentaires. En Australie et en Aotearoa / Nouvelle-Zélande, des développements similaires transforment les salles d’audience en sites de traduction pratique. Les notions occidentales fondamentales d’objectivité, de fait, de propriété et de linéarité temporelle commencent à faire place à la redistribution et à la coexistence d’interprétations d’une validité ontologique différente, mais équivalente[21]
Au cours du processus de traduction et de négociation, les deux traditions, indigène et occidentale, articulent de nouveaux domaines de pratique. Et alors qu’avec la restitution des terres tribales ou le rapatriement de restes humains et d’objets culturels, il y a un véritable renversement du sens de l’histoire linéaire, progressiste / destructrice du colonialisme et de la modernisation, ces « pratiques historiques » ne peuvent pas nous faire revenir en arrière. Elles revisitent et re-racontent des passés traumatiques afin de les redresser (partiellement). Les ré-enterrements guérissent les survivants qui doivent persévérer dans leur vision de la vie moderne. De la même façon, le fait de ramener des objets claniques et tribaux distants « chez eux » permet d’aller de l’avant. La construction prévue d’un « bol commun Nisga’a », un centre culturel dans la Vallée de Nass afin de « créer un dépôt public permanent pour ce qui était traditionnellement fait pour être connu et manipulé par des individus ou par certains lignages » montre la réarticulation sélective de la tradition en formes « tribales » novatrices qui fonctionnent au sein de sphères publiques régionales et nationales changeantes. Andrea Laforet laisse entrevoir la possibilité d’un modus vivendi post-assimilationniste : des pratiques de traduction qui vivent et laissent vivre, des traditions séparées mais en lien. Le fait que des sociétés autochtones du Canada exercent de réelles pressions dans les cours, les musées nationaux et autres arènes publiques, montre clairement le dynamisme de « pratiques historiques » contradictoires d’une modernité complexe. Ceci n’est pas le retour à un « tribalisme » atavique, ni le fait d’une acculturation ou, comme les analystes critiques de la postmodernité ont tendance à le défendre, de sociétés tribales s’accommodant du programme néolibéral multiculturel et ethnique. Les deux perspectives passent sous silence les politiques dynamiques de contestation, de traduction et d’articulation que Laforet décrit comme « des pratiques historiques qui reconnectent le très nouveau avec le très ancien ».
Traduit de l’anglais par Jessica De Largy Healy
Notes
[ 1] Extrait de « Indigenous Articulations », The Contemporary Pacific, vol. 13, n°2, automne 2001, p. 468-490.
[ 2] En français dans le texte (N.d.T.).
[ 3] Comme nous avons choisi de traduire le terme « indigeneity » par « indigénité », nous traduirons le plus souvent le terme « indigenous », non par « autochtone », mais par « indigène » (N.d.T.).
[ 4] Chapman, Murray, « On the Cross-Cultural Study of Circulation », in International Migration Review, 1978, n°12, et Chapman, Murray, « Pacific Island Movement and Sociopolitical Change : Metaphors of Misunderstanding », in Population and Development Review, 1991, n°17.
[ 5] Harvey Peak se situe dans les Badlands du Dakota du Nord.
[ 6] Appiah, Kwame Anthony, « Cosmopolitan Patriots », in Pheng Cheah et Bruce Robbins (dirs.), Cosmpolitics : Thinking and Feeling Beyond the Nation, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998.
[ 7] Welchman Gegeo, David, « Cultural Rupture and Indigeneity : the Challenge of (Re)Visioning “Place” in the Pacific », The Contemporary Pacific, automne 2001, vol.13, n°2.
[ 8] Il s’agit des difficiles négociations pour sauvegarder cultures et langues kanak dans la situation post et néocoloniale qui entraînent le jeu politique des alliances et des compétitions aussi bien en interne qu’avec l’extérieur pour leur reconnaissance aboutissant entre autres à un modus vivendi (N.d.T.).
[ 9] En français dans le texte (N.d.T.).
[ 10] En français dans le texte (N.d.T.).
[ 11] En français dans le texte (N.d.T.).
[ 12] En français dans le texte (N.d.T.).
[ 13] Bensa, Alban, Ethnologie et architecture : le Centre culturel Tjibaou, Société nouvelle Adam Biro, 2000.
[ 14] Extrait de « Traditional Futures », in Mark Phillips et Gordon Schochet (dirs.), Questions of Tradition, University of Toronto Press, 2004. James Clifford s’appuie ici principalement sur la recherche d’Andrea Laforet présente dans le même volume.
[ 15] Lilikala Kame’eleihiwa, Native Land and Foreign Desires, Bishop Museum Press, 1992, p. 22-23.
[ 16] Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », trad. M. de Gandillac, in Œuvres, Gallimard, t. 3, 2000.
[ 17] Écoles sous contrat (N.d.T.).
[ 18] Mark Maccaro, « Applied Sovereignty », communication pour la conférence « Sovereignty 2000 : Locations of Contestation and Possibility », Native American Studies Research Cluster, Université de Californie, Santa Cruz, 19 mai 2000.
[ 19] William Flores et Rina Benmayor (dirs.), Latino Cultural Citizenship : Claiming Identity, Space, and Rights, Beacon Press, 1997.
[ 20] James Clifford, Routes : Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Harvard University Press, 1997.
[ 21] Robert Layton explore cette problématique dans un contexte aborigène : « Representing and Translating People’s Place in the Landscape of Northern Australia », in Alison James, Jenny Hockey et Andrew Dawson (dirs.), After Writing Culture, Taylor & Francis, 1997, p. 122-143.