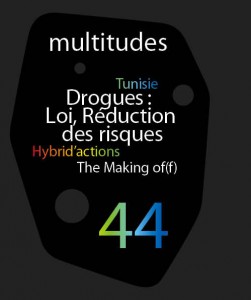« L’opium agrandit ce qui n’a pas de bornes,
Allonge l’illimité,
Approfondit le temps, creuse la volupté,
Et de plaisirs noirs et mornes
Remplit l’âme au-delà de sa capacité. »
Charles Baudelaire, Le Poison
Depuis les attentats du 11 Septembre, l’Afghanistan est considéré comme une pièce maîtresse des déterminants de l’équilibre mondial. Sur ce pays se cristallisent de multiples questionnements et enjeux contemporains : le rôle et le fonctionnement du système onusien et de la coopération multi- et bilatérale, la signification d’une présence militaire étrangère en appui à une stratégie de reconstruction, la nature des relations entre États du Sud et États du Nord, le sens des conflits irréguliers et du terrorisme, qui échappent aux conventions internationales formelles et informelles et la place des ONG internationales, en particulier occidentales.
Tous ces sujets ont fait l’objet de nombreuses analyses, mais de temps à autre, de façon discrète, moins visible qu’Oussama Ben Laden, les talibans ou les attentats meurtriers à Kaboul et la mort de soldats français, pointe la question des drogues, en l’occurrence celle du pavot à opium et de l’héroïne. On peut parfois lire dans la presse qu’un champ d’opium a été brûlé, que des projets de cultures de remplacement dans le cadre de programmes de développement rural sont envisagés. On voit aussi poindre de-ci de-là un reportage sur les terribles conditions de vie des héroïnomanes de Kaboul. Mais ces éclairages partiels apparaissent comme des prurits, disparaissant aussi vite qu’ils sont survenus. Surtout, personne n’a encore établi de lien entre, d’une part les dossiers inscrits à l’agenda national et international concernant l’Afghanistan et, d’autre part, la question des drogues considérée dans sa globalité, c’est-à-dire à la fois sous l’angle de la production et de la consommation.
Nous sommes ainsi régulièrement inondés d’une litanie de chiffres pour décrire le « drame afghan ». Les dégâts humains : mort de près d’un million d’Afghans, trois millions de blessés et mutilés, un million de personnes déplacées à l’intérieur du pays et plus de cinq millions de réfugiés à l’extérieur (soit un quart de la population). Les données économiques et sociales : un pays classé aujourd’hui à l’avant dernier rang sur l’Indice de développement humain, avec une majorité de la population illettrée et vivant avec moins de un dollar par jour, la destruction des infrastructures agricoles et industrielles ainsi que la disparition des forêts, la dislocation du tissu social. Et, bien sûr, les chiffres concernant les drogues : l’Afghanistan produit aujourd’hui plus de 90 % de l’opium mondial mais aussi de l’héroïne, qui est raffinée sur place ; les revenus tirés de la production et du commerce de l’opium et de ses dérivés représentent environ 50 % du PNB afghan…et, plus récemment, la population de consommateurs problématiques d’opium et d’héroïne atteindrait le chiffre de plus de 1 million de personnes pour une population totale de 28 millions d’habitants.
Mais quel est le sens de cette succession de données quantitatives et qualitatives, qui nourrissent de très nombreux rapports depuis trente ans, si aucun lien n’est établi entre eux, en dehors de l’exposition usuelle des conséquences des conflits ? Surtout, comment analyser les raisons qui ont conduit et conduisent toujours à un tel drame si l’on ne se pose pas la question des clés de lecture de la situation afghane ?
Comment lire le « cas afghan » à partir d’un élément principiel qui ferait sens pour relier toutes les composantes de ce tableau apocalyptique et pour comprendre l’enlisement du pays et ce afin d’élaborer une stratégie efficace de sortie de crise ? Cette question dépasse les oppositions binaires classiques, de type « militaire versus civil », « urgence versus développement », « sécurisation du pays versus reconstruction »…qui ne peuvent permettre de comprendre la situation et de dégager de véritable stratégie pour sortir du guêpier inextricable dans lequel les Afghans et le monde s’enfoncent, comme en témoigne l’augmentation régulière du nombre de morts parmi les soldats afghans et internationaux, les insurgés et les civils depuis 2006.
L’introduction d’une approche de Réduction des risques dans le pays, à l’initiative de Médecins du Monde depuis avril 2006, nous offre la possibilité de comprendre l’Afghanistan différemment.
Du carrefour des civilisations au carrefour des opiacés
• Dans l’espace-monde, l’Afghanistan a souvent occupé une place de « carrefour », soit zone tampon à la périphérie d’empires, soit zone centrale, au cœur de royaumes indépendants – certains d’entre eux étendus sur des surfaces très importantes incluant la Perse, l’Inde et l’Asie centrale. Gengis Khan, au XIIe siècle, et Tamerlan, au XIVe siècle, traversent cette histoire.
Sa situation géographique centrale, au carrefour des mondes chinois, indiens et euro-méditerranéens, fait de l’Afghanistan un enjeu géopolitique : son territoire s’impose comme stratégique pour le contrôle des routes commerciales ou l’accès à d’autres territoires. Pour cette raison, les empires russes et britanniques se sont opposés tout au long du XIXe siècle autour de l’Afghanistan dans le cadre du « Grand Jeu » décrit par R. Kipling (les Russes cherchant au sud l’accès aux mers chaudes, les Britanniques cherchant au nord à consolider leurs possessions en Inde et les intérêts commerciaux associés).
Alors que ses frontières bordaient l’URSS, l’Afghanistan s’est maintenu, pendant la guerre froide, comme zone tampon entre l’Est et l’Ouest. Et c’est bien cette place dans le contexte géopolitique mondial qui sera à l’origine du drame afghan. Le Premier ministre, Daoud, qui avait renversé en 1973 le roi Zaher Shah pour installer une république parlementaire, subit lui-même un coup d’État en 1978 organisé par les communistes, constitués en parti politique dès 1965, et instrumentalisé par l’URSS. Les luttes internes et les faiblesses du nouveau gouvernement rendent très vite impopulaires les communistes et conduisent les Soviétiques à intervenir militairement en Afghanistan pour sauver le régime. Le 27 décembre 1979, l’Armée rouge envahit le pays, ce jour constituant le point formel de départ des trois décennies de guerre.
L’Afghanistan, carrefour des civilisations, fournit un terrain d’affrontement privilégié aux États-Unis de Reagan en lutte contre « l’Empire du mal », l’URSS : y voyant l’occasion de faire tomber la forteresse rouge, ils décident de soutenir les Moudjahidines afghans, qualifiés de « combattants de la liberté ». Toutes les espérances américaines seront réalisées : le dernier soldat soviétique quitte l’Afghanistan en février 1989 mais ce départ préfigura l’effondrement de l’URSS et du Bloc de l’Est, symbolisés par la chute du Mur de Berlin en novembre de la même année.
• Succès mais à quel prix ? Pour financer l’effort de guerre, les fonds de la CIA et les livraisons de missiles Stinger par le biais des services secrets pakistanais ne suffisent pas. Les États-Unis vont alors fermer les yeux sur l’utilisation des opiacés comme source de financement, fidèles à leur stratégie d’instrumentalisation du trafic d’héroïne pour déstabiliser des régimes politiques qui n’ont pas l’heur de leur plaire. L’un des plus célèbres – et des plus violents – chefs de guerre impliqués dans ce trafic, Gulbuddin Hekmatyar, est toujours aujourd’hui un des acteurs du jeu politique afghan, allié aux talibans. Les laboratoires de production d’héroïne vont alors se multiplier sur la frontière pakistano-afghane, dont la matière première sera de plus en plus issue des cultures locales d’opium. Un indicateur indirect de cette intense activité est le développement rapide et massif d’une « épidémie » d’addiction à l’héroïne chez les Pakistanais. Autre indicateur, plus direct celui-là, la production d’opium en Afghanistan : elle va passer de 250 tonnes en 1979 à 1 200 tonnes en 1989. De la même façon que l’héroïne est entrée dans les veines des Pakistanais, la production et le trafic des opiacés s’introduisent comme une variable majeure du cas afghan. Il est assez ironique de noter qu’une des autres variables majeures nées de cette histoire s’appelle Oussama Ben Laden et Al-Qaïda. En effet, les « Arabes », comme les appellent les Afghans, se joindront d’autorité à ce « combat de la liberté » américain, profitant de cette opportunité de s’introduire dans le jeu afghan.
• Le départ des Soviétiques va très vite précipiter le désintérêt des Américains pour l’Afghanistan, dépourvu de tout enjeu géostratégique une fois le Bloc de l’Est tombé. C’est le début d’une guerre civile entre les Moudjahidines et le gouvernement communiste de Kaboul, jusqu’à la chute de ce dernier en avril 1992, puis entre les Moudjahidines eux-mêmes pour le contrôle de Kaboul et du territoire afghan. Cette guerre intestine se terminera avec la prise du pouvoir par les talibans (apparus dans le jeu afghan en 1994 lorsqu’ils prennent le contrôle de la zone de Kandahar dans le sud du pays). La population, épuisée par quinze ans de conflit et écœurée par les comportements prévaricateurs des différentes factions, remettra son destin entre les mains de ces « étudiants en religion » qui promettent paix et justice sociale. Les coulisses de cette période sont instructives : pour pallier l’absence des ressources américaines, les différentes factions vont toutes se livrer à une intensification de la production et du trafic d’opiacés. La production d’opium saute ainsi à 3 400 tonnes en 1994.
• L’arrivée au pouvoir des talibans, contrairement aux idées reçues, ne modifiera pas cette escalade dans la production d’opium. De même la période s’ouvrant le 7 octobre 2001 avec la déclaration de guerre au gouvernement taliban par la coalition de forces internationales (conduite par les États-Unis), ne changera rien à la question, au contraire, et ce malgré les déclarations offensives d’éradication des cultures d’opium. L’Afghanistan, sous la présidence de l’allié Karzaï, battra en 2007 le record de production d’opium, avec 8 200 tonnes…
Le pays est ainsi devenu, au cours de la période, le carrefour des opiacés, d’où provient la quasi-totalité de l’opium et de l’héroïne consommés dans le monde. Au fil des différentes périodes : guerre contre les Soviétiques (1979-1989), guerre civile (1989-1996), régime taliban (1996-2001) et conflit actuel depuis 2001, la drogue s’est installée au centre du système afghan.
La drogue, épine dorsale de l’Afghanistan
De ce point de vue, l’analyse de ce que représente la « drogue » en Afghanistan dépasse largement le cadre des approches géopolitiques classiques de type « drogues et conflits », pour lesquelles le trafic de stupéfiants ne constitue qu’une des dimensions, souvent marginale, associée à une situation de guerre ou d’insurrection. En Afghanistan, la « drogue » telle que nous l’avons définie se situe au cœur de toutes les activités, reliant tous les maux diagnostiqués, tout à la fois construction sociale, économique et politique :
• En termes politiques notons tout d’abord l’incurie d’un État corrompu et incompétent aux services instrumentalisés à des fins de prébendes par les représentants des familles des clans dirigeants. Cet État délégitimé, lui-même gangrené, au plus haut niveau, par le trafic de drogues, ne peut exercer aucune autorité en matière de contrôle des drogues, et ce d’autant moins qu’une partie grandissante du pays est sous le contrôle des insurgés.
• En termes économiques, deux niveaux se superposent : premier niveau, une économie légale ne reposant que sur l’aide internationale, déversée par milliards de dollars au gré des conférences de pays donateurs. Les premiers bénéficiaires de cette économie sous perfusion sont les Afghans corrompus, occupant des postes clés pour les allocations de ressource et prélevant leur dîme au passage ; puis les sociétés privées et autres consultants, à qui sont directement attribués des fonds alloués dans le cadre de la stratégie de reconstruction ; mais aussi – ne nous le cachons pas – de nombreuses ONG qui bénéficient de délégations de services publics, dans le cadre de contrats gouvernementaux, en contradiction totale avec leur volonté affichée de construire et renforcer les capacités afghanes.
Deuxième niveau, une économie illégale mais bien réelle, celle de la drogue. Elle intègre les opérations de la production de la matière première (opium) à la fabrication du produit fini (héroïne), les relations commerciales entre ces différents opérateurs, l’organisation du marché national et international de l’offre du produit fini (des quantités massives au commerce de détail). Il convient de rajouter les mises en réseau qu’elle nécessite, l’achat des protections destinées à garantir la sécurité des différentes étapes, dont les taxes sur les cultures, sur les récoltes, sur les stocks de marchandise et les droits de passage au profit des différents intervenants en conflit (que l’on pourrait considérer, d’un strict point de vue économique, comme une charge de fonctionnement), l’approvisionnement en capitaux initiaux (par exemple pour les cultivateurs) et l’écoulement des profits, c’est-à-dire la structuration d’une économie mafieuse reposant en particulier sur le blanchiment de l’argent, en Afghanistan et ailleurs, etc..
Face à ce désastre nourrissant les inégalités économiques et sociales en Afghanistan l’État est incapable, au-delà de ses faiblesses intrinsèques, de se construire puisque lui échappe ce qui constitue traditionnellement le levier de la puissance pour un gouvernement : la ressource fiscale. Dans une économie dominée par les drogues, donc illégale par nature, il est bien évidemment impossible de construire un système fiscal et donc de prélever le moindre impôt. En revanche, cette taxation existe, mais elle est appliquée par le mouvement insurrectionnel et sert au financement du terrorisme. Il est couramment admis que les revenus tirés par les insurgés et les groupes terroristes de la taxation des opérations de production et d’échange liées aux drogues s’élèveraient à plusieurs centaines de millions de dollars par an. Les drogues et la déstructuration de l’État et de l’économie entretiennent un lien incestueux qui obère toute possibilité de reconstruction et de développement.
• En termes sociaux la drogue en Afghanistan contribue à la destruction du tissu social et des individus. Évidemment, trente années ininterrompues de conflit ont engendré des conséquences terribles sur l’organisation de la société : déliquescence du système social permettant aux différents groupes et ethnies de communiquer et d’échanger ; il ne peut plus servir de rempart là où l’État et les institutions s’avèrent défaillants. Plus terrible encore, les violences physiques et morales endurées par les Afghans durant cette période ont nourri des comportements de survie ; la préservation de son propre intérêt, à commencer par sa vie, l’emporte sur toute considération collective. Ces conduites se traduisent, d’un point de vue strictement médical, par une forte prévalence des co-morbidités psychiatriques dans la population générale. Situation d’autant plus préoccupante que l’Afghanistan est un pays jeune, où les deux tiers de la population ont moins de trente ans c’est-à-dire n’ont connu que le conflit. En l’absence d’un système de santé publique capable de traiter les souffrances de la population, les opiacés fournissent un bon médicament dépresseur. Là réside certainement une des causes majeures des addictions en Afghanistan.
Ne disposant plus des filets de protection étatiques ou traditionnels, les Afghans livrés à eux-mêmes se tournent de plus en plus vers les drogues. Dans ce cadre, les seules réponses fournies ont longtemps consisté en des programmes alliant répression et sevrage obligatoire, sans respect des protocoles médicaux, promus par la communauté internationale et mis en œuvre par des équipes afghanes sans compétences en matière de prise en charge des addictions. Là encore nous retrouvons un problème majeur auquel est confronté l’Afghanistan : un manque de compétences dû à la déscolarisation ou à l’impossibilité de suivre des formations techniques ou universitaires sérieuses pendant toutes ces années de conflit.
De ce fait, le pays risque d’affronter un mal supplémentaire, qui au-delà de ses conséquences purement humaines constituerait une menace pour toute stratégie de reconstruction et de développement : les épidémies de sida et d’hépatites. Ces virus hautement transmissibles par le partage des matériels de consommation de drogues, se répandent très rapidement, dans un premier temps parmi les usagers de drogues eux-mêmes (ainsi que nous l’ont montré les modèles épidémiologiques de l’Asie centrale, de l’Asie du Sud-est et de l’Europe de l’Est). Puis, une fois le seuil de contamination franchi au sein de ces groupes dits à risque, il se diffuse progressivement dans la population générale, en particulier par voie sexuelle. Un tel scénario viendrait ruiner le système de soin afghan, incapable de couvrir les besoins liés à la prise en charge de ces pathologies en termes de ressources humaines et financières. Il affaiblirait surtout les forces vives de l’Afghanistan, sur lesquelles repose l’avenir du pays.
Que l’on se situe sous l’angle de la production ou sous celui de la consommation, l’Afghanistan paie le prix fort de la politique internationale de contrôle des drogues.
Une norme internationale puissante,
hypocrite et délétère
Comme toutes les parties afghanes en conflit, les talibans ont largement utilisé les ressources de l’opium pour financer leur lutte armée (en complément du soutien apporté par les services secrets pakistanais), puis leur État. En 1999, l’Afghanistan a produit 4 600 tonnes d’opium, soit deux fois plus que trois ans auparavant, lorsque les Talibans ont pris la ville de Kaboul et établi leur pouvoir sur le pays. Et le décret promulgué par le mollah Omar le 27 juillet 2000, interdisant la culture de l’opium, n’y change rien. Ce fut le subterfuge adopté par les talibans pour se faire tolérer par les États du Conseil de sécurité. Là encore, il n’est point question de morale ou de religion, mais d’intérêt bien compris, d’un côté comme de l’autre. Car si l’ONU et les États membres ont régulièrement menacé les talibans en raison de leurs méthodes barbares, ils étaient surtout préoccupés de pousser le régime à contrôler sa production d’opium. De ce point de vue, il est intéressant de constater que l’Office des Nations Unies de lutte contre les Drogues et la Criminalité (ONUDC) est la seule agence des Nations Unies qui n’ait jamais quitté le pays durant la période talibane…Cette stratégie de la reconnaissance internationale par le biais de l’édit de juillet 2000 n’a pas suffi à contrebalancer la réaction bushienne à la suite des attentats du 11 Septembre[1] !
Deux enseignements majeurs peuvent être tirés de cette histoire : la politique de contrôle de l’offre a généré le développement de zones illégales de production et l’essor d’économies mafieuses. La répression de la consommation de drogues illicites, a systématiquement poussé les utilisateurs aux marges des systèmes légaux et sociaux, établissant ainsi un terrain propice à toutes les prises de risques.
La courbe de production de l’opium augmente inexorablement depuis toutes ces années. Les stratégies d’éradication des cultures échouent totalement. Posons donc la vraie question : pourquoi, malgré la présence des plus fortes puissances militaires mondiales, malgré l’injection de fonds faramineux dans la reconstruction de l’Afghanistan, malgré tous les mécanismes de contrôle, pourquoi la courbe ne peut-elle s’inverser ? Pourquoi la drogue reste-t-elle la cause de tous les maux afghans, et ce faisant, du monde ? La politique internationale des drogues constituent la cause principielle de la situation inextricable actuelle en Afghanistan.
L’application aveugle de la logique répressive crée la valeur économique, à la source de tous les autres maux identifiés plus haut. D’autre part, la politique de contrôle de la demande, fondée également sur la répression, constitue un danger majeur, pour le pays. Supprimer cette logique reviendrait finalement à éliminer la cause principielle car, à toutes les étapes de la chaîne, ce sont bien les risques pris à enfreindre la politique internationale qui sont rémunérés.Supprimer cette logique aurait pour conséquence immédiate de supprimer la source des revenus illicites, l’opium perdant sa valeur économique associée à son statut illégal. Produire ne présenterait plus d’intérêt économique. Plus d’intérêt à produire, donc plus de nécessité d’envoyer les soldats de l’ISAF (Force d’Assistance Internationale à la Sécurité, dont la France est membre) se faire tuer dans les champs d’opium du Helmand. Plus de valeur économique donc plus de circuits financiers nourrissant l’économie mafieuse et les groupes armés. Plus de production illégale et de commerce parallèle, donc moins de pertes de potentiel fiscal pour l’État afghan. Et aussi, bien sûr, la fin de la répression des usages privés de drogues associée à moins de risques sanitaires et sociaux pour les Afghans et un pays qui ouvre la voie à une prise en charge médicale pragmatique (faire avec les usages pour réduire les risques plutôt que lutter contre) dont l’efficacité a été maintes fois démontrée au niveau international.
De l’intérêt de la Réduction des risques en Afghanistan
Jusqu’à aujourd’hui, l’objet social drogue est considéré soit comme une contrainte d’environnement, soit comme une variable secondaire d’ajustement. Il doit devenir la variable principale.
C’est exactement sur cette orientation que Médecins du Monde a conçu son programme Réduction des risques en Afghanistan. Outre la promotion d’une stratégie de santé offrant des soins et des services sociaux efficaces en réponse aux besoins liés à la consommation de drogues, il s’agit aussi d’apporter la preuve qu’une rupture dans la logique de la politique internationale de contrôle des drogues (du moins d’une des manifestations de cette politique qui ont conduit les États à réprimer les usages et les usagers de drogues) est acceptable et efficace. C’est tout l’enjeu, et, de fait, il se réalise petit à petit avec l’introduction progressive de programmes d’échanges de seringues, d’antirétroviraux pour le VIH, de traitements de substitution et d’autres services médicosociaux.
Il convient, sur cette base, d’aller au-delà et d’embrasser la politique des drogues dans sa globalité. Le lien entre la politique de contrôle des drogues et la Réduction des risques devient alors évident en Afghanistan : dans le monde, la Réduction des risques constitue une rupture – la seule – avec les catégories mentales définissant la guerre aux drogues et aux drogués. Le cas afghan, lui, nous oblige, moralement et politiquement, à aller plus loin et à étendre la rupture de concept à la matrice de cette guerre aux drogues et aux drogués, c’est-à-dire à la politique internationale de contrôle des drogues, tant les conséquences sont criantes en Afghanistan. C’est le seul moyen pour sortir, selon les propos de McCoy, d’un « cycle sans fin de drogues et de morts », au rythme des années qui voient à chaque printemps se développer les graines d’opium dans les champs et les graines de talibans chez les adolescents.
Si l’on accepte cette hypothèse, il faut alors admettre que la clé de la résolution du conflit ne se situe finalement pas en Afghanistan, mais bien dans les centres névralgiques où est définie et mise en œuvre la politique internationale de contrôle des drogues, c’est-à-dire à Washington, siège de l’empire et cerveau de la politique de guerre aux drogues depuis Nixon, ainsi qu’à Vienne, siège des organes des Nations Unies en charge du contrôle. C’est en ce sens que le « cas afghan » constitue une opportunité historique et politique majeure.
Aujourd’hui, le changement de paradigme est en cours. Dans le pays pour la première fois en septembre 2010, la ministre de la Santé afghane a à adressé un courrier à son collègue du ministère des Drogues pour lui rappeler combien la méthadone constituait une priorité de santé publique face à la logique habituelle de sevrage forcé. L’introduction et l’acceptation progressive de la Réduction des risques démontrent que le changement est possible dans ce pays. Pour faire écho aux propos de Baudelaire cités en exergue, allons explorer les limites de ce qui apparaît aujourd’hui comme un horizon indépassable.