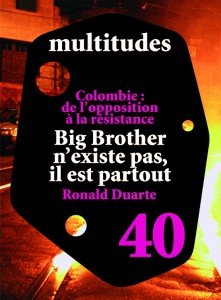Politiques d’État et migrations forcées en Colombie : cartographies historiques
Andrés Salcedo Fidalgo
Le déplacement forcé, même s’il n’a pas toujours été appelé ainsi, a fait partie, tout au long de l’histoire de la Colombie, des cartographies spatiales que les régimes coloniaux, républicains et modernes ont, tour à tour, imposé graduellement à certains groupes sociaux[1]. En assignant de manière inégale, de long en large du territoire, des hiérarchies, différences, valences bio-morales et seuils d’uniformité et d’altérité, ils ont préparé un terrain fertile pour le développement du conflit armé que le pays a vécu durant le vingtième siècle et qui se poursuit aujourd’hui.
Cet article propose quelques clés de lecture pour aider à comprendre la façon dont la mobilité des personnes a été étroitement associée avec différentes représentations et évaluations politiques et gouvernementales des territoires et des populations. Nous verrons aussi comment, entre 1999 et 2004, la confrontation brutale entre guérillas et paramilitaires qui provoqua une vague de déplacements forcés sans précédent en Colombie, coïncide paradoxalement avec l’entrée en vigueur de deux formations discursives : le multiculturalisme et le néolibéralisme. Je dirai pour finir quelques mots à propos du surgissement du « déplacement forcé » comme autre formation discursive durant le gouvernement d’Andrés Pastrana et le premier mandat d’Álvaro Uribe ainsi que de la façon distincte dont ils ont affronté le déplacement interne.
Indiens et Noirs en fuite
Durant le XVIe siècle et au début du suivant, les indigènes mitayos[2] étaient emmenés par la force pour travailler dans les mines d’or ou de sel, construire des villes (épitomés de la civilisation ibérique) et pourvoir en nourriture et services domestiques les familles espagnoles. Les indigènes en territoire conquis restaient sous la tutelle d’un encomendero ayant soin de leur éducation religieuse[3]. Celui-ci acquérait leurs services et percevait de leur part divers tributs économiques. Nombre d’indigènes s’enfuyaient et trouvaient refuge à la périphérie de la région andine où les groupes insoumis les accueillaient. On peut citer le déplacement forcé des Andaquíes qui, du Haut Magdalena, réussirent à traverser la cordillère orientale jusqu’aux grandes plaines orientales[4] ou la fuite des indigènes emberas du Chocó et guambianos du Cauca qui remontèrent jusqu’aux sources des rivières et se virent obligés de s’établir au-dessus de 2500 mètres[5]. Les esclaves d’origine africaine travaillaient pour leur part dans l’industrie minière (axe de l’économie coloniale), les haciendas et les plantations de canne à sucre des Caraïbes et de la Vallée du Cauca. Dans les zones minières, Noirs fugitifs et « marrons » cherchèrent refuge aux sources des fleuves de la région du Pacifique où ils se sont apparentés avec les groupes indigènes[6].
Ces points d’évasion contrastent avec le modèle d’organisation spatiale utilisé dans les villes durant la colonie pour imposer un ordre social et inculquer à la population « les normes de Dieu et du Roi »[7] : le centralisme et l’utilisation du dessin en damier (contenu dans les Lois des Indes occidentales) pour dessiner les villes, le contrôle des migrations ainsi que le regroupement régulier d’indigènes et de populations métisses suivant les calendriers religieux. Dans la zone andine, les colonisateurs – auto-denommés les honnêtes gens (gente decente) – exerçaient un contrôle strict sur « les gens du commun ». Les habitants des villes se classifiaient en strates et en couches sociales en fonction de leur métier, accomplissement de leur foi, lignage, lieu de résidence et couleur de peau. Par contraste, les territoires non conquis ni dominés étaient imaginés comme vides, des terres en friches et inhospitalières en attente d’être explorées, colonisées et peuplées, dont le contrôle était délégué au clergé qui se chargeait de l’éducation religieuse des natifs.
Classes dangereuses
Durant le XIXe siècle, les technologies républicaines continuèrent à situer la diversité interne dans des géographies d’inclusion et d’exclusion. La dissolution des resguardos (octrois) en 1821, fondée dans l’idée libérale qu’il fallait convertir les indigènes en nationaux, donc en propriétaires, aboutit au contraire à leur dépouillement, aux métissages et à leur débandade en désordre vers les villes. Cette population errante d’enfants et de jeunes gens fut recrutée par les différentes troupes des 52 guerres civiles qui eurent lieu au XIXe siècle[8]. Les élites politiques, admiratrices du libéralisme européen et championnes de l’ordre et du progrès, croyaient devoir corriger, éduquer et réformer les populations indigènes et noires perçues comme dispersées, désordonnées, paresseuses, ignorantes, dangereuses et sales. 75% du territoire continuait toujours d’apparaître sur les cartes nationales comme des terres en friche et dépeuplées dont les personnes fortunées, colons et commerçants, purent obtenir (grâce à la loi 61 de 1874) l’adjudication pour en extraire les ressources et entreprendre de nouvelles colonisations (d’Antioquia et des plaines orientales).
Les fractures entre protectionnisme et libre-échange, entre religieux fervents, désireux de conserver les principes et privilèges coloniaux de l’église, et ceux qui voulaient adopter les modèles républicains des lumières européennes, inaugurèrent l’antagonisme politique qui se convertit en partie constitutive de la construction de la nation ainsi que des confrontations bipartistes durant le XXe siècle. Paradoxalement, cette guerre entre filiations politiques conçues comme héréditaires faisait partie du modèle d’intégration d’un peuple résultant de la fusion de trois races originaires, avec une seule langue et surtout avec une seule et profonde racine catholique. Le bipartisme et la tutelle de l’Église se convertirent en piliers de l’identité avec comme point de mire la construction d’un noyau dur de la nationalité fondée dans l’idéologie d’une nation homogène blanche et catholique. Le système politique clientéliste, segmenté et pyramidal composé par les Libéraux et les Conservateurs, divisa les villes, les cantons et les provinces en deux couleurs, mais en même temps intégra efficacement par des liens clientélistes les caciques locaux et les agriculteurs métisses des zones andines.
Terres sans maîtres
Je laisserai ici de côté la grande diaspora interne qui résulta de la guerre bipartiste connue comme la période de la Violence provoquant 200.000 morts, un énorme processus d’expropriation des terres ainsi que l’urbanisation accélérée du pays durant les années 1950 et 1960[9]. Soulignons que les millions de travailleurs ruraux d’origine métisse et indigènes qui eurent à migrer vers les villes, contribuèrent à leur extension et urbanisation à travers le secteur de la construction (les hommes) et suppléèrent à une gigantesque demande dans le secteur des services (les femmes). Mais j’aimerais plutôt attirer l’attention sur la façon dont la machinerie bipartiste a relégué aux marges de la nation la contestation sociale et la mobilisation paysanne, durant les années 1920 sous la bannière « terres sans maîtres », puis dans les années 1960 et 70, sous la devise « la lutte pour la terre ».
Deux variantes de cette résistance ont lutté de la fin des années 1940 jusqu’au milieu des années 1960 pour une réforme agraire. D’un côté, il y avait le mouvement de résistance paysanne situé dans les régions périphériques et stratégiques de Sumapaz et Tequendama, adjacentes à Bogota, sous la tutelle du parti libéral. On y trouvait beaucoup de ceux que la presse et les élites désignaient comme « bandoleros » qui furent persécutés et assassinés ou qui se rendirent à l’amnistie générale proposée par le gouvernement militaire de 1953. D’autres descendirent la cordillère orientale, colonisant le bas des montagnes qui sépare la zone andine des plaines d’Orinoquie et d’Amazonie[10]. De l’autre côté, dans le sud du département du Tolima, un foyer insurgé d’autodéfense paysanne dirigé par le parti communiste dût fuir les opérations militaires et les persécutions de la police conservatrice vers des régions forestières, formant ce qu’un politicien conservateur nomma les républiques indépendantes qui donnèrent naissance en 1964 au mouvement aujourd’hui connu comme la guérilla des FARC.
Ce n’est pas une simple coïncidence si la violence politique a correspondu avec le développement et la modernisation le long des trois axes andins en excluant de ces processus les zones où, précisément, les mouvements d’insurrection politique avaient pris de la force. Les mouvements armés d’insurgés multiplièrent leurs fronts à partir des zones où il y avait une faible présence de l’État, utilisant la topographie stratégiquement : ils établirent des couloirs qui connectaient des zones avec un énorme dynamisme économique avec des zones de cache, d’attaque et de repli (Magdalena Medio, Sierra Nevada, Urabá, Atrato, Catatumbo, Bota Caucana) formant des autorités ou des gouvernements locaux semi-publics ou semi-clandestins et rivalisant ainsi avec quelques-unes des fonctions étatiques de fiscalité, justice et de sécurité depuis les années 1960 jusqu’à la moitié des années 1990.
Durant les années 1980, dans les mêmes régions, la culture de la coca a déchaîné une fièvre économique accompagnée d’une nouvelle vague de migration de colons métisses, dont des habitants des villes moyennes, vers ces zones de frontière. Les narcotrafiquants ont ainsi de nouveau modifié la cartographie nationale en achetant 37% des meilleures terres destinées à l’exploitation du caoutchouc, l’extraction d’huile de palme et l’élevage extensif[11]. Le paramilitarisme est né, en réponse aux menaces et extorsions de la guérilla, dans la zone stratégique du Magdalena Medio pour protéger de grands propriétaires liés au narcotrafic.
Les FARC se présentent comme « l’armée du peuple, constructeur de paix et de justice sociale qui lutte pour une distribution équitable de la richesse et le respect de l’auto-détermination des peuples ; avec Bolivar pour la paix et la souveraineté nationale »[12]. Les groupes paramilitaires se présentent comme une résistance civile armée d’honnêtes propriétaires, sauveurs de l’honneur familial, de gens raisonnables et éduqués, avec famille et enfants, des rédempteurs qui défendent celui qui a été attaqué par la guérilla[13]. À la fin du XXe siècle, les guérillas comme les paramilitaires s’étaient tellement renforcés économiquement et militairement qu’en 2001, les guérillas prirent le contrôle d’un tiers des 1100 municipalités et les paramilitaires d’autant en 2004. Ainsi, à l’aube du XIXe siècle, le mouvement d’insurgés, qui sous l’égide de Bolivar et par la souveraineté du peuple, avait proposé la construction d’une nation alternative et populaire, s’est trouvé confronté avec un groupe armé contre-insurgé appelant aux valeurs traditionnelles de la famille, de l’honneur patriotique, de la propriété, de la religion et, en général, au noyau dur de la nationalité colombienne blanche.
Émergence de la diversité nationale
Au milieu des années 1990, confluent trois processus qui vont modifier les cartographies : l’intensification du conflit armé, le discours du multiculturalisme, promettant la protection des droits culturels des groupes ethniques, et les réformes néolibérales de l’économie qui, d’un côté, restructurent les relations de travail et les modes de couverture étatiques en santé et éducation, et de l’autre, favorisent les concessions accordées à de grandes entreprises d’extraction de ressources dans des territoires où habite une grande proportion des groupes ethniques colombiens.
Déclarer la nation pluriethnique et pluriculturelle met fin au discours en vigueur depuis deux siècles qui proclamait son homogénéité ; on commence à parler de la contribution que certains groupes lui apportent en termes de diversité. Suivant les discours en vogue du multiculturalisme, les autorités nationales célèbrent en la répandant une image nationaliste, folklorique et harmonieuse d’un pays divers. Les indigènes et leurs cultures jusqu’alors perçues comme un poids lestant le développement latino-américain, commencent à être considérés comme des groupes écologiques dont le capital culturel ne saurait tarder à entrer dans le circuit des marchés. Parallèlement, la géopolitique de la guerre se concentre dans les zones où habitent ces groupes qui viennent d’obtenir des droits spéciaux, dont on exalte la relation authentique avec l’environnement et qui revendiquent désormais une revision du passé et une conception différente du développement (voir, ici, Calderón et Cano pour les Indiens, Viveros et Fuentes, pour les Afrocolombiens).
Des sinistrés aux déplacés : cartographies de l’humanitaire
Avant 1995, le terme de déplacement n’était pas du tout utilisé pour désigner les formes contraintes d’exil durant l’histoire coloniale et républicaine. L’État comme l’opinion publique y voyaient des processus démographiques liés à la migration des campagnes vers les villes (ceux qui étaient chassés des campagnes par la violence) ou des flux démographiques inévitables et même souhaitables pour l’urbanisation et la modernisation. Depuis la catastrophe d’Armero, qui résulta de l’éruption du volcan Ruiz en 1985, l’Office de prévention et d’urgences a pris en charge l’aide humanitaire de la population déplacée sur le modèle d’assistance qui avait été mis en place pour la population sinistrée. C’est sous la pression de secteurs progressistes de l’Église (représentée par la Pastorale Sociale et l’archevêché de Bogotá) et d’ONG comme CODHES que la loi 387 de 1997 a cessé de considérer le déplacement comme une catastrophe naturelle mais comme une violation des droits de l’homme et un délit[14]. Il revient alors à la Cour constitutionnelle d’obliger l’État à accomplir ses devoirs de protection envers les déplacés[15]. Toujours en 1997, se crée le Réseau de Solidarité avec une mission « préventive » et en 2000, suite au décret 2569, le Système d’Alerte Précoce identifiant les cartes de zones de réhabilitation et de consolidation avec les cartes des zones enclines à l’expulsion de populations. Le gouvernement réitérait ainsi cette association automatique entre pauvreté et violence basée sur l’idée que les populations les plus pauvres se laissent prendre plus facilement aux mécanismes violents.
Sous le gouvernement d’Andrés Pastrana (1998-2002), la population déplacée fait partie du Plan National de paix et de développement. Elle est alors perçue comme « population vulnérable ». L’afflux d’innombrables études psychosociales ancrées dans le paradigme du stress post-traumatique renforcent une perception humanitaire sur fond religieux qui voit la population déplacée dans une perspective victimologique, comme gravement affectée psychologiquement. Les négociations et les conversations de paix entre Pastrana et les FARC établissent une zone de distension de 42.000 km carrés, entre la chaîne orientale des Andes et les plaines de l’Amazonie, où l’armée n’a pas le droit d’entrer. Avec l’échec des négociations, la souveraineté du pays est mise en question pour la première fois dans l’histoire de cette cartographie de guerre et la situation s’aggrave avec l’entrée en vigueur du Plan Colombie en 2000 mis en place soi-disant pour attaquer les « causes profondes » de la violence dans le pays : le trafic de drogues et après 2001 le « terrorisme ».
Les mains propres, le regard plus droit
Le premier gouvernement d’Uribe entre en scène en 2002 avec le projet ferme de reconquérir l’image détériorée de l’armée et réinstaurer la souveraineté et la dignité perdues. Uribe annonce le Plan Patriote (18000 soldats) pour en finir avec les guérillas. Le processus de démobilisation des paramilitaires et la loi Justice et paix en 2005 contribuent à faire croire que le cours de la guerre a changé et qu’on assiste à une transition vers un régime de sécurité démocratique et libérale. Issue de cette loi qui, en pratique, fait partie d’une amnistie signée avec les groupes paramilitaires, Uribe crée la Commission de réparation et réconciliation afin de faire apparaître que celle-ci est un véritable processus de paix obtenu sous couvert du droit international. S’inaugure une nouvelle phase de fondamentalisme catholique dont les visées sont perceptibles dans la campagne lancée par la Direction nationale des stupéfiants en 2008 qui, utilisant l’image humanitaire et religieuse de l’enfance innocente, en appelle, par la voix d’une petite fille, à l’esprit et la bonté des cultivateurs de coca et d’amapola pour les persuader d’abandonner leurs pratiques criminelles, leur faisant ainsi porter responsabilité du conflit.
« Si tu ne trafiques pas la plante qui tue, tu verras un changement: tu te sentiras différent, avec le front plus haut, les mains propres, le regard plus droit ». Dans cette campagne, le message sous-jacent est celui d’une conversion quasi religieuse : ceux qui décident d’abandonner les cultures illicites pourront se regarder en face et leurs mains resteront propres. Ces personnes auront le regard plus droit (recto) qui acquiert la connotation opposée de tordu (torcido) associé, en Colombie, avec vicieux. De plus, ils acquerront l’apparence que devront avoir les nouveaux citoyens de Colombie : dignes, honnêtes et propres.
De façon similaire, Acción Social, qui remplace le Réseau de solidarité et centralise maintenant les fonds humanitaires internationaux et de l’État, promet l’assistance humanitaire à travers des discours moralistes qui diabolisent les groupes insurgés et défendent comme un bon père défend ses enfants, le prototype de nationaux travailleurs et propriétaires. Le gouvernement d’Uribe soutient que la violence qu’il appelle aujourd’hui « terrorisme » est « contrôlée »[16]. La violence et le déplacement sont désignés comme des assauts de groupes terroristes qui détruisent la vie, l’intégrité, la liberté et les biens, rejetant sur les guérillas la responsabilité du conflit armé et des déplacements forcés.
Durant le gouvernement d’Uribe, l’aide humanitaire arrive à certains endroits qui correspondent aux régions perçues comme isolées, marginales, pauvres et violentes mentionnées précédemment (Quibdó, Mocoa, Cúcuta, Apartadó, pour ce qu’il en est des antennes de la ACNUR, Agence pour les réfugiés de l’ONU) avec un code spécifique de conduite (neutralité), une éthique de travail (action sans dégâts, limiter les facteurs de risques, baisser les facteurs de stress), une vision unilatérale de progrès et de paix, un style de communication (appel à la politique de la compassion) et la présomption que les sociétés en voie de développement sont des lieux de pauvreté et de violences endémiques : « le déplacement est un symptôme du dysfonctionnement étatique et national », disaient les experts humanitaires, créateurs des droits en faveur des populations déplacés internes, Deng y Cohen en 1998. Cette coopération fonde ses actions dans l’idée que le modèle global de gouvernance néolibérale et démocratique doit se répandre et se renforcer pour assurer la protection des droits de l’homme et en particulier des minorités et populations indigènes. Acción Social fusionne avec la coopération internationale et certaines agences inscrites dans le Plan Colombie financent des programmes de Familles en action, Familles de « gardes forestiers » et familles victimes de la violence. L’aide est proposée à qui démontre un esprit entreprenant et suit les directives d’autogestion et de coresponsabilité si caractéristiques du néolibéralisme.
En guise de conclusion
En Colombie, les politiques gouvernementales pour inventer puis gérer les différences et les populations prennent forme géographiquement. Elles sont parties prenantes des inclusions et des exclusions propres à l’occupation et la construction d’un territoire toujours en train de se construire. Dans cette construction de la nation, l’antagonisme et la fuite hors du contrôle des institutions ont été des facteurs importants : les régions sous un grand contrôle politique et religieux comme la région andine ont forgé la sanglante guerre bipartiste et poussé la contestation vers les marges. La diversité culturelle et de pensée a été exclue par des mécanismes de classe et la criminalisation des mouvements insurrectionnels. La formation de cette nation a subi une direction d’État arbitraire et improvisée qui a déraciné et déplacé ses populations sans cesse. Au début du XXIe siècle, des versions divergentes de la nation et de la citoyenneté s’affrontent à un fondamentalisme sur lequel la nationalité colombienne s’est ancrée tout au long de son histoire, tandis que les revendications d’autochtonie et d’ancestralité, d’un côté, les guérillas, de l’autre, de façons diverses et parfois contraires, s’opposent au grand projet hégémonique néolibéral.
Traduit de l’espagnol par Pascale Molinier.