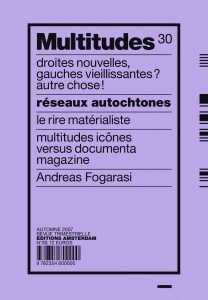« (…) il (l’ethnologue) a repris possession de la région sauvage de lui-même qui n’est pas investie dans sa propre culture, et par où il communique avec les autres »[1]. Pour Merleau-Ponty, la faculté de mettre à distance son environnement est le propre de l’expérience ethnologique. Il qualifie cette dernière d’« incessante mise à l’épreuve de soi par l’autre et de l’autre par soi »[2] . Cette conception de l’ethnologie renferme selon nous deux conséquences à pleinement considérer. La première est qu’elle propose l’expérience ethnologique comme geste de l’écart : l’expérience ethnologique établit d’une part une démarcation par l’éloignement des logiques épistémiques environnantes, au final de toute hégémonie épistémique, et compose d’autre part un espace de dialogue. L’énoncé de Merleau-Ponty induit en effet l’ouverture de l’autre, le conduisant à sa propre mise à l’épreuve. Autrement dit, avec une certaine symétrie, l’autre de la rencontre est conduit également à autre chose. Du grand pas en région sauvage à la petite secousse de la relation partagée, le geste de l’éloignement, sans être de même envergure, est ainsi commun.
D’où l’on parle : le geste de l’éloignement et la croisée des chemins
La seconde conséquence que nous pouvons tirer de cette conception est que l’ordre du discours ethnologique n’est finalement pas tant de combler les écarts que de se maintenir dedans afin d’en faire le lieu ouvert des pensées de l’écart lui-même. Se déplacer dans le lieu de l’écart pour pouvoir en parler, voilà donc la position ethnologique, mais également du même coup la position de cet autre du dialogue, afin d’élaborer un savoir qui n’est ni un savoir de l’autre en soi, ni un savoir sur soi à partir de l’autre, mais, en quelque sorte, un savoir autre, fruit de la mise à l’épreuve. Au fond, habiter sa région sauvage, ce n’est pas seulement s’ouvrir à autre chose, c’est également partager un espace de rencontre entre décalés, écartelés de tous chemins. C’est s’ouvrir à cette possibilité devenue radicale de faire potentiellement autre chose entre Autres égaux et différents. C’est cette proposition qu’apporte à la politique l’ethnologie, non comme discipline, mais comme expérience de la rencontre et de réunion dans l’espace de l’écart de la région sauvage. C’est ce qu’à leur tour et à leur manière proposent ces autres du dialogue engagé ici que sont les Peuples Autochtones[3].
Figure imposée, figure libre
Dans les hiérarchies épistémiques dominantes, la désignation Peuples Autochtones est toujours disqualifiante. Tout d’abord, dans son lien colonial aux termes Aborigène, Indigène, Autochtone, la (dis)qualification s’inscrit dans des schémas principalement évolutionnistes et racistes ; elle peut s’accompagner des gestes de l’extermination ou, dans un élan protectionniste et pastoral, d’une mise en réserve. Non seulement les connotations péjoratives de cette disqualification perdurent mais elles se renforcent d’un nouveau principe quand les acteurs disqualifiés reprennent pour eux-mêmes ces termes comme auto-identification positive et politique. Les termes deviennent alors pour les disqualificateurs synonymes de nationalisme archaïque et barbare, d’abstractions manipulatrices et falsificatrices de l’histoire, parfois tout simplement d’un déni de la vérité scientifique et de sa raison, se transformant quelquefois en leçon d’étymologie. Au regard de ce fardeau terminologique, on peut se demander si les Peuples Autochtones ne sont pas fous de se désigner comme tels !
Comme on peut le constater, la figure Autochtone a tout d’abord été une figure imposée. Elle fait partie du bagage pour ainsi dire factuel du colonialisme[4], soit une catégorisation logique d’infériorisation récurrente aux pensées coloniales et qui marque la distinction entre colonisateur et colonisé, autrement dit entre conquérant et conquis. Une manière aussi d’énoncer les bonnes origines en en faisant un régime de concurrence des appartenances. En effet, dans un surplus d’attention toute administrative, la distinction autochtone a servi d’outil analytique à l’examen des différences et des écarts civilisationnels, avec les colonisateurs bien sûr, mais aussi entre les différents groupes colonisés. Dans cette raison comparative, la figure Autochtone était paradoxalement conçue comme marque de l’extériorité barbare, elle représentait les plus barbares des colonisés, au bas de l’échelle donc, au rang où l’Autochtone est synonyme de primitif, de premier habitant non d’un lieu particulier mais du monde. La question autochtone à ses débuts est donc une affaire de temporalité, une survivance anachronique ; elle est un outil classificatoire sans grande précision, mêlant bien des groupes différents, représentants des « premiers habitants du monde ».
De ces qualifications exogènes, les groupes concernés ont bien souvent détourné l’unification classificatoire afin d’édifier et d’unifier, sous elles, les rassemblements rétifs aux mesures oppressives que celles-ci impliquaient. Si nous prenons le cas de l’Inde, les Aboriginal Tribes — comme les désignait l’administration britannique — de la région du Jharkhand forgèrent dans les années 1910, avec l’aide de quelques missionnaires bien intentionnés, le vocable sanscritisé Adivasi signifiant « premier habitant ». Cet acte n’est pas un simple geste de traduction. La traduction ne s’établit pas dans une des langues d’un de ces groupes, mais dans une langue « génitrice » de la société des castes, langue d’un Autre, donc, certes plus proche que le colonisateur britannique mais tout aussi extérieur, dominateur et colon. Ce choix de la langue de l’Autre est principalement conjoncturel. On est à l’époque où les deux grands groupes reconnus par les administrateurs britanniques — les « Hindous » et les « Musulmans » — s’engagent dans une vive concurrence pour obtenir, pour les premiers la suprématie sur l’ensemble des communautés colonisées et, pour les seconds, un régime distinctif garant de privilèges communautaires. En 1909, la communauté musulmane avait ainsi obtenu des autorités britanniques un électorat séparé afin d’avoir leurs propres représentants au sein des différents organes administratifs réservés aux Indiens. L’apparition du terme Adivasi n’a pas seulement servi à couvrir les différences effectives de chacun des groupes s’identifiant comme tels. Le terme devait simultanément unifier autour d’une communauté de destin et de luttes les groupes s’en réclamant et « autochtoniser » la catégorisation coloniale initiale pour en faire une réalité locale visible et audible. Ainsi, l’organisation au sein de laquelle avait été forgée le terme — Chotanagpur Unnati Samaj — demanda en 1927 auprès de la commission Simon, chargée des réformes constitutionnelles, la création d’un État réservé aux Adivasi du Jharkhand. Pour l’histoire, elle n’eut bien sûr gain de cause ni auprès des Britanniques ni, à l’Indépendance, auprès de la commission de réorganisation des États — Ambedkar, le père de la Constitution de l’Inde, pourtant intouchable, ne voyant pas pourquoi l’on attribuerait un État à des sauvages.
On le voit, la traduction est ici une dé-nomination, en charge de renommer le rassemblement initial d’hétérogènes sur d’autres différences, d’autres ressemblances, pour un autre but. On passe donc de la figure imposée à une figure libérée qui est encore loin de mettre en avant la relation à l’autochtonie dont le terme est porteur. Toutefois, la traduction contient déjà en substance l’écart : si une dépendance primaire lie la traduction à son référent, sa différence subalterne est aussi une condition de sa singularité et de sa potentialité d’autonomisation du sens initial translaté. Premier geste de l’écart par la langue, porteur, dans la politique de la traduction, d’autre chose.
Le mauvais esprit du colonialisme
Connu des spécialistes de la question autochtone en Inde ou des amateurs de l’histoire du hockey, Jaipal Singh est, au moment de la création de la nation indienne en 1947, l’un des grands leaders de la cause adivasi et plus particulièrement des Adivasi du Jharkhand. Il est d’ailleurs membre de l’assemblée constituante en charge de rédiger la Constitution indienne. C’est au cours d’un des débats de cette assemblée que la traduction réapparaît, cette fois sous une forme plus conflictuelle[5]. Jaipal Singh fait remarquer que le terme de Scheduled Tribes[6] ne renvoie pas à la traduction attendue et défend l’emploi du terme Adivasi :
La raison des réticences à ce terme ne tarde pas à tomber. Biswanath Das, membre du comité et ministre congressiste de l’État d’Orissa prend la parole :
À propos des États d’Europe de l’Est créés après la première guerre mondiale à la suite de l’effondrement des empires russe et austro-hongrois, Hannah Arendt avait exposé l’impasse de cette politique étatique qui condamnait des populations entières soit à l’assimilation, soit à devenir une minorité, soit à être purement et simplement des peuples sans État. Je reviendrai en conclusion sur cette dernière condition, mais retenons ici cette correspondance entre la situation à la sortie de la première guerre mondiale et la phase de décolonisation / recolonisation qui suivit la seconde. Le propos de Biswanath Das s’inscrit étroitement dans cet effet propre à la création des États-nations : sous couvert de préserver l’espace d’exercice du pouvoir du nouvel État indien de toute velléité séparatiste (la création du Pakistan ayant été vécue comme une amputation de la nation indienne), il énonce clairement qu’il ne peut y avoir différents pays d’origine et que seule compte la nouvelle géographie nationale. Les ambassadeurs indiens à l’ONU n’auront d’ailleurs de cesse de reprendre cette rhétorique lorsque les revendications adivasi, énoncées en termes d’autochtonie à la suite des autres Peuples Autochtones des différentes régions du monde, investiront ce lieu à partir de 1982 pour leur reconnaissance comme sujets autonomes relevant du droit international.
Ainsi, lorsqu’en juin 2006 se sont réunis les membres de la Commission des droits de l’homme en vue de la ratification de la Déclaration des Nations unies sur les droits de Peuples Autochtones, l’ambassadeur de l’Inde auprès de l’ONU, Ajai Malhotra, rappela que son gouvernement comprenait le syntagme de « Peuples Autochtones » (qui n’a pas comme nous allons le voir de définition) au sens donné par la Convention n° 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT), soit comme étant « les peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme autochtones du fait qu’ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d’entre-elles », et que, selon cette définition, il tenait « l’ensemble de la population de l’Inde à l’Indépendance et leurs descendants comme étant autochtones ».
Revenons sur cette lecture de la Convention 169 de l’OIT. « (…) les peuples dans les pays indépendants (…) sont considérés comme autochtones du fait qu’ils descendent des populations qui habitaient le pays (…) à l’époque (…) de l’établissement des frontières actuelles de l’État. » Si l’on devine l’intention signifiante de ce passage au (en) regard du phénomène colonial, il convient également de comprendre que cette histoire de frontières n’est pas tant géographique qu’interne à des systèmes sociaux autonomes étant assimilés à des peuples, comme l’indique la conjonction et reliant les deux conditions de la catégorie Peuples Autochtones. La frontière ténue qui sépare un Peuple d’un Peuple Autochtone est au final que ce dernier n’a pas la pleine souveraineté, malgré son autonomie interne sur l’ancrage territorial qui lui est reconnu. L’enjeu est bien cette souveraineté qui relève de l’autodétermination. En déclarant que tous les Indiens sont autochtones, Ajai Malhotra peut écarter l’article 3 de la déclaration se rapportant à l’autodétermination, qui ne concerne pour lui que « les peuples sous domination étrangère et (…) ce concept ne s’applique pas aux États souverains indépendants ou à une section de la population ou à une nation qui est l’essence de l’intégrité nationale ». L’inversion est ici intéressante. Si l’Union indienne à sa création fédère un nombre conséquent de communautés religieuses et linguistiques différentes ou de groupes sociaux aux modes de gestion distincts pour former le « peuple indien », la nation, une fois créée, ne renvoie plus qu’à un seul Peuple : celui de l’essence nationale auquel on peut adjoindre de « petits peuples » auxquels sont accordées plus ou moins d’attention ou de place par des discriminations positives ou encore la reconnaissance des droits coutumiers ou religieux dans le domaine privé, mais qui restent toujours subalternes.
De ce fait, Ajai Malhotra renvoie à l’article 3 bis de la déclaration (anciennement article 31, l’éloignement devant éviter la (con-)fusion) pour la compréhension du terme autodétermination par l’Inde. Cet article stipule que :
L’OIT s’était également prémunie contre des revendications des droits à l’autodétermination potentiellement compris dans le terme Peuple figurant dans la convention n° 169, en précisant que celui-ci ne pouvait être employé pour faire valoir ce droit de l’article 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 qui énonçait clairement que « tous les peuples ont le droit à disposer d’eux-mêmes ».
Auto-identification
Le terme Peuple n’est pas équivalent à celui de Population puisqu’il ouvre à des droits. C’est au nom de ces droits que les Nations unies se sont munies d’une Commission de décolonisation. Les Kanaks y ont fait appel avec moins de réussite que le Timor oriental. Les Peuples Autochtones ont d’ailleurs lutté jusqu’au dernier moment pour que figure ce terme dans la déclaration, plutôt que celui de population. Fait marquant, la grande partie des copies des interventions des représentants des États lors de sa ratification par la Commission des droits de l’homme comporte une correction : un s a été souvent ajouté au stylo à People pour les anglophones ; le représentant français, quant à lui, a barré population et mis peuple au début de son intervention.
Il faut bien comprendre ce mouvement de spécification. La raison autochtone a pour fonction principale la reconnaissance de l’extériorité radicale ou autonome vis-à-vis d’une entité nationale qui la contient. Elle propose une manière de nommer l’extériorité plus ou moins reconnue par l’ensemble des parts nationales. Elle crée ce glissement essentiel de relations sociales discriminantes à une politique de reconnaissance de droits. La particularité du phénomène est qu’il n’y a pas de changement objectif de statut entre les catégorisations sociales et la catégorisation politique. En cela, il existe une réelle proximité heuristique avec la situation, dès la fin du XIXe siècle, des juifs d’Europe occidentale, à cela près que le changement de statut entre les rapports sociaux de la condition d’être et leur répétition sous la forme politique est pour ces derniers imposé par l’État, tandis que pour les Peuples Autochtones il s’effectue, bien que contraint dans la terminologie, de leur propre volonté. En conséquence, la signification de cette distinction nous oblige à regarder de plus près ce glissement de la situation sociale à la situation politique et à la décomposer en fonction de la terminologie déployée. Si, dans le social, le terme d’autochtone est le marqueur de la différence et des préjugés, le marqueur du politique (au sens d’Arendt) est quant à lui le terme de Peuple, en tant que puissance potentielle de revendication de droits.
Le mouvement politique doit donc partir de ce terme ou plutôt doit y arriver, doit faire que l’on reconnaisse un Peuple. La question n’est toutefois pas tant ici de savoir philosophiquement ce qu’est un Peuple[8], mais plutôt d’interroger anthropologiquement ce processus qui pousse à se faire reconnaître en tant que tel par des semblables potentiels que sont — la différence est essentielle — les Peuples souverains.
Dans cette perspective, le phénomène autochtone témoigne que la pensée de la reconnaissance n’est pas un dialogue de peuple à peuple dans le sens où cela pouvait être le cas (non sans une surdité des plus violentes) au moment de la phase impérialiste du colonialisme, mais qu’elle doit plutôt faire face à l’heure actuelle à une configuration coloniale relevant de l’État-nation. Cette configuration déplace la négociation des statuts, elle pousse à faire des coalitions et à recourir à un tiers décideur égal ou plus fort que l’État-nation souverain. C’est du moins tout le dispositif de l’administration internationale de la gestion des rapports entre les différentes entités biopolitiques (Homme, genre, réfugiés, minorités, États, Peuples, Peuples Autochtones,…) et les instances gouvernantes souveraines (États, instances internationales, entreprises multinationales) qui, à l’opposé de la forme conflictuelle du dialogue politique, repose sur le lobbying dépolitisant des conventions de bonne gouvernance[9]. La tendance au style indirect du dialogue des dominés est ainsi une transfiguration inédite de la devise coloniale du diviser pour mieux régner. Il s’agit, à travers une multitude de dispositifs sensibles, moraux et juridiques, de faire jouer en sa faveur les différentes souverainetés existantes, et d’en rassembler le maximum. Toutefois, ce jeu n’est que la phase pour ainsi dire dialectique de la dépendance à la distribution actuelle du pouvoir où le nombre ou la force agissent comme centre décisionnel. Si la dimension politique des Peuples Autochtones est d’avoir particularisé le Peuple afin de se revendiquer comme tel pour avoir des droits et le droit suprême de décider ce qu’ils seront, l’autre dimension est la puissance même de la particularisation, qui ouvre potentiellement sur autre chose que le modèle national de la souveraineté. On pressent cette tension au sein des États qui sont non seulement contrariés par ce terme de Peuple, dont le potentiel juridique ouvrirait à des droits, et par l’inconnue de l’épithète qui lui est accolée.
Listant les points d’achoppement sur la déclaration des droits de « Peuples autochtones », l’ambassadrice permanente de la Nouvelle-Zélande auprès des Nations unies, Rosemary Banks, parlant également pour l’Australie et les États-Unis, réagit à l’absence marquante d’une définition de « Peuple autochtone » :
Clairvoyance certaine de la puissance potentielle de ce syntagme. L’insistance continue à ne pas définir « Peuple autochtone » relève du parti pris magistral de l’auto-identification. Chacun est libre de se réclamer non pas autochtone mais un Peuple Autochtone, c’est-à-dire de faire valoir radicalement son droit absolu d’avoir des points libres d’appartenance autour desquels organiser sa vie.
Autrement dit, il est donc des existences, comme celles des Peuples Autochtones, fondatrices non d’une u-topie, d’un non-lieu, mais d’une résistance aux expressions hégémoniques de la pensée du topos que l’on peut définir par ancrage, au sens où le lieu ne prend sens que des présences qui l’habitent. Si nous recourons ici à la terminologie maritime, c’est que la question de l’habitation du monde n’est pas, au sein de cette résistance, celle d’un enracinement, mais d’une navigation entre points d’arrêt, et qu’ainsi le lieu est l’autre terme pour désigner les déplacements familiers qui l’habitent et le bornent. Le lieu relève d’une généalogie des déplacements, si on entend par généalogie l’actualisation et l’activation présentes des rapports et accords passés. Ce n’est pas dans le polymorphisme des attachements au lieu en tant que tel que réside la contestation du régime dominant des configurations du topos, mais dans la reconnaissance, quelles que soient les modalités d’ancrage, du droit à déterminer librement ses relations au(x) monde(s), et donc dans la remise en cause radicale des hégémonies pyramidales et unilatérales de la configuration des ancrages, des liens et des relations.
Grandeur d’un petit geste
En 1995, comme chaque année depuis treize ans, se réunissaient en juillet dans l’hémicycle genevois des Nations unies les délégations autochtones, les organismes de solidarité et quelques représentants d’État pour faire le point sur l’avancée des travaux d’élaboration de la « déclaration des droits des Peuples autochtones » du groupe de travail de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Si les discussions au sein des groupes formels ou informels vont bon train, deux faits prédominent cette année. Le premier est sans nul doute la présence d’un petit groupe de Maohi de Polynésie française venant chercher quelques soutiens dans leur opposition à la reprise des essais nucléaires français. Un appel à manifestation devant les bâtiments onusiens contre la France n’est d’ailleurs pas allé sans créer quelques tensions diplomatiques avec cet État qui a délégué cette année une représentante, phénomène assez rare pour être mentionné. Nombre des représentants autochtones ont apporté leur soutien sans faille et se sont joints à la manifestation, faisant vibrer la place de chants mohawk. Le second événement, plus anodin et qui nous intéresse ici, vient de la présence d’une délégation de l’Interim Council of the Boer People. Comme chaque délégation inscrite, le Council a son droit de parole dans l’hémicycle pour énoncer brièvement sa situation. Au moment du tour de leur porte-parole, la grande majorité des délégations s’est levée, quittant l’assemblée le temps du discours. Cela leur a valu une protestation officielle de la délégation boer :
Il est pour nous des plus clair que ces gens sont plus intolérants et ont plus de préjugés qu’aucune personne blanche d’Afrique du Sud. Il est aussi clair pour nous que ces gens sont sectaires et racistes, au-delà même de ce que peut percevoir une quelconque personne blanche d’Afrique du Sud.(communiqué de presse, 25 juillet 1995)
Ironie de l’histoire, les Boers se trouvent pour la seconde fois dans la situation du colon colonisé. Si nous pouvons constater la persistance de la raison pigmentaire, l’événement nous dit avant tout que l’auto-identification n’oblige pas à la reconnaissance, elle laisse libres les choix d’alliances et n’interfère pas sur les prétentions de l’autre, elle induit une relation non organique. Le geste de l’ignorance ne doit pas ici être confondu avec la superfluité qui est une négation de la qualité revendiquée de l’existence à des fins de domination. Le geste de l’ignorance est un geste sans prétention qui écarte et rapproche, qui place de manière radicale l’attention dans des chemins d’alliance non impériale, il renferme en puissance la possibilité de coexistence de mondes parallèles divers.
Réseaux
Dans cette perspective, on comprend mieux l’importance des multitudes de réseaux dans lesquels se trouvent insérés les Peuples Autochtones[10]. Façonnant à partir d’intérêts communs des similitudes, ces réseaux sont autant de corps politiques protéiformes dont l’importance se situe plus dans l’organisation interne d’avantage encore que dans l’engagement externe. Les réseaux sollicitent en effet tout un dispositif d’agencements mobiles d’alliances et de relations toujours renégociables. Ils obéissent toutefois à la modélisation réticulaire des Peuples Autochtones définie par la configuration relationnelle de l’espace onusien. Chaque unité est simultanément autonome et singulière, tout en ayant pour affinité un point d’attachement particulier comme une aire géographique régionale (pensons aux différents regroupements artistiques et politiques océaniens) ou écologique, avec par exemple l’Alliance des peuples autochtones et tribaux des forêts tropicales ; un rapport historique, tels les réseaux autochtones infranationaux ou les Peuples Autochtones des pays du Commonwealth (Commonwealth Association of Indigenous Peoples) ; ou encore linguistique, comme la Coordination autochtone francophone. L’appartenance à l’un ou l’autre des réseaux n’est pas exclusive. Ce qui prédomine sont ces liens qui dessinent peu à peu d’autres modalités d’échange, d’assistance, de collaboration, de lutte. Dans un redéploiement plus global du regard sur le phénomène autochtone, ce mode de fonctionnement réticulaire apparaît comme le lieu des gestes effectifs de la construction de mondes parallèles qui luttent simultanément contre la conformation au modèle de la souveraineté qu’ils subissent de plein fouet. Ces gestes nous sont peut-être plus compréhensibles si l’on considère l’apparition du mouvement zapatiste du Chiapas. Le dialogue entre la distribution communautaire maya du pouvoir et la lutte révolutionnaire a reconfiguré simultanément les communautés au sein du mouvement, dans les relations aux femmes par exemple, et les modalités de la praxis révolutionnaire.
Ce que mettent en jeu des mouvements comme celui du Chiapas est le principe même de l’empathie solidaire dont il propose, à l’opposé, un principe d’alliance reposant sur cet appel souvent mal compris du Sous-Commandant Marcos à la constitution de par le monde de « Chiapas », c’est-à-dire de lieux en rupture avec le dedans et qui construisent une extériorité nullement « monastique » mais conditionnée par des affinités électives. La force du mouvement zapatiste est d’avoir compris que sa subsistance est liée certes à sa capacité de résistance à la répression, mais surtout qu’à moyen terme, donc dans la finalité idéologique de la lutte engagée, elle dépend de la capacité de fédération d’expériences similaires pour l’édification d’autres mondes faits de communs et de singuliers.
La politique par l’extériorité quelconque
Le nom d’écartelés peut maintenant nous servir à préciser ces formes d’engagement et de résistance productrices d’extériorité, dont une part des figures exemplaires se cache sous le syntagme Peuples Autochtones et dont d’autres parts attendent d’être pleinement constituées du côté des lieux européens du monde. Les écartelés sont ceux qui s’engagent dans un régime d’actions conduit par l’écart. L’écart implique d’être à la fois dedans et dehors : tout en étant assujetti à la structure du dedans, il s’agit de s’en défaire dans le choix de l’écart. Les deux positions s’avèrent ainsi étroitement dépendantes, et l’engagement dans l’écart souligne le fait d’être incorporé dans un dedans insatisfaisant. Le geste de l’écart est en premier lieu celui de l’élaboration des conditions d’un passage entre ce dedans et les possibilités d’en sortir, il est le décentrement vers le dehors pour accéder à d’autres lieux de possibilités.
Les situations Autochtones sont sur ce point exemplaires. Leur incorporation dans les empires puis les États-nations coloniaux ont eu pour unique fin la spoliation territoriale et leur transformation en reste plus ou moins encombrant. Devenir un reste n’est pas anodin : le reste est la trace de la situation précédente, il est ainsi l’élément toujours hétérogène à l’instant présent. Une des caractéristiques des Peuples Autochtones est ainsi d’être assignés à résider dans un dedans dont ils ne font pourtant pas partie, et d’apparaître sous le mode d’une altérité radicale qui ne compte pas ou, à l’inverse, d’être fondus dans les altérités relatives marginales composantes du dedans.
À bien des égards, ils sont la figure ultime des superflus, ces êtres qui, selon Hannah Arendt, ne comptent pas, n’ont aucun droit car ils sont privés du lieu d’expression même du droit, privés d’État. À bien des égards seulement. Si tous les environnements étatiques majoritairement ethnocidaires qui les englobent tentent sans fin de les effacer, les Peuples Autochtones ne sont pas sans lieux d’ancrage pour leur voix politique. L’a-cosmie (« être sans monde »), propre aux sans-État selon Arendt, ne peut dans le cas autochtone s’opérer car elle signifierait dès lors une autre inscription que celle de cette voix politique autochtone revendiquée. L’épithète Autochtone de Peuple renvoie en effet à un parcours complexe de jeux d’extériorisation : une extériorité de fait propre à la cosmologie de chacun de ces peuples, une extériorité de rejet propre à cette altérité radicale ressentie par les États qui la considèrent comme un reste, un résidu superflu, et enfin le choix de la transfiguration de la cosmologie de chacun en positionnement de leur voix politique. Autrement dit, pour les Peuples Autochtones, l’extériorisation initiale des discriminations devient la puissance potentielle d’énonciation de leur cosmologie comme cosmologie politique. Être autochtone, ce n’est pas tant appartenir à un lieu qu’offrir la pensée des fondements de politiques hétéroclites de l’écart et de la séparation, déjà énoncée dans l’extériorité cosmologique face aux hégémonies des modes d’administration des populations.
Bibliographie
BIBLIOGRAPHIE
 Miguel Abensour, Christine Buci-Glucksmann, Barbara Cassin, et al., Politique et pensée. Colloque Hannah Arendt, Payot / Rivages, 1996.
Miguel Abensour, Christine Buci-Glucksmann, Barbara Cassin, et al., Politique et pensée. Colloque Hannah Arendt, Payot / Rivages, 1996.
 Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme. L’impérialisme (1951), Fayard, 1982.
Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme. L’impérialisme (1951), Fayard, 1982.
 Centre tricontinental, L’Avenir des peuples autochtones. Le sort des premières nations, L’Harmattan, 2000.
Centre tricontinental, L’Avenir des peuples autochtones. Le sort des premières nations, L’Harmattan, 2000.
 Barbara Glowczewski et Rosita Henry (dirs.), Le Défi indigène. Entre spectacle et politique, Aux lieux d’être, 2007.
Barbara Glowczewski et Rosita Henry (dirs.), Le Défi indigène. Entre spectacle et politique, Aux lieux d’être, 2007.
 Maurice Merleau-Ponty, « De Mauss à Claude Lévi-Strauss » (1960), in Éloge de la philosophie et autres essais, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1989.
Maurice Merleau-Ponty, « De Mauss à Claude Lévi-Strauss » (1960), in Éloge de la philosophie et autres essais, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1989.
 Ram Dayal Munda et Sanjay Bosu Mullick (dirs.), The Jharkhand Movement. Indigenous Peoples’Struggle for Autonomy in India, Iwgia / Birsa, 2003.
Ram Dayal Munda et Sanjay Bosu Mullick (dirs.), The Jharkhand Movement. Indigenous Peoples’Struggle for Autonomy in India, Iwgia / Birsa, 2003.
 Gloria Munoz Ramirez, EZLN, 20 et 10. Le feu et la parole, Nautilus, 2004.
Gloria Munoz Ramirez, EZLN, 20 et 10. Le feu et la parole, Nautilus, 2004.
 Savyasaachi, Tribal Forest-Dwellers and Self-Rule. The Constituent Assembly Debates on the Fifth and Sixth Schedules, Indian Social Institute, 1998.
Savyasaachi, Tribal Forest-Dwellers and Self-Rule. The Constituent Assembly Debates on the Fifth and Sixth Schedules, Indian Social Institute, 1998.
 Alexandre Soucaille, « La forêt, le guerrier et les danseuses. Scènes autour de la question autochtone en Inde », in Barbara Glowczewski et Rosita Henry (dirs.), Le Défi indigène. Entre spectacle et politique, Aux lieux d’être, 2007.
Alexandre Soucaille, « La forêt, le guerrier et les danseuses. Scènes autour de la question autochtone en Inde », in Barbara Glowczewski et Rosita Henry (dirs.), Le Défi indigène. Entre spectacle et politique, Aux lieux d’être, 2007.
 Alexandre Soucaille, « Une question de point de vue. Dialectique de la tribu dans l’Inde contemporaine », in Purusartha, Éd. EHESS, n° 23, 2002.
Alexandre Soucaille, « Une question de point de vue. Dialectique de la tribu dans l’Inde contemporaine », in Purusartha, Éd. EHESS, n° 23, 2002.
 www.docip.org/HumanRightsCouncil/FirstsessionF.html
www.docip.org/HumanRightsCouncil/FirstsessionF.html
Notes
[ 1] Merleau-Ponty, 1960, p. 134
[ 2] Ibid. p. 133.
[ 3] Les majuscules servent ici à désigner l’ensemble des peuples qui revendiquent des droits sous ce terme générique, et non le rapport d’un peuple à sa propre autochtonie.
[ 4] On fait apparaître le terme en français dans les années 1560, apparition contemporaine des premières vagues d’occupation des Amériques.
[ 5] Au grand dam du gouvernement central, le hindi, langue majoritaire du Nord, ne pu être imposé comme langue nationale. L’anglais fut choisi comme langue administrative, et la constitution traduite dans les différentes langues des États de l’Union.
[ 6] Le terme de Tribes, qualifiant indistinctement au début de la colonisation britannique les castes (jati) et les groupes « Aborigènes », ne désignait plus, à la fin du XIXe siècle, que ces derniers. Dans la nation indienne, les « tribus répertoriées » correspondent donc à ces groupes identifiés comme « Aborigenal Tribes » par les Britanniques. Cette catégorisation toute administrative donne droit à des mesures de discrimination positive, à l’instar des Scheduled Castes regroupant les « Intouchables » ou selon leur propre désignation les Dalit (« exploités »).
[ 7] Savyasaachi, 1998, p. 101-108.
[ 8] La compréhension moderne se décline autour de ce cadre fixé par Valéry : « Le mot peuple (…) désigne tantôt la totalité indistincte et jamais présente nulle part ; tantôt le plus grand nombre, opposé au nombre restreint des individus plus fortunés ou plus cultivés. ». Ces deux dimensions se trouvent plus ou moins liées chez Rancière, le terme de Peuple devenant le contenant d’un rapport interne d’une opposition toute « tardienne » entre les acteurs de la police et ceux de l’action politique.
[ 9] Ce que les instances internationales proposent comme fin non politique de la négociation relationnelle, les sujets luttant s’en servent comme un moyen non politique pour leurs émancipations.
[ 10] Voir sur ces réseaux l’ouvrage de Glowczewski et Henry (2007).