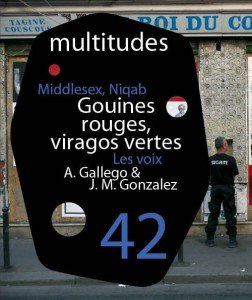Une lecture de L’« Allégorie » et de Phrase de Philippe Lacoue-Labarthe
« À nulles rives dédiée, à nulles pages confiée la pure amorce de ce chant… »
Saint-John Perse, Exil
La « littérature » de Philippe Lacoue-Labarthe – appelons-la ainsi par provision – est déroutante à plus d’un titre. D’abord, parce qu’elle oppose une résistance sourde à qui voudrait marquer son partage avec la « philosophie », ou inversement l’y réduire. « Poésie pensante », l’expédient de l’auteur que rappelle Jean-Luc Nancy[1], n’éclaire rien, à vrai dire. Le genre manque à identifier ce dont il s’agit – mais non le sentiment que c’est probablement tout aussi bien ainsi. Déroutante, ensuite et plus encore, parce qu’on ne peut dire avec certitude de quoi elle parle, quel en est le sujet. Tout au plus, le soupçon se formera, bientôt insistant, que c’est peut-être ça précisément dont il est question. De la déroute du sujet. Mais faisons encore comme si nous n’en savions rien, comme si nous savions faire, lire et commencer par le commencement. Par L’« Allégorie »[2] donc.
I. Ouverture. « Parfois, le soir on pénètre dans un jardin clos depuis longtemps ». Une entrée hasardeuse, incertaine, « parce que l’on s’est égaré (on a depuis longtemps erré entre des chemins non reconnus) » (pp. 13-14)[3]. On commence par se perdre, et toutes les routes qui se frayent dans ce texte sembleront poursuivre l’égarement initial. On progresse alors à travers un paysage à l’abandon – « sa désolation, son éloignement, son apparence équivoque (il paraît à la fois, on ne sait trop pourquoi, impénétrable et tout entier ouvert au regard) » (p.72). Bien vite on ne distinguera plus les voies, égales à le parcourir en tous sens comme aucun. L’insondable profondeur se confond avec l’évidence offerte sans réserve. En l’absence de repères, le doute s’installe : on n’avance pas, cela revient au même, les chemins sans cesse nous y reconduisent, peut-être ne l’a-t-on jamais quitté, n’a-t-on jamais fait que décrire – des cercles… « Parfois, le soir, on pénètre dans un jardin clos depuis longtemps » (p. 75). Comme un écho ? On croit reconnaître, les scènes s’é(qui)voquent – presque. Mais, en l’absence d’une voix unique, repérable, pour nous guider et nous dire : ici-maintenant, pour tisser et nouer ensemble ces fragments de paysage textuel, est-on jamais sûr de reconnaître vraiment les mêmes sentes de l’écriture, de pouvoir assurément les identifier[4] ? À supposer qu’on puisse d’ailleurs s’y retrouver, on n’en demeurerait pas moins perdu, la scène par ses flous restant « insituable » (p. 14). Les chemins ne mènent nulle part. Ni telos ni anabase. « Il devenait évident que cela n’aurait pas de fin, qu’il n’y aurait aucun retour possible, qu’il faudrait recommencer……. » (p. 70)[5] Ici recommencer, cela ne revient pas à revenir au commencement. Parce qu’il n’y en a pas, parce que l’entrée au jardin n’est pas inaugurale (une fois) mais d’emblée multipliée et indéterminée (parfois). Entrer, comme s’en sortir pour rentrer, cela « s’avère, on le savait, impossible » (p. 19).
En vain chercherait-on encore un surplomb d’où s’assurer l’espace aporétique, en quête d’une échappée, d’une ligne de fuite (car pour fuir il faudrait probablement pouvoir lever l’équivoque, donner au paysage une orientation, un sens). On pense parfois atteindre un tel point de dénouement, d’éclaircie – ici une terrasse « permet d’apercevoir une bonne partie de la ville. Mais la ville tout entière, certainement pas » (p. 101). On n’a que les bribes atopiques d’une carte dont il est fort douteux qu’elle ait jamais existé, complète. Déroutes, donc : de l’espace – du sens – de l’histoire. À défaut « peut-être des collines (d’où l’on verrait la plaine et tout un réseau de chemins) » (p. 14), il faut se « rendre à l’évidence » :
« nous étions perdus. Pour comble, peu après (comme c’était d’ailleurs à prévoir), nous commençâmes à nous perdre de vue ; nous nous étions dispersés en cours de route sans y prendre garde ; mais parce que la brume – qui maintenant s’élevait de la terre – avait tout rendu invisible autour de nous, au moment où nous pensâmes à nous appeler, il était déjà trop tard. Nous ne nous voyions plus et nos voix ne portaient plus, nos cris étaient immédiatement étouffés comme s’ils n’avaient jamais retenti ailleurs qu’en nous-même. » (p. 69)
II. L’évidence, c’est qu’on n’y voit plus rien. Le fantasme panoptique s’interrompt là où la brume se lève : entre le sujet et la voix. Nous avons cessé de nous entendre, et l’unité rassemblée à portée de voix se défait irrésistiblement. La perte est d’une unité qui n’est pas seulement celle de la communication (du contact visuel-auditif). Une disjonction suspend le retentissement des cris entre nous, la réverbération qui me renvoie ma voix depuis l’autre, mais cela me disjoint à mon tour : le miroir phonique est brisé, dans lequel un sujet se trouvait identifié par le détour spéculaire d’un écho.
« depuis le début…….
j’étais plusieurs…….
maintenant peut-être encore…….
Mais s’évanouissant les uns après les autres, ……… »(p. 70).
L’interruption traverse en retour le sujet à ne plus s’exposer dans la communauté des autres avec qui nous disons nous. Tandis que c’est « en nous-même » que retentissent « nos cris », nous disons nous pour moi seul, pour nous seuls, pour personne – « Le sujet est personne. Il est décomposé, morcelé » (Lacan)[6]. C’est si peu, à peine dicible, pas de quoi faire tant d’histoires, puisque « il ne se passe presque rien, sinon que cet événement foudroyant a lieu (mais indécelable, sans lieu – la scène est vide) : cet effacement insensé par lequel je disparais. » (pp. 15-16) Presque rien : ni être, ni néant, juste leur différence, pas vraiment un devenir : cette « lente catastrophe » qu’on lira dans Phrase comme une désertion. « Je n’étais plus moi-même » (p. 70) : ce qui s’évapore dans ces pages, c’est bien l’unité du sujet dans sa voix.
Mais reste les voix : elles qui se multiplient dans le brouillard désolé. On les entend, on les devine partout, le plus souvent « murmure à peine audible » (p. 54), « chuchotement » (p. 63, 87), « à voix basse » (p. 32). Elles se dessinent sans paroles (p. 77, 83), comme les traces incorporelles de corps qui au loin se cherchent, s’aiment, se séparent[7] – mais sans (se) le dire. Non plus cette voix, phénoménologique, dont Derrida a montré qu’elle génère l’illusion de la présence à soi[8]. Celle-ci était parole – signifiante s’entend – et le phonocentrisme un logocentrisme. Les autres restent inouïes dans le phénomène de s’entendre-parler, dans le blanc mirage de la présence désincarnée. Elles ne s’élèvent qu’à distance, de loin en loin, au suspens du sens. Alors, « ne serait-ce pas plutôt une musique ? » (p. 87), si :
« Souvent –, le soir, on entend un chant très pur et l’on pense à la mort d’une cantatrice, car cette voix qui chante expire avec la provenance de la nuit »(p. 24)
Cette voix, fragile et mortelle. Elle annonce sa disparition, la mienne. Son chant ne s’entend qu’à l’orée du silence nocturne, dans l’équivoque de l’heure (entre chien et loup) et de l’heur (entre douceur et douleur). Car « moi-même, cependant, j’éprouvais un sentiment plus nuancé […] je me perdais toutefois sans épouvante, je me sentais disparaître avec un certain plaisir » (p. 69). La voix n’est pas ce qui demeure de l’effacement que je suis, mais son accompagnement évanescent, la reprise de la fugue et sa coda fuyante. Elle devient alors allégorie, parlant déjà depuis l’ailleurs (le non-lieu) d’une absence. « L’essence allégorique elle-même, la fugacité [Vergägnlicheit] », écrivait Adorno[9].
III. La voix s’élève au soir ; elle vient tard, trop tard en tout cas pour supporter ce qui a déjà commencé à se perdre en chemin. Elle porte l’après-coup, réverbéré dans l’« effacement de soi – vide » (p. 15), l’écho différé de ce qui me parcourt et me discourt, une phrase, « ce qui se prononce en moi – loin, ailleurs, presque dehors – depuis très longtemps »[10] :
« Je parlais sans parler. Ou plutôt j’écoutais. Je serais tenté de dire : je m’écoutais, si cet intarissable discours […] n’avait été précisément inaudible – « sans voix » – et si j’avais pu me défaire alors, si je pouvais me défaire aujourd’hui, de l’impression confuse et déconcertante qu’au fond de moi, en moi, ce n’était pas tout à fait moi qui le tenais. Ni pour autant, je m’empresse de l’ajouter, un « autre ». »(p. 45)
Avant la voix comme toute autre chose, une phrase me vient. Que je puisse parler, que je sois un « être parlant », cela ne tient pas à moi – qui me tenait pourtant pour maître de mon propre discours – mais à elle, qui m’échappe, que je peux à peine saisir fugacement, au détour d’un silence, « lorsque je me tais sans pour autant ne rien / vouloir dire » (p. 129). Cette phrase renverse la maîtrise du logos, la souveraineté du sujet. Elle n’est pas cependant l’indice d’une inspiration, d’un assujettissement à la parole originaire d’un Autre, à l’événement de quelque signifiant transcendantal. Surgie de nulle part – « rien ni personne […] ne peut être à l’origine de la phrase » (p. 20) –, « vide de sens » et « privée de contenu » (p. 11), elle (n’) est signe de rien. Seulement la remarque en moi d’un manque, indéfini mais irréductible, d’un creux d’où elle sourd et où elle résonne. Dans le Phèdre, Platon liait le pouvoir de l’âme à se mouvoir elle-même avec son immortalité. La phrase de Lacoue-Labarthe, en interrompant cette autonomie automobile supposée, ouvre le sujet sur le vide qui le précède, « l’inouï, tout simplement, d’avant que l’on nous ait précipité » (p. 98), comme cette mort de cent milliards d’années dont parle Antoine Volodine[11]. Son écoute est une expérience – ex-periri, une traversée de mortalité –, celle de ma naissance comme de ma disparition – au langage (à quoi d’autre ?) « Une énigme est le pur jaillir », écrivait Hölderlin. « Phrase » est peut-être seulement un nom proposé pour cette énigme, se gardant d’y répondre, mais entraînant le vertige dont Lacoue-Labarthe dit ailleurs qu’il est « expérience du néant : de l’(in)advenir, «en propre» comme dit Heidegger, du néant »[12]. Ce qui m’abîme ainsi en m’arrivant, autant dire que cela ne m’arrive donc pas – pas à moi[13]. La phrase se déroute bien plutôt à mon abord, elle me déroute et m’efface, elle est « l’arrivée de rien / à ce rivage sans bord. Douceur et douleur, ensemble » (p. 25).
IV.
« Ce qui nous parle et nous terrasse, nous abat, nous ruine dans un tel silence est inconnu, reste (car cela ne dit rien) sans rapport à ce qui nous semble tenir à nous. » (p. 69)
Difficile d’en dire plus à son sujet. De la phrase, « je ne peux / rien savoir positivement » (p. 11). Si ce n’est qu’il faut d’emblée renoncer à l’espoir de parvenir à l’énoncer, de pouvoir un jour la présenter. Cela devra toujours échouer : la phrase est imprononçable.
Mais cet échec, lui, n’est pas rien : « Cette prononciation avortée, cette hantise, je l’appelle décidément littérature. » À la défaillance du sujet à accueillir (ou à devenir) le sens plein de la phrase vient répondre la littérature, qui résonne dans l’absence de ce qui, s’il ne venait à manquer, imposerait le silence et la mort. La littérature correspond au phrasé, vient à sa place pour en tenir lieu sans revenir au même : elle est la différance de l’énoncé imprononçable de la phrase, sa « paraphrase infinie » (p. 12, 14). Littérature au lieu de rien, allégorie d’un néant. Un avortement entre mes deux morts.
La littérature, échouée « faute ne serait-ce que d’un infaillible rivage » (p. 9), ce n’est donc pas rien. Mais il lui faut la voix, insiste Lacoue-Labarthe. Cette « douce voix que nous savons n’être pas nôtre » et qu’il « nous est donné aussi d’entendre bruire en nous, dans l’étroit de la gorge » (p. 68). La voix nous étrange et nous échappe, délivrant ainsi la littérature, l’abandonnant, l’adressant. Aucune destination n’est assurée, la brume peut toujours l’étouffer, mais « il se peut qu’elle soit entendue » (p. 16). Il faut à la littérature cette voix qu’on ne peut dire nôtre pour qu’elle nous déborde, se départisse de nous et devienne, encore autrement, allégorique. Dans L’expérience de la poésie, Lacoue-Labarthe évoque l’Unheimliche de l’art poétique comme un « «étrangement» généralisé » de l’homme, un oubli de soi depuis l’abîme du langage, ce « lieu sans lieu de l’intime béance »[14]. C’est bien en une telle béance intime que résonne la voix : Phrase suggère ainsi que la littérature trouve là son inquiétance, dans l’étrange familiarité d’une phonè qui se noue en l’opacité de mon corps. La voix inquiète le sujet, le trouble parce qu’elle est la remarque d’un corps qui lui échappe et lui manque. Elle divise la proximité de sa pensée en la vocalisant avant toute transparence idéelle : la pensée est ce qui se noue « entre nuque et larynx », « du côté de l’arrière-gorge », mais « dans ce qui ne m’appartenait plus exactement comme ma tête ou ma gorge » (p. 45). Elle devient « comme une sorte d’intangible consistance – je dirais approximativement : prend souffle – et vient se confondre avec l’expiration où il me semble qu’elle ne se perd pas, mais s’altère simplement et, s’altérant, s’articule ou se module en un vague chant atone » (pp. 45-46). La littérature comme cette pensée-voix est alors l’incessante paraphrase, la traduction sans cesse échouée de la phrase au détour du corps – ailleurs, avant, presque sans moi. « Nous traduisons ainsi, tâche sans fin, une vague musique / inchoative, privée de sens, dans un chant » (p. 131). La phrase s’y altère, s’égare dans la vocalité de la littérature où elle se prend, mais ne passe pas.
La voix, si nécessaire qu’elle lui soit, ne parviendra donc jamais à rassurer la littérature. Elle ne lui garantit aucune présence vivante, aucune immédiateté du sens. Même vocalisé, l’art littéraire garde en creux l’empreinte de notre mort. La phonè ne possède ici aucun privilège sur l’écriture. Lacoue-Labarthe disait ailleurs : « Nous écrivons : nous sommes dépossédés, quelque chose ne cesse de fuir, hors de nous, de se dégrader lentement »[15]. On comprend désormais qu’il en va exactement de même de nos voix. Elles nous manquent et résonnent, après la phrase, comme une seconde dépossession, ce à quoi (ni en quoi) on ne peut plus se tenir.
« Il est illusoire de se fier à sa propre voix, qui ne nous appartient pas plus que notre façon de nous mouvoir ou que notre regard. Il est bien connu que nous la méconnaissons, cette voix, et que seule une autre nous est à la rigueur accessible, j’entends : pour une part au moins (je pense à la tienne, cela coule de source, je n’ai rien à dénier). » (p. 130)
V. C’est manifestement dans la littérature que Lacoue-Labarthe a cherché à poursuivre phrase et voix, ces différances du sens qui ne sont ici « absurdes » qu’à entendre le mot depuis quelque surdité. Vouloir ainsi dire la voix par l’écriture, la phrase par la parole, cela reste néanmoins une entreprise impossible, située au bord de la folie. Les textes de L’« Allégorie » et de Phrase s’inscrivent dans une zone grise, celle de l’indétermination, du vague, de ce « presque » omniprésent : l’espace littéraire comme clair-obscur, au lieu de l’aveuglante théorie. Parce que le discours qui y sourd ne se laisse pas tenir ni soutenir comme une thèse qu’on pourrait vouloir poser. Ces textes cherchent un suspens – mais à rompre le silence, ils courent comme toujours à l’échec (et que dire alors de la lecture proposée ici !) Discours sans sujet : « Ce dont parle [la littérature], d’où elle arrive, n’est pas. Elle ne peut jamais parler de ce dont elle parle. » (p. 23) La littérature n’y arrive pas, échoue, parle toujours d’autre chose, elle est encore une fois allégorique. Mais elle est aussi autre chose. L’une des seules citations explicites de Phrase provient d’Adorno, qui écrivait ceci : « Si jamais la philosophie pouvait se définir, ce serait comme l’effort pour dire ce dont on ne peut pas parler, pour amener le non-identique à l’expression, quand l’expression l’identifie toujours »[16]. La « littérature » de Lacoue-Labarthe s’engage dans cet a-poros. À vouloir relever la philosophie ainsi entendue, L’« Allégorie » et Phrase en relèvent assurément – jusque dans leur déroute annoncée.
Mais il en restera peut-être toujours quelque chose.