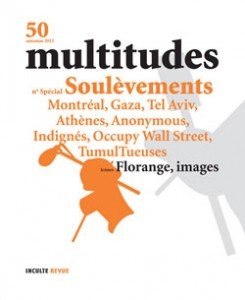De la révolte des banlieues françaises en automne 2005, à la déferlante étudiante en Italie (l’onda anomale) puis grecque, des Indignados espagnols du 15 mai à l’embrasement du Maghreb puis du Moyen-Orient, aux émeutes de Londres d’août 2011 et à la révolte d’Athènes en décembre, chacun comprend que sont derrière nous les années de plomb, celles de la défaite définitive du socialisme réel, de la répression de Tien An Men. Désormais, c’est le produit même de trente ans de mondialisation, d’unification européenne qui se lève de l’intérieur. Contre, mais dedans. Résolument dedans. Global, autrement mondialiste. Et c’est ce qui doit nous rendre immensément optimistes.
L’âge des mouvements ?
La question n’est pas d’inciter à une révolte légitime. L’émeute, l’indignation, le dégoût sont aussi naturels à ce riche et bariolé échantillon des humiliés et des offensés, que s’enfuir pour les esclaves des plantations, que brûler les laissez-passez sud-africains pour les femmes des ghettos de Soweto en 1960, que la grève pour les mineurs britanniques dans le cycle précédent, que le cocktail Molotov aux rues pour le précariat des métropoles, que les 250 000 incidents de masse dans l’immense Chine.
Le mouvement est aussi répandu que les réseaux sociaux. Les problèmes sont aujourd’hui directement ceux de la politique tout court. Sauf à se réfugier dans une confiance vague dans l’avènement de l’événement révolution, il faut reconnaître que cette richesse des mouvements minoritaires en tous genres contraste crûment avec la pauvreté conceptuelle et la vulgarité concrète de la « grande » politique en général, de son cadre institutionnel, mais aussi avec celle de la micro-politique de « proximité » qui ne peut nous servir d’alpha et d’oméga. Entre le retour increvable des professionnels de la politique et les gourous « tribuns du peuple », nous pourrions être mieux lotis tant nous manquons cruellement de politique, de politique nouvelle.
Pour la politique des multitudes que nous aurions cru pouvoir tirer de la trilogie Empire / Multitude / Commonwealth, de Cochabamba à la révolution de Jasmin, il faut avouer une impression de sur-place. La révolte des banlieues françaises, les émeutes anglaises, l’incroyable mobilisation espagnole sont nos feux de Bengale ; elles illuminent notre nuit de la politique d’une lueur forte, mais aussi âcre qu’éphémère. Il est dur d’admettre que la continuité, la croissance, la vitalité des mouvements ne sont pas données. Ni pour nous ni pour l’appétit des informaticiens ou des académiques de la science électorale. La capitalisation de l’anticapitalisme spontané est l’exception, un miracle presque aussi rare que les vraies révolutions. La fronde de David se change en pierre de Sisyphe. C’est là que nous voyons ce que la politique devrait apporter : bloquer le boomerang pour le renvoyer un peu plus haut sur la montagne.
Il serait trop simple de déduire que les mouvements génèrent la politique dont ils ont besoin pour durer et qu’un pareil automate pourrait faire vivre le projet de changer le monde. Au contraire, le simulacre que produisent les mouvements, lorsqu’ils durent, finit le plus souvent par se retourner contre eux. Leur institutionnalisation devient leur prison, une prison d’abord dorée puis de plus en plus hostile à leur réplication dans une descendance durable.
Nous sommes tous à la recherche de la politique. Non pas d’une autre politique, comme si ce que l’on couvre de la toge de la politique pouvait y prétendre. Non pas comme le Maréchal de Soubise qui cherchait son armée à la chandelle après la bataille, mais comme ceux qui se lancèrent sur les océans. Plus que de théories et d’exemples, nous avons besoin de caravelles et de portulans. En tout cas, c’est à quoi pourraient servir ceux qui se nomment « les intellectuels », s’ils ne veulent pas verser dans la prétention, autrefois insupportable, aujourd’hui comique, des avant-gardes, ni pour autant se renier en se refugiant dans l’alibi perpétuel de la génération spontanée des mouvements.
L’apport de l’opéraïsme
La formidable intuition de ce que l’on appelle l’école opéraïste consiste à soutenir que le ressort de l’accumulation de profit de la part du capitaliste individuel, puis du capital social comme système global (rien à voir avec le capital social de Bourdieu), tient à la nécessité vitale où il se trouve engagé de contrôler l’insubordination permanente des travailleurs dépendants salariés. La classe ouvrière est la seule anarchie du capital qui n’est pas anarchique ni contradictoire en lui-même. Que ce motif puisse aussi se confondre avec l’intérêt et la cupidité explique la plasticité de la relation de capital qui concerne aussi bien les marchands avec leurs pauvres, les petits patrons artisans avec leur prolétariat, les planteurs des colonies avec leurs esclaves. Elle n’autorise pas les tautologies basiques du genre : si les capitalistes accumulent les profits au lieu de les consommer en dépenses somptuaires et en rente, c’est parce qu’ils en veulent toujours plus (le greed redécouvert par J. Stiglitz), ou bien les tautologies savantes des marxistes bègues qui répètent comme des médecins de Molière, « l’accumulation, c’est la loi et les prophètes ». En vertu dormitive de quoi, le capital a tendance à s’accumuler tout seul.
La deuxième découverte géniale de l’opéraïsme était d’illustrer étape après étape comment au sein de la relation d’antagonisme, le prolétariat d’abord, la classe ouvrière ensuite, le salariat moderne enfin, avaient toujours un temps d’avance de socialisation sur l’homme aux écus, sur le patron, sur l’État des capitalistes. Que cette asymétrie de puissance poussait la classe en retard des capitalistes à deux choses :
1) régler ses mécanismes de constitution de son pouvoir en classe sociale, bref son pouvoir spécifique, sur ceux de la classe ouvrière, y compris et jusqu’à l’absurde quand elle s’est constituée elle-même en syndicat patronal et a appuyé fortement l’institutionnalisation des classes moyennes puis des « classes » de consommateurs ;
2) se servir de l’argent, vite transformé en moyens de production, en machine puis en technologie, en mécanisme de désocialisation (de décomposition) pour combattre le mécanisme de socialisation et de communisation que le salariat porte avec lui. Ainsi l’histoire de la technologie, de la finance, de l’accumulation de l’argent non comme rente mais comme pouvoir (maintenir le travail dépendant dans la relation de production sous son commandement) reprend à la fois son sens et une unité bien plus intéressante que dans la vision proposée par l’histoire académique qui, dans ses revendications « d’autonomie », dissout la déterminité solaire et cruelle des contours de l’histoire dans une nuit commode où pouvoir et puissance, autorité légitimité et état, sont joyeusement mélangés. Tandis que Mario Tronti se tournait vers l’autonomie résolue des luttes politiques par rapport à l’économisme objectiviste du marxisme stalinien en mettant en avant l’autonomie du politique, Antonio Negri élaborait, en 1976, la théorie de l’ouvrier social comme base de la théorie de l’autonomie ouvrière (dont on peut retrouver des échos sous d’autres prémices théoriques dans l’intérêt de Sergio Bologna pour le travail autonome indépendant, dans celui de Alberto Magnaghi pour celui de la fabbrica diffusa). Cette coupure avait eu lieu dès avant 1967, quand Negri quitta la revue Contropiano dès le deuxième numéro ne croyant plus possible de réformer le PCI de l’intérieur.
On peut dire ainsi que le seul rameau vert sur le vieux tronc du marxisme occidental, abattu largement par le socialisme soviétique et par le réformisme keynésien, fourchait à son tour. Une branche, celle de l’autonomie du politique, retrouvant la thèse polanyienne de l’encastrement de l’économie par la société politique, devenait une théorie objective de la subjectivité cristallisée dans des institutions, empruntant à Carl Schmitt la théorie de la décision et de l’antagonisme spécifiquement politiques. Tandis que l’autre branche s’orientait vers une théorie et une pratique subjective d’un antagonisme ouvrier dans sa nouvelle composition, récusant la possibilité d’un usage ouvrier possible des institutions politiques du capitalisme. L’optimiste presque hégélien et bernsteinien de l’opéraïsme (le mouvement est tout, le but n’est rien) hybridait dans le premier cas avec le réformisme de la social démocratie, mais sans doute trop tard. Dans le second, l’optimisme tendait à exaspérer la subjectivité révolutionnaire « léniniste », mais se combinait avec un pessimisme tout francfortien sur l’intégration du mouvement ouvrier dans l’appareil de contrôle global du capitalisme.
D’un côté, on obtint la politique en théorie (les formulations de l’autonomie du politique ont une certaine allure rhétorique), mais on perdit et le puissant Parti communiste historique (réduit successivement au PDS puis au PD) et la Révolution : le PCI n’échappa pas au naufrage général des partis communistes occidentaux et se retrouva dans une position guère plus enviable que le PCF, qui n’eut jamais de théoriciens de la trempe d’un Mario Tronti.
De l’autre, on eut des mouvements sociaux, voire des insurrections sans parti ni révolution, et une sévère défaite pour des milliers de militants. Bref, une discontinuité qui fit passer l’Italie de « l’anomalie sauvage » à la vulgarité cruelle du Craxisme socialiste d’abord, puis du Berlusconisme du Parti de la Liberté, c’est-à-dire une régression absolue du politique, dont la Ligue du Nord est la répugnante illustration : réactionnaire, raciste, petite-bourgeoise, rentière.
Du capitalisme à l’accumulation primitive
de la classe ouvrière
J’avais été frappé commençant mes recherches à la fois militantes et théoriques sur les immigrés, sur la classe ouvrière multinationale, par une sous-évaluation dans le schéma de Tronti de la question de la mobilité internationale. Si l’histoire du capital s’expliquait par les mouvements de la classe ouvrière en formation, le premier de ces mouvements, c’était l’auto-mobilité. Comme pour le capital, dont le secret de l’accumulation repose sur la violence de l’accumulation primitive (le corsaire Drake pour le Trésor d’Elizabeth Premier d’Angleterre, le vol, la rapine, l’esclavage), il devait y avoir une histoire de l’accumulation primitive de la classe ouvrière. Pour remettre en marche le moteur de la politique révolutionnaire, il fallait faire sortir la classe ouvrière de l’amnésie de son accumulation primitive.
Marx dans le fragment magnifique sur l’homme aux écus et le prolétaire, n’avait qu’évoqué furtivement le véritable récit de la rencontre. Dans l’épisode, l’homme aux écus, poussé par une faim dévorante de main d’œuvre pour valoriser son argent comme capital, vient chercher le prolétaire qu’une expropriation a rendu opportunément perceptif au chant de sirène du travail dépendant. Mais qu’en était-il vraiment ? L’homme aux écus ne rencontrait-il pas d’abord en Europe le pauvre, un prolétariat en haillons semi-délinquant, vagabond, qui agace prodigieusement Marx ? D’autre part, dans cette histoire de rencontre, de coup de foudre, comme dans le trop fameux combat du « maître et de l’esclave », ou plutôt du valet, du serviteur, le prolétaire est inerte, immobile. Le mouvement, l’agilité se trouve du côté du magnat commerçant, entrepreneur. Enfin on oubliait dans cette histoire trop téléologique que le capitaliste gagnait à tous les coups, que le pauvre n’était qu’une origine inerte que le prolétaire saluait d’un petit coup de chapeau et s’empressait d’oublier, comme la classe ouvrière allait le faire à l’égard du prolétariat en haillons, du brassier paysan (pourtant le véritable acteur de fond de la révolution française à travers la grande peur et la nuit du 4 août).
Or l’histoire des lois sur les pauvres montrait quatre choses. D’abord, que les pauvres ont été capables de résister de 1300 à 1700 à leur incorporation dans le travail dépendant, ce qui rappelle étrangement la résistance du Sud au développement capitaliste sous et après le colonialisme. Ensuite, que cette incorporation n’avait pu se faire que sous la forme de travail dépendant non libre, l’esclavage moderne avec des Africains et des aborigènes contraints par la guerre, la menace de génocide. Les veines de Amérique Latine, de l’Afrique et de l’Asie ont dû saigner pour que vive le capitalisme.
La troisième chose stupéfiante, c’est que la relation de salariat libre ne se déduisait pas d’un capitalisme qui aurait porté la liberté comme un pommier des pommes. La quatrième chose encore plus scandaleuse, hérétique par rapport aux doxas libérale comme marxiste, c’est que le marché lui-même n’arrivait à fonctionner que comme marche vers la liberté des esclaves et avait été « inventé » par la lutte des esclaves pour se libérer, comme la force des pauvres de l’Ancien régime résultait de la libération médiévale du servage.
Le caractère politique de la constitution de la classe ouvrière, le making of the English working class de E. P. Thompson, comprenait l’histoire monde et pas simplement l’économie monde, avec ses luttes paysannes, capitales dans la constitution d’une féodalité, mais aussi avec ses luttes de femmes expulsées de la production, de la cité, avec ses Africains déportés, ses esclaves, ses semi-esclaves mobiles, son Atlantique des engagés enfuis, ses brigands, ses braconniers, ses gabelous. Mais ce making avait été un unmaking of the Poor, the Aborigenous, the Women, un défaire le monde, l’Umwelt, l’environnement humain (qui était en même temps l’environnement écologique), sans lesquels on ne peut rien comprendre à la politique, à la résistance comme à l’assaut contre le ciel.
En rejetant l’accumulation primitive de l’histoire dans une préhistoire plus jamais questionnée, on oubliait que son moteur interne et central se jouait à la soi-disant périphérie. Or cette idée, c’est précisément la thèse cruciale du post colonial défendue avec le plus de netteté par Anibal Quijano et Walter D. Mignolo – avec lequel il était nécessaire que l’opéraïsme se trouve confronté de façon féconde et pas seulement dans d’absurdes bagarres de préséance.
Fixer le pauvre sur place
Quand l’ouvrier qualifié de l’usine standardisée métallurgique fut laminé et battu politiquement par le développement du fordisme (dès après la première guerre mondiale aux États-Unis, vingt ans plus tard en Europe) qui absorba les paysans, les noirs, les femmes sur les chaînes de montage de la production de masse, les référents culturels et matériels changèrent profondément, mais un marxiste orthodoxe continuait à y retrouver ses petits. Quelle qu’ait été la forme du régime libéral, fasciste, nazi, la chaîne de montage de l’usine géante régnait de Detroit à Mirafiori, de Billancourt à Wolfsburg, et rapidement à Togliattigrad (Volgograd), ou ToyotaShi (Aïchi). L’ouvrier masse partageait avec l’ouvrier qualifié et même avec l’aristocratie ouvrière une condition commune, celle de col bleu, et l’usine, telle qu’elle s’était mise en place depuis la Grande Fabrique et l’entreprise décrite par A. Chandler. Certes, il y avait bien quelques scories autour, pas très claires (le travail des enfants, l’entretien, la sous-traitance, les cités ouvrières, les classes dangereuses, ces outcasts marginaux pas simplement à Londres, les quelques millions d’ouvriers aux Indes sans domicile fixe). Mais tout cela était du lumpen prolétariat, du prolétariat non pas en haillons mais en embryons. Bref de la préhistoire. Pas la peine d’en faire une histoire !!!
La base économique de l’exploitation, le rapport de subordination à un patron étaient censés avoir raison du développement inégal des degrés de conscience de classe. L’économie et le capitalisme travaillaient comme leurs propres fossoyeurs. Qu’il n’en ait jamais été ainsi dans l’histoire réelle de la classe ouvrière, mais qu’il se fût agi d’une « fable pour enfants », comme aurait raillé Tronti, d’un mythe quasi Sorélien – c’est une autre histoire, ou plutôt le même problème, que l’histoire du salariat et sa longue parenté avec l’esclavage (sa face sombre) m’avaient fait toucher du doigt.
Mais après Mai 68 et l’Automne chaud, quand le travail précaire, le travail social se propage parallèlement à la crise des OS, du travail parcellisé en usine, et de façon d’autant plus forte que cette transformation productive n’est ni aperçue ni analysée, quand l’ouvrier social apparaît dans le vocabulaire visionnaire de Negri, c’en est fini de cette « communauté » commode. L’usine n’est plus dans l’usine, l’ouvrier n’est plus ouvrier, il est dans la société, dans le territoire diffus, dans les centres sociaux, les comités de lutte de quartier. Il devient hybride, plus qualifié que l’ouvrier qualifié de la grande industrie, plus mobile et précaire que le héros de Vogliamo tutto du roman de Nani Balestini mais surtout plus insaisissable, plus éphémère dans ses apparitions. Produit-il au moins un produit, quelque chose à quoi se raccrocher à défaut d’une adresse ? Même pas !
L’opéraïsme avait déjà fait un joli scandale dans les milieux socialistes et communistes en défendant la valeur du refus du travail et non pas celle du travail. Mais le refus ouvrier, s’il était un non proche de la « chienlit » anarchiste, était au moins ouvrier. Là, que veut dire la perte du critère discriminant de l’appartenance au travail productif au sens étroit et précis du terme (salariat d’abord, col bleu ensuite) ? Peut-on s’en tirer en invoquant son caractère productif indirect et pas direct ? Tiens, comme la femme du prolétaire à la maison ?
Pourtant, avec la montée en puissance du travail immatériel dans la mondialisation et la délocalisation des usines à Shanghai, à Chonqing (notre nouveau Manchester dans les usines de Foxconn), fallait-il traiter les ingénieurs de l’Ipod ou de l’Iphone de rentiers de la propriété intellectuelle ? Pour que naisse un « marché » du travail où s’échange de l’argent contre du travail dépendant, il fallait fixer le pauvre sur place, c’était cela la première discipline, l’accumulation originelle. Et pour que la rupture par un travailleur dépendant de son contrat ne détruise pas toute possibilité d’accumulation économique, il fallait que le pauvre « enfui » reste dans la même zone. Deux voies s’offraient au marchand aux écus : a) ou bien marquer le vagabond, le fuyard au fer rouge et l’asservir ; b) ou bien le retenir par le bénéfice d’une aide administrée par l’Église (les lois sur les pauvres, cette histoire de la lutte de classe sous l’Ancien Régime).
Le marché ne possédait donc les vertus d’indiquer un prix du travail que si de puissants ressorts collectifs étaient mis en œuvre par la puissance publique. L’État précédait la relation « de marché », comme le montrait la première législation après la grande Peste en Europe. Le hors-marché façonnait la possibilité même de la prétendue « main invisible ». Le risque de rupture de la relation de travail dépendant et les fuites effectives constituaient l’enjeu majeur des dispositifs qui réglementaient l’échange économique sans apparaître dans la sphère économique elle-même. Ces éléments expliquaient la longue hésitation entre le travail libre et l’esclavage moderne.
Des éléments similaires expliquent aujourd’hui la férocité avec laquelle le capitalisme néolibéral tente de reprendre le contrôle sur une force de travail (cognitif) qu’il lui est de plus en plus difficile de fixer, tant les nouveaux modes de production multiplient les occasions de fuite. Les « mouvements » (sociaux) sont d’abord à comprendre dans la perspective de ce mouvement de fuite de la force de travail : ils sont en grande partie une conséquence des mesures répressives que met en place le capitalisme pour endiguer cette fuite.
De l’ouvrier social à la pollinisation
Pour comprendre les formes successives, les métamorphoses de l’échange argent/travail dépendant, il fallait mettre au cœur de l’analyse ce que les économistes appellent les « externalités » ; c’est-à-dire les conséquences non incluses dans l’échange monétaire des transactions globales entre les agents économiques (pas seulement les transactions marchandes).
Que vaut l’abeille du point de vue de l’économie réelle, me demandai-je ? Et la réponse fut d’autant plus instructive que la catastrophe du syndrome d’effondrement des ruches (une surmortalité très inquiétante apparue aux États-Unis puis devenu générale depuis) allait apporter à partir de décembre 2006 un chiffrage irréfutable. La valeur économique des abeilles ne réside pas principalement dans le miel et la cire qu’elles « produisent » avec leurs petites mains, mais dans la pollinisation qui permet la survie de la biosphère de la planète. La valeur de celle-ci est sans prix direct. Nous n’avons pas de planète de rechange si la majorité de nos aliments végétaux ne peuvent plus se reproduire, vite suivie de nos aliments carnés, puis de l’ensemble de la flore et de la faune, et enfin de nous-mêmes. Mais en termes approximatifs de PIB annuel de la planète (total des activités marchandes de l’ordre de 60 000 milliards de dollars), la pollinisation des abeilles représente le tiers du PIB agricole. L’intéressant, c’est que la pollinisation représente annuellement entre 790 fois et 5000 fois la valeur marchande du miel et de la cire. La sphère marchande est encore bien plus minuscule que la partie émergée de l’iceberg.
Supposons un instant que l’activité humaine soit gouvernée par les mêmes lois. Remplaçons la pollinisation des abeilles par l’interaction et le lien social. La théorie marxienne de l’exploitation des « abeilles humaines » correspond admirablement à l’art « improbus » (malhonnête) de l’apiculteur qui en retirant les rayons de miel de la ruche oblige les abeilles à produire plus de miel que ce qu’elles feraient si elles devaient simplement mettre de côté leur nourriture pour elles-mêmes et leur progéniture. L’exploitation ou sur-travail est là. Pour obtenir ce surplus absolu, l’apiculteur peut mal nourrir ses abeilles, mal les loger, mais cette prédation se retournera contre lui si elles sont menacées de disparitions. En échange de soins, principalement contre les maladies et les intempéries, il obtient une plus-value relative.
La pollinisation humaine, le seul travail tout à la fois sans prix et fondamental, constitue la tâche aveugle de l’analyse de l’économie politique classique (marxisme orthodoxe compris). Le réductionnisme européen, qui commence avec le capitalisme dès son aurore, peut à bon droit être reconnu par les aborigènes comme une forme de barbarie particulièrement primitive vis-à-vis non seulement des humains mais aussi des vivants de la planète. Cette vérité cruelle disqualifie l’humanisme qui prétend appuyer ses bonnes intentions sur une économie standard (qu’elle soit capitaliste ou socialiste). L’utilité des activités humaines et la production des richesses réelles pour la société dans son ensemble doit repartir de là et de nulle part ailleurs.
Biens communs, économie publique, activité de pollinisation du lien social, soin de la vie de l’ensemble des vivants sont les véritables boussoles et les portulans dont nous parlions plus haut. Voilà l’usine sociale, le soleil autour de laquelle tourne la terre de la politique. C’est à cette révolution copernicienne que notre politique doit procéder.