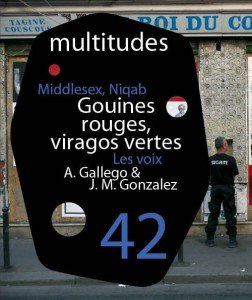Monique Selim : L’appel à contributions « quarante ans après » m’a immédiatement interpellée. J’avais 17 ans en 1968, près de 20 ans quand j’ai rejoint le MLF et que je me suis immergée dans ce qu’on appelait à l’époque un « groupe de conscience ». J’ai désiré y répondre à travers une confrontation avec toi, une femme de quarante ans qui n’a pas vécu cette expérience, anthropologue comme moi, appartenant à la même équipe de recherche[1], ayant travaillé avec des ouvrières et des prostituées en Bolivie[2], et concernée par la question féministe.
Pascale Absi : Je souhaiterai que tu reviennes sur cet engagement dans le MLF, il y a quatre décennies.
M. S. : Pour moi c’était une évidence personnelle, collective comme en 1968, très liée sans aucun doute à la politisation de ma famille. Mais surtout l’évidence subjective résidait dans ma volonté de ne pas être une femme. Le MLF était pour moi un espace où pouvait être affirmée la négation profonde du désir d’être une femme. Avec le recul et de nombreuses discussions avec des femmes de ma génération, je comprends que beaucoup de femmes ne partagent pas du tout cette perspective. Ne pas être une femme, ne pas être assignée à une position inférieure, c’était échapper à toutes les trappes que je constatais partout et que j’observais socialement. Le fait de se situer comme non-femme impliquait tout d’abord le refus de la maternité, car, dans mon esprit, être mère équivalait à ne plus pouvoir fuir l’appartenance à la catégorie de femme et plus précisément, éviter toute sexuation. J’adhérais à cette chimère qui fait du masculin un emblème du dépassement des catégories de sexe. Paradoxalement j’avais signé dans une réunion la pétition des 343 salopes[3] pour la liberté de l’avortement, alors même que je n’avais jamais été enceinte ni bien sûr avorté. Pour moi c’était l’acte politique qui importait bien plus que l’expérience personnelle et je ne voyais donc dans ce ralliement aucune contradiction.
P. A. : Je voudrais t’interroger sur la cohérence entre ton refus individuel de l’assignation à être une femme, ton militantisme et tes engagements d’anthropologue.
M. S. : Pour moi, me jeter corps et âme dans l’anthropologie, passer ailleurs, dans l’altérité, devenir donc anthropologue me paraissait être le meilleur moyen de ne pas être une femme, bref d’être un homme neutralisant les impositions de sexe. En étant dans une société autre, il me semblait que je désubstantialisais toutes les assignations, ne serait-ce que par la fonction d’écoute et d’analyse sociale de l’anthropologue. Dans sa propre société, il est beaucoup plus difficile d’échapper à sa classe d’origine, à son appartenance sexuée, etc.
P. A. : Pourtant la question méthodologique, épistémologique d’être une femme anthropologue, à différents âges de la vie est essentielle : les représentations que les acteurs sociaux se font de l’anthropologue influent sur la production des connaissances.
M. S. : Ici, en France, sur les terrains urbains très ghettoïques et stigmatisés dans lesquels je m’étais immergée, les gens me voyaient comme venant « d’ailleurs », une zone sociale qui leur était inaccessible et ce d’autant plus que j’étais une jeune femme sans contrainte maritale, familiale, totalement disponible pour leurs invitations et leurs récits. En revanche, au Bangladesh où la « séparation des sexes » était très stricte, le fait d’être une femme étrangère, « d’ailleurs », a été un atout, une plus-value symbolique, me permettant de franchir toutes les barrières entre les espaces masculins et féminins. En général, être une femme étrangère me parait être pour une anthropologue une manière de se positionner comme une non-femme sans être un homme contraint par son sexe, dans un univers des possibles qui s’ouvre ainsi. Mais, là encore, il s’agit d’une interprétation personnelle et beaucoup d’anthropologues divergeraient sur ce point.
C’est aussi probablement en raison de ma crainte de me retrouver assignée par mon objet d’étude, que j’ai choisi de ne jamais me spécialiser sur les questions qu’on appelait alors rapports sociaux de sexe avant de les nommer études féminines ou de genre et qui débutaient dans les années 70. Mais sur mes différents terrains, ces rapports sociaux de sexe s’imposaient dans leur caractère structurant, que je me suis attachée à démonter. Sur 35 ans, une fois à peu près tous les cinq ans, j’ai écrit un article qui traitait des femmes et des rapports sociaux de sexe. Dans les dernières années, j’y ai été poussée un peu plus par une collaboration à mes yeux très fructueuse avec Anne Querrien[4]qui a lancé cet appel à contribution.
P. A. : Revenons sur la manière dont tu as traité l’assignation sexuelle sur tes terrains anthropologiques…
M. S. : J’ai d’abord envie de revenir sur mon premier terrain, le pays basque français, où, dans un contexte militant je me suis mise au service d’une association de petits paysans de montagne dont le leader m’a proposé de me focaliser sur une pastorale [forme théâtrale du Moyen Age] qui se montait alors dans un village (Barcus). Le fait que les femmes étaient interdites de participer comme actrices à ce spectacle exceptionnel, que les rôles de femmes étaient tenus par des hommes était inesquivable pour l’anthropologue débutante que j’étais. Tout comme dans les entretiens, les discours des femmes dénonçant leur condition d’esclave corvéable à merci dans les fermes, le malheur de leur vie conjugale et familiale au regard duquel servir les hommes à table sans pouvoir s’asseoir avec eux n’était que la partie la plus visible de leur asservissement et, la migration vers les villes comme unique espoir de libération… ce qui m’a d’ailleurs conduite dans le foyer basque de Paris où j’ai mené une étude sur les représentations de la domination masculine et les stratégies féminines. Dans le champ de l’anthropologie rurale française la tonalité était plutôt alors dans le début des années 70 à l’harmonie villageoise et la complémentarité des sexes et mon discours faisait immédiatement rupture.
En revanche, lorsque j’ai effectué une recherche (1977-1979) sur une cité HLM de la périphérie de Paris, bien que mes matériaux soient issus en majeure partie d’entretiens avec des femmes, c’est sur la figure imaginaire de l’étranger comme fondement négatif des rapports sociaux que j’ai centré l’analyse, délaissant de fait la question des femmes en tant que telles, ce dont un(e) autre anthropologue au contraire se serait peut-être saisi. Avec le recul, je perçois bien là les effets contradictoires de mon positionnement subjectif sur ma production scientifique.
P. A. : L’histoire n’est jamais linéaire. Les rapports d’assignation sexuelle font leur retour dans certains contextes politiques actuels comme tu l’as observé en Ouzbékistan indépendant où tu as travaillé avec des chercheuses subissant fortement les processus de retraditionnalisation dictatoriale en cours…
M. S. : L’Ouzbékistan actuel montre de façon exemplaire que la légitimation de la domination masculine est avant tout une affaire d’État. L’État soviétique s’était voulu émancipateur pour les femmes dans cette République musulmane en les mettant à l’école et au travail contre la volonté de la société locale. Après la chute de l’URSS, l’État indépendant, qui fait de l’identité nationale un dogme, remet les femmes à leur place inférieure, à la maison, dans la servilité domestique et sexuelle, sous l’autorité des hommes. Pour les femmes de cinquante, soixante ans, chercheuses de l’académie des sciences, poussées par leur famille à l’époque soviétique à se hisser au plus haut de la hiérarchie scientifique et intellectuelle, le plus tragique a été de voir leurs filles éduquées, mariées, enfermées par leur belle-famille, interdites d’études, de sorties, de loisir, de travail, etc. Ces contradictions vécues dans une même trajectoire féminine ont conduit à des exils tant les déchirements étaient insupportables.
P. A. : Ce rôle de l’État comme ordonnateur des catégories de sexe est également un des enjeux centraux du débat gouvernemental sur l’identité nationale « française ».
M. S. : Oui, les termes du débat vu du côté femmes sont les suivants : la France est une société exemplaire qui a libéré entièrement « ses femmes », qui sont donc totalement libres et égales, ce qui, bien sûr, est une escroquerie, un mensonge tant les inégalités de fait (travail, etc.) sont flagrantes. Les femmes sont ainsi replacées sur le devant de la scène politique, car dans une période de crise économique, il faut produire la figure d’un Autre, étranger, à expulser et haïr et le principal trait distinctif de cet Autre, c’est qu’il asservit « ses femmes ». Les femmes font la différence dans l’imaginaire ente le soi et l’Autre, le barbare. Elles sont un simple prétexte politique à assurer la survie d’un gouvernement et d’une classe dominante que l’ubris des revenus, l’arrogance, l’image autoritaire qu’on croyait révolue, mettent en péril.
P. A. : Dans le débat sur l’identité nationale, l’assertion de l’égalité des femmes en France – même si ces dernières subissent de fait la domination masculine – joue comme caisse de résonance, comme levier fantasmatique de l’assignation à l’altérité en général.
M. S. : C’est la scène primitive – au sens freudien du terme – du débat sur l’identité nationale en France aujourd’hui. Durant la période coloniale, les femmes ont d’ailleurs fonctionné sur un mode fétichiste identique : le colonisateur était légitimé dans son entreprise civilisatrice par la situation inique des femmes dans laquelle l’indigène les maintenait. D’une façon générale, la domination masculine n’est qu’une boite de légitimation de la domination sociale, politique, impériale. D’où d’ailleurs l’importance, il y a quarante ans du mouvement des femmes qui a permis une autre construction des légitimités sociales et étatiques. Nombreux sont ceux qui ont souligné, à juste titre, que la « libération » des années 70, a permis de fait une reconfiguration des modes de domination dans tous les champs sociaux.
P. A. : Peux-tu en dire plus, en particulier sur la « récupération » des mouvements féministes par le(s) pouvoir(s) ?
M. S. : Dans les années 70 le clivage principal se situait entre féminitude, différentialisme d’un côté et de l’autre égalitarisme humaniste et universaliste. Ce clivage est, de fait, rentré dans l’espace public, s’est rhizomatisé et son évolution jusqu’à aujourd’hui est significative : le différentialisme s’est largement diffusé dans la société et sous son ombrelle, l’égalité a été rebaptisée parité. La presse féminine invite les femmes à être « tout », hyperpuissantes, exceller dans le travail, la sexualité, la conjugalité, atteindre les sommets du pouvoir, à être mères mais aussi « putes », toujours séduisantes et séductrices et jouissant « sans entraves » pour reprendre le vieux slogan ! La femme devrait donc être dans cette logique différente mais identique et l’ancien clivage idéologique s’est donc brouillé au profit d’un différentialisme à la fois affirmé et occulté. Du côté des mouvements féministes, on observe une multitude de positions, éclatées, recomposées et, de ce point de vue, la focale des prostituées vues comme travailleuses du sexe illustre bien cette nouvelle nébuleuse. En défendant les « prostituées » comme victimes d’abus de droits, sous une nomination qui les réhabilite, il y a un changement de grammaire d’action face à la domination masculine. On est confronté à des transformations idéologiques essentielles, dont l’analyseur est la défense des droits des prostituées. En mettant l’accent sur les droits, on tente de sortir des luttes et des conflits sociaux violents, ce qui n’est nullement gagné en période de crise durable. Les mutations touchent à la fois la matrice idéologique dans laquelle s’inscrit l’opératrice femme et le champ politique de la révolte et de l’opposition.
P. A. : Ceci nous ramène à l’appel à contribution qui embrasse et lie au-delà des fragmentations, les évolutions des féminismes et les changements sociétaux et politiques.
M. S. : L’espace pratico-idéologique du féminisme est un des révélateurs d’une transformation globale qui débute il y a quarante ans. Mais à l’intérieur de cet espace pratico-idéologique du féminisme, il y a de mon point de vue trois objets nodaux sur lesquels il faut centrer l’attention : les quotas, les prostituées, la gestation pour autrui qui permettent de mieux comprendre comment dans leurs articulations internes/externes les discours et les revendications se sont reformulés. Ainsi les quotas opposent universalistes fondamentalistes et féministes pragmatiques qui soulignent leur nécessité pour atteindre l’égalité dans un contexte où comme on l’a déjà souligné la femme doit être tout, mère, grand-mère, carriériste, pute, etc., un modèle, une fiction qui ne peut qu’engluer les femmes dans leur défaillance, leur échec personnel.
La gestation pour autrui divise aussi les féministes qui, dans leur grande majorité, sont contre les mères porteuses, au fond au nom de l’unicité et de la sacralité de la maternité, c’est-à-dire avec des arguments « traditionnels ». Mais pourquoi la marchandisation généralisée s’arrêterait à l’utérus des femmes dans le cadre du développement du capitalisme ? Les femmes, avec la dot et le prix de la fiancée, ont toujours été une valeur marchande, autrefois comme aujourd’hui. Ne revenons pas sur « Ni putes ni soumises » qui a fait balancer une partie du féminisme du côté de l’appareil idéologique d’État, dans la négativation de l’Autre dont l’interdiction de la burqa est un des aboutissements.
P. A. : À l’image de la fragmentation idéologique actuelle tu me parais toi-même « fragmentée » : parfois universaliste, d’autres fois du côté de la singularité, du particularisme selon les thématiques abordées, ce qui fait réfléchir les anthropologues que nous sommes. Ces clivages et ces fragmentations réapparaissent en effet dans tous les champs politiques, tels par exemple les quotas ethniques. De fait il n’y a plus de position unitaire tenable tant au plan personnel que global. Ces quarante ans ont principalement débouché sur cette fragmentation idéologique qui pousse aux incohérences subjectives, alors que j’ai le sentiment que dans le MLF, à l’époque des débuts, il y avait la possibilité d’une plus grande unification à toutes les échelles.
M. S. : Je crois que ce que tu soulignes est très important pour analyser les changements de la société, bien au-delà du féminisme.
P. A. : C’est pourquoi je voudrais qu’on revienne sur le passage des mouvements sociopolitiques violents à la défense des droits actuels. Avant, on était dans un monde bipolaire, avec des alternatives pensables.
M. S. : Les revendications des droits des homosexuels sont, de ce point de vue, très significatives puisqu’elles visent non plus l’opposition à la norme – conjugale, familiale, etc. – mais au contraire l’intégration dans le champ de la normalité avec le droit au mariage, à l’adoption, à la famille, etc. Le MLF a beaucoup joué sur la provocation pour précisément ridiculiser la norme, la minoriser, la marginaliser en quelque sorte. Aujourd’hui la juridisation – et la judiciarisation – de la société signent aussi sa pacification, la neutralisation des conflits, ce qu’implique la défense des droits qui poursuit comme objectif la légalisation des existences. Les combats par procès donnent des droits qui s’étendent à ceux qui en étaient exclus. Mais dans le même moment des droits essentiels qui avaient été conquis, arrachés dans la violence, sont amputés. C’est vrai dans le champ du travail, de la sécurité sociale, etc. L’idéologie des droits est donc un oxymoron : au moment où de nouveaux droits sont posés dans l’espace des mœurs, d’autres essentiels, sociaux s’effritent, tombent en désuétude, sous le coup des normes financières. On va ainsi produire des sans-droits absolus alors même que le droit progresse en tant qu’idéologie. S’il faut penser ces quarante ans qui viennent de s’écouler force est de constater qu’on se battait pour être hors-normes alors qu’actuellement la défense des droits de toutes sortes de gens vise à élargir l’espace idéel des normes.
P. A. : Que dirais-tu maintenant de l’étude des rapports sociaux de sexe aujourd’hui, en particulier dans l’anthropologie ?
M. S. : Les recherches dites féminines, féministes, genrées se sont multipliées et ont acquis une légitimité scientifique notable, plus notons-le dans la sociologie qu’en anthropologie. Mais toutes ces recherches, aussi passionnantes soient-elles, se sont aussi normalisées, fragmentées par leur spécialisation et évitent en fait souvent des questions globales et surtout idéologiques qui créent du dissensus ; des chercheuses comme C. Delphy font exception. Le rapport à l’altérité est particulièrement esquivé dans les recherches « de genre » qui prennent une position autocentrée, souvent ethnocentrique, qui s’aligne sur les normes politiques du moment. C’est un des effets de l’institutionnalisation des études de genre. Corollairement, il n’est plus possible aujourd’hui d’être dogmatique comme il y a quarante ans. Le dogmatisme, quel que soit son domaine d’application, est mis en abîme. C’est ce que nous montre en particulier le débat sur la burqa qui vise à l’interdire par la loi et qui va aboutir in fine à enfermer dans des écoles musulmanes spécifiques des jeunes filles et à renforcer leur assignation aux catégories religieuses, sexuelles, ethniques, confondues.
Pour l’anthropologue c’est l’arène globalisée des discours, des pratiques, des perceptions internes/externes qui se présente comme un objet pertinent d’analyse. Que des jeunes femmes converties cherchent aujourd’hui à se rapprocher de dieu sur un mode mystique extrême en se drapant entièrement sous des voiles noirs évoque, à contrario, nos ébats nus, autrefois, sous la pluie dans des espaces publics !
Dans cette arène globalisée, on ne peut pas isoler au plan épistémique les femmes, en faire un domaine entièrement séparé. Ce sont les nouveaux agencements et dispositifs politico-idéologiques qui attirent l’attention. L’altérité des femmes et l’altérité des Autres sont de plus en plus liées dans les formules de gestion proposées. Ainsi lorsqu’est annoncé – après un débat public qui court sur dix ans – « un rapport consensuel sur les statistiques ethniques » et qu’il n’est « nul besoin d’une loi » pour les mettre en oeuvre[5], la coagulation devient effective entre parité et « diversité », qui sont deux slogans actuels d’étouffement d’inégalités persistantes, criantes, moteurs d’explosion sociale en ces temps de crise. Le subterfuge du « ressenti d’appartenance » qui labellisera désormais les interrogations/ interrogatoires sur l’origine, doit être déchiffré à la lumière du procès – au sens althusserien-d’imposition ethnique qui se consolide en particulier « sur le dos » des femmes. Il y a une perversité sournoise à prétendre vouloir abolir les discriminations qui touchent les femmes et des groupes sociaux en voie d’exclusion croissante en les désignant aux yeux de tous dans leur différence ontique, en les astreignant à des « mesures », au double sens du terme : quantitatives et existentielles, en pointant leur permanente distance aux dynamiques d’intégration et leur impossible atteinte des normes dominantes. Cela vaut pour les femmes écrasées, dit-on, sous le « plafond de verre », belle expression pour rendre tangible l’inutilité de leurs efforts dans le champ du travail et de l’emploi, leur impossible ajustement aux critères en vogue.
Je voudrais souligner pour conclure que, en quarante ans, les combats féministes se sont transmués et ont aussi contribué en partie à l’établissement d’une norme globale de genre qui est un des instruments idéologiques de la gouvernance du capitalisme : on la retrouve au centre des ONG, des organisations internationales et elle participe aux processus d’hégémonisation économiques, politiques, financiers.
Et pourtant, à la manière d’Alain Badiou et Slavoj Zizek[6], je dirais volontiers qu’il y a une idée féministe qui continuera dans l’avenir à soutenir les imaginaires et irriguer le réel. Cette idée, au-delà de la foultitude de ses symbolisations éclatées, je l’ai faite mienne, elle est au cœur de ma vie, de mes désirs.