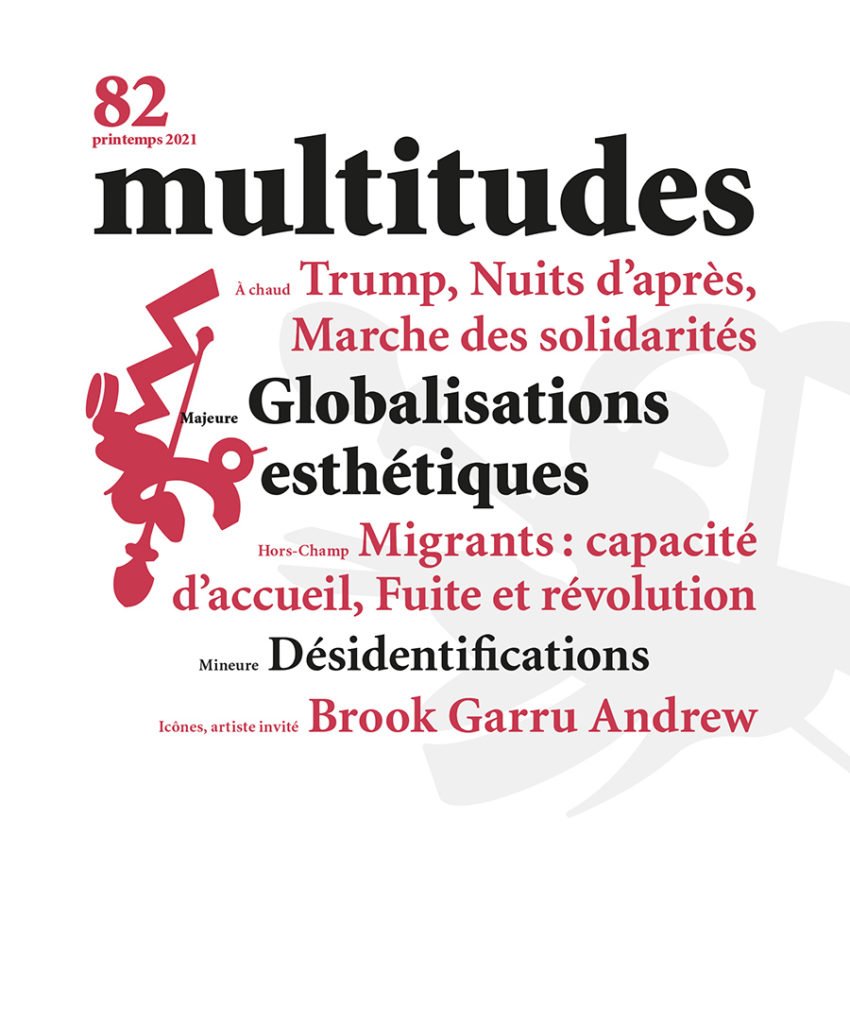Même si l’hégémonisme de Netflix est repoussante, spectateurs et spectatrices reconnaissent que la globalisation des productions de série n’ôte rien au génie des scénaristes et que Netflix déploie des trésors de stratégie pour adapter son offre d’un coin de la planète à l’autre. Les jugements esthétiques sont aux prises avec des questions d’échelles de diffusion, et il faut donc se préserver des simplifications moralisatrices qui veulent aligner le bien et le mal sur l’opposition entre local et global. Les échelles les plus tentaculaires sont toujours plus processuelles que ne le prétendent les procès en hégémonie. Mettre les échelles locale et globale en ballottage dialectique conduit souvent à dévaloriser le niveau macro et à idolâtrer les niveaux locaux.
La préférence pour les grandes échelles cartographiques est un premier niveau de contestation de l’asymétrie entre des pratiques culturelles dominantes et des expressions artistiques dominées. La déconstruction des valeurs prêtées aux esthétiques globalisées remet en cause le mythe qui méconnaît la transformation à l’œuvre dans l’élargissement à l’échelle de la planète. Cette méconnaissance élude complètement l’idée de rugosité de la nature, de complexités propres aux environnements localisés. C’est pourquoi nous ouvrons ce dossier avec la traduction d’extraits de la réflexion d’Anna Tsing, « Vers une théorie de la “nonscalabilité” ». Suivant le concept de « scalabilité » (qui prescrit une illusoire continuité qualitative de ce qui gagne en extension), un art ne serait pas plus corrompu par un succès planétaire que par une gloire nationale. En alignant la conquête des grandes échelles sur les efforts de colonisation, Tsing représente l’ordre esthétique de la modernité comme une globalisation inexorable. Pour le dire avec les termes de l’historien anarchiste James C. Scott : « Pour un œil occidental, les champs étaient manifestement en désordre ; on supposait que les cultivateurs étaient eux-mêmes négligents et imprudents. Les agents de promotion s’efforcent de leur enseigner des techniques agricoles « modernes » et appropriées. Ce n’est qu’après une trentaine d’années de frustration et d’échecs qu’un Occidental a pensé à examiner scientifiquement les mérites relatifs des deux formes de culture dans les conditions de l’Afrique de l’Ouest. Il s’est avéré que le « gâchis » dans le domaine ouest-africain était un système agricole finement adapté aux conditions locales. La polyculture et la culture relais permettaient d’assurer une couverture végétale pour prévenir l’érosion et capter les précipitations tout au long de l’année ; une culture fournissait des nutriments à une autre ou l’ombrageait ; les diguettes empêchaient l’érosion par ravinement ; les cultivars étaient dispersés pour minimiser les dégâts causés par les parasites et les maladies1. » Qu’il s’agisse de la logique industrielle fordiste ou de l’alimentation genre Mac Donald, la mise au cordeau érase les mouvements imprédictibles des êtres vivants. Imaginer une vision plurielle des modes opératoires ou processus créatifs est présumé retarder une efficacité globale. Une fois la « scalabilité » garantie sans incidence, elle prend le parti du plus gros, supposant que les œuvres d’art, pour être essentielles, doivent viser la diffusion la plus large. C’est comme ça que la radio en vient à distribuer le patrimoine musical par strates. Par exemple, les quotas de chanson française assurent que les œuvres de Natasha St-Pier procèdent d’une esthétique moins globalisée que les titres de Beyoncé, pourtant très disruptifs.
Au lieu d’interroger les échelles musicales à travers leurs réseaux de diffusion, nous visons les perturbations esthétiques générées par les frottements entre différentes échelles. En reprenant à Anna Tsing l’idée d’une « friction de l’interconnexion globale » pour l’identifier dans la circulation des marchandises musicales, l’article de Bastien Gallet présente un régime d’imprévisibilité des effets de collusion des échelles qui n’est pas loin de dissoudre les velléités de subversion esthétique de tel ou tel artiste dans un jeu d’aléas de croisements des flux. Quand Karen Barad souligne l’importance de mettre en regard les échelles, elle en appelle à lire une échelle à travers l’autre par « diffraction ». À la place d’une lecture sagement spatialisée selon telle métrique isolément insignifiante, elle vise les enchevêtrements d’échelles, dans un mouvement comparable aux nouveaux matérialismes2 qui examinent de « nouvelles formes de matérialité et donc de relations entre la/les matière(s), les individus et les groupes sociaux, et cherchent à élargir et à enrichir l’expression de l’agentivité évoquant une pluralité d’agents, devenant ainsi l’expression d’une capacité polycentrique d’action3 ». Au lieu de dissocier des espaces producteurs de normes et des espaces récepteurs (avec, éventuellement, des bifurcations), il s’agit de produire une théorie des agentivités au sens des rapports que ces matérialités engagent, en produisant des formes de vie entre autonomies et flux.
Les technologies de représentation de l’universalité musicale déplacent, d’une génération à l’autre, les manières d’apposer des intentions esthétiques sur la variété des cultures du globe. La réflexion de Bastien Gallet montre comment l’universalité musicale est devenue une machine à égaliser le tempérament, depuis la performance radiophonique de Stockhausen jusqu’aux contre-usages de l’Auto-Tune. Caroline Creton et Julien Bellanger prolongent cette analyse, en soulignant que la variété des contextes les empêche, du point de vue harmonique, d’épuiser les effets globalisants du recours à ce qui reste. Si la neutralité technologique peut paraître d’autant moins désirable qu’elle s’avère hors sujet, la contribution d’Anthony Masure arrive à tenir une frontière très lisible entre des usages normatifs de logiciels de standardisation du design graphique et des performances de contre-usage ouvertement anti-globaux. Ces inventions mettent en scène ces écarts à la norme comme autant de capacités à la réinvention à partir des potentialités que chaque occasion de temps et d’espace, de matières et de pensées proposent, ou aident à co-construire. D’un point de vue idéologique, la tension existe toujours vis-à-vis d’un rapport à la norme et au pouvoir ancrés territorialement, mais c’est aussi une illusion, une manière de faire tenir le minoritaire.
Construire et participer à une métaphysique qui embrasse temporalités et spatialités diverses, selon les multiples entités vivantes concernées, pourrait donner une assise à l’idée de solidarité généralisée et, donc, de responsabilité écologique. La question de l’esthétique et du sensible est, dès lors, centrale et fonde la responsabilité entretenue des uns vis-à-vis des autres. Si la question de l’esthétique conduit à résister aux standardisations et tentatives de tous poils des pouvoirs de donner des ordres, elle est également force d’affirmation et de production créatrice. Les formes environnementales et les formes de vie sont des modes d’affirmation de ce qui compte, de la manière dont cela compte, ce qui entraîne une manière de rendre compte. Ce qu’on appelle sentiment écologique ici passe par des manières de faire entrer en scène ce qui bien que toujours présent a souvent été ignoré. Ce qui peut advenir est le potentiel du présent, l’écart entre l’achevé et l’imaginable. La potentialité est le caractère de ce qui existe en puissance.
Quand l’été dernier, alors que la taïga brûlait, des Russes étaient interviewés et disaient : les Brésiliens doivent s’occuper de l’Amazonie puisque le changement climatique nous dit que nous sommes tous ensemble à devoir faire quelque chose. La globalisation, c’est d’abord une perspective, mais qui ne doit rien ôter à l’idée que d’être tous ensemble ne nous réduit pas à être tous les mêmes. Nous sommes infinis dans nos variations. Plus qu’une somme d’échelles, la globalisation est une échelle parmi d’autres. D’où la nécessité de sortir du dualisme global/local dans lequel nous enfermait une récente tradition critique.
En réponse à l’ouverture aux marchés globaux, aux capacités de mise en place d’une paix marchande d’un bout à l’autre du globe terrestre des années 1980 et 1990, de nombreux travaux, tant empiriques que théoriques, se sont développés. Ulf Hannerz (1992) et Arjun Appadurai (19964) proposaient d’examiner les processus de flux entre des lieux pensés séparément, mettant au défi les singularités culturelles de perdurer dans ces grands courants déterritorialisants de la globalisation, et mettaient l’accent sur les interconnexions davantage que sur l’autonomie des espaces5. L’idée sous-jacente restait de faire dialoguer les flux et les localités, les uns venant impacter les autres et en réduire le sens, voire les assujettir. D’où le rejet socio-économique et politique de la globalisation à l’origine de mouvements conservateurs et identitaires contemporains. Cette grille de lecture aux métriques savamment ajustées, du grand au petit, du global au local, relève d’une géographie dogmatique. Ce manichéisme naïf consiste, sur le plan politique, à opposer ceux qui territorialisent d’un côté, ceux qui déterritorialisent de l’autre. Autour de pratiques territorialisées, il y a des dynamiques de potentialisation de nouvelles actions.
La perspective globalisante est plutôt le problème central lui-même, la totalisation opérant à la mesure du fantasme d’une « société-monde » déjà en cours de réalisation par la maîtrise de plus en plus perfectionnée de la question de la valeur, de sa création, de sa promotion et de sa répartition. C’est comme ça que les institutions publiques semblent vouées à perdre leurs repères dans les différentes strates, comme l’illustre la contribution de Sophie Orlando sur les Écoles d’art. La description de Véronique Pittolo confirme ce point de vue par l’analyse de la critériologie institutionnelle et de son imposition sur ses ateliers d’écriture en milieu hospitalier. Dans un cas comme dans l’autre, coexistent la volonté de rendre explicites les injonctions contradictoires qu’une culture évaluative mondialisée fait peser sur les institutions concernées et comment la réalité des échanges qui partent des nécessités particulières des étudiants ou des patients débordent de partout le nouveau langage imposé.
La coexistence est productive. Pour le dire dans les termes de Brian Massumi, la similitude acte à la fois la singularité et la généricité par « une pensée-sentiment de la marge de changement. On pourrait même parler d’indétermination, puisque les ressemblances peuvent se chevaucher et se contaminer6. » Jacques Derrida traite de l’itérabilité pour théoriser le paradoxe de la simultanéité de la similitude et de la différence dans un cheminement. Il s’agit d’une possibilité de répétition, où le langage s’épelle en tant qu’il est double, absolument singulier, pris dans un contexte et pouvant être reproduit, mais aussi semblable et différent dans un nouveau contexte, le temps de la « différance ». Cette dynamique créatrice est un choix politique, celui, par exemple, des petits actes de défiance anonymes et des rébellions populaires massives. Ne peut-on considérer, en ce sens, que les flambées actuelles de confrontation ouverte plus risquées sont précédées de signes de rebellions diverses et plus ou moins organisées (ZAD, etc.). L’ensemble de ces manifestations discrédite la thèse selon laquelle il n’existerait qu’une norme esthétique et problématique à laquelle des individus et collectifs divers feraient défaut.
En vérité, l’esthétique peut qualifier des orientations pour l’action sans fondement ni norme de référence relevant d’une philosophie de la plasticité et d’un mode de résistance aux totalisations. Les contributions citoyennes aux communautés via le transfert des expériences alternatives ou oppositionnelles ou la participation aux réseaux sociaux s’opèrent par la mise en évidence visuelle, acoustique, odorante etc., dans l’espace public. Elles y garantissent l’insertion de savoirs non-experts et l’effectuation symbolique et esthétique du sens des communautés participantes. Cela confère à l’espace public une nouvelle dynamique et y apporte l’expérience du quotidien pris comme un mélange de routines, d’apprentissages esthétiques et de négociation sociale. C’est notamment par le biais des formes dont les personnes rendent compte par les récits, les jugements synthétiques concernant leur cadre de vie ou les ambiances, qu’elles peuvent ainsi contribuer à l’espace public. Soyons clairs, cette participation est inégale, genrée, racisée, et différente selon qu’on est « assigné » à domicile, sans emploi ou non. Pour rendre compte de cette réalité empirique, Nathalie Blanc retrace une collecte expérimentale en Seine-Saint-Denis de recettes de cuisine qui, certes, ressortent d’un commun, mais aussi illustrent des trajectoires de vie culinaire. Et parce que le pronom nous flotte au-dessus des réalités empiriques et des tensions, il demande lui-même d’être repensé : avec Actualités de l’entre-nous, le collectif Contre-culture psychique propose de viser la désarticulation des fixismes globaux et locaux à l’échelle du pronom « nous ».
1 James C. Scott, 2019, Two Cheers for Anarchism : Six Easy Pieces on Autonomy, Dignity, and Meaningful Work and Play, Kindle books, p. 134.
2 Barad, K., 2016, « La grandeur de l’infinitésimal. Nuages de champignons, écologies du néant, et topologies étranges de l’espace-temps matérialisant », Multitudes 65, Dossier « Nouveaux Matérialismes », p. 64-74.
3 Blanc N., Depeau S. et Tallec J., « Pensées critiques urbaines : vers un paradigme relationnel », in F. Adisson, S. Barles, N. Blanc, O. Coutard, L. Frouillou et F. Rassat (dirs.), Pour la recherche urbaine, [s.l.] : CNRS Éditions, mars 2020, p. 27 50. URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02530978v1. Consulté le 3 avril 2020.
4 Appadurai A., 1996, Modernity at large. The cultural dimensions of globalization, Minneapolis, University of Minnesota Press.
5 Hannerz U. 2010 [1992], Cultural complexity. New York, Columbia university press.
6 « Each repetition will be different to a degree, because there will be at least micro-variations that give it its own singular experiential quality and make it an objective interpretation of the generic motif. The semblance makes each particular a singular-generic. It is because it presents difference through variation that it is a thinking-feeling of margin of changeability. You could even say of indeterminacy, since likenesses can overlap and contaminate each other ». The Thinking-Feeling of What Happens » 10 Inflexions 1.1 How is Research-Creation? www.inflexions.org