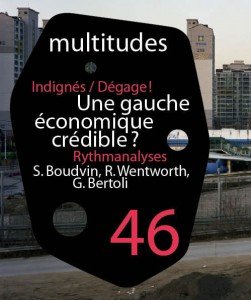Associées au monde des technologies, les notions de rythme et de cycle de vie ont de prime abord un petit quelque chose de dérangeant. Un air de déterminisme, plus proche de la fumisterie des lois de l’économie que de l’éternel retour de Nietzsche. Car la poésie, l’art et la puissance politique des cultures jouant et se jouant de l’outil technologique, des hackers de New York aux jeunes révoltés de Syrie ou d’Iran, doivent bien plus au culte païen de l’imprévisible qu’aux réincarnations boursières et post-industrielles de la Pythie de Delphes. « Notre vision du monde consiste à accepter le chaos et l’entropie. C’est ce que nous faisons en créant des programmes en open source. C’est aussi ce que fait Wikileaks[1] », explique ainsi Amette, caïd de la révolution numérique fréquentant l’un des plus grands hackerspace européen : la c-base de Berlin. D’où notre question : le concept de rythme est-il antinomique à ce chaos et à cette entropie sans lesquels les nouvelles technologies ne seraient in fine que des instruments de contrôle et de manipulation marketing ?
Le techno-rythme n’est pas le cycle de vie des produits
Comment expliquer ce sentiment persistant du caractère réducteur d’une rythmanalyse appliquée au domaine des nouvelles technologies ? Est-ce la proximité intellectuelle de la notion de rythme avec la notion de cycle dans la théorie économique ? Ceux qui ont essuyé leur derrière sur les bancs d’études liées de près ou de loin à la bête économique se souviennent certainement des plus réputés des cycles courts, de huit à dix ans, dits de Juglar, ou de leurs homologues bien plus longs, de quarante à soixante ans, dits de Kondratieff, fondés tous deux sur l’observation de récurrences et de retours plus ou moins systématiques de similarités dans l’analyse historique de l’économie des États et de leurs crises. Soyons honnêtes : l’aspect barbant et fort scolaire de ces cycles-là ne peut expliquer à lui seul notre hésitation à embrasser la notion de rythme en matière de technos. Non, le souci vient de l’assimilation de la question technologique à celle de l’innovation, et de cette question de l’innovation à son acceptation par le vaste public grâce aux entourloupes du marketing.
La plupart des chercheurs, sociologues compris, ont en effet enfermé depuis un demi-siècle cette notion de cycle dans un registre économique, voire « économiste ». La caricature de ce tropisme reste la fameuse courbe en cloche du cycle de vie des innovations, c’est-à-dire de leur diffusion dans une population, telle qu’elle a été théorisée par le sociologue Everett Rogers en 1962 avant de devenir la bible du marketing des nouvelles technologies. Il y a donc, à suivre ce graphe ô combien orienté, l’infime minorité d’innovateurs, premiers expérimentateurs du gadget, du logiciel ou du service, et à l’opposé cette bande de ringards que sont les « traînards » (« laggards »), puis dans l’entre-deux les « premiers accédants » (« early adopters »), une majorité première (le tiers de « early majority ») puis une majorité tardive (le tiers de « late majority »). Chacun, dans ce cycle-là qui se traduit en marketing par les phases de lancement, de croissance, de maturité et de déclin d’un produit, n’est jugé que sous l’angle de son rapport à l’objet ou au service tel que strictement pensés par l’entreprise qui les a lancés, selon ses règles d’adoption à elle et non celles de celui qui l’utilise. L’usage en devient une boîte noire, coquille vide sans intérêt en attendant la mise sur orbite d’un nouveau produit. Ici sont niés les jeux infinis de l’appropriation et de la réappropriation, du bricolage et de la récup’, y compris de techniques très communes. L’enjeu d’une analyse via la notion de rythme est donc, sous ce regard, de réintégrer la culture au cœur du rapport aux nouvelles technologies. De nous permettre de comprendre, pour ne prendre que cet exemple, comment le vinyle, enterré par le CD, a pu renaître et revivre mille vies après sa mise en bière par les industries culturelles. D’en finir avec l’assimilation des multiples fruits de la technologie à de simples produits fermés, c’est-à-dire à des objets inaltérables, subis et non créés, détournés, réinventés, déprogrammés et reprogrammés par les usagers eux-mêmes selon les principes du logiciel et de l’art libres…
Ce qu’oublient les théories économiques classiques et plus encore cette trop fameuse courbe en cloche, il est vrai caricaturée depuis des lustres à des fins commerciales, c’est l’incapacité des ingénieurs à anticiper eux-mêmes les usages de leurs propres inventions, tout comme celle, plus violente encore, des valets du marketing à concevoir le détournement de leurs offres ou des supports technologiques qui les portent. Le succès hallucinant des SMS à partir de 1998, par exemple, a littéralement explosé « dans le dos de l’histoire » économique comme l’aurait dit Hegel[2]. Au départ, le SMS n’était en effet qu’un signal utilisé par les techniciens pour s’envoyer et recevoir des données sur le réseau. Les opérateurs, à l’époque, le conçoivent comme un service « rustique », à destination de populations ciblées du monde professionnel. Résultat : ce sont les plus jeunes qui vont s’en emparer au mépris de toutes prévisions et en faire un langage barbare, tout en communication asynchrone.
Bref, parler de rythme d’évolution et de transformation des technologies et de leurs usages, ne peut avoir de sens qu’à condition d’envisager ce concept sur un registre culturel bien plus qu’économique. Sous ce regard, il n’y a pas un rythme, celui de la vente et de la diffusion des « produits », mais une multitude de rythmes, courts ou longs, lents ou brutaux, avec des ruptures, des effacements, des progressions, des mutations, des récupérations, des réinventions. Nourris de la multiplicité des usages imprédictibles mais aussi de notre imaginaire fantasmatique de « devenir dieu », ces rythmes-là en deviennent musicaux, loin du caractère opérationnel dudit cycle de vie des produits et services. Ils se façonnent en toute imprévisibilité à partir de boucles, de samples d’histoires d’hier et d’avant-hier, de bruits autant que de figures classiques de l’adoption et du détournement des technos. L’analyse des rythmes est donc complexe, car impossible à cantonner à une unique ou même deux disciplines universitaires, telles que l’économie et la sociologie. Pour modéliser les récurrences entre temps différents, on peut s’inspirer des observations de l’ensemble de Mandelbrot ou dans un genre plus prosaïque des côtes de Bretagne, dont on reconnaît de mêmes formes chaotiques selon qu’on les regarde de très près, comme avec une loupe à pied le long de la mer, ou de très loin, comme perché sur la lune. Autrement dit : il s’agit de partir du principe que les similarités, les étapes d’évolution dans le temps court de l’appropriation et de la réappropriation des technologies, du SMS aux « tweets », ou de Facebook à la visiophonie par Skype, se retrouvent peu ou prou dans l’analyse des temps longs de notre rapport à ces mêmes technologies.
Du psychotrope comme technologie de rupture
Prenons deux moments clés, deux climax de cette histoire chaotique et entropique de notre rapport aux technologies. Premier climax : 1966-1969 et l’explosion psychédélique et hippie. Deuxième climax : 1986-1989 et la déferlante de la house et de l’acid house des clubs enfumés de Chicago aux clubs d’Ibiza, d’Ibiza à Londres via une bande de DJ passionnés, puis de ces boîtes londoniennes, fermées par Margaret Thatcher, aux raves parties sauvages des banlieues de la capitale du Royaume-Uni au nez et à la barbe (virtuelle) de la Dame de Fer[3]… À ces deux moments, parents l’un de l’autre, s’opère une même étrange coagulation, d’où s’extirpe en un indescriptible chaos une contre-culture devenant pour le coup une culture bien au-delà de la musique. Et dont les sources, à chaque fois, s’avèrent être une voire deux ou trois technologies que les circonstances, notamment politiques, vont transformer en une « contre-technologie », en vecteur d’une transformation radicale. Et imprévue.
La première de ces technologies (car c’en est une !), c’est le LSD, ou plus largement les premiers psychotropes chimiques. Sans entrer dans les détails là encore, cette drogue, dérivée de composés issus de l’ergot de seigle, est synthétisée pour la première fois en 1938 au sein des laboratoires Sandoz en Allemagne. L’objectif des recherches et expérimentations, qui vont être abandonnées une première fois, est thérapeutique… et commercial ! Un peu plus tard, dans les années 1940 et 1950, l’enjeu des tests et tentatives de lancement de cette techno reste, d’une part thérapeutique, notamment dans les milieux psychiatriques, et d’autre part… militaire et de « sécurité nationale » !… Pour preuve : le scandale du projet MK-ULTRA de la CIA qui, entre 1951 et 1953, réalise dans le plus grand secret des expérimentations visant « à administrer du LSD sur des sujets ignorants dans diverses situations sociales[4] », selon les mots du Sénateur Kennedy lors de sa révélation en 1977. L’enjeu est le « contrôle mental » des populations, et notamment de celles jugées dangereuses par l’État fédéral. Autrement dit : comme la plupart du temps en ces matières technologiques, la première phase de l’histoire est de l’ordre du contrôle par le ou les pouvoirs, qu’ils soient scientifiques, économiques ou politiques. D’ailleurs, pour l’anecdote, il faut savoir que l’article source du papier mythique des deux professeurs qui ont inventé en 1960 le terme « cyborg », Manfred E. Clynes et Nathan S. Cline, s’appelait non pas « Cyborgs and space » mais « Drugs, space and cybernetics »[5]… En cheville avec la NASA et les officines de recherche du Pentagone, les deux savants considèrent en effet la cybernétique et les drogues biochimiques du type LSD comme les clés de l’homme augmenté qu’ils souhaitent façonner pour naviguer sans contrainte de respiration dans les tréfonds intersidéraux du cosmos.
Sauf que l’imprévu va venir de l’écrivain Aldous Huxley, médecin qui prescrit des prises contrôlées de LSD au sein de sa clinique dès la deuxième partie des années 1950, puis de Timothy Leary, professeur à Harvard dont les recherches de 1960 à 1963 ont pour but, via « l’élargissement de la conscience », de réhabiliter des criminels ou de traiter des maux comme l’alcoolisme ou… le manque de libido. Interdits, le LSD ainsi que d’autres hallucinogènes vont échapper aux experts, aux pouvoirs de contrôle ainsi bien sûr qu’aux multinationales de la santé. En revanche, ils vont envahir le monde de la pop, de la musique, du cinéma. De Revolver des Beatles en 1966 à la micro symphonie Good Vibrations des Beach Boys de Brian Wilson, une digue saute et libère les potentiels d’une création qui explose les cadres convenus des sons et images populaires. Les titres s’allongent à n’en plus finir, les guitares deviennent folles sous un déluge d’effets, des globules liquides rouges, jaunes, mauves, jaunes ou oranges apparaissent sur les murs dans les hangars désaffectés, les festivals se multiplient et investissent des espaces de plus en plus immenses à l’air libre, on danse, on oublie les contraintes du quotidien… Cette technologie qu’est la drogue devient un vecteur d’altération, de chamboulement de vie et de vision du monde, pour les artistes autant que pour leur vaste public. À l’instar des Beatles, qui assumaient leurs prise de cannabis mais ont toujours avoué une méfiance vis-à-vis d’autres drogues, l’on peut vivre et être acteur de ce renversement sans prendre soi-même l’hallucinogène du docteur Leary. Le LSD devient le relais imaginaire autant que le vecteur réel d’une révolution qui n’est pas que mentale, et qui surtout façonne une culture transversale au-delà de l’économie. D’abord technologie médicale puis technologie de contrôle, experte donc, la drogue devient le symbole d’une « contre-culture », d’une opposition « pop » aux valeurs mais aussi aux pouvoirs dominants, dont bien sûr ce gouvernement des États-Unis qui envoie ses jeunes se faire dézinguer au Vietnam.
L’acid house en symbole du techno-rythme
Une petite génération après l’explosion psychédélique et son « Summer of Love », l’histoire va en quelque sorte se répéter pour une série d’autres « printemps de l’amour » dans la deuxième moitié des années 1980 au Royaume-Uni. Une drogue chimique, l’ecstasy, va certes jouer un rôle dans la réinvention du flower power et du smiley sur fond techno-house. Mais cette fois, un autre vecteur intervient : l’invention et la commercialisation en 1982 de la norme MIDI, destinée aux musiciens professionnels. Elle permet aux différents instruments de musique électronique de marques et modèles différents de communiquer entre eux. Or, selon François Kevorkian, DJ majeur qui, après le disco, a vécu la naissance de la house music, ce disco sans le sou :
« c’est la technologie qui a rendu la house possible. Les fabricants de claviers ont découvert le système MIDI, et c’est ça qui a permis aux gens de piquer des sons pour programmer leurs boîtes à rythme. Soudainement, plus besoin de studio et de musiciens : il suffisait d’une petite boîte de 400 ou 500 dollars, la Roland TR 707, la TR 606 ou la TR 808, et vous pouviez créer tous les rythmes que vous souhaitiez. Ce qui a rendu la house si radicale, c’est cette façon que les DJ avaient d’utiliser ces machines avec leur son incroyable, la basse et les haut-parleurs, en live dans leurs clubs. Lorsque j’ai entendu les premiers trucs de house comme “Love Can’t Turn Around” ou “Can you Feel it” de Mr Fingers, j’ai pensé aux peintures du Douanier Rousseau. Vous savez, ces tableaux qui semblent sortis de l’esprit d’un enfant, et pourtant magnifiques, avec cette beauté naïve, mais finalement ce côté si profond et si mystérieux… »
Ce que Kevorkian raconte là, c’est une épidémie d’usages, les DJ se prêtant leurs machines, enregistrant les uns sur les autres pour le bonheur des danseurs, selon des logiques que l’on retrouvera plus tard entre gamins de nos cités avec le home studio puis les ordinateurs transformés en orchestres à tout faire…
L’autre anecdote symbolique de cette fièvre, c’est la naissance du son « acid » des raves de 1988 et 1989 : il a été inventé au hasard de la dèche par DJ Pierre et son comparse Spanky sous le patronyme sans faute d’orthographe de Phuture… Nous sommes en 1987. DJ Pierre et Spanky n’ont pas un denier pour se payer un studio ou l’un de ces premiers séquenceurs à pointer sur le marché. Leur seul instrument est une Bassline TB 303, une machine bas de gamme que le constructeur Roland destinait aux groupes pop en panne de bassiste. Cet appareil tombé en désuétude, en phase terminale de notre bonne vieille courbe en cloche, est censé reproduire les sons d’une basse électrique. Il est peu fiable et possède un son pourri. Pierre fait une gaffe : il efface la ligne de basse programmée par Spanky la veille et s’amuse à tourner les boutons en tous sens et non sens… D’où un effet saisissant : en accélérant à outrance une programmation censée imiter la basse, et en la saturant dans les aigus, Pierre se retrouve face à une boucle névrotique et totalement iconoclaste. Il se dépêche d’ajouter dessus une boîte à rythmes, sommaire mais très funky, puis il refile la cassette à Ron Hardy. Le DJ joue cette combinaison mutante jusqu’à cinq fois par soir au Warehouse, et quinze jours plus tard, « Acid Trax » est le morceau dont tout Chicago parle. Sauf que personne ne connaît le nom de ce morceau en cassette, de cette étrange bestiole entraînante et aux accents discordants que Ron Hardy aime d’amour pulsionnel. Les danseurs en parlent entre eux comme d’un OVNI qu’ils reconnaissent par ces mots : « What a crazy acid trax »… Et c’est ainsi que DJ Pierre et Spanky décident d’appeler leur chose impossible « Acid Trax », lançant sans le savoir un mouvement qui va secouer l’Angleterre puritaine comme jamais depuis le punk : l’acid-house. Aciiiiid ![6]
Comme à partir de 1966 au Royaume-Uni puis aux États-Unis, la ou les technologies, de la drogue aux instruments du numérique, servent de catalyseurs à un vaste mouvement dont l’une des clés est encore et toujours politique Cette fois, il s’agit du « right to party ». Du « droit à faire la fête ». « Qu’ils gueulent, semblent leur dire les ravers. Nous, on s’amuse. » De 1987 à 1989 démarre une course-poursuite entre le gouvernement Thatcher et les fêtards impénitents. La police ferme les boîtes d’acid-house ? Qu’importe : on se réfugie dans les hangars. Condamnée par les autorités, l’ecstasy devient signe de reconnaissance. En fermant les clubs et en plongeant des milliers de jeunes dans l’illégalité, le gouvernement britannique dynamise une contre-culture embryonnaire. À chaque rave, ils ne seront pas deux cents mais vingt mille de toutes castes à battre la campagne – to rave – dans le bocage anglais, à des dizaines de minutes de Londres, et en non-stop durant tout le week-end…
Et puis le net, Facebook et les révolutions de Tunisie et d’Égypte…
Bien plus tard, autre pays, autre contexte, autres technologies : début 2011 en Égypte, c’est une page Facebook qui sert de symbole voire de détonateur à une révolution quant à elle profondément politique dans son essence. Ce profil est celui d’un blogueur assassiné par la police égyptienne : Khaled Said.
Pour la petite histoire, à l’origine de l’Internet, donc aux sources lointaines du réseau social, il y a un réseau constitué en septembre 1969 par un autre pouvoir, en l’occurrence une branche du Pentagone. Arpanet, puisque c’est son petit nom, relie quatre ordinateurs, de l’armée américaine et de trois universités travaillant pour ce même Pentagone. La rythmanalyse du réseau des réseaux et de ses infinités de développements, du tout premier courrier électronique en 1972 à l’explosion de l’Internet mobile sur les smartphones, du navigateur Netscape au logiciel libre, est certes à construire. Nous avons néanmoins la certitude, tant les indices abondent, d’y retrouver selon les cas et familles de « produits et services » de mêmes figures que celles des deux climax de 1966-1969 et 1986-1989. Soit en vrac, et avec d’infinies variantes : invention dans un cercle d’experts ; expérimentations dans les laboratoires des grandes puissances privées ou publiques ; usages sécurisés, parfois à des fins de contrôle, ou lancement commercial et tout aussi maîtrisé à grande échelle ; développements d’usages recto puis d’usages sauvages ou détournés ; mouvements de réappropriation hors des pouvoirs privés ou publics, voire contre ces mêmes pouvoirs.
À l’image des musiques minimalistes ou électro, de Steve Reich à Daft Punk, la répétition au fur et à mesure du temps de mêmes figures rythmiques ne compose jamais la même musique. Cycles courts, moyens ou longs, simple service du type SMS ou langage universel à la façon de l’Internet, le jeu de ces rythmes raconte une histoire irréductible aux courbes du marketing et de la théorie économique. Une histoire dont la géographie et la géopolitique évoluent, les territoires changent et les intensités varient, mais dont les temps forts naissent immanquablement de conflits, d’oppositions qui se cristallisent en des pratiques.
Même s’il est trop tôt pour en finaliser l’analyse, les révolutions de Tunisie, d’Égypte, de Lybie ou de Syrie ne font pas exception. Pas plus que le mouvement psyché et hippie des années 1960, elles ne peuvent se résumer aux usages d’une ou plusieurs technologies. Elles se sont certes nourries d’une colère sociale et politique, mais sauvage et ressemblant diablement à celle des ravers anti-Thatcher, rejetant le jeu classique de la politique pour mieux se reconnaître dans une version de la démocratie proche des premières utopies de l’Internet. « Je n’ai pas participé au premier jour de la révolution, raconte ainsi le jeune cairote Tarek Amr dans son blog. J’avais un peu peur, j’étais à moitié convaincu que ça puisse changer quelque chose, et aussi, je préfère suivre ce genre d’événements sur Twitter et Facebook à y participer directement ». Mais quand les autorités ont censuré tout accès à la toile, que ce soit via les mobiles ou les ordinateurs, comme beaucoup d’autres, il s’est révolté. « Ils croyaient que ça allait empêcher les gens de communiquer et d’organiser d’autres manifestations, écrit-il. Mais ce qui s’est passé, c’est que ce black out de l’information m’a motivé – ainsi que des milliers d’autres personnes – à descendre dans la rue et à participer aux manifestations du “Vendredi de la colère” »[7], ce fameux 28 janvier 2011… Bref, Tarek Amr n’a pas pris de LSD, n’a pas dansé sans fin dans les raves, mais il a manifesté au nom de sa culture internaute, techno, egotiste, mais vécue comme libre de toute attache aux instances dirigeantes de la société égyptienne voire mondiale. Mobile en poche, il a quitté son écran d’ordinateur pour la protéger, cette culture, et mieux en retourner les productions contre le pouvoir, selon des règles informelles et désormais universelles qui, sans aller contre les intérêts de Facebook ou Twitter, en ont inventé un usage politique, donc imprévu.