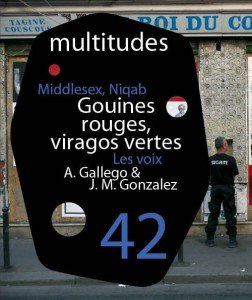L’enfant naît : il crie. Ses poumons doivent s’emplir d’air. Toutes les personnes qui assistent à ce moment veillent à ce premier souffle. À peine au monde, le nouveau-né fait entendre sa voix : biologiquement parce qu’il doit respirer, socialement parce que ceux qui l’accueillent attendent cela de lui.
Introduite par le biais de sa toute première expression, la problématique de la voix se place d’emblée sur le terrain de son acquisition entre sa nature corporelle et son inscription institutionnelle (hôpital, famille, etc.).
Dans les Recherches philosophiques[1], Wittgenstein neutralise ce type d’opposition en concevant le langage comme une activité qui renvoie à d’autres activités et finalement à une forme de vie. Faire entendre sa voix fait ainsi partie de notre histoire naturelle au même titre que boire, manger, marcher, sourire, appeler, donner un ordre et ainsi de suite.
J’aborderai donc la question de la voix par le biais de l’apprentissage du langage. La description que j’en donnerai aura comme objectif d’éclairer notre jeu de langage « faire entendre sa voix » pour essayer de comprendre les connexions entre ce jeu de langage et d’autres jeux de langage. Je vous mettrai sous les yeux une certaine image, celle de la naissance de la voix, pour essayer de vous faire voir le lien qu’elle entretient avec l’apparition de la subjectivité dans le langage. De fil en aiguille apparaîtra la trame où s’entrelacent les motifs de la voix et du politique.
Jeu de langage et méthode des jeux de langage
En abordant le concept de voix par le jeu de langage « faire entendre sa voix », j’adopte la perspective grammaticale de Wittgenstein. Elle implique une double contrainte qui oblige à faire coïncider en tous points l’objet à décrire et l’instrument de sa description. Le jeu de langage sera en même temps ce que je décris et ce avec quoi je le décris.
L’abandon de tout métalangage descriptif relève d’une grande méfiance à l’égard d’un sol trop lisse sur lequel on glisse toujours vers la métaphysique. Nos interrogations doivent ainsi s’accrocher aux aspérités de nos usages quotidiens du langage. Mais ce retour à l’ordinaire ne veut pas dire un recours à l’évidence. La description de nos transactions langagières quotidiennes est à la fois difficile et exigeante. C’est un travail sur notre langage et sur nous-mêmes pour apercevoir ce que nous avons sous les yeux et comprendre les connexions qui existent entre nos concepts ordinaires. La démarche grammaticale a pour but d’éduquer le regard. Il faut entendre grammaire dans son double sens ordinaire de « description d’un usage » et « usage lui-même ». L’adéquation de la description dépendra de la rencontre entre la description du descripteur et la reconnaissance de cet usage par l’usager à qui elle est adressée. Cette rencontre peut avoir lieu comme elle peut ne pas avoir lieu.
Mais s’attaquer frontalement à la problématique de LA voix nous fait courir le risque de chercher une substance « voix » derrière le substantif voix. Si l’on prend au sérieux les mises en garde wittgensteiniennes du Cahier bleu[2] contre l’essentialisme de ce type de définition, il serait plus prudent de partir d’une pratique comme « faire entendre sa voix ». Pour ce faire, je prendrai une série d’exemples. Ils ne donneront pas une explication du sens par défaut, mais bien la seule possible. En effet, nous avons appris notre concept de voix par l’usage au moyen d’exemples et toute tentative de l’expliquer autrement que par des exemples (un corps de signification, par exemple) serait vouée est à l’échec.
Comme notre usage de l’expression «faire entendre sa voix» est extrêmement complexe, je tirerai mes exemples d’usages du langage plus simples que font les enfants quand ils apprennent à parler. Cette réduction à l’expression primitive (au sens mathématique) me permettra de vous proposer une certaine vue de notre concept ordinaire de voix. J’utiliserai, pour ce faire, des images qui sont tirées de vidéo d’enfants qui jouent dans une cour de récréation. Ces images n’auront pas pour but de vous communiquer une expérience (même s’il n’est pas anodin que j’aie une grande expérience des enfants qui jouent), mais de vous faire voir certaines connexions qui existent entre les différents jeux de langage que nous jouons avec notre concept ordinaire de voix. Mes images auront donc un statut assez simple : je vous montre un usage et vous le reconnaissez (ou vous ne le reconnaissez pas). La signification que je cherche à vous faire voir est physionomique. Elle est diffuse, mais aussi précise que peuvent l’être nos concepts ordinaires.
Un jeu de langage est, chez Wittgenstein, autant une méthode de recherche que l’objet de cette recherche. Ce dédoublement provient de l’impossibilité d’adopter un point de vue extérieur sur le langage. La réduction de nos usages à des usages plus simples a pour but de nous faire prendre assez de distance à l’intérieur du langage pour pouvoir trouver un point de comparaison. Le point de vue comparatiste qu’adopte Wittgenstein est profondément anthropologique. Le détour qu’il fait par l’apprentissage du langage n’est pas une fin en soi, mais le moyen de se décaler assez pour nous permettre d’éclairer la signification de nos mots. Ce pas de côté introduit néanmoins une certaine conception de l’acquisition du langage. On peut la résumer assez simplement : l’enfant apprend beaucoup de choses par le jeu ; par analogie, on peut dire que l’enfant apprend à parler en jouant ; on peut finalement appeler ce type de jeu un jeu verbal ou un jeu de langage.
La conception wittgensteinienne de l’acquisition du langage s’oppose à une conception empirique qui voudrait qu’un enfant soit confronté au monde, s’en forge une représentation et finalement donne un nom aux différentes significations issues de son expérience sensorielle[3]. Cette dernière conception a, en effet, le gros défaut de tenir pour séparés l’enfant et le monde, l’apparition du langage servant de trait d’union entre les deux. Nous sommes alors obligés de supposer un sujet préexistant au langage et non pas concomitant à son développement, solution qui nous pousse vers un sujet solipsiste et transcendant. Au contraire, les jeux de langage wittgensteiniens nous forcent à poser différemment le problème. Le jeu étant une activité, le seul sujet dont nous avons réellement besoin sera le sujet de l’action[4]. La question de l’acquisition se pose alors en des termes très différents : comment le nouveau joueur entre-t-il dans la communauté des joueurs ? La question de la voix peut être à son tour formulée différemment : comment, à partir des jeux de langage des autres, l’enfant est-il amené à jouer son propre jeu, ou, en ce qui concerne le langage, comment, à partir des expressions des autres, l’enfant va devenir capable d’exprimer sa propre voix ? L’enfant arrive dans une partie en cours qui précède toujours son entrée en jeu. Faire entendre sa voix peut alors être considéré comme un problème politique puisque ce jeu de langage définit d’emblée ma voix par rapport aux voix des autres, c’est-à-dire par rapport à une communauté.
« Ma société, si elle est mon expression, devrait aussi me permettre de trouver ma voix. Si les autres étouffent ma voix, parlent pour moi, j’aurai toujours l’air de consentir. On n’a pas une voix, sa voix propre, par nature : il faut la trouver pour parler au nom des autres et les laisser parler en votre nom. Cela montre encore une fois la proximité de la question du contrat – de la question politique en général – et celle de l’apprentissage du langage »[5].
La voix et le politique
Certes nous héritons nos jeux de langage de nos aînés, mais comment se fait cette transmission ? Wittgenstein nous met en garde contre toute tentation de vouloir trouver un fondement aux jeux de langage : ils ne sont pas fondés, mais fondateurs au sens où ils sont toujours déjà là. Mais, à trop se méfier des origines, ne court-on pas le risque de ne plus s’apercevoir que dans un jeu, il y a toujours quelqu’un pour poser le jeu et quelqu’un d’autre pour jouer le jeu ? Une cour de récréation fournit un terrain (anthropologique) privilégié pour observer comment le jeu se met en place parce qu’il est un lieu où se croisent anciens et nouveaux joueurs, un lieu d’héritage.
Dans notre premier exemple, une enfant (S) va chercher une éducatrice (E) pour l’aider à initier un jeu. Dans la cour, elles tiennent la discussion suivante :
E : Soit tu respectes les règles du jeu, soit tu fais autre chose [avec l’index dressé en signe de mise en garde].
S : Mais c’est moi qui a choisi le jeu…
E : Tu as entendu, mais tu dois respecter, même si tu as choisi ou proposé le jeu.
S : Non, non, c’est moi qui commande le jeu, parce que c’est moi qui a choisi.
E : Oui, c’est pas parce que c’est toi qui as choisi, qui as incité ou proposé le jeu que c’est à toi de commander. Et il y a personne qui commande, Sarah, vous jouez tous ensemble, tous ensemble avec le même règlement. Y a pas des règles différentes pour Sarah et pour les autres. Et si ça va pas comme ça, tu peux faire autre chose […].
Dans ce dialogue, l’adulte et l’enfant entrent en conflit. Leur désaccord porte sur les règles du jeu. Il va nous permettre de voir plus clairement le rapport qui existe entre voix et politique.
Dans sa dernière réplique, l’éducatrice donne une injonction complètement paradoxale à l’enfant. Elle dit en même temps « soit tu respectes les règles du jeu, soit tu fais autre chose » et « c’est pas parce que c’est toi qui as choisi, qui as incité ou proposé le jeu que c’est à toi de commander ». Elle met en place le jeu en commandant tout en niant que commande celui qui pose le jeu. Il y a un écart entre ce qu’elle dit et ce qu’elle veut dire. Pourquoi ? Ici, l’entendement se cogne contre les limites de notre propre langage – pour le dire à la façon de Wittgenstein[6]. La bosse que nous nous faisons est le signe que nous nous heurtons à un problème philosophique. Lequel ?
Le problème dans notre exemple n’est pas tellement celui de la règle « vous jouez tous ensemble, tous ensemble avec le même règlement » que le problème de celui qui pose le jeu. En ce sens, l’enfant a raison de dire que « c’est moi qui commande le jeu, parce que c’est moi qui a choisi ». La menace de l’adulte « et si ça va pas comme ça, tu peux faire autre chose » corrobore d’ailleurs le fait que celui qui pose le jeu commande.
Le problème se situe alors au niveau de l’autorité de la règle : qui dit la règle (« soit tu respectes les règles du jeu, soit tu fais autre chose ») et qui entend la règle (« tu as entendu »). Nous retrouvons la voix dans son double aspect de celle qui est dite et de celle qui est entendue. En effet, pour qu’existe un auteur de la règle il faut qu’existe un sujet de la règle (l’existence est, ici, grammaticale). La confrontation entre l’adulte et l’enfant tient à ce que tous deux veulent occuper la place de celui qui pose le jeu, tous deux veulent occuper la place de l’autorité de la règle.
Dans notre exemple, l’enfant va chercher l’adulte pour l’aider à poser le jeu dans la cour. Il pourrait apprendre à le faire, mais dans le couple formé par celui qui dit la règle et par celui qui entend la règle, l’aîné ne veut pas laisser sa place au cadet. L’enfant ne parvient à pas faire entendre sa voix qui sera d’ailleurs complètement étouffée dans la même situation quelques minutes plus tard :
E : D’accord ? Alors, venez là au milieu.
S : Mais moi, j’ai quelque chose à dire…
E : Non, non, non, c’est moi qui arbitre et c’est moi qui décide et Sarah, elle joue ou elle joue pas, mais elle rapplique pas son grain de sel.
S : [inaudible]
E : Alors, c’est parfait.
Dans ce dialogue, l’éducatrice ne laisse à S que le choix de se conformer à l’autorité de l’arbitre, celui qui dit les règles, ou d’être exclue du jeu. L’enfant n’a pas son mot dire. Elle reste sans voix ; elle peut entendre, mais n’a rien à dire. Lui refuser une certaine autorité revient à ne pas reconnaître ses efforts pour imiter les adultes qui posent le jeu, à ne pas tenir compte de ses envies de grandir.
Du point de vue de l’acquisition du langage, « faire entendre sa voix » devient immédiatement un problème politique parce que ce jeu de langage implique le rapport de l’enfant à sa communauté, l’accord entre celui qui arrive et ceux qui sont déjà arrivés. Est-ce que les anciens acceptent de céder une part de leur autorité aux nouveaux venus dans leurs efforts pour apprendre ou est-ce que ces derniers doivent rester à leur place ? Dans une société de la conformité, le petit n’a d’autre choix que de se conformer ou de ne pas être conforme (être exclu, être fou, être racaille, etc.). Dans une société du consentement[7], le grand devrait accepter que son autorité soit remise en question et que le petit puisse exprimer sa voix. Mais que veut dire consentir ? De quel type d’accord s’agit-il ? Si donner une voix voulait simplement dire donner la parole, un contrat pourrait être établi. Mais un enfant ne passe pas de convention avec ses aînés. L’accord qu’il peut trouver avec sa communauté « n’est pas un consensus d’opinion, mais de forme de vie »[8]. La liberté d’expression n’est donc pas une question de volonté politique, mais une question d’attitude politique, d’attitude envers l’autre. La différence tient à ce que la violence symbolique que subit le dominé (ou le petit) s’exerce à son insu, mais avec son consentement, comme l’a très bien vu Bourdieu. Cela laisse planer une ombre sur toute politique volontariste du consentement pour laquelle l’adhésion à une communauté serait affaire d’opinion. Si mon consentement est dès le départ pris dans un rapport de domination, la voix que je donne n’est rien d’autre qu’une forme d’extorsion (elle est une expression de la voix de l’autre, pas expression de ma voix).
Dans le premier dialogue, quand l’éducatrice donne de (bonnes) raisons à l’enfant de se soumettre, non pas à elle, mais à la règle « Sarah, vous jouez tous ensemble, tous ensemble avec le même règlement », elle cherche son consentement en se mettant à sa hauteur (voir Images 1).
Dans le deuxième dialogue, alors que S lève la main en disant « mais, moi j’ai quelque chose à dire » (vignette 1), l’éducatrice lui coupe la parole « non, non, non », en se dirigeant vers elle de toute sa hauteur un index menaçant pointé vers le ciel, puis pointé dans la direction de l’enfant (voir Images 2).
L’adulte avance, l’enfant recule. L’enfant veut prendre la parole, l’adulte lui coupe la parole. La voix est exprimée, elle peut être entendue ou non, mais l’expression va de pair avec l’écoute. La voix est dialogue. Avec l’autre, avec ma communauté.
Ma voix a donc une expression. Elle a un corps, elle a un lieu. Ainsi comprise, la voix ne peut se satisfaire d’une conception désincarnée et monologique du sujet[9].
La voix et le sujet
Dans l’exemple qui suit, l’enfant R dit « celui qui vient avec moi s’assit là ». A et S entendent sa voix, ils accourent pour s’asseoir à côté de lui (voir Images 3).
Un enfant peut donc avoir autorité pour poser le jeu. Mais, je ne peux pas poser le jeu sans que d’autres acceptent de le jouer. Cette impossibilité est grammaticale. Elle est inscrite dans notre langage. Dans notre cas, l’enfant R appelle les enfants S et A pour former deux équipes qui vont jouer au volleyball.
La dissymétrie entre l’enfant qui dit et ceux qui écoutent reproduit parfaitement celle entre adulte et enfant de l’exemple précédent. Parmi les enfants, il y a aussi des grands et des petits qui entrent dans des relations de domination (domination grammaticale du type « je pose le jeu – il joue le jeu » ; « je dis la règle – il suit la règle » ; etc.). Dans ce contexte, comment est-ce qu’un enfant fait entendre sa voix ?
Dans les images qui suivent, R et S sont dans la même équipe de volleyball (vignette 1). S envoie le ballon dans l’autre camp (vignette 2). Le ballon revient et R, le plus âgé des deux, s’exclame « hé, laisse-moi. C’est un son tour, j’ai dit » (vignette 3) tout en mettant le ballon hors de portée des mains de son coéquipier (voir Images 4).
Dans cette formulation de la règle, faire entendre sa voix veut dire faire parler son corps. L’enfant protège le ballon de son dos tout en regardant son coéquipier droit dans les yeux. Mais, ce n’est pas son bras, son dos ou son regard qui parle, c’est lui qui s’exprime. L’incarnation du sujet n’équivaut donc pas à une disparition de la subjectivité, mais redonne une certaine naturalité à l’expression de soi.
Ainsi, l’action peut-être expression comme dans l’exemple qui suit où le grand lance le ballon dans l’autre camp en disant « j’ai dit passe ton tour » (voir images 5).
L’enfant dit la règle en même temps qu’il l’applique. Sa voix se fait geste. Mais la règle ainsi édictée ne fait autorité que dans la mesure où quelqu’un s’y soumet sans quoi elle ne vaudrait que comme simple lancé de ballon. La voix est dialogique au sens où elle ne dit que si quelqu’un l’entend et, dans notre exemple, entendre veut dire consentir à ce qui est dit. Par sa passivité, l’autre enfant se conforme. Il reste sans voix. Dans ce cas, l’auteur de la règle est autoritaire et le sujet de la règle est assujetti.
Le pouvoir de la voix ne s’exerce donc que dans la mesure où elle est reconnue par celui qui l’entend. Mais cette reconnaissance n’est pas intellectuelle, elle est à la fois relationnelle et corporelle. Comme le relève Bourdieu, elle peut agir sur moi à mon corps défendant. « Elle est souvent associée à l’impression d’une régression vers des relations archaïques, celle de l’enfance et des relations familiales »[10].
Dans la cour de récréation, les petits subissent la domination des grands. N’est pourtant petit que celui qui accepte sa place de petit et accorde au grand sa place de grand. Cet accord n’a rien de conscient. Il plonge ses racines dans l’histoire naturelle de nos jeux de langage (comme obéir ou désobéir, punir ou récompenser, etc.) dont la grammaire s’est inscrite dans nos corps lors de notre apprentissage du langage.
Dans les images qui suivent, R, le grand, va s’approcher de S, le petit, il va lui prendre le poignet (vignette 1) et lui donner une suite de tapes sur la main (vignettes 2 et 3). Le grand agit sur le modèle qu’ont certains parents de faire comprendre une interdiction à un tout petit (ne pas mettre les doigts dans une prise, par exemple). Sur nos images S reste sans réaction, complètement soumis à la volonté de R (voir images 6).
La soumission, imposée comme subie, dans notre exemple, reproduit une relation asymétrique plus primitive. Il y a régression d’une forme de vie (la cour de récréation) à une autre forme de vie (le cercle familial).
Le jeu de langage « faire entendre sa voix » implique (possibilité grammaticale) deux joueurs complémentaires : celui qui donne de la voix et celui qui l’a entendue (au sens du « tu as entendu » du premier exemple). Cette asymétrie se développe en même temps que mon langage. Elle fait partie de ma compréhension pratique des autres et de moi-même. Souvent informulée (mais pas informulable), elle forme l’arrière-plan incorporé de ma subjectivité. Ma voix a une histoire naturelle : histoire au sens de projection ou de régression entre différentes formes de vie ; naturelle au sens où elle a pour arrière-plan mes réactions naturelles (la peur que quelqu’un me tape sur les doigts) que la grammaire de mon langage transforme en seconde nature au cours de mon apprentissage.
Cet arrière-plan forme le fond sur lequel ma parole peut se dérober à mon corps et ma voix peut m’échapper, raison pour laquelle elle est si difficile à trouver et impossible à fixer.
Avoir sa place, avoir une voix
Ma voix semble bien déterminée. Mais cette détermination est grammaticale, c’est-à-dire dépendante d’une place que j’occupe. Dans mon dernier exemple, nous allons voir comment une petite fille arrive à dire son mot dans le cercle des grands (voir images 7).
Dans la cour des garçons (coin inférieur droit de l’image) sont en train de former des équipes pour jouer à la balle à deux camps. Ils tentent de répartir les joueurs de manière équitable. La négociation devient serrée quand il s’agit de savoir qui va prendre M (vignette 1), une petite, dans les propres termes de ceux qui parlent d’elle. C’est à ce moment de la discussion que M fait entendre sa voix en disant « je suis petite qu’il vous dit » et alliant le geste à la parole, elle s’accroupit et fait quelques pas à croupetons.
Les grands ne réagissent pas vraiment à ce qu’elle dit, mais la petite se situe assez près d’eux pour qu’ils entendent sa remarque. Sans prendre vraiment part à la conversation, elle fait néanmoins partie du cercle de la discussion (vignette 3) (voir images 8).
Il serait d’ailleurs plus juste de dire qu’elle se fait sa place dans le cercle de ceux qui parlent. En effet, peu avant de s’exprimer, elle fait une série de pirouettes sur elle-même (vignette 1 et 2). Cette action n’aurait aucune valeur si elle ne délimitait pas exactement la place qu’elle occupera ensuite.
Le comportement de M n’est pas un hasard. Il exprime sa volonté de participer au jeu. À un autre moment, alors qu’elle voit un enfant qui entre dans la cour, elle va à sa rencontre et le pousse l’éloignant ainsi de l’endroit où elle se trouve (voir images 9).
Ces deux actions (les pirouettes et la poussette) sont des expressions. Le jeu de langage « faire entendre sa voix » est lié au jeu de langage « faire sa place ». C’est la dimension invisible de la voix.
Certes, ce que dit la petite fille n’est pas repris par les grands, mais sa seule présence lui permet l’irrévérencieuse ironie de son expression « je suis petite qu’il vous dit » accompagné de sa courbette impudente à l’égard de ceux qui parlent en son nom. L’humour est une voix possible pour se faire entendre pourvu que ce genre de subversion ait encore sa place dans les rapports entre grands et petits.