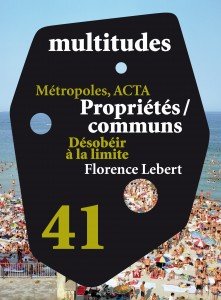Bien que la transformation de la connaissance en marchandise dans un régime de capitalisme industriel fût assez répandue, les conditions nouvelles créées par le capitalisme cognitif sont en train de créer une situation en diffèrant sensiblement ce qui entraîne des conséquences importantes pour la gestion régionale et biopolitique de la population requise par l’État moderne. Nous appellerons cette situation la financiarisation de la connaissance.
Cette financiarisation de l’université entraîne toute une série d’ajustements de ses conditions de travail, de son financement, des emprunts des étudiants, et des droits de propriété intellectuelle. Le rôle des acteurs principaux est redéfini. Le savoir a été transformé de bien public en produits à valeur marchande ; la faculté autrefois chargée de reproduire les élites sociales à une échelle élargie a été transformée en machine à produire et répandre du précariat ; la recherche ne se fixe plus comme but prioritaire le développement des disciplines mais l’accumulation de brevets et d’indicateurs d’excellence. Ces changements qui ont commencé dans les universités anglophones se sont répandus rapidement dans les universités du sud-est asiatique. Ils interviennent maintenant en Europe avec le processus de Bologne commencé en 2001 et les négociations sur la libéralisation du marché des biens et des services dans le cadre de l’OMC. Pour Andrew Ross, la financiarisation de l’université conduit à la transformation totale de l’université en entreprise de connaissance[1].
Par « financiarisation de la connaissance », nous visons en ce qui concerne spécifiquement les humanités, à l’institution d’agences d’évaluation comme moyens de contrôle et d’uniformisation via l’informatisation. Du fait de la disparition postmoderne et postcoloniale d’un standard culturel unique permettant à un ensemble de valeurs d’être transmis ou traduit, selon le modèle diffusionniste, ce qui était le cas dans les conditions du capitalisme industriel, où des connaissances marchandes évaluables (par les pairs) étaient échangées sur un marché national. La valeur des biens vivants dans l’université contemporaine informationnelle obéit à un modèle interactionniste où la valeur des assemblages innovants en matière de corps, de langues, d’esprits reconnus comme connaissables, est soumise à des fluctuations erratiques qui requièrent de nouvelles formes d’évaluation et nouvelles formes de traduction.
Les premières formes d’évaluation les plus importantes sont le degré d’informatisation et la capitalisation (ou valorisation) des connaissances et apprentissage en droits de propriété, ces deux opérations se traduisant par le recours à l’anglais global. Elles aboutissent à l’utilisation d’une gamme homogène d’indices commerciaux (Science Social Citation Index : SSCI) ainsi qu’à des formes bureaucratiques d’audit qui débouchent sur des classements internationaux globaux et des politiques « d’excellence » censées favoriser la promotion sociale à différents niveaux et échelles à la différence de l’unifomité républicaine. Certes, les indices commerciaux donnent en général plus de poids aux publications anglophones, mais la tendance de long terme est d’inclure d’autres langages, comme les langues asiatiques nationales. À la manière des agences de notation pour l’attribution de crédits, les agences d’audit dans les sciences sociales sont devenues un outil pour imposer des critères externes à la production, ce à fin de former un avis commun nécessaire à la valorisation des biens-connaissance dans des aires culturelles hétérogènes.
Il importe de souligner que dans la pratique de l’évaluation, la connaissance n’est pas directement évaluée, mais devient plutôt l’objet d’une quantification selon des indicateurs spécifiques. Ce qui importe n’est pas le niveau d’innovation – qui serait impossible à mesurer quantitativement, mais plutôt le nombre de publications, de citations, de récompenses, de brevets qui constituent les valeurs numériques dans les classements des universités. Dans le processus d’informatisation, les indicateurs quantitatifs reconnus par l’agence d’évaluation ne véhiculent plus aucune signification autre que leur valeur comme indicateur. Ils deviennent en d’autres termes les outils d’une désubjectivation.
Il se produit ainsi une déconnexion que Brian Holmes repère dans la crise financière entre l’information (la mise en forme et en indices) et l’événement[2]. On retrouve le même phénomène dans ce que l’on a appelé les études d’aires culturelles consacrées aux territoires non-occidentaux. Durant l’invasion impériale japonaise de la Chine ou pendant la gouvernance britannique de la Palestine et du Moyen Orient, on observe une production de connaissances officielles sur la société coloniale qui est tellement détachée de la réalité qu’elle contribue à l’opposé de ce qu’elle voulait à activier une violence qui finit en catastrophe.
Chargées de la légitimité de la différence anthropologique héritée du colonialisme, les aires culturelles ont été largement structurées dans l’ère postcoloniale par les débats sur le sens et l’éthique de la différence cutlurelle. Les enjeux politiques de ces débats sont directement reliés à la division globale du travail et à la valeur des passages de frontière des biens et des services en général. Mais ce que ces débats ignorent toujours est à la fois la manière dont la différence culturelle en soi a été historiquement construite comme un modèle normatif de gouvernance pour les états nationaux du système mondial qui ont émergé hors de l’impérialisme et la manière dont la logique de la différence culturelle sert maintenant un objectif entièrement différent dans la gestion des oscillations sauvages qui caractérisent les transitions sociales chaotiques du capitalisme industriel au capitalisme cognitif.
En 1981 Gayatri Spivak avait réfléchi aux relations de pouvoir qui s’établissent entre des textes théoriques d’une extrême hétérogénétité de registre de la périphérie colonisée et ceux du centre métropolitain. « Toutes les relations Est- Ouest, réécrites aujourd’hui sous l’angle Sud-Nord opèrent toujours en termes de possibilité de production d’une plus value plus absolue et moins relative, et non dans le sens pur de l’effet d’excès d’un texte[3]. Le postfordisme nous met au défi de penser l’extension qui définit le surplus de valeur de multiples manières par delà la mesure classique du temps de travail. Or nous ne constatons pas seulement l’effondrement de cette mesure décrite d’abord par les opéraistes italiens, mais aussi une réintensification de ce qu’elle signifie. Dans le postfordisme, il y a en fait une oscillation au cœur du processus de valorisation, entre le pôle de l’immatériel et celui du travail de misère. Le capitalisme cognitif a besoin d’un moyen d’articuler les deux, sous la forme d’une idéologie. La « différence culturelle » fournit l’indicateur nécessaire, mais ce n’est pas seulement un index mais une forme d’organisation et de valeur intrinsèque à la production postfordiste. Les codes culturels qui sont nécessaires à la production sont étendus à tous les aspects de la vie. Ils constituent un des moyens privilégiés de rétablir une mesure de la production postfordiste.
L’Université du Capital Cognitif : d’INT à iPrint®
Vu l’importance de la « différence culturelle » dans la gestion des relations sociales pendant la dure transition vers le capitalisme cognitif, les institutions sociales les plus directement associées à la « différence culturelle » ont pris une importance nouvelle. Dans le capitalisme industriel, l’Université pouvait être décrite dans sa meilleure part comme un Institut national de la traduction (INT). Elle formait une composante institutionnelle du processus de nationalisation. Sa mission était de traduire en connaissance toute expérience – spécialement l’expérience des populations supposées servir la nation en tant qu’autres que citoyens c’est-à-dire des sujets – et de traduire toute la connaissance dans et depuis les idiomes de ces nationalisés ; elle servait aussi en même temps à légitimer de manière générale la division domestique, c’est-à-dire nationale du travail sur une base sociale de classe. Au-delà de son rôle crucial d’Institut national de traduction dans la création de la culture nationale et l’affirmation de la différence de la civilisation, l’autre objectif était de nature théorique : il s’agissait d’établir une proportion raisonnable entre expérience et connaissance qui garantirait une relative stabilité de la taxinomie du social.
À l’époque postfordiste, la production est de plus en plus caractérisée par le travail coopératif. Les droits de propriété intellectuelle (IPR) sont devenus le nouvel étalon de mesure imposable à la production. L’INT du capitalisme industriel a été transformé en lieu de certification d’une signature au moyen d’un iPrint® qui atteste ces droits de propriété intellectuelle. Cela entraîne un remodelage géoculturel. Lors de l’accumulation primitive et du développement fragile du capitalisme industriel, l’apparition des INT dans les pays émergents est beaucoup plus tardive que dans les centres impériualistes. Si bien que ce lent processus de consolidation des INT dans les pays décolonisés du Sud, souvent dans des conditions d’instabilité politiique prolongée et d’expropriation économique, est arrivé à maturité juste au moment où le capitalisme opérait sa mue révolutionnaire cognitive. Rien n’est plus emblématique de ce changement que les établissements d’enseignement supérieur. Parmi les trois systèmes de classement qui font autorité, celui de Shanghai Jiao Tong University (SJTU) depuis 2003 est le seul localisé hors du monde occidental ; et cela n’étonnera personne que ce soit celui qui renforce le plus le statu quo par ses indicateurs. Le classement SJTU accorde deux fois plus d’importance à la publication dans les revues classées A que les deux autres. Il s’appuie sur l’agence Thomson-Reuters (qui publie aussi des données financières) pour la collecte des données et a mis en place son système en collaboration étroite avec la Banque Mondiale, ce qui montre l’importance que la finance mondiale accorde à l’éducation (le niveau mondial des échanges de services en éducation et en finance est du même ordre). Comme les Humanités sont structurées en fonction des « emprunts culturels », ce qui veut dire que des compétences linguistico-culturelles sont nécessaires aux industries créatives dans un environnement mondial, la partie humaniste de l’université garde son importance précédente comme INT, mais l’opération de traduction qui était le cœur de l’INT est déplacée d’un sujet national cherchant les droits des citoyens vers un sujet culturel établissant des droits de propriété intellectuelle. Ce réagencement est la base de la financiarisation de la connaissance par l’iPrint®[4].
Dire que la connaissance est le principal bien produit par l’usine éducative ou l’entreprise de production de connaissance que l’université est devenue aujourd’hui, ne servirait à rien si nous ne complétions pas par l’analyse de la connection entre les corps, les langues et les esprits. La connaissance, pour devenir efficace, doit toujours être transmise et archivée. Elle doit en d’autres termes être incorporée et articulée aux problèmes de médiation, ou de bruit, eux-même liés à chaque forme particulière d’incorporation ou d’expression. La production de connaissance implique une physique des langues – des langues qui sont formées par la discipline d’une certaine manière pour acquérir une force d’impact dans un champ particulier. Ainsi toute forme de connaissance est une articulation de corps, de langues, d’esprits.
C’est parce que l’université produit des gens – des assemblages de corps, de langues, d’esprits – autant que de la connaissance, qu’elle devient un lieu majeur des technologies gouvernementales et biopolitiques de gestion des populations. L’université globalisée comme usine cognitive présente la singularité d’être à la fois un appareil cognitif et un appareil matériel.
Langage, culture et propriété
Les transformations dans le statut du langage peuvent aider à illustrer l’impact du iPrint® sur le dispositif des aires géoculturelles dans la nouvelle distribution de la propriété. Nombreux ont été ceux qui se sont répandus à se sujet sur les effets délétères de la domination de l’anglais. Peu d’attention a été accordé en revanche à la manière dont elle affecte la réorganisation de la dichotomie public/privé en relation à la propriété. L’association de l’anglais à l’international et celle des autres langues au contexte local impose une nouvelle manière de délimiter l’espace public et l’espace privé selon une démarcation entre accès mondial et accès local. Elle confère un statut implicitement privé aux langues autres que l’anglais associées avec le local. Par une ironie du sort nous entrons dans une période où des langues nationales – résultat historique d’une captation des échanges culturels par une classe installée dans l’État afin de légitimer ses normes, sont en train d’être progressivement privatisées par rapport à l’usage public de l’anglais global. Ainsi la République de Corée, dans le cadre de la convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003), est parvenue à labelliser à son profit exclusif le Festival du Bateau Dragon, pourtant commun à la Chine et à d’autres pays d’Extrême-Orient. Cela montre à quel point la culture nationale est devenue une forme de propriété privée, sujette à l’IPR. Il est fascinant de voir comment le régime du travail immatériel typique de la production postfordiste conduit à de telles revendications de propriété, portant sur la connaissance, la formation et le langage, du moins celui qui a déjà été nationalisé. Vu la propension des gouvernements néolibéraux à agir comme parties prenantes d’intérêts d’entreprises transnationales et à minimiser les questions citoyennes, les revendications collectives implicites sur des ressources immatérielles de ce type tendent à suivre une logique semblable. La lutte contre l’expropriation (par exemple la dépossession de la connaissance médicinale indigène par les compagnies pharmaceutiques multinationales) débouche ainsi sur une revendication par les États de la gestion de la propriété immatérielle.
La privatisation commerciale du langage sous l’influence de l’anglais global advient au moment même où l’incorporation d’un modèle inguistique dans le processus de production signifie que la langue est devenue une source de valeur et de droits de propriété. L’open access a souvent été présenté comme un remède aux clôtures créées par les droits de propriété intellectuelle. Dans le domaine culturel, l’essentiel du matériel en accès libre est presque exclusivement en anglais, ce qui aggrave encore une situation particulière à la production postfordiste. L’effet pollinisateur essentiel au processus productif est virtuellement monopolisé par l’anglais, entraînant par ricochet la privatisation de langues entières. Les défenseurs de l’open access dont les positions s’appuient sur l’externalité positive de l’anglais devraient être conscients de ce qui est exclu, c’est-à-dire des externalités négatives culturelles (appauvrissement de la noo-diversité). Dans un monde d’externalités et de travail immatériel la seule question qui préoccupe réellement le capital est de parvenir à imposer un étalon de mesure sociale sur les produits intellectuels quand la valeur de ces produits, comme celle des dérivés, fluctue de manière sauvage. Mais les apparences sont trompeuses. Le nouveau système global repose en fait sur la fluctuation de la différence. S’il y a un tel potentiel massif dans l’appropriation ou la mise en commun de l’effet de pollinisation dans un seul langage, c’est pour bien plus que le désir moderne d’un langage universel. La domination de l’anglais laisse d’autres assemblages de corps, de langues et d’esprits exposé à une prolétarisation relative et à une privatisation, particulièrement dans les États dont les élites au pouvoir refusent des positions sociales intéressantes au travail innovant et créent donc les conditions pour que les travailleurs se retournent vers des mouvements fondamentalistes ou nationalistes. Pour ces raisons la question de l’open access dans les humanités doit être déplacée vers la pollinisation translinguistique et transcorporelle contre la privatisation et la prolétarisation des corps, des langues et des esprits.
Comme modèle implicite de traduction, l’anglais global amplifie les effets de pollinisation disponibles à un moment donné[5]. C’est la raison pour laquelle l’exigence de régir le travail créatif par la norme des droits de propriété se fait sentir le plus fortement dans les medias dans l’édition anglophone, en particulier pour les droits de traduction vers des medias et des contextes non anglais. Les implications biopolitiques en matière de gestion des populations sont considérables : de même qu’il peut être difficile d’identifier la population à laquelle un langage optimisé pour la pollinisation comme l’anglais correspond, la correspondance entre d’autres langues nationales et des populations spécifiques est incertaine. Cela fournit matière à une privatisation limitée qui étend au-delà du langage la formation de diverses sortes de communs que le capitaliste peut alors mobiliser : le commun du langage et le commun du travail pour commencer, mais aussi le commun des sujets testables par les biotechs et la pharmacie, le commun génétique, et le commun de la connaissance sur la population spécifique à laquelle correspond l’idiome national.
La définition classique du droit de propriété entendu comme la faculté d’exercer un choix sur un bien ou un service ne peut pas nous aider à comprendre le phénomène contemporain de la mise en commun d’une population, comme celle de la Chine, qui est par ailleurs mobile et hautement diverse. Quelle est l’articulation entre différents outils comme les dérivés d’un côté et la logique de la différence culturelle institutionnalisée dans les divisions par discipline de l’autre, qui sont utilisés pour gérer le chaos inouï de notre période actuelle de transition? Cette articulation se manifeste le plus dans l’expansion croissante des universités anglophones asiatiques, particulièrement mais non exclusivement en Chine. Ici la financiarisation de la connaissance atteint un sommet tout comme la compétition pour arriver en tête des classements universitaires qui conduit à une emphase disproportionnée sur les indicateurs d’anglais commercial, tandis que les universités anglophones se dépêchent de se déployer sur les campus étrangers. Emerge ainsi une université mondiale comme système éducatif international, qui combine deux registres, le cognitif et le matériel, dans un seul appareil de gestion de la population. C’est là que le iPrint® constitue un phénomène crucial. Pour nous, comme pour Y. Moulier Boutang, il n’est pas du tout étonnant que les deux systèmes américain et chinois développent le discours de la différence culturelle, qui semblerait les séparer, dans une bureaucratie cognitive singulière vouée à la gestion de la privatisation des corps, langues et esprits chinois d’un côté et à la pollinisation par l’anglais global de l’autre[6]. Maintenir les corps, les langues et les esprits chinois dans un dispositif de mise en commun serait virtuellement impossible pour un seul État qu’il soit corporatiste ou de mobilisation totale comme celui de la république populaire chinoise. Arriver à composer et mettre en commun est encore plus compliqué car il s’agit d’orchestrer la difficile interface entre la forme émergente de capitalisme qu’est le capitalisme cognitif et sa forme antérieure industrielle – un fossé qui ne régit pas seulement la division internationale mais qui refend chaque nation aussi à l’intérieur. L’anglais global a toujours été intégré activement à la reproduction de la différence de classe dans les formations sociales chinoises. Le récent incident impliquant la position de Google en Chine et la liberté de l’Internet illustre la manière dont opère le système. Alors qu’il est impossible de connaître l’étendue d’une cyber attaque, nous savons qu’en Janvier 2010 Google et Baidu, principaux concurrents sur le marché chinois, ont été sujets à une attaque cyber sans précédent et que chacune de ces entreprises était largement connue pour avoir des liens forts avec les administrations au pouvoir. La Chine et les médias chinois plaidèrent contre l’hégémonie de l’anglais sur l’Internet tout en réclamant que le contrôle de ce derniet soit cohérent avec celui de beaucoup d’États dans le monde, y compris ceux d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord. Les États-Unis et les médias anglophones se répandirent contre un degré de censure inacceptable de l’Internet. La revendication chinoise de la particularité culturelle fut opposée à la revendication américaine de représenter des normes universelles. Derrière cette rhétorique, on assistait à une escalade dans la guerre cybernétique pour le partage du marché.
La première tâche d’une bureaucratie cognitive internationale n’est pas de créer une hégémonie universelle (à sens unique) (comme ç’eût été l’objectif de l’INT dans le capitalisme industriel), mais plutôt d’accroître l’efficacité des chaînes de diffusion et d’intensifier la proportion de signal sur le bruit. La recette de base consiste à exclure les alternatives qui ne rentrent pas dans le schéma alternatif binaire de la différence culturelle.
Oscillations
Bien que cela puisse prendre du temps avant que la financiarisaton du savoir induise le même genre de crise que la financiarisation du capital, les modèles de monde artificiel propagés par la finance et la connaissance sont devenus inextricablement connectés entre eux puis qu’ils sont d’accord tous deux pour écarter toute compensation des dégâts irréversibles qu’ils occasionnent. Tout en réfléchissant à des solutions sur le long terme, nous devrions définir des stratégies pour survivre à la violence des régimes biopolitiques qui s’appuient dorénavant sur le langage comme sur la propriété culturelle.
Tandis que la bureaucratie cognitive internationale émergente emmagasine du prestige et consolide sa position, nous pouvons nous attendre à ce qu’à l’instar de la Chine, l’Europe devienne elle-aussi le théâtre de la lutte entre une position qui se range dans la société du côté de la pollinisation et d’une traduction effectuée au moyen de l’international English (le globish), principal outil de l’informatisation et de la financiarisation, et une autre position qui adhère à une défense rétrograde des institutions nationales et des formes de traduction héritées de la période antérieure de capitalisme industriel et de la formation culturelle d’une modernité bifurquée (coloniale/impériale). Bien que la contradiction entre les deux positions soit intense, prises ensemble elles forment une sorte de gros et lâche système de contrôle sur les oscillations sauvages de valeur qui caractérisent la période de transition contemporaine. Le contrôle exercé par un tel système est au mieux chaotique. Il constitue un très pauvre ersatz de l’innovation produite par les combinaisons ex-centriques de corps, langues et esprits. Parallèlement à la financiarisation des moyens d’accumulation matérielle, la financiarisation actuelle de la connaissance court le risque d’être constamment confrontée à des paroxysmes sociaux (fondamentalismes et idéologies du retour, mais aussi hybridations et nouvelles formes technologiquement assistées de corps, de langues, et d’esprits) qui débordent les variations de l’opinion collective qui sont tolérés dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires à la financiarisation qui recherche une création de valeur privée potentielle à partir de l’incertitude et des futurs collectifs. Il est temps de répondre à cette instabilité en ne se contentant pas, par le biais de la mise en commun de populations sur le modèle de la propriété, de renforcer un appareil qui est à la racine du problème.
Traduit de l’anglais par Yann Moulier Boutang