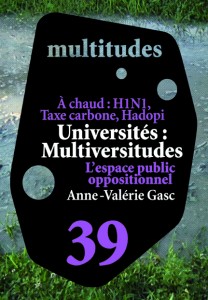Observations de l’intérieur
Le paradoxe essentiel de toute éducation consiste dans la tension entre le moment autonome de pensée qui rend l’enseignement – inévitablement – autoritaire et non-démocratique, et le moment de dialogue et de la pensée libre d’un étudiant, qui exige que l’université soit un lieu ouvert et ultra-démocratique. Cette tension a toujours existé, mais elle prend une urgence particulière aujourd’hui, au moment où la démocratisation et la commercialisation menacent l’autonomie des universités, alors que l’idéologie politique et économique de notre monde – le libéralisme du calcul et de la discipline – reste lui-même un produit théorique, un exemple de ce que Lacan avait appelé le « discours universitaire[1] ». Dans ce qui suit, je montrerai comment, en Russie contemporaine, cette tension crée une situation aussi critique que symptomatique.
Une crise globale de l’université
Les tendances mondiales actuelles dans la sphère de l’éducation universitaire se caractérisent, comme on le sait, par le démontage du système « allemand » de l’éducation spécialisée, qui consistait principalement en des cours monologués donnés par des professeurs. En vérité, ce système était déjà inadéquat à partir des années 1950-60, quand l’éducation universitaire est devenue une institution de masse et, en plus, quand ces « masses » ne voulaient plus être « instruites » d’une manière autoritaire. Les universités sont devenues des fabriques, de plus en plus « postindustrielles ». Ce mouvement était sans doute progressif, dans le sens de la démocratisation et de l’ouverture de l’éducation vers les nouvelles idées. Cependant, il a créé une tension dans le noyau même de l’institution : par sa définition, l’éducation ne peut pas être complètement « démocratique », justement parce qu’elle exige l’autonomie et la liberté des enseignants – qui doivent mener les étudiants, en critiquant leurs opinions préexistantes. Actuellement, après la révolution démocratique dans les universités, il se passe en Europe une nouvelle révolution : la révolution commerciale. Les universités sont sommées de répondre aux exigences et questionnements de la société, qui sont exprimées, par exemple, sur le plan économique. Ceci, de nouveau, n’est pas absolument faux. Seul un intérêt social, pratique, peut animer un cheval de pensée. Mais le danger est, bien entendu, que la pensée soit soumise à des « exigences » et à des « intérêts » qui, eux, ne sont pas pensés. L’université doit garder le droit de poser les questions, et non seulement donner les réponses. Cela, sans doute, n’est possible, qu’à la condition que l’université ne se renferme pas en un « ghetto », mais reste une institution publique, que les enseignants participent eux-mêmes à des pratiques sociales et, dans le cas idéal, qu’ils divisent leur temps entre une pratique « réelle » et l’enseignement.
Le « processus de Bologne » est un nouveau moment dans la série des transformations des cinquante dernières années. Ce « processus », qui est censé réformer l’éducation universitaire européenne, a pour tâche primordiale d’introduire le modèle anglo-américain, avec son système des « crédits » et sa standardisation des programmes de cours, sur la base d’un parcours en deux étapes, « Bachelor » et « Master ». Bien que ce processus soit global (les pays hors EU comme la Russie en font aussi partie et il rapproche le système européen de son homologue nord-américain), cela n’implique nullement que ses effets, et le contenu spécifique des changements qu’il induit, soient partout les mêmes. Aux États-Unis, par exemple, un système qui est similaire à celui de « Bologne » existe depuis longtemps, mais les universités (au moins les « grandes » universités) sont généralement capables d’y préserver l’autonomie et l’informalité de l’enseignement (même si une approche appliquée et pragmatiste de la science est profondément caractéristique de la culture américaine). Cependant, dans les dernières années, l’université américaine a subi elle aussi une transformation néolibérale. De moins en moins de professeurs obtiennent la tenure (la titularisation), le travail académique se précarise et perd de son autonomie. Une manifestation des changements qui se déroulent apparaît dans le conflit tout récent (décembre 2008) de la New School of Social Research à New York, où les professeurs et les étudiants ont publiquement protesté contre la commercialisation de l’École par son président[2]. Dans ce sens, il s’agit moins de l’américanisation de l’Europe, que d’une crise globale de l’Université.
L’éducation supérieure en Russie
C’est dans ce contexte qu’il faut parler du système de l’éducation universitaire en Russie (« l’éducation supérieure », dans les termes acceptés en Russie). L’éducation supérieure a subi, après la chute de l’Union Soviétique, une transformation radicale qui a été, dans un sens, une reforme néolibérale extrême. La Russie, étant un avant-poste du néolibéralisme (dans le sens, que j’expliquerai plus loin) reste toujours un symptôme de ce que les néolibéraux pourraient et voudraient faire ailleurs, s’ils n’étaient pas restreints par l’inertie sociale et par la résistance de la société civile. Cependant, il serait faux de dire que le néolibéralisme en Russie soit le même qu’en Europe ou en Amérique du nord. Dans ces pays-ci, le « néolibéralisme » existe au sein d’un système des forces qui se situe quelque part entre l’ancien conservatisme et la social-démocratie, et qui représente en partie leur synthèse, en partie leur annulation mutuelle. En Russie, le néolibéralisme n’existe qu’en symbiose avec les institutions post-soviétiques de l’État, qui ont en principe gardé leur structure et leur culture institutionnelle, ainsi qu’une grande partie de leurs cadres. À la différence de l’Europe et des États-Unis, le néolibéralisme en Russie est rarement reconnu ou critiqué comme tel : le régime est perçu par l’opposition comme corrompu et autoritaire, et l’opposition libérale-démocratique emprunte le plus souvent le langage néolibéral (dénonçant l’inefficacité économique, le manque de transparence), en le mélangeant avec des slogans de « démocratie » libérale (cela vaut, par exemple, pour « L’Autre Russie »).
En effet, les réformes néolibérales des années 1990 et 2000 n’ont pas été poussées à leur terme. Elles ont formé une société curieuse, où le néolibéralisme constituait une forme dans laquelle les institutions (post-)soviétiques ont continué à exister – sous la condition de leur réorientation commerciale. La sécurité sociale est restée relativement bien protégée par la loi. Mais cela n’a pas empêché sa destruction dans les faits. La précarité extrême du travail (une large masse des employés travaillent sans contrat permanent, pour ne pas parler du travail des centaines de milliers d’immigrés clandestins) coexiste avec un système assez solide de sécurité sociale imposé par l’État : c’est à cause de ce système que les employeurs préfèrent de l’éviter d’une manière plus ou moins clandestine.
Qui plus est, la chute de l’idéologie communiste a créé un climat d’anomie, où la corruption ou, au moins, l’évasion fiscale ne sont pas généralement perçues comme répréhensibles. Par exemple, depuis les années 1990 jusqu’à aujourd’hui, la médecine reste en grande partie publique et gratuite, mais les médecins sont très mal payés par l’État. Donc, ils utilisent habituellement leurs postes et l’infrastructure de leurs cliniques pour rendre des services payants à ceux qui en ont vraiment besoin (et qui en ont les moyens), d’une manière officielle ou non. Une situation analogue s’est développée dans les universités. L’éducation est restée gratuite (sous la condition du succès à l’examen), mais plusieurs doyens des Facultés ont mis en place un système de pots-de-vin que les parents doivent payer pour l’inscription des étudiants. Par ailleurs, d’autres sources de revenus officiels sont sollicitées, telles que la croissance de la quantité des étudiants payants (ceux qui ne réussissent pas l’examen d’entrée), et la location des bâtiments universitaires aux firmes commerciales.
Depuis la chute de l’Union Soviétique, le nombre des étudiants est monté de 3 millions (environ) à 6 millions, ce qui constitue plus de la moitié de la population entre 17 et 22 ans. Le nombre des établissements d’éducation supérieure a plus que doublé depuis 1990, surtout à cause de la naissance des institutions privées[3]. En même temps, les salaires des professeurs payés par l’État étaient, pendant les années 1990, dérisoires (autour de 100 dollars par mois, en moyenne). Si on ne participait pas à la corruption, il fallait enseigner plusieurs cours dans plusieurs établissements. Un poste mal payé à l’Université d’État donnait toutefois souvent accès à des cours moins prestigieux mais mieux payés. Même aujourd’hui, le salaire d’un enseignant à l’Université d’État n’est pas suffisant pour vivre bien, et la plupart des gens accumulent plusieurs postes.
La transformation des hiérarchies
entre les disciplines
Concernant le contenu de l’enseignement, la situation était assez variée, selon l’institution et la discipline. Dans l’Union Soviétique, les sciences de la nature étaient développées au plus haut niveau mondial. Dans les années 1990, les spécialistes de ces disciplines (mathématiques, physique) ont émigré en masse à l’étranger. L’effondrement de l’économie russe a ruiné la demande pour les scientifiques, et ces disciplines ont perdu leur prestige. Les sciences humaines enseignées en Union Soviétique étaient idéologisées, et leur prestige social était très inférieur aux sciences de la nature. Cependant, il y avait une tradition forte de philologie, par exemple, et des auteurs connus en Occident, en particulier de l’école de sémiotique « Tartu-Moscou » ( Yu. Lotman, M. Gasparov, etc.). Dans les années 1990, les membres de cette école ont émigré en masse eux aussi.
En ce qui concerne les sciences sociales, la situation à l’URSS était la plus triste. Un marxisme-léninisme dogmatisé régnait dans les Facultés de philosophie, la science politique n’existait pas, la sociologie n’était pas représentée au niveau d’une Faculté propre. L’exception était la psychologie, dont une Faculté existait dans les universités, et où il s’est formé une véritable école de psychologie marxiste (idéologiquement proche de la tendance saluée officiellement comme l’« humanisme » socialiste). Ce sont toutefois les sciences humaines et sociales qui, dans les années 1990, sont devenues en vogue et prestigieuses. C’était en partie lié au rôle que la sociologie avait joué pendant la perestroïka, en attirant l’attention sur les phénomènes d’opinion et de protestation. C’était aussi lié en partie au « boom » de la littérature du XXe siècle, qui avait été interdite auparavant. Mais en grande partie, c’était lié à la structure changeante de l’économie. L’industrie russe a beaucoup souffert des réformes néolibérales : la réorientation vers l’économie des services, ou vers le « travail immatériel », était donc inévitable et, bizarrement, elle a été contemporaine, non tant du progrès de l’économie, que de son krach.
Il n’y avait pas d’emploi dans les usines (ou s’il y en avait, les salaires n’étaient pas réellement payés), mais l’argent qui circulait dans l’économie était investi dans la consommation des marchandises et des services – souvent dans des services inouïs auparavant, comme la psychothérapie. Les ventes de marchandises de masse, nouvelles pour la Russie, ont créé une demande pour les études de publicité et de marketing, qui utilisaient les méthodes sociologiques. Enfin, les élections démocratiques, à tous les niveaux, en l’absence de partis et d’électorats stables, ont mis les politiciens en grande dépendance de leurs spécialistes de Relations Publiques, qui s’appelaient en russe les « technologues politiques ». Vers la fin des années 1990, avec la restauration graduelle de l’économie, et suivant les tendances mondiales, il y a eu une augmentation du nombre des « bureaux » et des postes des managers (à la spécialisation souvent indéterminée).
En conséquence, beaucoup d’étudiants suspectaient que leur choix de discipline importerait peu pour leur future carrière. Ces étudiants ont choisi les Facultés des sciences sociales et humaines, juste à cause de leur relative facilité. Tout cela a changé la hiérarchie qui avait existé à l’époque soviétique, et les Facultés des sciences sociales et humaines sont devenues prestigieuses et à la mode – et même profitables pour les administrateurs malhonnêtes. La première place de popularité était (et demeure) tenue par les études de droit et d’économie.
Dans les nouvelles Facultés de sociologie et de science politique, dans les anciennes Facultés de psychologie et philosophie, la réforme a produit une transformation du contenu des enseignements. L’importation massive des théories occidentales et l’abandon (parfois, accompagné de démonisation) du marxisme – qui a abouti à la désorientation idéologique spectaculaire et à la destruction des écoles soviétiques existantes – n’étaient pas accompagnés de la rotation des personnels. L’État n’a pas osé réduire le nombre des enseignants et des chercheurs. Il les a tous gardés, y compris les marxistes-léninistes orthodoxes qui, dans plusieurs cas, sont devenus libéraux orthodoxes, puis nationalistes orthodoxes.
Dans ces conditions, l’ouverture vers l’Occident a conduit à l’importation, mais non à l’exportation du savoir social. À la différence des sciences de la nature et même des sciences humaines, il y a peu des représentants des sciences sociales russes connus en Occident – hormis les spécialistes de la Russie en Russie, les area specialists qui habitent « sur le terrain[4] ». Les limitations linguistiques, la sélectivité des traductions et surtout l’incompréhension des débats actuels en Occident, de même que le manque d’attention de la part de l’Occident (avec son « marché », serré par la compétition, des textes et des personnes) ont rendu difficile un dialogue productif entre les traditions russes et les traditions américaines ou européennes. Cela a conduit progressivement à la fermeture du milieu, à la popularité croissante du nationalisme parmi les professeurs dans les sciences sociales, et à la prolifération de débats aussi bizarres qu’exotiques, générant des « nouvelles » disciplines endémiques. On a ainsi vu émerger la « synergétique » (un cadre théorique très populaire dans les sciences sociales russes, qui explique le fonctionnement de la société par les lois de la cybernétique), une « imagologie » (théorie de la « technologie politique »), une « socionique », une « acméologie », etc. Cela dit, l’autonomie du contenu de la pensée a permis aux chercheurs sérieux et originaux de bénéficier d’un « luxe » qui manque souvent chez leurs jeunes collègues occidentaux – le luxe de pouvoir avancer tranquillement dans leur travail, sans trop de pression de la part des concurrents ou de ces « censeurs » disciplinaires qui sont les « peer reviewers ».
Les procédures d’enseignement ont également changé. La structure générale du plan d’études est restée la même, mais l’atmosphère générale de la société, la taille modeste des salaires, et celle plus modeste encore des bourses d’études, ont créé une nouvelle culture : une culture dans laquelle les étudiants ne se sentent pas obligés de venir aux cours, et où les enseignants ne sont pas motivés pour les juger de façon rigoureuse. Sous le système soviétique et post-soviétique, une note « 2 » (échec) donnait à l’étudiant le droit de revenir et de repasser l’examen à une date postérieure. Cela imposait à l’enseignant un travail supplémentaire, en lui donnant, de plus, un sentiment de culpabilité (il a gâché la vie d’une personne par une mauvaise note). Le nombre des mauvaises notes et surtout des échecs s’est donc drastiquement réduit…
Le cas symptomatique des protestations du « groupe OD »
Quel a donc été le résultat de ces transformations ? Il en est sorti une symbiose très particulière entre la logique commerciale et la logique de l’institution auto-suffisante. Comme le note Kirill Titaev dans un article récent :
« l’éducation supérieure accorde à ses consommateurs un bloc de services qui, paradoxalement, s’excluent l’un l’autre. D’un côté, elle accorde (ou prétend accorder) une qualification nécessaire pour la carrière. De l’autre, elle garantit un moratoire, une période pendant laquelle les jeunes gens peuvent chercher des aventures, des partenaires, et/ou un travail qui n’est pas lié avec la discipline qu’ils étudient. Ces deux biens se contredisent l’un l’autre : plus élevée est la qualification, moins il y a de temps pour le reste. [En Russie], dans tous les départements de sociologie, la plupart des étudiants achètent le moratoire, et non la qualification, de sorte que l’institution, suivant la logique économique, doit s’orienter vers les besoins de cette majorité [5]. »
L’article de Titayev a été écrit à l’occasion d’un mouvement d’étudiants qui, en 2007, s’était levé contre l’administration de la Faculté de sociologie de l’Université d’État de Moscou (MGU), en particulier contre la personne du doyen M. Dobrenkov. Un groupe d’étudiants, l’« OD-groupe » (de 20 à 30 personnes sur les 2000 étudiants de la Faculté) a publiquement résisté, au printemps 2007, contre l’administration de la Faculté. Le prétexte immédiat était la cantine étudiante où les prix correspondaient à ceux d’un bon restaurant. Mais les demandes avancées par le groupe concernaient surtout la qualité de l’éducation à la Faculté, et le manque d’engagement des étudiants dans la recherche. L’administration de la Faculté n’a pas cédé aux demandes des étudiants. Le doyen a appelé la police quand le groupe a organisé une protestation publique, et a exclu la plupart des membres du groupe de la Faculté. Au cours du scandale qui a suivi, une commission de la Chambre Sociale de Russie a évalué l’enseignement de la Faculté assez négativement, et plusieurs cas de plagiat ont été trouvés dans un manuel de sociologie écrit par Dobrenkov. Malgré cela, le doyen est toujours à son poste, et les étudiants du groupe OD ont dû poursuivre leurs études ailleurs.
Il faut dire que la Faculté de sociologie de MGU est un cas extrême : le doyen exprime personnellement des convictions qu’on peut caractériser d’extrême-droite : il a lancé une campagne pour le retour de la peine de mort et pour l’interdiction des avortements. Dans sa Faculté, il a créé une nouvelle discipline qui s’appelle la « sociologie orthodoxe ». Titayev, dans l’article déjà cité, considère ce cas comme symptomatique de la situation générale dans le pays et, à partir d’une série d’entretiens réalisés dans plusieurs universités russes, il fait un diagnostique très pessimiste de l’état des choses dans l’éducation supérieure russe – de même que des possibilités de mobilisation étudiante.
On pourrait objecter, premièrement, que la situation dans les autres institutions, même si on se limite aux Facultés des sciences sociales des universités d’État, est différente. Ce qui est commun, c’est la priorité des tâches administratives et commerciales sur les questions de l’enseignement et de la recherche. Cela veut dire qu’il manque un contrôle efficace du niveau des savoirs et des capacités intellectuelles, chez les étudiants comme chez les professeurs. Comme partout dans l’État russe, c’est l’inertie d’un statu quo, le clientélisme et aussi l’efficacité commerciale qui déterminent surtout la politique du recrutement. Mais Titayev oublie que l’université n’est pas une institution commerciale par son essence, et même les réformes des années 1990 n’ont pas réussi à la rendre telle. On ne choisit pas, normalement, une carrière en philosophie ou en sociologie pour gagner de l’argent ou du prestige. Les étudiants sont spontanément intéressés par le sujet qu’ils étudient, même si cet intérêt reste modéré. Il est donc aussi vrai que les Facultés des sciences sociales abritent plusieurs chercheurs et enseignants qui sont sérieux et parfois même brillants. Ils profitent de l’anarchie relative et font leur recherche sans être trop dérangés par l’administration et sans subir la pression permanente à la publication. Dans la situation d’anarchie qui règne presque partout, beaucoup dépend de la personnalité du doyen ou même du titulaire de la chaire (qui constitue la subdivision de base des Facultés russes).
Les réformes néolibérales :
un remède pire que le mal
Cela nous amène à une autre objection. Comme on peut le voir par le vocabulaire qu’il emploie, Titayev s’appuie sur l’hypothèse du caractère économique de tous les rapports sociaux. C’est la méthode qui dépend implicitement d’une certaine idéologie néolibérale : il faut créer les institutions formelles et anonymes (comme les peer-reviewed journals), et le « choix rationnel » des chercheurs les rendra bons sociologues, politologues ou philosophes[6]. Il y a un « parti » des intellectuels russes (unis surtout autour du site polit.ru) qui lutte actuellement pour la reforme radicale de l’éducation et des sciences sociales russes, selon le modèle anglo-américain. Certaines mesures allant dans ce sens sont déjà acceptées par le gouvernement. Par exemple, depuis quelques années, il existe un examen écrit uniforme pour tous les lycéens, qui doit déterminer leur droit d’entrée à l’université. Cette mesure est dirigée contre la corruption aux examens d’entrée, et elle peut être efficace. Mais pour l’instant les grandes universités (Moscou et Saint-Petersbourg) y résistent avec succès, en soulignant – non sans raison – que cet examen abstrait et impersonnel ne peut vraiment permettre de sélectionner un étudiant talentueux dans un certain sujet spécifique, surtout si ce sujet n’est pas enseigné au lycée.
De mon point de vue, l’analyse économico-institutionnelle et les mesures technocratiques ne restent que formelles. Les auteurs en question ne prennent pas en compte que la corruption et le plagiat parmi les enseignants de l’université proviennent, non seulement du « choix rationnel », mais aussi de l’état d’anomie extrême dans lequel se trouvent les enseignants. La chute de l’Union Soviétique et la crise éthico-idéologique qui s’en est suivie ont transformé ces personnes en individus solitaires et désespérés, qui ne pensent qu’à leur survie et ne croient pas à la possibilité d’une délibération intellectuelle (bien qu’ils soient très sérieux dans leurs convictions, qui n’ont rien à voir avec la pensée).
La réforme technocratique néolibérale – qui a déjà partiellement commencé en Russie, avec le processus de Bologne – ne pourra pas transformer radicalement la situation. Dans le meilleur des cas, elle va conduire à la prolifération de l’ennuyeuse « science normale », où les critères formels seront respectés, mais d’où la pensée sera absente. Les rares personnes qui réussissent à publier dans les revues occidentales obtiendront une tenure et un salaire disproportionnellement grand, tandis que le reste des postes sera réduit ou très mal payé. Cela créera un esprit de compétition qui n’est pas toujours salutaire pour la recherche et pour une institution intellectuelle. L’accès aux postes pour les jeunes chercheurs sera rendu plus difficile. Dans le pire mais plus probable des cas, les règles seront adaptées à la situation. Les règles de peer-review seront observées, mais les références obligatoires seront dans le champ de la « sociologie orthodoxe ». Et le contrôle de l’enseignement amènera à l’autoritarisme bureaucratique de l’administration par rapport aux enseignants. Tout dépend donc de la motivation intellectuelle et de la solidarité des chercheurs.
Les mesures néolibérales qui sont dirigées contre la corruption peuvent mener à des résultats qui sont aussi néfastes (voire pires encore) que la corruption : la formalisation et l’uniformisation de la vie intellectuelle. En vérité, ce genre des mesures se fonde implicitement sur les mêmes prémisses que la corruption : l’égoïsme anomique et cynique des acteurs de la vie intellectuelle. Il n’est donc pas étonnant que les mesures technocratiques formelles déjà mises en œuvre soient incapables de résoudre le problème de corruption, sans parler de la tâche de mobiliser les universités et la réflexion de la société dans son ensemble.
L’exemple de l’Université Européenne
de Saint-Pétersbourg
Tournons-nous pour terminer vers un autre cas de mobilisation politique d’étudiants, celui de la fermeture de l’Université Européenne de Saint-Pétersbourg. Cette Université est une institution spéciale, une parmi trois ou quatre nouvelles institutions d’enseignement supérieur qui ont été créées en Russie dans les années 1990 avec le soutien des fondations américaines et qui visaient à reproduire les principes institutionnels des universités américaines. L’Université Européenne propose des enseignements de troisième cycle (M.A. et Ph.D.), sur le modèle d’une Graduate School américaine, où les étudiants suivent plusieurs cours, avant de passer à l’écriture d’une thèse. L’Université ne fait pas partie de l’État, et elle n’est autorisée à attribuer ni le diplôme officiel de M.A., ni le doctorat. Toutefois, les étudiants qui viennent à l’Université sont attirés surtout par la haute qualité de l’enseignement et par les liens avec les universités occidentales, qui permettent à un chercheur d’entrer dans des réseaux internationaux. L’Université a réussi à attirer plusieurs chercheurs russes avec un doctorat étranger. Les intérêts des enseignants sont centrés sur plusieurs aspects de la société russe (on étudie des sujets tels que la mafia en Russie dans les années 1990, le processus électoral, le rôle des femmes dans la société russe, le concept de république appliqué au cas russe, etc.). Au début de son existence, l’Université pouvait offrir à ses employés un salaire significatif, par rapport au salaire moyen en Russie. Dans les années 2000, quand l’économie russe a crû fortement, et que la vie est devenue de plus en plus chère, cet avantage financier a disparu, et l’Université est devenue, pour plusieurs enseignants, un lieu de travail parmi plusieurs autres.
Le 8 février 2008, l’Université a été fermée par le service des pompiers à cause d’irrégularités dans la sécurité du bâtiment. Tout enseignement était interdit. Il était évident pour quiconque suivait la politique russe que la fermeture avait une motivation politique. En 2007, l’Université avait ouvert un centre d’études électorales, financé par l’Union Européenne. Les hauts représentants du pouvoir ont remarqué cette nouvelle institution, créée juste à la veille des élections parlementaires et présidentielles. Le Président Poutine et son aide S. Yastrzhembsky ont mentionné l’Université dans leurs discours. Suite à des échanges informels, le rectorat a fermé la subdivision « électorale », mais c’était trop tard : l’Université était fermée, suivant une méthode (usage du droit administratif pour des buts politiques) qui est très souvent employée par les autorités russes. Le régime avait visiblement peur d’une intervention de l’Occident dans les élections, selon le modèle serbe ou ukrainien. Une campagne de protestations publiques a suivi, dont les trois modes d’action les plus importants furent des négociations informelles au niveau des élites, des lettres ouvertes (dont une signée par plusieurs membres de l’Académie des Sciences de Russie), et, last but not least, plusieurs manifestations organisées par les étudiants, déguisées sous la forme de « performances ». Les étudiants ont ainsi créé une « Université de rue », où ils ont proposé chaque semaine des conférences courtes, dédiées surtout à l’histoire des mouvements étudiants. Les autorités ont finalement cédé aux demandes, s’apercevant peut-être du caractère assez apolitique de l’université, ou ayant peut-être peur de la mobilisation étudiante. Le 21 mars 2008, l’Université était réouverte.
Trois aspects de cette histoire sont symptomatiques. Premièrement, les autorités ont visé une institution qui n’avait jamais été politiquement radicale : la plupart des membres de l’Université défendent des positions objectivistes par rapport à la société, et leur engagement ne va pas plus loin que la critique libérale de n’importe quel régime du pouvoir, ce qui est caractéristique de l’intelligentsia en général. Le danger semblait provenir de l’influence de l’Occident – via ses « fondations » – bien que l’Université cherche actuellement plutôt ses sources de financement en Russie. Les responsables de la police secrète russe ne comprennent pas la logique de fonctionnement des fondations occidentales. Ils voulaient savoir ce que les fondations demandaient en échange de leur aide, et ils étaient méfiants quand on leur disait qu’il n’y avait pas de vrai contrôle. Comme on le sait, les fondations sont assez peu intéressées par le contenu du travail académique : la thématique générale et l’opinion des experts, voilà tout ce qui leur importe. De cette façon, l’Université a ainsi pu rester libre – entre deux maîtres, en évitant aussi bien l’assujettissement complet aux diktats du capital que la soumission à ceux du gouvernement. Il est à cet égard intéressant, et paradoxal, de voir une institution essentiellement néolibérale (l’université privée) devenir, en Russie, l’un des rares lieux où soit possible la recherche libre, innovatrice et internationalement respecté.
Les leçons à tirer du cas particulier de l’Université Européenne sont complexes. La position de cette université à la périphérie pourrait permettre un point de vue distancié qui aurait accès à la vision totale de la situation globale. Il y a toutefois aussi de fortes sources de blocage de l’activité synthétisante ou généralisante, liées au fait qu’en Occident, les intellectuels russes ne sont bienvenus que comme spécialistes de Russie. Cette demande, de même que la popularité de l’idéologie positiviste (lié au néolibéralisme), rend la plupart des recherches entreprises à l’Université Européenne, objectivistes, centrées sur les causes effectives et analysant des relations extérieures. On s’y pose donc plutôt des questions de tactique que de stratégie.
Deuxièmement, la mobilisation des étudiants est allée dès le début dans le sens du soutien de la profession. Il y avait aussi des slogans et des conférences politiques, mais après la réouverture de l’Université les étudiants sont « rentrés dans les auditoires » et ont refusé de continuer leur activité publique. Les autres jeunes activistes qui ont soutenu le mouvement continuent les sessions régulières de l’«Université de Rue[7] », mais les étudiants de l’Université Européenne n’y viennent plus. La réouverture de l’Université a donc effectivement servi à démobiliser les étudiants révoltés. La situation est donc assez différente de celle du groupe OD : non seulement ce groupe n’a pas gagné sa bataille, mais plusieurs de ses membres sont devenus politiquement actifs d’une manière continue, développant un intérêt pour une sociologie qui soit moins objectiviste et plus activiste.
Troisièmement, l’Université Européenne qui a difficilement survécu à la crise politique subit actuellement des problèmes financiers. Les fondations internationales ne peuvent plus soutenir l’Université au même niveau qu’avant, et elle cherche du soutien auprès des entreprises russes. Cette réorientation exige une réforme interne dont le plan actuel va dorénavant dans le même sens que les projets les plus radicaux des réformateurs néolibéraux en Europe. L’Université propose une restructuration qui la rendra plus dépendante du marché. Une mesure importante consiste en l’introduction du poste d’endowed professor (professeur financé personnellement par une fondation). Ce professeur, selon le plan, gagnera trois fois plus qu’un membre ordinaire de la Faculté, et on va choisir les candidats essentiellement sur la base des publications et des citations internationales (c’est-à-dire surtout sur la base des revues anglophones qui sont peer-reviewed). Cette réforme peut créer une motivation d’excellence, mais elle va nuire à l’esprit de travail collectif et au climat démocratique de l’Université. Une telle réforme rappelle la politique néolíbérale dans la construction des villes post-communistes : au lieu de développer un plan urbain d’ensemble, on construit un énorme et solitaire gratte-ciel. Ainsi, les vives tensions entre la barbarie bureaucratique et la technocratie objectiviste tendent-elles à se décider dans le sens du néolibéralisme.
Quelle réforme pour l’université (russe) ?
Sur la base de ces exemples, on peut se faire une idée générale de la situation actuelle de l’éducation universitaire en Russie. Je voudrais pour conclure revenir à ce par quoi j’ai commencé. Il est trop facile de décrire la situation politico-économique mondiale avec une formule, par exemple « la reforme néolibérale », ou « le post-fordisme et le travail immatériel ». Ces tendances existent globalement, mais elles entrent en collision avec des forces différentes et produisent les effets qui sont parfois opposés l’un à l’autre.
Dans la sphère de l’éducation, les mesures néolibérales, telles que la formalisation stricte de l’administration, l’introduction de l’examen uniforme d’entrée aux universités, l’investissement dans la base technologique de l’éducation, sont censées reformer le système, mais en vérité elles le conservent en l’état, parce qu’elles renforcent le pouvoir de l’administration, sans toucher le contenu ni les cadres de l’éducation. L’économie des services et des bureaux ne pose pas de hautes exigences quant à la qualité de l’éducation, et, en créant une demande pour les sciences sociales et humaines, elle contribue à la conservation de leur niveau actuel, ainsi qu’à l’isolation croissante de l’université russe du reste du monde. Ce niveau est très inégal, et même la haute qualité intellectuelle des professeurs, là où elle est présente, ne garantit pas la qualité de l’éducation, faute de motivation et de moyens de contrôle des connaissances.
La seule solution, dans ces conditions, pour l’État (si on suppose, pour un instant, la bonne volonté de certains bureaucrates) serait de créer des nouvelles institutions internationales, d’y inviter les savants professionnels et les intellectuels « organiques » (des praticiens qui pensent), au renom international (ou au moins national), capables de poser des questions d’intérêt général pour la société et de rejouer/repenser certains types des pratiques sociales et matérielles. Il faudrait leur donner des moyens et des « cartes blanches » pour rassembler et administrer ses « équipes » – avec la possibilité financière d’inviter en Russie des savants et des praticiens étrangers, d’éditer des revues bilingues, etc.
Même si l’ouverture actuelle des universités en direction du marché est, comme on l’a déjà signalé, dangereuse pour la qualité intellectuelle, il n’empêche qu’une certaine ouverture vers la société leur est sans doute nécessaire. La reproduction des tours d’ivoire serait une erreur. L’intégration des universités au sein des autres institutions sociales ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire d’un échange temporaire des cadres entre les universités (dont les professeurs doivent être envoyés dans les industries, dans les bureaux, etc.) et ces institutions (dont les « intellectuels organiques » doivent être obligés de passer au moins un semestre dans une université pour systématiser leurs réflexions et discuter avec les intellectuels professionnels). Bien sûr que les médias, où a lieu le débat public, doivent faire partie de ce système. Par ailleurs de petites « universités » autonomes doivent être créées par les grandes industries et corporations – ce qui est actuellement fait par plusieurs corporations en Occident, mais avec un accent inévitable sur la recherche appliquée qui bannit souvent toute discussion publique.
Tout cela exige l’abandon à la fois du narcissisme isolationniste et de l’approche commerciale de l’éducation. Un « démocratisme » anarchique, une auto-éducation des étudiants (dans « l’esprit de 1968 ») n’est non plus pas une option, même si une démocratisation des modes d’opération de l’université est absolument nécessaire. La tâche principale d’une réforme consiste à combattre l’anomie, et recréer l’esprit de la pensée libre et du travail collectif. Cela n’est possible qu’en combinant l’autonomie avec l’ouverture publique des universités.
Si l’éducation en Russie continue à être subordonnée aux logiques bureaucratiques et commerciales, elle continuera à se détériorer, ce qui mènera à l’approfondissement de la crise de solidarité sociale, à la perte de l’esprit créateur et à l’absolutisation de la violence répressive comme seul moyen de « tenir » la société ensemble. Il va de soi que la Russie est ici un laboratoire socio-politique mondial, où les tendances et les dangers actuels se montrent d’une façon plus nette qu’ailleurs – et qui fournit donc à tout analyste le temps et le lieu pour commencer à penser universellement.
On se trouve ici dans la semi-périphérie, sans accès direct au grand pouvoir mondial, mais avec une certaine distance envers celui-ci. On peut y développer une connaissance intime des lignes de front de la « mondialisation », qui tracent de multiples divisions entre le Nord et le Sud (ainsi qu’en leur sein même). Un point de vue universel s’ouvre ici, entre celui des maîtres du monde et celui de ces lignes de front. C’est en apprenant à regarder universellement de ce point de vue qu’on trouvera de quoi enseigner dans chacune de nos universités.