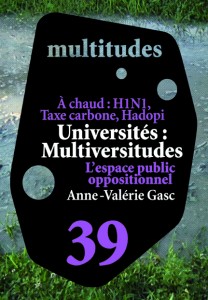Les tendances globales du capitalisme après la reconversion industrielle des années 80 ont porté l’information et la connaissance au centre des rapports de production de la nouvelle économie. Les activités cognitives, immatérielles et relationnelles gagnent de l’importance dans la production de la valeur marchande[1]. En Europe, cette conception économiste s’est concrétisée lors de la déclaration de Lisbonne (2000) lorsque les différents pays de l’Union s’engagèrent à construire « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde » d’ici 2010. Ce processus, appelé Capitalisme cognitif[2], est fondé sur l’appropriation du general intellect[3] à des fins mercantiles. Le processus d’adaptation de la machine capitaliste reproduit l’action d’éclatement des terres communales au XVIe-XVIIIe siècles[4], en imposant à nouveau des barrières à la coopération dans la nouvelle ère de l’information[5]. Des mécanismes coercitifs s’imposent, les uns après les autres, dans les rapports juridiques et institutionnels de la production intellectuelle, et essayent d’enfermer l’ensemble des activités et des relations humaines dans les cadres expropriants de la concurrence et du profit. Comme l’explique Geneviève Azam, « l’émergence d’une « économie de la connaissance » correspond à un approfondissement du capitalisme par la transformation d’un bien gratuit en un bien marchand »[6]. Dès lors, les espaces d’antagonismes et de contre-pouvoirs se déplacent de l’usine industrielle vers des nouveaux secteurs, composés par une multitude d’info-prolétaires d’un côté, et par une nouvelle classe créative[7] dirigeante de l’autre.
Une des caractéristiques de ce nouvel esprit du capitalisme[8] est le processus expansionniste des activités marchandes vers l’ensemble de la vie et des rapports sociaux[9]. Aujourd’hui les centres de travail stricto sensu ne sont pas les seuls terrains de la production capitaliste. C’est l’être humain entier et son environnement qui deviennent potentiellement des marchandises. La communication, la réflexion, le voyage, la sexualité, les liens affectifs, la créativité… : ces éléments transversaux à tout rapport productif sont devenus les nouveaux espaces de valorisation du capital. Ce processus transforme l’essence libre et autonome de ces activités, tant par l’aliénation et la domination directe des personnes que par leur mise en concurrence et leur intégration dans les techno-structures du biopouvoir[10].
Dans ce contexte, l’université comme espace relativement autonome de production et de transmission des savoirs rentre en décadence, pour devenir progressivement une institution potentiellement mise au cœur des modes de régulation et des rapports de production capitalistes.
Du capitalisme cognitif aux réformes universitaires
L’université est définie par Manuel Sacristán selon ses trois principales fonctions historiques : la transmission des connaissances pour la configuration des professions; l’éducation des chercheurs et l’organisation de la production scientifique et technologique ; et finalement, la création d’une hégémonie des classes dominantes[11]. Les processus actuels de réformes universitaires européennes[12] (Bologne-1999 et Ljubljana-2008) et françaises[13] (LMD-2003, Loi de Programme pour la Recherche-2006 et LRU-2007) ne sont donc pas à considérer comme une « modernisation » brutale des institutions, mais davantage comme le renforcement des logiques compétitives et productivistes d’ores et déjà ancrées dans le fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche. En France, la dualité université / « grandes écoles » est à cet égard assez emblématique : l’organisation du système d’enseignement supérieur a clairement pour priorité la reproduction des élites politiques et/ou économiques, au détriment d’une volonté de démocratisation des savoirs tant affichée par les classes dirigeantes.
Loin d’une vision idyllique d’une prétendue époque où les universités auraient été émancipatrices et ouvertes à tou-te-s, il conviendra toutefois de noter la cohérence d’une stratégie globale mise en œuvre depuis plus d’une dizaine d’années, qui ne cesse d’aggraver la situation. Dans la droite ligne de l’Accord Général sur le Commerce des Services (1994), l’enseignement et la recherche se voient attribuer un rôle central et exclusif dans l’« économie de la connaissance ». Ce processus, désigné par les activistes étudiant-e-s espagnols Judith Carreras, Miguel Urbán et Carlos Sevilla comme « le passage de l’université de masse à l’université-entreprise »[14], construit de nouveaux mécanismes juridiques et institutionnels dans le seul but d’accroître la rentabilité de l’entreprise universitaire.
Le Nouveau Management Public contre l’autonomie des universitaires
La réforme relative aux Libertés et Responsabilités des Universités (LRU, 2007), accompagnée de ses nombreux décrets d’application (orientation active des étudiants, statut des enseignants chercheurs, création de l’AERES, nouveau contrat doctoral…), a pour but d’adapter l’université aux règles du Nouveau Management Public[15]. Cela se traduit par l’introduction des logiques issues de l’ordre économique capitaliste, tant dans le fonctionnement et la composition des instances que dans les missions même des universités.
En remplacement de la situation antérieure, fondée sur un principe de collégialité (défendue par certains comme université citadelle coupée du monde, parfois même sacrée, symbolisée par l’héritage historique de la Sorbonne), la gestion des universités est désormais effectuée par un conseil d’administration restreint, où la proportion des membres issus du «monde socio-économique » a été fortement accrue. Au sein de ce processus, les présidents/managers[16] se sont vu attribuer des pouvoirs sans précédent, afin de satisfaire efficacement les objectifs de rentabilité de plus en plus pressants du ministère, des lobbies industriels et des nouvelles agences d’évaluation. Dans cette mise en concurrence des établissements, les principes de démocratisation de l’université s’effacent peu à peu derrière les maîtres mots de compétitivité, productivité, flexibilité, attractivité, visibilité internationale…
L’enseignement comme outil de production des travailleurs cognitifs
Dans le champ de la formation, ce processus s’est traduit par une vision de plus en plus utilitariste des cursus universitaires. La transcription française du processus européen d’« harmonisation » des diplômes (réforme LMD-2002) a donné lieu à un foisonnement de filières dites « professionnalisantes », entretenant des liens étroits avec le marché de l’emploi. L’augmentation du nombre de licences et masters hyper-spécialisés, effectuée avec des budgets en baisse, a participé à la détérioration des conditions d’études dans les filières plus généralistes, quand ce n’est pas leur disparition. Loin d’offrir aux étudiants un cadre d’analyse critique du monde dans lequel ils évoluent, encore moins le « simple » plaisir d’apprendre, l’enseignement universitaire tend à se réduire à une liste de compétences, « lisibles » et directement « valorisables » par le système économique. La science n’est pas le dépassement de ce qui existe par son inscription dans la totalité du sens, mais se réduit progressivement à une technique inconsciente d’elle-même.
La recherche et l’innovation au service du productivisme
Le monde de la recherche tend également à être subordonné à cette logique marchande. Sous le prétexte d’une prétentieuse « excellence » autoproclamée par les nouveaux managers, les critères d’évaluation (AERES) et d’attribution de moyens (ANR) se focalisent sur la capacité des chercheurs à valoriser leurs résultats (en termes de brevets) en vue de leur transfert au monde de l’entreprise. Loin de l’autonomie annoncée, le gouvernement français a engagé une série de mesures visant à piloter la recherche, en favorisant les domaines qu’il juge les plus utiles à l’économie et à sa politique : création de l’ANR, de l’AERES, des pôles de compétitivité, démantèlement des organismes de recherche, crédits impôt-recherche, opération campus, programme national de la recherche et de l’innovation… Ainsi, à l’échelle nationale[17], européenne[18] et mondiale[19], la recherche est avant tout envisagée dans le but d’accroître la compétitivité et la croissance de l’économie capitaliste.
Précarisation et flexibilisation au service de la compétitivité
L’une des nécessité de cette mise en concurrence généralisée des universités, réside dans la précarisation de l’ensemble de ses acteurs. Pour ce faire, la loi LRU et ses décrets ont donné aux présidents d’université la possibilité de gérer les « ressources humaines » selon les règles de la flexibilité : gestion de personnel (dont enseignants et chercheurs) sur contrats à durée déterminée, gestion des primes et des promotions, modulation de service des enseignants-chercheurs titulaires, « négociation » des salaires et missions attribués aux doctorants… Profitant de l’indifférence estivale, la loi dite « relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique » a été promulguée donnant aux nouveaux managers le droit de licencier les fonctionnaires[20].
Concernant les étudiant-e-s, la sélection à l’entrée de toutes les filières ainsi que l’augmentation des frais d’inscription, initialement prévues par la LRU, ont finalement été reportées afin d’obtenir l’accord du principal syndicat étudiant (UNEF). Cependant, la sélection en fin de cursus (L3, M2) et en doctorat est déjà en place, sans parler des spécificités françaises que sont les instituts et écoles internes aux universités (IUT, IEP, IAE, médecine, pharma, écoles d’ingénieur et de commerce…). En réponse aux recommandations de l’OCDE dans son rapport « Objectif Croissance 2009 »[21], des députés de l’UMP ont déposé une proposition de loi[22] allant dans le sens de l’endettement étudiant comme source de financement des universités. La prochaine étape du processus de marchandisation des universités en France sera sans nul doute l’augmentation des frais d’inscription des étudiants, justifié auprès du personnel comme le seul moyen d’assurer leurs emplois.
Comme ce fut le cas en 2005 lors d’augmentations massives et illégales des frais pédagogiques, de telles mesures portant directement atteinte à la condition étudiante, seront probablement à l’origine de l’élargissement d’une prise de conscience des dérives marchandes que subit l’université. D’une manière plus générale, la précarisation tant universitaire que sociétale et environnementale, fait émerger la nécessité de développer de pratiques coopératives et contre-hégémoniques qui permettront de renverser la tendance dominante du capitalisme cognitif.
Des réformes des universités aux pratiques coopératives du cognitariat
La multiplicité des réformes que subit l’hétérogène « communauté universitaire » impose, de plus en plus durement, les règles concurrentielles et privatives du capitalisme cognitif à un monde où coopération, partage et transmission devraient être la norme. Cependant, dans ce climat de mise en concurrence généralisée, les mouvements de ces dernières années ont participé au développement de pratiques coopératives entre les différents acteurs de l’université. Alors que le mouvement dit anti-LRU (2007) était principalement porté par des étudiant-e-s et des lycéen-e-s, nous avons assisté cette année 2009 à l’élargissement de la vague de contestation à des catégories traditionnellement plus conciliantes envers le pouvoir. La rapidité avec laquelle se succèdent les réformes a beaucoup contribué à ce phénomène : alors que beaucoup criaient au procès d’intention face aux mouvements étudiants de ces dernières années, ils en viennent peu à peu à établir le lien entre les actuelles réformes plus abouties, les touchant plus directement, et les précédentes qui en fixaient le cadre[23].
À travers la confrontation des intérêts propres à chacune des catégories impliquées dans les derniers mouvements, se construit peu à peu l’idée d’un intérêt commun, participant ainsi à ce que l’on pourrait définir comme l’émergence d’une conscience des travailleurs-euses cognitifs, le cognitariat[24]. Les atteintes portées, comme nous l’avons vu, tant à la condition étudiante qu’à celle de l’ensemble du personnel des universités, participent à la construction de solidarités entre des mondes extrêmement hiérarchisés[25].
Tandis qu’un nombre inédit d’enseignant-e-s et de chercheur-euse-s se soulèvent (enfin!) contre les règles de la concurrence, de l’évaluation et de la soumission à une hiérarchie bureaucratique, les échanges avec leurs étudiant-e-s posent les bases d’une profonde remise en cause des modalités même de production et de transmission du savoir. N’en déplaise aux enseignants-chercheurs, y compris des plus mobilisés, l’université et par conséquent eux-mêmes soumettant leurs étudiants aux dures lois de la compétition scolaire, participent à la reproduction des conditions nécessaires au maintien de l’élitisme inhérent au système capitaliste[26].
Ainsi le cognitariat universitaire s’engage dans une réflexion collective sur le rôle que joue et devrait jouer le savoir dans nos sociétés. Dans un contexte global de crise économique, l’analyse nécessaire de l’existant aboutit à la critique d’une université prenant part aux dérives du productivisme capitaliste : reproduction des élites, stratégies industrialo-militaires[27], rôle des experts dans la légitimation des politiques menées par les dirigeants… Ainsi cette année 2009 fut la première occasion pour les mouvements étudiants européens[28] de se rejoindre pour élaborer une réponse commune aux stratégies de la globalisation lors de plusieurs contre-sommets (conférence interministérielle de Leuven et Louvain-la-Neuve[29], G8 des universités à Turin[30]). Par ailleurs, l’élaboration de l’« après-Lisbonne » par les chefs d’État européens au printemps 2010 a donné lieu à la création d’un collectif réunissant les principaux syndicats universitaires français (tout du moins certains de leurs membres…), s’élargissant peu à peu à d’autres syndicats européens en vue d’organiser un nouveau contre sommet en mars 2010[31].
L’auto-réforme coopérative de la « vie étudiante »
Même si ce processus trouve au sein même des universitaires des alliés non-négligeables[32], des pratiques créatives et innovantes subsistent dans un soulèvement permanent en opposition aux gouvernants et à leurs projets de société. Une partie considérable des étudiant-e-s et des personnels universitaires gardent à l’esprit la culture et les outils des mouvements sociaux qui ont émergé comme sujet de transformation dans les époques précédentes (prolétariat, autonomistes, écologistes, féministes…). Les universités et leurs noyaux contestataires peuvent surement être pris comme référence de mobilisation et de critique radicale des nouvelles sphères de la production immatérielle. La réappropriation des infrastructures et des ressources, ainsi que la ré-organisation temporelle du quotidien, font partie du paysage habituel d’un bon nombre d’universités du monde[33].
En France, de multiples ateliers et projets alternatifs, portés par des collectifs et groupes affinitaires, murissent année après année dans les universités. Cette mosaïque multiforme d’événements et de pratiques, surtout lors des périodes de forte mobilisation, est capable de créer des communautés de transmission de savoir émancipateur et d’établir des rapports de force contre-hégémoniques. « Universités populaires » et autres groupements de coopération entre les étudiants fleurissent pour organiser des réunions et des débats, produire des textes[34] et des discours, et essaient ainsi de modifier les structures productrices, les modalités et les espaces de transmission de savoir[35].
En parallèle, certaines expériences émergent en rupture avec le caractère intellectuel et cognitif vers lesquels sont habituellement orientés les établissements universitaires. Les occupations des bâtiments pendant les grèves étudiantes et la réinvention des rapports quotidiens d’auto-organisation et de vie collective sont l’exemple le plus évident de cette rupture. La mise en place des zones de gratuité pour favoriser les échanges non-marchands et pour combattre la misère des étudiants et des précaires se situe dans la même optique[36]. On assiste également à la réappropriation des terrains universitaires pour y implanter des jardins communautaires[37], y faire la promotion de l’agriculture paysanne et de la relocalisation de la production. La consolidation des collectifs de soutien aux sans-papiers et de combat contre les mesures de répression des « étrangers » en France peut être aussi révélatrice de cette envie de dépassement du cloisonnement habituel du milieu étudiant[38]. Finalement, les différentes périodes de mobilisation de ces dernières années ont donné lieu au partage avec les différentes générations de militant-e-s qui se sont rapproché-e-s des assemblées et des comités de mobilisation.
En cherchant à constituer un processus d’auto-réforme coopérative de l’université, ces pratiques se confrontent aux enjeux majeurs de sa pérennité et de son degré de coordination à l’échelle nationale et européenne. La transmission inter-générationnelle du bilan collectif des périodes de mobilisation[39] et le renforcement de leurs perspectives à long terme, jouent un rôle essentiel dans la re-constitution et la consolidation permanente des « étudiants comme sujets politiques… qui se battent pour que la révolte s’étende à l’ensemble de société [40] ».
L’ouverture des mobilisations universitaires vers l’ensemble de la société
La force du mouvement dit anti-CPE du printemps 2006 fut cette jonction de différents éléments de la société dans une même conscience d’une situation partagée. L’exploitation sans reconnaissance que sont les stages rejoint celle d’un contrat avec une période d’essai de deux ans. La précarité de l’étudiante converge avec celle de la jeune travailleuse qu’elle est également souvent. Elles partagent une même dépossession de leur production, de plus en plus parcellaire. Ce mouvement fut donc le rassemblement de l’ensemble de la jeunesse précarisée en France. Chaque période de mobilisation fut marquée dans les assemblées générales par des prises de parole émanant d’autres secteurs en lutte. Le dépassement des clivages permit d’obtenir une conquête, certes partielle mais néanmoins révélatrice des capacités d’influence macro-sociale du mouvement.
Le mouvement dit anti-LRU de l’année 2007/2008 fut en revanche victime d’une absence d’ouverture vers l’extérieur qui ne lui permit pas d’y être relayé. Le champ médiatique étant structurellement biaisé, un mouvement étudiant ne peut espérer passer outre sa décontextualisation car le succès d’un mouvement social se détermine par les réseaux qu’il tisse au travers de la société. Un exemple très significatif de la difficulté de cette ouverture se trouve, une année après l’autre, dans le conflit central autour de l’élargissement (ou non) des revendications dans les Coordinations Nationales Étudiantes. D’un côté, les jeunes proches du PS, militant-e-s de l’UNEF et autres acteurs « décadents », gardent un esprit de mobilisation extrêmement corporatiste, alors que de l’autre, les activistes étudiants autonomes, libertaires, écologistes, féministes ou alter-mondialistes… se battent pour donner un sens plus large et convergent aux revendications et pratiques des mobilisations universitaires.
Comme nous l’avons mentionné plus haut, le mouvement des Enseignantes-Chercheuses, des BIATOSS et des Étudiantes contre les actuelles mesures de régression de l’université a montré une capacité sans précédant de convergence de ces différents acteurs. De plus, consciente de la casse généralisée du système éducatif dans son intégralité, la 4e Coordination Nationale des Universités du 20 février 2009 appela à la constitution d’un front unitaire dans l’ensemble du système éducatif « de la maternelle à l’université ». Même si cet appel ne fut que très peu suivi par les syndicats majoritaires du primaire et secondaire, il permit tout de même de nombreux échanges et actions avec les personnels les plus engagés de l’Éducation Nationale, ainsi qu’avec les étudiant-e-s d’IUFM[41] et lycéen-e-s mobilisé-e-s.
La convergence des luttes est donc naturellement un enjeu central des mobilisations universitaires. Au-delà du désir de visibilité dans l’espace public et de conquête d’une hégémonie culturelle gramscienne, la convergence est avant tout la conscience du partage d’un même référentiel dans lequel se déroulent la mobilisation et les pratiques auto-organisatrices. En prenant comme référence le modèle de la Guadeloupe et la grève unitaire du LKP, plusieurs villes (Rennes, Toulouse, Lyon, Grenoble…) se sont lancées, dès le 29 janvier 2009, dans des projets de convergence pour construire une grève générale et illimitée[42]. La convergence des luttes, pour réussir, doit être comprise dans une perspective ouverte et critique d’instauration d’un espace commun de mobilisation, et non pas comme un mot d’ordre hérité d’un romantisme révolutionnaire qu’il s’agirait de réactualiser.
Les potentiels de ce nouvel espace productif
L’intégration de l’université au capitalisme cognitif est donc un enjeu central dans la définition des mouvements étudiants à venir. Il ne peut y avoir de résistance que dans une optique de compréhension des logiques de mise en œuvre de ce nouvel espace productif[43]. Celle-ci pourrait nous conduire au dépassement de la situation actuelle de l’université, située à mi-chemin entre une citadelle isolée du monde et une entreprise capitaliste, en ouvrant la brèche d’une profonde remise en question de son rôle dans la société. Pour aboutir à une réelle convergence, cette contradiction ne doit pas être comprise en termes absolus et figés, mais comme un processus dynamique d’interactions et de critiques mutuelles, pouvant aboutir à des propositions alternatives. Toute résistance, si elle est a minima un refus, contient en elle-même une force créatrice[44] pouvant catalyser les désirs de transformation d’une multitude d’acteurs à la recherche d’autres mondes autant possibles que nécessaires.
Le problème, comme l’expliquait André Gorz, est qu’il y a une incompatibilité structurelle entre le capitalisme cognitif et une économie (non capitaliste !) qui serait basée sur la connaissance. Cette dernière « demande à être une économie de l’abondance, du partage, de la mise en commun, de l’auto-organisation omnilatérale par concertation permanente [45] ». Ainsi, le capitalisme cherche en vain à survivre en étendant la marchandisation à un savoir qu’il dégrade peu à peu en connaissances[46] qu’il cherche à s’approprier. Ces mutations révèlent l’urgence de reconsidérer la place qu’étudiant-e-s, enseignantes-chercheuses, personnels administratifs et techniques, et citoyen-ne-s jouent dans le renversement de la situation actuelle. Si, de part ce paradoxe systémique, la sortie du capitalisme a déjà commencé [47], tout reste à imaginer parmi la richesse des possibles.
À travers la prise de conscience de la complémentarité de l’université, en tant que lieu de savoirs et d’échanges, avec la société et son environnement, l’émergence d’un cognitariat universitaire ne peut se construire qu’en interaction et en convergence permanente avec d’autres secteurs et subjectivités.