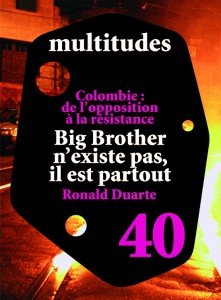Ou des fables de science-fiction comme moyen de déjouer les pièges de la sousveillance
Ariel Kyrou
Surveillance ? Contrôle ? L’analyse de ces deux mots, de leur sens et de leur non-sens les plus contemporains aboutit à deux paradoxes.
Le premier paradoxe, c’est « l’auto disqualification » de ces termes à la faveur de leur décryptage. La surveillance ne surplombe plus le surveillé. Elle s’exerce à hauteur d’individu, chacun prenant tour à tour le statut de surveillé et de surveillant en une danse confuse à ras des champs de pissenlits numériques. D’où ce terme de « sousveillance »[1], inventé pour signifier cette plombée nouvelle de la veille de tous sur tous, notamment sur soi-même. Le contrôle, quant à lui, se désincarne. À l’instar du pouvoir, il n’a plus de tête. Le Léviathan capitaliste et sécuritaire est un « Alien ». Il incube en nous. Il se cache dans notre ventre avant de dévorer notre cerveau. Désormais, ses sbires pratiquent moins la vérification d’identité que le suivi de nos traces digitales et le calcul de nos probabilités d’actions. Ils ne frappent plus l’individu a posteriori, mais a priori, en toute discrétion et sans la moindre violence apparente. Mieux, les anges noirs de la sousveillance voguent au cœur même de notre intérieur, allègrement profilé par les bases de données.
Le second paradoxe est une conséquence directe de cette perte de substance des notions de surveillance et de contrôle selon leur acception classique. Il se traduit par une remise en cause de nos références les mieux établies. Le désir d’actualiser l’étude des mécanismes de pouvoir pousse d’abord à revenir aux sources, à s’abreuver (de nouveau) à la fontaine des deux monstres sacrés de nos multitudes : Foucault et Deleuze. Sauf que leurs lumières, aussi nécessaires soient-elles pour éclairer les prémices d’une réflexion, paraissent vite insuffisantes à tracer un chemin dans la nuit de nos temps numérisés. Comble du désarroi philosophique : la référence qui vient naturellement sous toutes nos plumes pour déshabiller les formes et méformes de cette « sousveillance globale » est un film hollywoodien : Minority Report. Pas un essai à potasser longuement : une fiction à consommer, qui plus est réalisée par l’un des plus fameux saltimbanques des industries du divertissement, Steven Spielberg. Que ce long métrage, sorti en 2002, ait été créé à partir d’une nouvelle de Philip K. Dick, écrivain de science-fiction paranoïaque décédé en 1982, quelques jours avant sa première consécration par Hollywood avec Blade Runner, ne change rien à l’ambiguïté de l’affaire : un objet majeur de la mise au pas de nos imaginaires nous aide à comprendre les infinies subtilités de cette sousveillance qui éteint en nous toute velléité de révolte, tant il s’avère confortable de suivre les tentations de notre double statistique et de son avatar au cœur de nos écrans personnels…
Bref, il semblerait bien que l’une des réponses essentielles aux nouvelles fictions de sécurité et de consommation qui nous habitent réside désormais dans nos facultés à nous appuyer ou à créer de véritables contre-fictions…
L’hypnose de l’ère post PC
La première clef de Minority Report tient à son univers intégralement ubiquitaire. Invisible, l’informatique et sa fille Internet y vivent partout, aussi omniprésentes que l’électricité pour les enfants de la fin du XXe siècle. En 2054, Tom Cruise dialogue avec le moindre élément de sa maison, comme si de rien n’était. Il dit tout haut, sa demeure entend et exécute ses ordres. Les engins automobiles, si ce terme a encore un sens, semblent glisser tout seuls, en automatique, sur d’immenses bandeaux roulants, qu’on imagine écologiques. La moindre porte a des yeux électroniques, selon une merveille de contrôle biométrique, appelé « Identoptic ». Avec, pour couronner le tout, une myriade d’invitations au bien-être. Détail tout aussi majeur : les créatures digitales des affiches de pub s’adressent directement au passant, au travers des pupilles de l’œil qu’elles « scannent » et dont elles reconnaissent immédiatement le porteur humanoïde. Leurs messages circulent des yeux au cerveau. Ils entrent à l’intérieur du crâne, et proposent au quidam le produit correspondant le mieux à ses traces multiples, donc à ses goûts et couleurs. Le scénario autour de « Précrime » et de son système d’anticipation des délits est indissociable de ce contexte « post PC »[2]. Car c’est ce paysage d’ensemble, et non tel ou tel de ses aspects, qui dessine les contours d’un monde qui se veut parfait. D’une société dont les technologies auraient éradiqué toute incertitude.
Tel est bien en 2010 l’horizon de la sousveillance globale : l’illusion d’un monde certain. Sans bugs. Vert tendance hygiéniste. Mais avec tout le confort des technologies les plus serviables, nous obéissant au doigt et surtout à l’œil, à la condition de nous laisser guider par notre double numérique…
Au départ, Anderton (alias Tom Cruise) n’est qu’un zélé serviteur du système d’anticipation des actes. Plus que quiconque, il est persuadé de sa justesse. De sa totale absence de failles. Il y croit. Son désir farouche d’échapper à tout accident, né de la perte de son fils alors même que Précrime n’existait pas, participe à son envoûtement. Ce que j’induis de l’analyse de l’environnement global du film, en phase avec les obsessions de Philip K. Dick, c’est la puissance de cet envoûtement, qui tient non seulement à l’anticipation des délits mais au cadrage des multiples désirs de consommation. Lorsque Amazon me conseille un livre ultra-pointu, par exemple l’introuvable scénario du long-métrage jamais réalisé du roman Ubik, écrit par Dick lui-même, il anticipe mon envie. Grâce à l’analyse des traces que j’ai laissées sur le site de e-commerce, il me bluffe. Il me donne le sentiment qu’il me connaît mieux que moi-même et qu’il m’offre une maîtrise unique sur mon devenir, alors même que celui-ci m’échappe. Ce phénomène d’hypnose est le cœur de cette sousveillance qui se construit hic et nunc au cœur de notre quotidien, là en 2010… De l’ordre de la sorcellerie païenne bien plus que d’un système de contrôle classique, il agit sur mes intentions et oriente discrètement mes décisions. Il rend dès lors impossible toute barrière ou toute sanction juridiques. Je reste en effet libre de mes actes, et ce d’autant que je suis satisfait de la proposition de la mécanique e-commerciale.
On retrouve dans ce phénomène l’utopie d’une société sans conflit, au cœur du Meilleur des mondes d’Aldous Huxley (1933). Les ressorts de la servitude volontaire évoluent, la rendant chaque jour plus agréable voire souhaitable, mais l’essentiel reste encore et toujours de l’ordre de la captation de la psyché. Son effet est de nous convaincre de vivre dans un monde d’une fluidité absolue, dont chaque objet nous sert avec une politesse de l’ordre du plus bel animisme technologique. Soit un envoûtement qui nous lave de notre moi éternellement sceptique pour mieux installer en notre carcasse un avatar éternellement satisfait, ronronnant de plaisir à la satisfaction de ses désirs comme à son sentiment de sécurité absolue. Sauf que la drogue du Meilleur des mondes, ce soma délicieux, qui se veut le sésame de son paradis factice, a été remplacée dans Minority Report, ce miroir de notre science-fiction si réelle de 2010, par les multiples artifices de lecture de notre âme et d’adaptation de notre futur proche à « l’à-venir » le plus sécurisant et le plus rentable. Timothy Leary, le prêtre du LSD, avait bien anticipé cette évolution de la drogue chimique à la drogue numérique. Il rêvait ce troc de piquouse pour le meilleur : une nouvelle conscience planétaire. L’ère post PC de l’Internet partout annonce-t-elle le pire ? C’est-à-dire un devenir machine de l’homme, mécanique heureuse mais intégralement prévisible par la grâce des bases de données nourries de nos traces multiples ? Oui, sauf à ce que cette machine puisse nous surprendre…
Je suis mon propre garde-chiourme
Même si inspiré de la dictature stalinienne et des multiples modèles de totalitarisme du siècle dernier, Big Brother n’est qu’une métaphore fictionnelle d’un écrivain lui-même engagé, George Orwell. Certaines des figures de 1984 (1948), comme la « novlangue », gardent une belle vérité. Mais la permanence d’un abrutissement par des mots vides, guerriers ou au sens opérationnel, la puissance tranquille de leur anesthésie par la pub, par le management ou les vrais faux « amis » des réseaux dits sociaux, tient justement au caractère « sousveillant » de cet assèchement, sans aucune instance surplombante.
La « Police de la pensée », elle aussi, ne s’incarne en nul Grand Inquisiteur, qui dirigerait de son estrade une armée de zombies, leur casque d’écoute sur les oreilles. Cette police-là, qui est aussi celle du Brazil de Terry Gilliam, est-elle pour autant absente du paysage de la « sousveillance » globale ? Non. Car cela signifierait la disparition de la peur comme mode de gouvernement des corps et des âmes. Orwell, d’ailleurs, met en scène dans son œuvre le caractère tout autant physique que métaphysique de ce contrôle omnipotent. Ce qui a vieilli ou s’applique mal à notre temps, c’est cette idée d’une terreur disciplinaire, portée par un pouvoir ouvertement totalitaire. Ce qui n’a pas pris une ride en nos démocraties de Foires du Trône numériques, c’est la façon dont Orwell décrit le Big Brother qui sommeille en chacun de nous. Il s’éveille lors des « Deux Minutes de la Haine », cette cérémonie vocifératoire[3]. Il se nourrit du climat de suspicion, de cette impression fantasmatique que rien n’échappe à « ce » qui nous surveille. Et c’est justement cette illusion d’un pouvoir tutélaire qui alimente cette crainte tenace qui, peu à peu, grignote mes synapses et me transforme, à mon insu, en agent de la peur. L’enjeu, ici, n’est plus la surveillance mais l’illusion de la surveillance, son ombre fantasmatique. Et cette manière qu’a mon voisin de me regarder en sous-main, lorsque je lui avoue que je ne me ferai pas vacciner contre la grippe A[4]…
De la banalité « a-morale » de mon autocontrôle
Cette complicité de l’homme ou de la femme avec son Big Brother intérieur, Philip K. Dick l’a décortiquée dans Substance Mort en 1977, repris au cinéma sous le titre A Scanner Darkly en 2006. Fred, alias Bob Actor, y est chargé de rédiger un rapport sur lui-même. En tant qu’agent de la Brigade des Stups, il doit guetter les moindres faits et gestes du consommateur de stupéfiants qu’il est lui-même par ailleurs. Il est son propre suspect, d’ores et déjà présumé coupable.
Première figure prémonitoire de notre sousveillance contemporaine : lorsqu’il exerce son métier, dans sa peau de flic, Fred porte un « complet brouillé », c’est-à-dire un costume invisible et hyper sophistiqué qui donne à sa voix un timbre changeant et sans caractère, et à son physique un aspect si neutre que le personnage en devient méconnaissable, avec un visage qui semble mille visages en un. On ne saurait mieux affirmer l’absence totale de visage, mais aussi l’infinie banalité de cet autocontrôle numérique que décrivent dans notre dossier Éric Sadin, Antoinette Rouvroy et Thomas Berns. Ce costume inconcevable est la métaphore idéale de notre corps statistique, sans visage ni événement. Il crée, une fois que nous l’avons enfilé, le sujet parfait de la sousveillance et de ces processus de voyance active, à la fois avatar de nos corps suants et modèle à suivre pour notre sécurité et notre bonheur, c’est-à-dire pour la meilleure adéquation de nos êtres de chair aux normes si confortables de la société de l’ère « post PC ».
Deuxième clef de Substance Mort : l’auto « big brotherisation » de l’individu. D’un point de vue classique, rappelons-le, le pouvoir se revendique de la bonne morale et du maintien de l’ordre qui va avec. Il justifie sa discipline par la défense du Bien contre le Mal. L’auto « big brotherisation » de la personne permet d’éviter ce recours à la « moraline », au purgatoire comme au paradis ou à l’enfer sur Terre.
Suivez la logique de Substance Mort : profitant de son absence et de celle de ses colocataires, Fred invite ses collaborateurs de la Brigade des Stups à venir installer lignes d’écoutes, puces et autres « holocaméras » dans les moindres recoins de la maison du consommateur de drogue qu’il est également. L’univers ubiquitaire de Minority Report et de notre nouvelle salade globale s’installe chez lui, le drogué, via son avatar de flic. Dans cette double identité de l’anti-héros s’unissent les deux faces contraires de la sousveillance : d’un côté l’agent de l’ordre, garant de la sécurité au mépris de toute vie privée, de l’autre le bouffeur de psychotrope en archétype du consommateur dépendant de son produit. L’un n’est pas plus « moral » que l’autre. Fred passe ainsi des jours et des nuits à regarder les bandes enregistrées de Bob, c’est-à-dire à se regarder lui-même au cœur de son propre appartement. Son spectacle, c’est lui tel qu’il se surveille. Soit la métaphore de l’autocontrôle absolu, consacrant la fusion-confusion du surveillé et du surveillant selon les règles de l’amoralité la plus égotiste, de l’illusoire sécurité comme de la consommation hyper-capitaliste.
Là se situe la grande performance du système de sousveillance contemporain, de ses formes et méformes à venir : l’auto « big brotherisation » permet de suspendre le jugement de la société. L’essentiel est de suivre ses voies digitalisées. De dire oui à ses vrais faux amis de MySpace et Facebook, oui aux camelots qui veulent notre bien sur Internet. Oui aux cookies, oui au GPS, oui aux achats conseillés par les puces. Que nos traces numériques soient laissées partout et nulle part ? Qu’il y ait du porno, de l’anarchisme, du sadisme, du racisme, du communisme, de la gouine rouge, de la révolte en bouteille, de la concupiscence en piqure ou de l’égoïsme en boîte dans les intentions puis les actes ainsi tracés par nos soins ? Qu’importe tant que nos chemins ont été prévus, cadrés, calibrés, facturés, enregistrés, rangés en multiples tiroirs virtuels de données. Il n’y a aucun souci à être tout à la fois le flic et le drogué, la chienne de l’ordre et le fieffé bandit, Monsieur la vertu et Madame la libérée ! La nature, correcte ou non, de nos actes n’a strictement aucune importance, dès lors qu’ils rentrent dans les cases anticipées à leur effet.
Comme l’écrit Philip K. Dick dans Visite d’entretien, une nouvelle prémonitoire et très néo-luddite[5] datée de 1954, « peu importe l’idéologie dominante ; peu importe que ce soit le communisme, la libre entreprise, le socialisme, le fascisme ou l’esclavage. Ce qui est important, c’est que chacun de nous soit en parfait accord avec elle ; d’une loyauté absolue, tous. (…) Grâce au swibble, on a pu transformer ce problème sociologique fondamental qui est la loyauté en simple problème soluble par la technologie – une simple question d’entretien et de réparation » [6]. Dans une société devenue totalement opérationnelle, donc sans nécessité de morale, c’est une métaphore de nos technologies « post PC », comme le « swibble » ou le « complet brouillé », qui garantit pour « l’à-venir » proche notre bien-être. Nul besoin de Big Brother : il suffit de rester dans la ligne, c’est-à-dire en ligne.
Les deux pôles d’un « à-venir » sans événement
Les principes et les processus de la sousveillance contemporaine reposent sur un sésame majeur de Minority Report : la « précognition », c’est-à-dire la capacité à connaître l’événement avant même qu’il ait lieu. Ce qui, de fait, l’annule en tant qu’événement. Ce mode de gouvernement sans gouvernants ne s’opère plus dans l’espace mais dans le temps, que celui-ci soit réel ou non. Là est sa révolution.
Sa mise en œuvre se joue selon deux registres complémentaires, qui semblent comme le « pôle – » et le « pôle + » d’un même système de mise en adéquation de chacun aux normes de la société qui sont dorénavant celles de nos corps statistiques.
Le pôle +, versant positif de cette mise au pas de « l’à-venir », concerne l’immense majorité des citoyens de notre cité, idéale car sans conflit par la grâce de ses capteurs omniscients et de ses créatures digitales qui nous guident dans nos choix. Il est de l’ordre de la vérification des actes, de façon à ce que ceux-ci se conforment à la prévision, prévision elle-même conditionnée par la multiplicité des traces numériques que laisse chacun dans le monde « post PC ». Chaque acte est en quelque sorte orienté par les précédents, dans une spirale de consolidation temporelle, l’habitude engendrant la bonne prévision, et la bonne prévision l’habitude. Ce pôle + de ce que Frédéric Neyrat nomme les sociétés de clairvoyance[7] est piloté, de façon générale, par les besoins de la société de consommation hypercapitaliste – dont il convient de ne pas sous-estimer la capacité à satisfaire tous types de désirs.
Le pôle – de ce merveilleux dispositif d’envoûtement « précognitif » est non plus de l’ordre de la vérification ou de l’orientation, comme son pôle +, mais de l’ordre de la correction forcée de l’immédiat « à-venir » à des fins de sécurité du système. De la réparation préalable d’un problème, c’est-à-dire d’une action non prévue. Son modèle s’incarne tout naturellement dans les mécanismes d’anticipation des délits de Précrime. Le meurtre, surtout lorsqu’il est de nature terroriste, représente sous ce regard l’accident suprême dans le bel ordonnancement de la société sans conflit, l’essence même du crime (rare) qu’il s’agit d’éradiquer par avance.
Minority Report ne raconte pas stricto sensu cette réalité-là. Ce qu’il met en scène lors de ses premières minutes, alors que Tom Cruise n’est encore que le plus zélé lieutenant du système, n’est pas l’attentat de quelque petits-fils de Ben Laden mais un crime passionnel, surgi d’une multitude de hasards en cascade. La clef, livrée de façon presque involontaire par les scénaristes de la machine hollywoodienne, c’est le caractère inattendu de ce méfait. Pour la société de clairvoyance, sœur du monde parfait de l’ère post PC, le crime ne s’explique pas et se justifie moins encore pour quelque raison sociale ou politique. Il tombe sur ses brebis, victimes ou coupables, par surprise, comme l’acte terroriste le plus gratuit et le plus imprévisible. Et c’est bien là le comble de l’horreur : son imprévisibilité. Cambriolage, vol à la tire ou bombe dans un bus, tout délit de la société de clairvoyance en devient un simple « bug », nécessitant une réparation de la machine globale. Un raté technique, dont tout converge à indiquer qu’il doit un jour ou l’autre disparaître. Car les citoyens, orientés par le pôle +, c’est-à-dire par tout ce que cette société d’hyper-voyance leur offre de bonheur pour combler leurs désirs, mais aussi par la certitude que tout délit sera réprimé avant même d’avoir lieu, sont censés marcher droit d’eux-mêmes. L’intervention des brigades de Précrime pour empêcher qu’un accident ne fasse quelque victime et ne mette du désordre dans la société est donc l’exception qui confirme la règle, ce qui parachève un dispositif de « gardiennage du troupeau » d’une performance sousveillante que Platon lui-même n’aurait jamais imaginée.
Acte tout à fait significatif de cette chasse à l’accident, aux « bugs » d’une société se voulant absolument efficiente : dans leur étrange baignoire constellée d’électrodes, les « précognitifs » de Minority Report sont des humains changés en machine. Non pas une femme et deux jumeaux à moitié demeurés mentaux, avec cependant des dons de voyance exploités par la police, mais des êtres humains transmutés en pure technologie. La vision de ces objets opérationnels, à peine capables de baragouiner entre deux flashs, rend par contraste d’un ridicule accompli la « happy end » du film : Précrime est enterré, et les trois mutants vivent, heureux, dans un coin reculé de la planète. Autrement dit : il aura suffi d’un unique « bug » dans la chasse aux « bugs » pour que soit abandonné l’aboutissement de tout une évolution technologique, sociale et politique, concentrée depuis des lustres vers la recherche de l’omnipotence, du confort et de la sécurité absolus ! Même le scénariste du Manège enchanté ou des aventures de Casimir le monstre gentil aurait ri aux éclats à la naïveté grotesque d’un tel final !
Prisonnier d’une nasse temporelle
L’horizon ô combien pessimiste esquissé par Dick dans une nouvelle comme Marché captif (1955) semble bien plus en phase avec la philosophie induite par les 99% de Minority Report qu’avec sa conclusion bêtasse. Si les sociétés de clairvoyance avaient une icône, ce serait la « vieille femme d’affaire » de ce Marché captif : ayant le don de naviguer dans le temps, elle oriente le futur de ses clients afin de préserver son marché. Elle leur apporte de quoi construire une fusée pour fuir la Terre dévastée, puis « choisit » leur devenir entre les diverses pistes du temps de façon à ce que la fusée toujours s’écrase – tout en laissant ses occupants en vie, histoire de leur apporter à nouveau, et pour toujours, un matériel encore plus sophistiqué. Telle est bien la logique ultime du marketing. Sauf que ces clients d’un texte d’il y a un demi-siècle ne subissent pas le pouvoir des marques pour la vie entière mais juste la même éternelle vieille marchande[8]. De fait, la sousveillance et sa cohorte de satisfactions commerciales judicieusement anticipées nous enferment dans le même type de nasse temporelle, certes plus joyeuse que sur la planète dévastée de l’auteur de science-fiction et sa vieille marchande, mais tout aussi tragique d’un point de vue existentiel.
Nous sommes des rats, perdus dans le labyrinthe high-tech du bonheur post PC, drogués, envoûtés peut-être, aveuglés tant nous rêvons debout d’un monde sûr et certain. Car la logique de la « précognition » et de son petit frère, le voyage dans le temps, se résume à l’abolition de toute incertitude. Or qu’y a-t-il de plus contraire à la quête du savoir que cette illusion-là ? Ce constat cauchemardesque d’une société prisonnière d’elle-même car intégralement voyante et sousveillante, c’est exactement celui qu’ébauche Philip K. Dick dans le préambule puis dans le texte d’Un p’tit quelque chose pour nous, les temponautes ! (1974). « En toute naïveté, écrit-il, on pourrait croire qu’en allant dans l’avenir, et en en revenant, nous ferions progresser, et non régresser nos connaissances. Or nos trois temponautes vont dans l’avenir, en reviennent, et se retrouvent pris au piège, peut-être pour l’éternité, dans une série de paradoxes, parmi lesquels – et c’est peut-être le plus grand de tous – leur propre stupeur face à leurs propres initiatives. Tout se passe comme si l’accroissement de la masse des connaissances provoqué par cet exploit technique, à savoir la notion préalable de ce qui va arriver, amenait le déclin de l’entendement véritable » [9]. Ironie tragique : par les voies de « l’émergence » et de la « réémergence temporelle », les temponautes, ces héros de la Nation, assistent à leur enterrement, à leur propre cérémonie commémorative avec cortège de Cadillac drapées de noir. Concentrés sur leur présent de rescapés provisoires, prisonniers d’un passé à transformer au nom de l’avenir, ils rejouent à jamais la même boucle temporelle, le même futur, immuable comme dans l’idéal inatteignable de la société de clairvoyance et de ses mécanismes de voyance et de sousveillance.
Dire du futur qu’il pourrait être unique, voire se réduire à quelque prédiction, aussi complète et multiple qu’elle puisse être, c’est déclarer la mort de son « à-venir ». Ce futur figé, macabre donc, ne pourrait vivre en nous qu’au travers d’un souvenir lui-même fixé, et tout aussi mortifère. Affirmant qu’il n’y a qu’un futur, celui qui aura lieu par la grâce de cette société de clairvoyance qui ne veut que notre Bien, je l’enferme dans une prison. C’est comme si je possédais d’ores et déjà des photos et films numérisés de moi demain, mes parcours GPS, les traces de mes trajets dans la Toile sous forme de cartes postales, bref des objets plus ou moins virtuels de mon « à-venir » avant même qu’il ait lieu. Il est bloqué. Comme s’il était mon passé. Passé donc. Dépassé. Inaltérable. Ce futur solitaire stoppe le temps. Il écrase l’évolution. Il est celui, très répandu, de la langue de bois médiatique ou politique, lorsqu’elle exige qu’on s’incline devant ce qu’elle appelle la réalité. Que diable !, on ne remet pas en cause la volonté des Français, les lois du marché, celles de la nature, l’avis des comités d’experts ou la culpabilité des suspects d’un grand procès à spectacle mis en scène par l’État. Affirmer qu’il n’y a qu’un futur, c’est faire comme si celui-ci avait déjà été vécu, sourd à tout désir de liberté. C’est transformer le temps en boue de temps. Voire en glue de minutes, d’heures et de jours. Comme un ressort qui sans cesse nous ramènerait au présent, incassable pour l’éternité.
Le problème tient au caractère unique de « l’à-venir ». Ou à son singulier. Le futur se doit de rester pluriel. Ouvert donc. Et toujours incertain. Les amateurs de science-fiction le savent bien : pour ne point tuer l’à-venir, le voyage dans le temps suppose la pluralité des futurs, entre une multitude de pistes toutes plus improbables les unes que les autres. Pour reprendre le terme des hermétistes du Moyen Âge tel Giordano Bruno, il ne peut y avoir de jubilatoires projections sans une pluralité des mondes. Plein de mondes possibles, tous parallèles les uns aux autres. Plein de futurs. Plein de souvenirs de ces futurs. Et donc une ouverture à la totale incertitude de nos actes. Au grain de sable dans la machine. À la poésie naturelle. La mort y est commune, variant ses apparitions et ses figures selon les mondes alternatifs visités – ou ignorés. Ou plutôt faudrait-il parler de toutes les morts, grandes ou minuscules. Comme l’ironie ou l’autodérision, ces petites morts qui ne tuent que le crétinisme qui prend ses aises au-dedans ou en dehors de nous.
Le combat des fictions créatrices
La précognition et le voyage dans le temps ne sont que les métaphores du puissant horizon sousveillant de l’ère post PC. D’une certaine façon, le penseur rationnel aurait raison d’affirmer qu’il ne s’agit là que de chimères de l’esprit. Sauf qu’en nos temps pilotés par les technologies les plus démiurgiques, ces chimères-là nous gouvernent. La précognition est l’une de nos perspectives high-tech, au même titre que l’ubiquité et l’omnivoyance. Qu’est-ce que le téléphone, qui nous permet d’être là sans être là, à distance, si ce n’est le premier instrument pour concrétiser nos désirs d’ubiquité ? Qu’est-ce qu’incarne Google Street View, si ce n’est l’infinie prétention que rien de la planète n’échappe à nos regards transfigurés par les écrans ?
L’ambition et l’exercice du pouvoir ne se jouent plus sur le registre du contrôle, c’est-à-dire de l’observation, de la permission ou de l’interdiction, de la punition ou de l’imposition des actes selon leur nature délictueuse ou nécessaire à l’ordre dominant. Selon la logique de la sousveillance, hypnotique et générée par le consommateur, le pouvoir s’investit en amont des actes, au niveau des intentions, voire des motivations de chacun. Il cible nos neurones dans l’idée de nous orienter vers son « à-venir » à lui, qui est d’ailleurs tout autant le nôtre que son contraire potentiel. Son champ de bataille est notre imaginaire. Les influx, informations, sons et images, idées et suggestions qui alimentent sans cesse notre cerveau sont les armes de ce pouvoir diffus comme elles sont celles de ses contre-pouvoirs éventuels. Il s’agit d’une guerre de tranchées intérieures. D’une guerre d’influences cognitives. D’une guerre de séduction. D’une guerre dont la dimension est virtuelle dans tous les sens du mot, des simulations et autres jeux vidéo aux virtualités de notre esprit. Ne l’oublions pas : dans ce combat des imaginaires, le spectre de la sousveillance s’appuie sur les multiples traces de notre corps statistique. Il cherche à s’allier à notre avatar de base de données, qui n’est que notre double prévisible.
Le paysage intérieur de ce conflit mental ressemblerait à une bagarre d’ego. Les souvenirs de marques, tel ou tel café servi par un bel air de pub, le faux ami du coin du réseau dit social et la mémoire d’un vieux copain d’enfance pourraient être parmi les personnages schizoïdes de cet espace cognitif. D’un côté, en notre tête, il pourrait y avoir Allison, que le lecteur prend d’abord pour une divinité toute puissante dans Le monde qu’elle voulait (1955) de Dick. De l’autre, il y aurait Larry, à qui elle lance : « Vous avez un monde bien à vous quelque part ; dans celui-ci, vous n’êtes qu’un aspect de ma vie. Pas tout à fait réel. Je suis la seule personne qui soit entièrement réelle dans ce monde-ci. Vous autres, vous êtes tous là pour moi. Juste en partie réels » [10]. Allison est notre avatar, notre moi tout heureux de suivre les parcours fléchés, mais avec la conviction que son univers se conforme en permanence à ses affabulations. Qu’elle maîtrise sa vie. Ce double réduit son interlocuteur, qui n’est autre qu’une autre version de nous-mêmes, à une virtualité, ni vraie ni fausse, ni tangible ni intangible. Esthétique des décors, ambiance des bars ou teneur des événements : le paysage d’Allison donne l’impression de se métamorphoser au gré de ses délires à elle. Sauf qu’à la fin de la nouvelle, c’est Larry qui fait disparaître Allison. « C’est toi qui t’en vas », dit Larry. Et une boule de lumière d’effacer Allison. Elle n’existe plus. Elle n’a jamais existé. Et nous sommes désenvoûtés. Ou envoûtés par une autre puissance, elle aussi plus ou moins impersonnelle. Par la grâce de sa paranoïa anticipatrice, Philip K. Dick nous dévoile l’une des vérités des mécanismes du pouvoir sousveillant qui nous habite : son enjeu n’est plus de l’ordre de l’action et de la réaction, mais de la création.
Car le numérique sert bien plus qu’à compter ou programmer des logiciels de comptabilité, et ce depuis longtemps. Comme Jean Baudrillard l’a montré il y a une génération déjà, la simulation, à forcer de prendre modèle sur la réalité, est elle-même devenue réalité. Elle a fait disparaître son modèle[11]. Sur un autre registre, lorsque mes deux fils jouent en ligne, à World of Warcraft par exemple, ils entrent littéralement dans leurs personnages. Ils sortent de leur corps et deviennent eux-mêmes des créatures numériques. Ils sont vraiment le nain à barbe ou l’elfe vaillant. Ils tissent un irréel à vivre, à la façon classique des jeux de rôles, mais en y intégrant des vérités créatrices (celles de WoW) qui ne sont pas les leurs, ou pas uniquement les leurs. Ils entrent en effet dans l’imaginaire des concepteurs et designers du jeu. C’est ainsi, d’une certaine façon, que naissent nos avatars de bases de données, se construisant au fur et à mesure de nos échanges. Il y a quelque chose de l’ordre d’une véritable création dans la fabrication de nos doubles algorithmiques, se tissant au fur et à mesure de nos tribulations numériques, de nos parcours enregistrés sur le Net à nos chemins balisés par le navigateur GPS, de nos achats par carte bleue à nos jeux vidéo sur la Toile, de nos reconnaissances biométriques à nos discussions en RFID, etc. Le numérique est la pâte à modeler de nos imaginaires contemporains. Les figures que dessinent ses traces, avec notre consentement le plus souvent, sont en elles-mêmes des « science-fictions ». Elles forment un immense laboratoire sousveillant, qui demain sera connecté de tout et de partout. Et ce laboratoire est tout autant un supermarché de rêve qu’une enfilade de palais de nos désirs. Bref, il est plus proche de Disneyland que de la sous-préfecture du coin.
Le contrôle n’est plus identifiable à un rond-de-cuir. À un peine-à-jouir. À un Mister « Non » aux ciseaux castrateurs. Le contrôleur sousveillant, ce fantôme digital aux multiples facettes, est un Mister « Oui ». Un beau jeune homme ou une belle jeune fille aux qualités artistiques indéniables, à qui l’on peut faire confiance tant il nous connaît bien. Un copain qui ressemble à notre premier « ami » sur MySpace : le gentil Sam, ou quelque chose du genre. Qui nous incite d’ailleurs à créer nous-mêmes, grâce à ses conseils avisés. Et à multiplier les « amis »…
Faire dérailler le réel statistique
pour réveiller nos imaginaires
Sur le terrain mental où se joue l’hypnose de l’à-venir, la CNIL n’existe pas. Ou si peu… Défendre le respect de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, c’est bien. C’est même la moindre des choses. Mais les fantômes de la sousveillance et ses légions de la clairvoyance en rigolent doucement. Le droit appartient au monde de la discipline et du contrôle, qui plus est avec un temps de retard sur les pratiques du monde réel. Au mieux peut-il se donner la douce illusion du maintien des bases de données en l’état de non-communication mutuelle. Et encore… Les puissances de la sousveillance vivent dans une autre dimension, celle de l’invisible, d’un réel aussi intangible que calculable. Parler de « métadroits », droits à l’oubli, à la désobéissance et à la capacité de (se) rendre compte, comme le font dans leur article Antoinette Rouvroy et Thomas Berns, permet d’avancer d’un pas plus lucide vers nos nouveaux spectres intérieurs. Mais aller plus loin encore et pénétrer leurs univers suppose bien autre chose, qui est, je le répète, de l’ordre de la création bien plus que du recours à la loi et au législateur.
Même le sommet de l’anticipation hypnotique en mode post PC ne sera jamais à l’abri de gamins débrouillards, d’arrière-petits-enfants du Chaos Computer Club et des hackers les plus dévergondés de notre temps.
Aucun système n’est infaillible. Aucune technologie n’est indétournable. Aucune réalité n’est intégrale, quelle que soit l’épaisseur de ses murs (numériques).
Faire défaillir les systèmes, détourner les technologies de leur rôle de sousveillance, désintégrer la réalité dominante par de joyeux attentats de l’imaginaire : ceci est un pur programme de création, supposant des amateurs et non des consommateurs.
Il s’agit bien d’imposer des contre-fictions aux fictions dominantes.
Il s’agit de les détourner pour mieux se désenvoûter.
De les infester de samples afin qu’elles « buggent ».
De déshabiller leurs ressorts par la grâce de quelque tarte à la crème, numérique ou non, afin que chacun puisse se réapproprier son bel intérieur à ciel ouvert.
Lorsqu’un certain « Fredjlp » détourne ses créatures de World of Warcraft et un sketch de François Pérusse pour monter une satire de Miami Vice, il glisse un moustique dans le grand programme ludique de la jeunesse connectée[12]. Pour survivre à l’inflation de sons et d’images du temps, qui le programment à consommer en 3D, il détourne les outils virtuels de tournage, d’enregistrement et de montage de ces jeux vidéo plus ou moins calibrés. Il agit pour rire (et pour sa santé mentale) comme d’autres artistes improvisés de ce qu’on appelle les machinimas, s’amusant quant à eux de Quake, Halo, des Sims 2 ou encore du récent TrackMania. Et tous, il rompent avec « l’à-venir » sûr et certain que ces jeux leur traçaient.
Quand le libre combo de hackers transalpins Ippolita crée des « scookies », c’est-à-dire un système permettant aux internautes de s’échanger entre eux les petits fichiers espions de Google et consorts, cookies qui enregistrent nos traces pour mieux nous servir, ils glissent des zestes de chaos dans l’organisation si magnifiquement « profilée » du moteur de recherche, de ses robots et de ses pubs si joliment personnalisées. Que le fan de heavy metal reçoive une invitation à écouter le dernier Rika Zaraï ? Ne reste plus qu’à la sampler, Rika… Et les belles machines de sousveillance connectées en perdront leur langage de programmation html ou xml !
D’eux-mêmes, comme les mécaniques des textes de Dick, les robots du bel ordre post PC pourraient se mettre non seulement à parler mais à regimber. Eux aussi, pourraient dire « non ». Ou revendiquer leur « droit à l’oubli ».
Lorsqu’il y a cinq ans, à Vienne en Autriche, le groupe 01001011101011101.org rebaptise la KarlPlatz en NikePlatz, il pratique l’usurpation d’identité et suscite immédiatement un court-circuit dans nos synapses marqués du « Swoosh », le logo de Nike. Tout le monde y croit. Certains passants protestent. Et la firme intente un procès aux hérétiques. Les artistes, qui adorent Nike autant qu’ils en détestent le symbole, entrent par la porte de derrière dans le paysage mental des Viennois. Ils créent un accident de réalité[13]. Cette performance hors-la-loi, en prise directe avec notre imaginaire, représente tout ce que ne supportent pas nos suppôts de la sousveillance, intérieurs ou extérieurs à notre espace intime. Plus que de lois sur la protection des données, c’est d’imposteurs à la façon de 01001011101011101.org ou des Yes Men dont nos esprits connectés ont besoin pour nous permettre de changer de globes oculaires, comme Tom Cruise dans Minority Report. De façon à ce que les créatures de pub s’adressent à nous comme à Monsieur Yamamoto et non plus comme à Monsieur Anderton. Ainsi apparaît une solution pour échapper aux scans de tous ordres et à leur entrée dans la tête, donc fuir cette hypnose de l’à-venir qui nous fait prendre le présent ubiquitaire pour le meilleur des mondes : au sens propre, troquer un regard contre un ou plusieurs autres. Soit une chirurgie empathique consistant à réellement échanger nos yeux, digitaux ou non, contre l’un ou l’autre de ceux de la multitude fictionnelle, robots et extraterrestres compris.
Sur le même sujet
- Icônes 80. ACBE/Johann Hauser/Óscar Fernando Morales/Janko Domsic/Szabolcs Bozó/Giovanni Bosco/Dwight Mackintosh/José Manuel Egea/Alberto Jorge Cadi/Louis Bec/Guo Fengyi/Davood Koochaki/Mihai Zgondoiu/
- Multitudes : Summer
- Des corps en public
- Consulter les oeuvres de Daphné Le Sergent
- Créer une nouvelle forme de vie