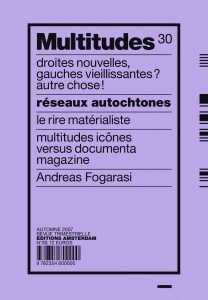Joe Orton est né le 1er janvier 1933 à Leicester, Angleterre, issu d’une grande famille ouvrière. Il passe les années 50 à écrire des romans loufoques, excessifs, osés, en collaboration avec son mentor et amant Kenneth Halliwell. En 1962, il est condamné pour avoir défiguré des livres de bibliothèque et il est incarcéré. Après sa libération, il se tourne vers l’écriture dramatique et constate que son art a mûri, qu’il s’est durci : « Le temps passé en prison a rendu mon écriture plus froide et détachée. Je n’étais plus impliqué et, tout de suite, ça allait mieux. »[1] Il produit coup sur coup une série de pièces impitoyables et efficaces, dont les plus réussies prennent d’assaut la famille (Entertaining Mr. Sloan), la gendarmerie (Loot), l’Église (Funeral Games) ou les hôpitaux psychiatriques (What the Butler Saw). Il tire son inspiration tantôt de son apprentissage littéraire auprès de son amant cultivé, tantôt de la culture souterraine homosexuelle, telle qu’il la côtoie dans les toilettes publiques britanniques, et, plus tard, auprès de jeunes prostitués marocains. « Il appelle les toilettes des hommes “le dernier refuge des privilèges masculins”[2]. » « On ne peut pas prendre des amants en Afrique ! Le coût même du trajet serait insoutenable[3] » En 1967, jaloux de la réussite commerciale, artistique et sexuelle de son compagnon volage et soudainement célèbre, Halliwell met un terme à la carrière ainsi qu’à la vie d’Orton en lui assénant plusieurs coups de marteau sur la tête. Les circonstances qui entourent cette mort rappellent la brutalité libidineuse, drôle et symétrique, qui clôt habituellement ses pièces, et semblent bien confirmer l’auto-appréciation qu’il proposait aux critiques scandalisés, aussi bien qu’à ses proches, parfois coupables de paternalisme : « Mes pièces ne sont pas des fictions. J’écris la vérité. »[4] Qu’est-ce qu’Orton entendait donc par « la vérité » ? Sans être un théoricien, on pourrait le qualifier de matérialiste. Son œuvre dramatique ne présente aucun système matérialiste, mais témoigne de ce que Machiavel appellerait sa « vérité effective ». D’ailleurs, si Orton partageait une affinité élective avec des philosophes, ce seraient Machiavel et Deleuze. Comme Machiavel, il refuse de voir dans les relations sociales autre chose que les structures de pouvoir qui les constituent et n’accepte pas plus qu’une telle démystification puisse prendre une tournure moralisatrice.
L’une des conséquences de ce double refus, c’est un humour espiègle qui annonce des faits cruels (« les hommes oublient plus vite le meurtre d’un père que la perte d’un patrimoine ») avec une insouciante franchise, choquante aux yeux des moralistes qui préféreraient ne pas parler de telles choses, ainsi qu’aux yeux des tyrans que flatte ironiquement Machiavel. Le rire qu’Orton provoque est à la fois le moyen et le résultat de la critique matérialiste qui le fonde. Sa rigueur est immédiatement rendue manifeste par son succès, plus subtilement encore pour ceux qui en suivent délibérément les mécanismes.
On peut situer le point de départ d’Orton sous les auspices du rire machiavélien : il l’emploie pour créer la texture linguistique qui soutient une structure dramatique dont la matière est plus riche et variée que celle du Florentin. Les thèmes ortoniens qui manquent chez Machiavel ont une consonance deleuzienne, mais Orton les traite avec une gestuelle comique tout à fait machiavélienne : la force anarchique et finalement impersonnelle du désir sexuel ; la critique de l’identité du moi accompagnée par un défi lancé aux définitions cliniques et aux perceptions sociales de la folie ; l’abandon des vestiges de l’intériorité aristocratique encore présents chez Machiavel à la faveur d’une affirmation de l’objectivité et de l’extériorité absolues (« tout ce qui vaut la peine d’être fait, vaut la peine d’être fait en public »[6]). Orton condense la violence et la folie implicites du quotidien en une série de séquences tendues, tout en exigeant qu’elles soient mises en scène sans ironie ni distance. Il défie avec une vive impatience l’instinct qui ne permet l’absurde qu’à condition qu’on le traite comme fantaisie ou jeu : « Clairement, Loot n’est pas écrit de manière naturaliste, et cependant on doit le mettre en scène et le jouer avec un réalisme absolu. Pas de “stylisation”, pas de “kitsch”, pas de tentative de rivaliser avec l’extravagance de l’auteur dans le dialogue, par une extravagance dans la mise en scène[7]. »
suite.
Orton s’oppose nettement à une tendance de ses contemporains qui consiste à employer les victoires chèrement payées du naturalisme comme un prétexte pour proposer un réalisme psychologique trivial, comme si la représentation banale offrait un accès direct sur le réel. Il y a presque pour Orton une contradiction dans les termes du « réalisme psychologique », puisque la matérialité du monde ne peut être comprise dans une perspective exclusivement psychologique, rationalisante.
La méthode qui s’ensuit chez Orton donne à son œuvre une vitalité indestructible, à distance égale du quotidien et du fantasque. Son objectivité amorale et macabre rappelle certains grands moments du théâtre élisabéthain, principalement sa rencontre avec la pensée machiavélienne, telle qu’on peut la voir chez des auteurs comme Marlowe. On peut dire qu’Orton lui-même retrouve une inspiration machiavélienne, ramenant ainsi au théâtre anglais une intensité qu’il avait perdue jusque-là. En fait, sa réappropriation de l’objectivité le rend plus fidèle à l’esprit de Machiavel que ne l’étaient ses prédécesseurs élisabéthains, dont les plus grandes réussites étaient le plus souvent des tragédies. Leo Strauss a remarqué que « s’il est vrai que toute culture qui se respecte pose nécessairement quelque chose dont il est absolument interdit de rire, on peut dire que la volonté de transgresser sanza alcuno rispetto cet interdit fait intimement partie ici de l’intention de Machiavel[10]. » Cette « volonté » est essentielle à l’intention d’Orton : la production d’un rire véritablement univoque, qui ne remplit pas une fonction subalterne ou partielle dans son projet esthétique, mais lui sert au contraire de moteur et de telos. Comme chez Machiavel, la visée comique n’a chez Orton rien de trivial ; la capacité de rire de tout suppose à la fois une distance à l’égard des forces oppressives qui exigent d’être prises au sérieux, et une liberté face à la tristesse qu’elles espèrent nous communiquer.
L’intention polémique d’Orton fait que le tempo ne ralentit jamais : alors même que le mélange subtil de suspens et de chaos nous entraîne vers une culmination violente, notre première réaction sera toujours de rire. Orton parvient à maintenir cette constance grâce à sa maîtrise de tous les ressorts du comique ; bien que l’équilibre de chaque pièce repose sur une construction de moments à significations variées, le style ou la technique doivent demeurer impitoyablement identiques. À cette fin, l’auteur doit faire preuve d’une habileté digne des meilleurs écrivains comiques, celle de commettre des plaisanteries abracadabrantes mais drôles, qui font entendre la note dissonante recherchée : « Si tu cherches le Prince de la Paix, il te trouvera, et tu récolteras un coup de cran d’arrêt dans le dos »[12]. Ou encore : « Les négrillons en peluche (golliwogs), elle les fait blancs ; elle les vend dans les coins où la question raciale est un peu sensible »[13]. Et enfin :
Orton emploie ce talent pour éviter la moindre superfluité médiocre, afin que toute remarque passagère, tout échange insignifiant se transforme en un non-sens qui vient accroître notre malaise. « Vous êtes libre de répondre quand on sonne à votre porte, mademoiselle. C’est à cela qu’on sait si on habite dans un pays libre ou non. »[15] Ses dialogues ne sont jamais « ordinaires », même à des fins de suspens ou pour souligner l’univers du quotidien (comme chez Pinter), car pour Orton le quotidien est implicitement fou, et il vise à rendre cette folie explicite à tout moment. L’intégrité qui en résulte distingue Orton d’une grande partie du théâtre du vingtième siècle, et le classe parmi les meilleurs élisabéthains. Orton efface toute trace de fabrication en faisant apparaître un naturel qui camoufle la subtilité même qui le sous-tend. De plus, disposant de ce talent, il est également capable de le durcir, de le condenser, afin de traiter de ses préoccupations les plus sérieuses.
La complicité avec l’oppression, latente dans cette platitude conservatrice (« sous n’importe quel autre système politique… »), se révèle brutalement, en même temps que le cliché lui-même se trouve violemment ridiculisé par le contexte dans lequel il est présenté.
Plutôt que de dénoncer toute monarchie comme relevant de la tyrannie (ce qui en maintiendrait, en un sens, la légitimité), Machiavel abandonne en silence le raffinement aristotélicien qui distingue ces deux systèmes. Ainsi, il peut continuer de manier un langage plein de tels raffinements — par exemple, la « vírtù » — avec un humour et une efficacité que ses cibles n’aperçoivent pas. De même, Orton remarque que « le rire est une chose sérieuse, et la comédie une arme plus dangereuse que la tragédie. Voilà la raison pour laquelle les tyrans la traitent avec tant de prudence. La matière de la tragédie vaut tout aussi bien pour la comédie »[17].
Le rire d’Orton est matérialiste en ce sens qu’il réduit tout à un même plan d’immanence — l’immanence du comique. Il s’ensuit un mouvement négatif ou critique, ainsi qu’un mouvement positif ou affirmatif, qui tendent à devenir indiscernables dans la légèreté du style d’Orton, tout en retenant la rigueur qui les différencie. Dans la mesure où on exige des séparations telles que homosexuel-hétérosexuel ou frère-sœur, le rire d’Orton tend à les niveler ; mais si on tend à en ignorer la signification, alors Orton affirme joyeusement les différences, ne serait-ce que pour le chaos qu’elles engendrent.
Orton a écrit que sa première pièce à succès, Entertaining Mr. Sloane, visait à « abattre les cloisons qui séparent chez les gens leurs différents compartiments sexuels »[19]. La pièce est centrée sur Sloane, un vagabond bisexuel, violent, qui convainc Ed et Kath, un frère et une sœur d’âge indéterminé mais proches de la quarantaine, de dissimuler qu’il a tué leur père, à la condition qu’il se partage sexuellement entre eux. À la fin de la pièce, il semble plus que probable qu’Ed et Kath soient l’oncle et la mère de Sloane, l’homme qu’il a tué étant alors son grand-père. Quoique ce méli-mélo d’inceste et de meurtre, qui évoque des intrigues de Middleton ou de Webster, soit « objectivement » tragique, c’est précisément l’objectivité froide et détachée de la pièce qui permet qu’on rie aux scènes les plus pénibles. La sexualité domine tout, mais sous une forme insensible et impersonnelle, forçant Ed et Kath à briser sans hésitation des barrières morales et familiales, alors que Sloane l’utilise comme un moyen de survie. Tout au long de la pièce, les personnages déguisent leur faim et leur cynisme sous les clichés de la bienséance.
Les premières lignes de Loot récapitulent de manière concise le message omniprésent des pièces d’Orton : « Réveille-toi ! Cesse de rêver[20 ! » Comme l’œuvre de Machiavel, Loot est une critique amorale des « républiques imaginées ». Orton cherche moins à montrer qu’elles ne peuvent pas se construire, qu’à détruire la « république imaginée » de l’auto-fiction idéologique produite par l’État moderne, soi-disant démocratique. À la veille des obsèques de sa mère, Hal dévalise une banque avec son amant Dennis, enlève le corps de sa mère et cache l’argent dans le cercueil. Durant le cours de l’histoire, Fay, la fiancée meurtrière de Dennis, McLeavy, le père crédule de Hal, et Truscott, l’inspecteur de police brutal — tous découvrent le crime. L’intrigue se développe comme une satire du projet des Lumières visant à réinstaurer la société comme utopie au moyen de l’intérêt personnel bien compris et « éclairé ». Au départ, McLeavy est le seul personnage qui adhère à l’idée d’une bonne volonté de la société : « J’aimerais qu’on donne à la police plus de pouvoirs. C’est une bien belle équipe[21]. » Le fait qu’il refuse de changer d’avis entraîne rapidement, non seulement la découverte du vol par Truscott, mais aussi un arrangement par lequel Hal, Dennis et Fay (les criminels) et Truscott (l’inspecteur de police) montent un coup contre le servile McLeavy et se partagent l’argent en quatre.
La critique politique d’Orton a un côté acéré qui la rend plus spinoziste qu’humaniste. Loot évoque, par son style comique et détaché, la fameuse redéfinition spinoziste du droit naturel, qui l’annule de fait : « Les poissons sont déterminés par la Nature à nager, les grands poissons à manger les petits ; par suite les poissons jouissent de l’eau, et les grands mangent les petits, en vertu d’un droit naturel souverain[22]. » Les criminels sont unis avec l’inspecteur de police par la claire perception qu’ils ont du pouvoir. Ils embrassent le langage moral dont se sert McLeavy, mais parce qu’ils reconnaissent qu’il est dépourvu de sens, ils le tournent à leur avantage, ou encore prennent du plaisir à son exécution.
Au final, le moralisme aveugle de McLeavy s’avère plus dégoûtant aux yeux de son fils que la brutalité de Truscott. Il organise avec plaisir la mort de son père incarcéré, tout en concevant une certaine admiration pour son ennemi (tout comme le républicain Machiavel pouvait admirer Hannibal ou César Borgia) : « C’est un brave homme. Effacé, à sa façon[24]. »
Sloane et Loot présentent des vues conséquentes de la société, soulignant les thèmes de la sexualité et de l’idéologie. À première vue, il semble que la dernière pièce d’Orton, What the Butler Saw, mette en valeur quant à elle le thème de la folie dans le même horizon. Il serait plus juste de dire cependant que la folie est l’horizon implicite de l’œuvre d’Orton dans son ensemble. « Les gens d’aujourd’hui sont si déséquilibrés », dit Fay, dix-sept fois meurtrière : « Cet homme-là, à côté de vous dans l’autobus, pourrait être fou[25]. » Orton voulait démontrer que les barrières familiales, idéologiques et en fin de compte rationnelles, que l’homme érige pour canaliser et contrôler l’énergie immanente de la vie elle-même, sont tôt ou tard condamnées à se rompre comme des digues. Si la folie est généralement considérée comme l’ignorance de ces barrières, alors, dans la perspective d’un matérialisme radical, la vraie folie serait la tentative de les maintenir. Comme l’a souvent dit Deleuze, ce n’est pas le sommeil de la raison qui produit des monstres, mais l’hystérie même de la raison[26]. En recherchant un moyen dramatique d’exprimer cet aperçu, Orton s’est tourné vers le genre assez marginal de la farce théâtrale — quasiment la comédie de boulevard. Il faut bien admettre que la farce se réduit souvent à des effets théâtraux et au pantomime, mais Orton y voyait, dans son principe même, l’espoir paranoïaque de la panique de se prendre pour la raison, ou pour le dire autrement, le potentiel d’une méthode qui exhiberait la raison comme elle-même une forme de la panique. Par conséquent, Orton emploie le genre de la farce pour développer une technique voisine de ce que Deleuze appelait, à peu près au même moment (1966-67), « la méthode de dramatisation »[27]. Orton et Deleuze visent tous deux à afficher « le mouvement par lequel la pensée logique se dissout en pures déterminations spatio-temporelles, comme dans l’endormissement »[28], et ainsi à montrer comment le logos dérive du drame, qui à son tour s’identifie à la vie même.
Butler, dont le récit se situe dans un asile psychiatrique, commence comme une farce conventionnelle, par le malentendu produit par une tentative de séduction ratée. Mais les événements s’enchaînent rapidement jusqu’au point où les personnages, soûls, drogués et ensanglantés, déclarent chacun la folie de l’autre sous la menace d’une arme, et réussissent à se convaincre les uns les autres qu’ils appartiennent en fait au sexe opposé : « Il n’y a que deux sexes. Ta tentative de fusion ne peut conduire qu’à des cœurs brisés[29]. » De même que le rire est l’affect le plus manifestement physique et mental à la fois, l’anarchie sur scène doit pareillement correspondre à un dialogue rigoureusement chaotique. Le problème typique du satiriste, c’est : comment adopter la langue de sa cible afin de la faire imploser ? La satire la plus efficace tire sa force de sa proximité extrême envers son objet, tout en maintenant une distance immaculée. Orton pousse ce procédé à l’extrême, produisant certes une satire magnifiquement réussie, mais, surtout, une critique qui se transforme en célébration du potentiel comique du grotesque de ses victimes. Si Butler est l’apothéose de l’art d’Orton, c’est parce que l’élément destructeur est pleinement assimilé dans l’affirmation, le rire, lequel est aussi bien le moyen que le résultat de cette destruction. Cela est rendu possible parce que, comme l’a dit Machiavel de Laurent de Medici, Orton allie la pesanteur et la légèreté dans une « combinaison quasi impossible ». Il manie le rire comme une arme, mais ses pièces ressemblent moins aux coups de marteau qui l’ont tué qu’à des grenades qui ne cessent d’exploser.
Traduit de l’anglais par Brian Marrin et Karl Blau
Notes
[ 1] Joe Orton, The Complete Plays, Grove Weidenfeld, 1976, p. 15.
[ 2] Ibid. p. 388.
[ 3] Ibid. p. 393.
[ 4] Joe Orton, The Orton Diaries, Harper & Rowe, 1986, p. 46.
[ 5] Joe Orton, The Complete Plays, Grove Weidenfeld, 1976, p. 340.
[ 6] Joe Orton, Head to Toe & Up Against It, Da Capo, 1988, p. 232.
[ 7] Joe Orton, The Complete Plays, Grove Weidenfeld, 1976, p.20.
[ 8] Ibid. p. 217.
[ 9] Ibid. p. 443.
[ 10] Leo Strauss, Pensées sur Machiavel, trad. Michel-Pierre Edmond et Thomas Stern, Payot, 1982, p. 68. (Strauss renvoie à la fin de ce passage au Gai savoir de Nietzsche, aphorisme I. NdR.)
[ 11] Joe Orton, The Complete Plays, Grove Weidenfeld, 1976, p. 167.
[ 12] Ibid. p. 359.
[ 13] Ibid. p. 387.
[ 14] Ibid. p. 250. (L’anglais joue sur le génitif objectif et subjectif : « limbless girl killer » peut vouloir dire « le tueur des filles cul-de-jatte » mais aussi « la fille cul-de-jatte assassin ». NdR.)
[ 15] Ibid. p. 235.
[ 16] Ibid. p. 235.
[ 17] Ibid. p. 7.
[ 18] Ibid. p. 413.
[ 19] Ibid. p. 18.
[ 20] Ibid. p. 195.
[ 21] Ibid. p. 206.
[ 22] Spinoza, Traité théologico-politique, chap. XVI, GF-Flammarion, 1965, p. 261.
[ 23] Joe Orton, The Complete Plays, Grove Weidenfeld, 1976, p. 256.
[ 24] Ibid. p. 275.
[ 25] Ibid. p. 201.
[ 26] Voir par exemple le cours de Deleuze à Vincennes du 13 décembre 1983. NdR.
[ 27] G. Deleuze, « La méthode de dramatisation », Bulletin de la Société française de philosophie vol. 61, no 3 (1967), repris dans L’Île déserte et autres textes, éd. D. Lapoujade, Minuit, 2002.
[ 28] Deleuze, « La méthode de dramatisation », in L’Île déserte et autres textes, p. 151.
[ 29] Joe Orton, The Complete Plays, New York, Grove Weidenfeld, 1976, p. 415.