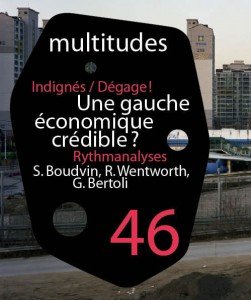Le texte complet n’est pas encore disponible en ligne. Vous pouvez le consulter sur le site de Cairn à l’adresse suivante : [http://www.cairn.info/revue-multitudes-2011-3.htm->http://www.cairn.info/revue-multitudes-2011-3.htm.Un enjeu politique central est susceptible de mobiliser les esprits à gauche dans la perspective des échéances électorales de 2012, désormais imminentes : la crédibilité économique, c’est-à-dire la capacité revendiquée de gouverner l’économie française dans une Europe et un monde durablement marqués par la crise globale et la dégradation des finances publiques qui en a résulté. À cette thématique de la crédibilité s’ajoute d’ailleurs la question mitoyenne de la confiance politique, c’est-à-dire la capacité de rassurer la Nation sur l’impartialité et l’équité de l’action publique après des années traumatiques au cours desquelles les autorités de l’État ont sciemment aggravé les inégalités et les clivages parmi les citoyens. Mais l’impératif de crédibilité économique, qui hante la gauche de gouvernement depuis l’ère mitterrandienne au moins, doit être profondément revisité à l’aune de la crise européenne et plus encore des crises écologiques qui s’accélèrent.
La gauche, et singulièrement le Parti socialiste, se trouve en effet tiraillée depuis les années 1980 entre sa fidélité à une identité philosophique et historique de justice et de solidarité et sa volonté de démontrer qu’elle est, tout autant que la droite, capable de maîtriser les grands équilibres économiques dans un monde ouvert, complexe et incertain. Etre de gauche et prétendre au pouvoir, ce serait devoir faire la preuve que l’on sait résister à la pente naturelle de son camp : s’abstraire des contraintes économiques pour affirmer « l’optimisme de la volonté ». Le mitterrandisme, sa relance manquée de 1981 et son « tournant de la rigueur » de 1983, a bien légué un commandement économique premier : ne pas trop promettre pour ne pas trop décevoir. C’est encore plus vrai quand les marges de manœuvre budgétaires ont été rongées par l’impéritie fiscale et la plus grave récession depuis la crise des années 1930. Mais l’obsession suicidaire de la crédibilité financière à l’œuvre dans l’Union européenne et la zone euro depuis le déclenchement de la « grande récession » à l’été 2008 appelle la gauche française à un sursaut de lucidité sur ce qu’être économiquement crédible veut vraiment dire. L’urgence des crises écologiques lui commande en outre d’articuler question sociale et question environnementale pour engager l’économie française dans la transition écologique avec les citoyens – et non pas malgré eux – et inventer par là, au-delà de la crédibilité économique, une crédibilité social-écologique.
Comment la gauche de gouvernement doit-elle aujourd’hui comprendre son devoir de crédibilité économique ? Comment surtout ne pas se tromper sur son sens ?
Sortir de la crédibilité exterminatrice
L’état des finances publiques françaises est mauvais, c’est une évidence qu’il vaut mieux admettre comme préalable. Il n’est pas catastrophique. Il est surtout de second ordre : le déficit et la dette publics ne sont que des moyens, des objectifs intermédiaires de la politique économique, dont les finalités sont l’emploi, le pouvoir d’achat, la cohésion sociale (mesurée par exemple par le niveau des inégalités) et plus généralement le bien-être des citoyens (revenu, santé, éducation) étroitement lié à la soutenabilité environnementale.
Il y a pourtant fort à parier qu’une partie de la gauche et du centre ne concentre ses forces sur un procès en incompétence budgétaire du gouvernement Sarkozy-Fillon et ne se range de ce fait sous la bannière de ce que l’on pourrait nommer la crédibilité exterminatrice à l’œuvre dans l’Union européenne.
Partout en Europe, dans l’après-coup de la « grande récession » qui fut, malgré les dénégations outragées, plus violente de ce côté-ci de l’Atlantique, les gouvernements s’emploient à mettre en place des politiques de crédibilité financière qu’ils pensent efficaces et qui se révèlent contre-productives : entaillant la fragile reprise de l’activité économique, instituées simultanément par des partenaires commerciaux d’une zone économiquement intégrée, elles reviennent à une dépression économique coordonnée qui n’est parée que d’une crédibilité factice. Les situations budgétaires du Royaume-Uni et de la Grèce, qui ont opté respectivement librement et sous la contrainte pour une thérapie de choc budgétaire, nous le montrent bien : une politique budgétaire brutalement restrictive appliquée sur une économie anémique déprime la croissance et l’emploi et conduit à creuser encore plus les déficits et la dette. Si la crédibilité budgétaire affichée sous la menace des agences de notation se révèle une illusion comptable, c’est en revanche une catastrophe sociale bien réelle. La France elle-même a cédé à cette pente de la crédibilité exterminatrice : la réforme des retraites décidée dans la précipitation en juillet 2010 sous le chantage d’une dégradation de la notation financière nationale a brouillé l’horizon social des salariés et réduit leur niveau de vie sans résoudre la question de la soutenabilité de notre système par répartition.
La crédibilité n’est pas le contraire de la démocratie
Pour se dégager au plus vite de ce piège de la crédibilité, il importe de comprendre ses ressorts. On en trouve le détail dans les travaux de la nouvelle macroéconomie classique, en particulier dans l’article fondateur de Kydland et Prescott publié en 1977. Le message de ces auteurs, qui a servi de socle pour mettre sur pied les banques centrales modernes, est assez simple : plus on s’éloigne du pouvoir politique inspiré par la décision démocratique, plus on est crédible. La notion d’incohérence temporelle des politiques publiques veut que des autorités publiques usant de politiques discrétionnaires, mêmes optimales, soient incapables d’atteindre les objectifs qu’elles se fixent dès lors que les conséquences de leurs engagements sont parfaitement intégrées dans les anticipations d’agents décrits comme rationnels.
La théorie économique a ainsi joué un rôle décisif dans l’émergence de la crédibilité exterminatrice à l’œuvre aujourd’hui en Europe. Ce schéma d’analyse promeut l’institution de règles économiques, prétendument neutres, pour encadrer la puissance publique, règles mises en œuvre par des agences indépendantes de la décision démocratique dans le but de retirer des mains des responsables élus, trop absorbés par leur intérêt propre, les moyens de nuire au bien commun.
Les statuts de la Banque centrale européenne, qui est aujourd’hui l’institution économique la plus indépendante au monde, procèdent entièrement de cette conception des politiques publiques. C’est exactement cette ligne d’analyse qui conduit à confier à des agences de notation qui ont pourtant administré au monde la preuve de leur incompétence lors de la crise des subprime, le destin des sociétés européennes. C’est également ce qui justifie le projet caressé par certains économistes de créer des institutions budgétaires indépendantes pour régler le problème actuel des finances publiques, c’est-à-dire dans les faits d’opérer une véritable contre-révolution démocratique puisque les gouvernements représentatifs modernes sont nés avec le pouvoir budgétaire conquis par les Parlements.
La soumission aux marchés ne rend pas crédible
Cette conception de la crédibilité est socialement toxique, cela ne fait aucun doute. Elle est surtout d’une confondante naïveté. Car les sociétés européennes sont entrées dans une crise politique où la neutralisation du processus démocratique est un handicap insurmontable pour la crédibilité des politiques économiques et sociales.
Ce handicap vaut autant dans la relation aux marchés que dans le rapport aux citoyens. Aux yeux des acteurs des marchés financiers, le spectacle de l’impuissance et de la soumission des autorités publiques aiguise les appétits au lieu de les modérer : plus les États se conforment aux desiderata des marchés, plus ceux-ci augmentent leurs exigences. La crédibilité que les États croient accumuler en donnant des gages aux agences de notation se révèle donc un processus autophage. Qui plus est, l’effet de solidarité commerciale et financière est tel en Europe que lorsqu’un État a cédé, les autres qui l’ont sacrifié en croyant renforcer leur propre crédibilité se retrouvent à leur tour attaqués, faute d’avoir compris que la crédibilité européenne est collective ou n’est pas.
Le deuxième aspect de cette crise politique concerne le rapport aux citoyens. Que se passe-t-il dans l’économie et la société lorsque la puissance publique ne cède ni aux « sirènes du populisme », ni au désir d’améliorer le bien-être des citoyens, mais aux dogmes économiques ambiants et qu’elle ne met plus en scène sa puissance arbitraire mais son impuissance résignée ? Quand, par exemple, elle laisse entendre qu’elle n’assurera plus que partiellement le paiement des retraites, la protection contre la maladie, et plus généralement la justice sociale pour complaire aux exigences de ses créanciers ?
Si les individus prennent la puissance publique au sérieux, ils vont se prémunir, quand ils le peuvent, au plan privé contre un recul de la solidarité en privatisant eux-mêmes tout ou partie de leur protection sociale et des services publics dont ils ont besoin. Le degré d’inégalité sociale s’accroîtra et le périmètre de la puissance publique se rétrécira. L’État joue contre l’État. À l’inverse, si les individus refusent de se résigner à ce désengagement public, la défiance à l’égard des autorités publiques se muera en résistance farouche, qui rendra impossible toute réforme.
La politique économique crédible aujourd’hui en Europe et en France n’est pas celle qui pourra infliger le maximum de souffrances sociales en un minimum de temps pour plaire aux agences de notation. La crédibilité ne vient précisément pas en démocratie d’institutions régulatrices supposées justes parce qu’« aveugles ». La politique économique tire sa crédibilité du cadre démocratique, plus encore en période de crise.
La véritable crédibilité économique n’est pas celle des objectifs intermédiaires (déficit, dette, inflation) mais celle des objectifs finaux (emploi, développement, soutenabilité). C’est la crédibilité d’un programme qui raisonne en termes de biens publics et pas d’instruments économiques. Il faut donc, en Europe, abandonner le fétichisme des objectifs intermédiaires. C’est le premier devoir de la gauche française que de mener ce combat.
Au-delà de cette crédibilité économique revisitée, l’élément nouveau de cette élection sera la crédibilité écologique. Tout programme qui ferait semblant d’ignorer la contrainte écologique ne sera pas crédible non seulement aux yeux des citoyens mais aussi des gouvernements du monde. Car le débat écologique devient permanent et nul ne peut plus faire semblant de l’ignorer.
La crédibilité social-écologique[1]
Les grands sujets écologiques sont au cœur du débat global : dans tous les sommets internationaux désormais, la dimension écologique est présente et la gauche ne sera pas crédible au plan global si elle n’a pas de position déterminée et informée sur ces enjeux. Car la mondialisation est aujourd’hui autant écologique qu’économique. En Europe, si la gauche veut gouverner avec ses partenaires elle trouvera au Royaume-Uni comme en Allemagne deux leaders qui connaissent à fond toutes les grandes questions écologiques et qui incarnent la relève social-écologique de la social-démocratie : Ed Miliband pour le Labour, Sigmar Gabriel pour le SPD.
Mais il s’agit d’articuler le débat écologique européen et global avec la conversation nationale. Il manque à cet égard à la gauche française deux piliers dans son programme de gouvernement : un plan stratégique de développement de l’économie verte et la priorité donnée, au-delà des mots, à la préoccupation social-écologique axée sur la lutte contre la précarité énergétique et les inégalités environnementales.
Développer l’économie verte, c’est d’abord développer les éco-industries et protéger les ressources naturelles dont dépendent des millions d’emplois. Cela suppose à la fois de développer de nouveaux secteurs de production de biens et services environnementaux (par exemple les énergies renouvelables), mais aussi de « verdir » les secteurs existants à mesure que s’imposent les nouveaux impératifs écologiques (lutte contre le changement climatique, préservation des écosystèmes et de la biodiversité).
C’est ici qu’une deuxième dynamique se fait jour en matière « d’économie verte ». Le verdissement de l’économie suppose en effet trois impératifs : il faut « dé-carboniser » l’économie en réduisant l’usage du carbone contenu dans les énergies fossiles dans les processus de production, la des-énergiser en accroissant les économies d’énergie et l’efficacité énergétique (deux processus qui détiennent, selon l’Agence internationale de l’énergie, la clé de 54 % de la réduction des émissions de gaz à effet de serre nécessaire d’ici à 2050) et la dé-naturaliser, en augmentant la productivité dans l’usage de toutes les ressources naturelles et en limitant au minimum notre prélèvement sur elles.
Dans cette transition écologique, l’économie circulaire (qui limite au maximum l’usage de ressources non recyclables et l’énergie) et l’économie de fonctionnalité (qui transforme des biens en services pour en limiter la production) doivent monter en puissance. Cet indispensable « découplage » absolu entre croissance économique et pollutions est possible, comme l’atteste l’exemple du Danemark, qui a réduit de près de 10 % ses émissions de CO2 tout en multipliant son revenu par habitant par un facteur 8 de 1971 à 2007, ou celui de l’Union européenne, qui a réduit significativement ses polluants atmosphériques et ses émissions de dioxyde de souffre tout en accroissant son revenu par habitant par un facteur 1,75 de 1995 à 2008.
Changer la manière de mesurer la richesse
Mais « l’économie verte » ne se limite toujours pas à ce deuxième aspect : il s’agit, fondamentalement, de changer de mode de développement et rien n’est plus puissant dans cette perspective que l’altération de nos systèmes de mesure de la valeur sociale. L’économie, science de la mesure du bien-être humain et pas seulement de la gestion de la rareté, a un rôle capital à jouer ici. C’est bien le message implicite du Programme des Nations Unies pour l’Environnement lorsqu’il définit l’économie verte comme « une économie dans laquelle les liens vitaux entre l’économie, la société et l’environnement sont pris en considération et dans laquelle la transformation des processus de production et des structures de consommation et de production, tout en contribuant à réduire la quantité par unité produite de déchets, de pollution et d’usage des ressources, matériaux, énergie revitalisera et diversifiera l’économie, en créant de nouvelles opportunité d’emplois décents[2], promouvant le commerce soutenable, réduisant la pauvreté, améliorant l’équité et la distribution du revenu ».
On le voit bien, trois exigences sont à distinguer en matière d’« économie verte ». La première vise à développer des secteurs de l’économie qui, tout en créant de l’emploi, peuvent limiter l’impact des activités humaines sur l’environnement (climat, écosystèmes, biodiversité)[3]. La deuxième, plus ambitieuse, consiste à changer les modes de production et de consommation. La troisième vise à transformer nos systèmes de mesure de la valeur sociale, c’est-à-dire à redéfinir la notion même de développement en insistant davantage sur sa dimension humaine (soutenabilité environnementale, égalité, santé, éducation : de nombreuses analyses et pistes de réforme sont proposées dans le Rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi publié en 2009).
Dans cette triple perspective, il faudra certes que la puissance publique donne un prix au carbone, favorise le financement de l’innovation et de la recherche à visée écologique et investisse dans la formation pour permettre le développement des métiers de l’écologie. Mais il faudra aussi développer de nouvelles infrastructures pour accueillir les innovations en matière de consommation et de production. Il faudra enfin définir et diffuser de nouveaux indicateurs de pilotage de l’action publique centrés sur le bien-être individuel et social incluant la dimension environnementale.
Il revient à la gauche d’articuler dans son programme ces trois dimensions de l’économie écologique.
Développer écologiquement la justice sociale
Mais comment ne pas voir que cette nouvelle économie écologique souffre d’un problème de crédibilité auprès des citoyens ? Ce n’est pas d’abord en raison de son soi-disant manque d’efficacité économique, mais parce que les enjeux de justice sociale qu’elle contient ne sont pas assez explicités.
Il nous faut, chercheurs et décideurs, au cours des campagnes à venir, politiser et incarner les enjeux écologiques : tant que les questions écologiques ne seront pas systématiquement éclairées sous le jour de la justice et dans leur rapport aux réalités sociales, et notamment aux inégalités, elles demeureront de l’ordre de la politique étrangère pour la majorité des citoyens.
Or le lien entre justice sociale et écologie a un sens précis : les inégalités sociales sont parmi les causes les plus importantes des problèmes environnementaux actuels, tandis que les crises écologiques contemporaines, qui s’entremêlent de plus en plus, affectent et affecteront le plus durement les plus démunis, dans les pays pauvres comme dans les pays riches.
Deux ambitions social-écologiques majeures doivent mobiliser la gauche : combattre la précarité énergétique et réduire les inégalités environnementales.
L’effet extrême des inégalités énergétiques à l’œuvre est désormais connu sous le nom de « précarité énergétique », véritable bombe sociale à retardement en France et dans nombre de pays de l’Union européenne, dès lors qu’elle dépend de la combinaison de trois facteurs qui s’aggravent dans la période actuelle : la faiblesse du revenu, de mauvaises conditions de logement et des prix élevés de l’énergie. Un adulte passant en moyenne 12 heures dans son logement, le lien entre précarité énergétique, morbidité et mortalité est clair (et bien établi empiriquement, notamment par des études britanniques), ce qui explique que l’Organisation mondiale de la santé se soit intéressée précocement à ce sujet.
Au Royaume-Uni, un ménage est considéré comme en situation de « pauvreté énergétique » (fuel poverty) s’il dépense plus de 10 % de son revenu pour maintenir la pièce à vivre à 21 degrés et les autres pièces de son logement à 18 degrés (on inclut également le coût en énergie du chauffage de l’eau et de l’éclairage). Il y aurait en 2008, selon ce mode de calcul, 4,5 millions de ménages pauvres en énergie au Royaume-Uni (16 %). En France, le groupe d’experts précité a estimé à 13 % le nombre de ménages dans cette situation, soit environ 3,4 millions de ménages, soit encore près de 8 millions de personnes. À l’échelle de l’Union européenne, ce sont 21 % des ménages qui seraient dans l’incapacité de chauffer de manière adéquate leur logement.
Même si ce nouveau front de l’inégalité sociale a fait l’objet en France d’une reconnaissance par les pouvoirs publics (dix ans après le Royaume-Uni) avec l’installation ces dernières semaines d’un Observatoire de la précarité énergétique, les politiques publiques ne sont en l’état ni commensurées à l’ampleur du problème, ni même coordonnées. Les aides financières (au titre des aides à l’énergie du Fonds de solidarité logement) ne concerneraient en 2008 que 306 000 familles. La rénovation thermique des logements mise en chantier par le Grenelle est loin du compte (le fonds national d’aide à la rénovation thermique des logements privés géré par l’Agence nationale de l’habitat vise 300 000 logements de propriétaires occupants modestes et très modestes d’ici à 2017 et « l’éco-prêt logement social », dont l’objet est la rénovation thermique du parc de logements sociaux les plus consommateurs en énergie, concernent 800 000 « logements énergivores »). Enfin, les tarifs sociaux de l’énergie sont mal connus des bénéficiaires potentiels (en 2009, 940 000 foyers ont bénéficié de ces tarifs pour l’électricité alors que 2 millions sont éligibles et 298 000 en ont bénéficié pour le gaz alors qu’un million sont éligibles). Beaucoup reste donc à faire pour lutter contre ce fléau social-écologique dont on commence seulement à prendre la mesure.
Avoir pour priorité l’équité environnementale
Enfin, les inégalités environnementales doivent devenir un sujet de préoccupation central pour les pouvoirs publics. L’idée fondamentale qui sous-tend l’exigence de justice environnementale se formule simplement : des politiques publiques visant l’équité qui ne prendraient pas en compte la dimension environnementale manqueraient un aspect essentiel de la question sociale. Il est impossible de faire l’impasse sur l’environnement dans lequel vivent les individus dès lors que celui-ci détermine en partie leur santé et plus largement leur bien-être. La perspective des inégalités environnementales permet de saisir cet enchaînement essentiel. On peut en distinguer quatre types :
– Les inégalités d’exposition et d’accès : cette catégorie désigne l’inégale répartition de la qualité de l’environnement entre les individus et les groupes. Définition négative (l’exposition à des impacts environnementaux néfastes) ou positive (l’accès à des aménités environnementales telles que les espaces verts et les paysages). Dans cette catégorie d’inégalités sont inclus la vulnérabilité aux catastrophes social-écologiques et le risque d’effet cumulatif des inégalités sociales et environnementales – les inégalités environnementales n’étant ni indépendantes les unes des autres ni indépendantes des inégalités sociales (revenu, statut social, etc.) ;
– Les inégalités distributives des politiques environnementales : il s’agit de l’inégal effet des politiques environnementales selon la catégorie sociale, notamment l’inégale répartition des effets des politiques fiscales ou réglementaires entre les individus et les groupes, selon leur place dans l’échelle des revenus ;
– Les inégalités d’impact environnemental : les différentes catégories sociales n’ont pas le même impact sur l’environnement ;
– Les inégalités de participation aux politiques publiques : il s’agit de l’accès inégal à la définition des politiques environnementales qui déterminent les choix touchant à l’environnement des individus.
Le cas des zones urbaines sensibles (ZUS) françaises permet de montrer comment celles-ci rétroagissent sur les conditions sociales. Les travaux de la Direction interministérielle à la ville (DIV) indiquent que les ZUS sont bien plus exposées aux risques environnementaux liés aux activités industrielles que les autres territoires : leurs habitants représentent les deux tiers de la population française totale exposée au risque industriel. Le danger d’un impact cumulatif des inégalités environnementales et sociales est manifeste : la dégradation de la santé des résidents des ZUS du fait de leur plus grande exposition au risque environnemental aggrave encore la précarité de leur condition sociale. Un rapport récent du Haut conseil de la santé publique remarque que les populations défavorisées[4], « parce qu’elles peuvent plus difficilement se soustraire à des conditions défavorables d’exposition […] sont plus souvent exposées aux risques environnementaux, et cumulent fréquemment différentes sources d’expositions et de nuisances : habitation en zone bruyante, à proximité d’installations dangereuses, d’axes routiers importants, logement insalubre, pollution atmosphérique… En outre, les populations défavorisées bénéficient d’un accès moins bon à l’information et aux soins, et sont généralement en capacité moindre d’agir auprès des pouvoirs publics pour améliorer leur environnement ».
Écologiser les politiques sociales
C’est l’ensemble des politiques sociales qui peuvent et devraient prendre en compte la dimension environnementale. Dans le domaine urbain par exemple, médiocrité de la qualité environnementale et précarité de la condition sociale interagissent et doivent donc être traitées de conserve. De même, le développement des transports collectifs permet à la fois de réduire le coût écologique et le coût économique des déplacements. En définitive, il apparaît nécessaire d’encastrer les politiques écologiques dans les politiques sociales au moment même de leur conception, et ce afin de garantir leur caractère écologiquement efficace et socialement neutre, voire progressif, et leur acceptabilité politique. Il convient aussi de parler de « politiques social-écologiques » afin d’éviter d’isoler artificiellement la dimension environnementale des politiques publiques. On pourrait préconiser la création d’une mission interministérielle pour définir au mieux ces politiques d’un nouveau genre. Une des priorités de ce nouvel axe de l’action publique serait de doter la France d’un système performant de repérage des inégalités environnementales. Il s’agirait dans un premier temps de poser les problèmes analytiques inhérents à la mesure des inégalités environnementales et de rassembler de manière cohérente les travaux épars existants par exemple sur le risque d’inondation, l’exposition au bruit, ce que l’on pourrait appeler la « précarité environnementale » ou « pauvreté environnementale » (difficulté d’accès à l’énergie et à l’eau), etc.
Il reviendra à un gouvernement de gauche, d’abord de comprendre cette interface social-écologique (c’est la social-écologie comme grille d’analyse de notre environnement), puis de s’appuyer sur elle pour réduire les inégalités sociales et atténuer les crises environnementales (la social-écologie comme nouvel horizon politique). Il disposera pour ce faire de puissants moyens d’action et peuvent compter sur la réactivité du cadre démocratique. Mais pour souhaitable qu’elle soit, cette nécessaire mutation social-écologique n’est-elle pas vouée à l’échec du fait du jeu d’intérêts des groupes sociaux en présence ?
C’est la crainte exprimée par Jacques Theys[5], qui fait preuve d’un certain pessimisme quant à la possibilité d’articuler politiques écologiques et sociales. Des raisons de fond s’opposent selon lui à l’avènement de la social-écologie dans l’espace public. D’abord, la mythologie d’une humanité solidaire et unie face aux menaces écologiques plaide contre la reconnaissance de l’inégalité sociale face aux défis environnementaux. Ensuite, les mouvements écologistes seraient impulsés par les classes moyennes supérieures et non par les classes populaires, ce qui corrobore l’idée que la demande d’environnement est avant tout l’apanage des plus riches. Enfin, l’incapacité des partis politiques à abandonner les clivages sociaux qui les ont fait naître les empêcherait de repenser à nouveaux frais notre mode de développement. Il y aurait en somme un obstacle culturel, un obstacle sociologique et un obstacle politique qui barreraient le pont entre la rive sociale et la rive environnementale.
On pourrait ajouter à ce sombre tableau deux motifs supplémentaires d’inquiétude : la crise actuelle, qui avive le sentiment d’un choix exclusif entre développement économique et équilibre écologique, et la mondialisation des crises écologiques, qui amoindrit l’importance des politiques nationales et affaiblit la volonté des citoyens et des gouvernants d’être exemplaires quand les autres ne le sont pas.
L’écologie sociale est aujourd’hui urbaine
Un regard en arrière achève de nous convaincre de la difficulté de l’entreprise. La période où les mouvements écologistes ont vu le jour réunit en effet des traits qui paraissent orthogonaux à notre temps. Dans les années 1960 et 1970, c’est au sein de sociétés d’affluence, égalitaires de surcroît et d’économies relativement fermées qu’ont pu s’exprimer les préoccupations environnementales, alors que les considérations matérielles reculaient sous l’effet d’un progrès social généralisé. Quoi de plus contraire à nos société d’inégalités, de repli identitaire, de précarité et de régression sociale prises dans la tourmente d’une crise systémique mondialisée ?
Pour reprendre espoir, c’est plus loin qu’il faut porter le regard, vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, une période qui ressemble davantage à la nôtre. C’est alors que s’est développée avec une force sans précédent la civilisation urbaine et que s’est affirmée avec elle la préoccupation écologique moderne. La sociologue de l’environnement Dorceta Taylor[6], qui a travaillé sur la question du lien entre classes sociales et politique environnementale, montre comment la dynamique des inégalités sociales a engendré le renouveau écologique dans l’univers urbain américain ; comment cette montée a contribué à un renouvellement de l’écologie qui ne se résume pas selon elle à l’attachement des classes aisées américaines pour la nature vierge (la fameuse wilderness) : les différentes classes sociales ont chacune porté leur propre discours écologiste et de nombreux progrès ont pu être réalisés dans les domaines de la santé, des loisirs ou encore de la sécurité au travail.
Autrement dit, la montée des inégalités sociales a fait naître un nouvel environnementalisme inscrit dans l’espace de la ville, l’espace par excellence de la « seconde nature » chère à Cicéron. L’histoire de l’assainissement des eaux dans les villes européennes et américaines entre la fin du XIXe siècle et le premier tiers du XXe siècle illustre bien la manière dont les villes ont d’abord concentré puis réduit les inégalités environnementales[7]. De même, alors que la coopération internationale sur le changement climatique est paralysée, les grandes métropoles mondiales s’engagent résolument et efficacement dans la réduction de leurs émissions et dans un effort d’adaptation qui va durer des décennies. Les villes assument donc aujourd’hui comme hier leur vocation écologique. Or, pour la première fois dans l’histoire, plus de 50 % des humains habitent aujourd’hui dans des villes (cette proportion atteint 80 % dans le monde développé), qui n’occupent que 4 % de la surface de la Terre. C’est donc dans ces espaces hyper-concentrés, dont la densité est un formidable atout[8], que se jouera l’enjeu social-écologique. D’autant que les villes étant en moyenne de 4 degrés plus chaudes que les zones rurales, elles seront plus exposées aux canicules liées au changement climatique, sans parler des risques inhérents à la situation côtière de nombreuses grandes métropoles de la planète, notamment en Asie et en Amérique du Nord. Social-écologie et écologie urbaine vont donc de pair.
On pourra toujours rétorquer que demain (en 2030), 80 % des habitants des villes vivront dans les pays en développement et que c’est dans les villes de ces pays-là que se livrera la bataille la plus décisive pour la soutenabilité environnementale qui sera de ce fait autrement plus ardue à livrer. Mais c’est oublier que certaines métropoles émergentes ont déjà emprunté un sentier soutenable. Ainsi Curitiba, capitale de l’État de Paraná au Brésil, a-t-elle pu absorber une croissance impressionnante de sa population (de 360 000 habitants en 1960 à plus d’1,8 millions d’habitants en 2008) sans souffrir de problèmes excessifs de pollution ou de congestion[9] grâce à une planification de la croissance urbaine selon un modèle « radial-linéaire » développé dès 1966 et affiné en 2004. Celui-ci permet de détourner le trafic automobile du centre-ville, de développer les espaces verts et les zones à forte densité d’habitation, le tout appuyé sur un réseau très dense de transports publics (qui assurent 45 % des déplacements). Ce schéma de croissance maîtrisée permet aux résidents de Curitiba de consommer près de 15 fois moins d’essence par personne que les habitants de Sao Paolo (quatre fois moins que ceux de Rio de Janeiro) et de bénéficier d’une des plus faibles pollutions de l’air du pays. Des solutions viables, en matière de transport et d’habitat, existent également pour les villes chinoises en pleine expansion, mais elles doivent être mises en œuvre suffisamment en amont afin d’éviter de « verrouiller » (effet lock-in) les modes de vie des habitants sur des trajectoires insoutenables[10].
Le débat sur les vices écologiques des espaces urbains actuels ne doit pour autant pas être escamoté : la population urbaine est passée de 1,5 milliards en 1975 à 3,2 milliards aujourd’hui et elle atteindra 6,5 milliards en 2050. Or les villes consomment deux tiers des ressources énergétiques planétaires et produisent 70 % du dioxyde de carbone mondial. La transition vers la ville post-carbone est donc une impérieuse nécessité.
Une crédibilité ancrée dans le débat démocratique
L’économie politique de la social-écologie n’est donc pas d’emblée favorable. Mais pour peu que les forces progressistes au niveau national et local s’en emparent, justice sociale et impératif écologique peuvent être conciliés, dans les pays riches comme dans les pays en quête de développement. Mais comment convaincre les citoyens, qui détiennent, de par leurs comportements, la clé de la transition écologique ? Par l’affirmation de la centralité du principe de justice dans les débats environnementaux et par l’organisation concrète de ces débats à toutes les échelles territoriales, du pied d’immeuble au quartier, à la ville, à la région, à la nation et au delà.
Le projet social-écologique, constitue le cœur de la crédibilité économique et écologique de la gauche pour 2012. À vrai dire, à bien y réfléchir, et même si ce réflexe ne s’est pas encore imposé, la crédibilité écologique est première par rapport à la crédibilité économique : sans elle, un programme de gouvernement n’a pas à proprement parler de crédibilité car il n’a pas d’avenir