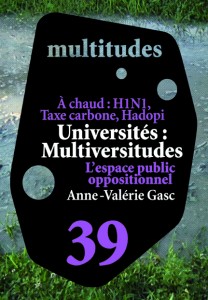Pour une taxation
de tous les flux
financiers et monétaires
Ainsi c’est décidé : la France fera de la taxe carbone. Ne peuvent que s’en réjouir ceux qui, comme moi ou Jérôme Gleizes[1], se sont opposés fortement aux écologistes partisans du marché des droits de polluer (Laurence Tubiana ou Alain Lipietz) en prédisant que ce quasi-marché cumulait tous les inconvénients (qu’il serait inefficace, inégal et surtout insuffisant), bref qu’il faudrait en venir à la taxe publique.
Mais il faudrait être plus précis hélas. La France fera dans la taxe carbone, bien plus qu’elle ne fera de la taxe carbone, c’est-à-dire bien plus qu’elle ne pratiquera sérieusement une taxe carbone. Le débat entre 14 ou 17 € ne change pas grand chose par rapport aux 100 € à atteindre, donc au minimum de 32 €, comme l’a établi la Commission Rocard. On apprivoise timidement un principe sans s’y soumettre vraiment. Pourtant chacun sait qu’une incitation forte à lutter contre l’effet de serre devra être mise en place.
Le nœud gordien fiscal
Pourquoi tant de résistance à une taxe solide ? Parce que c’est une taxe qui vient s’ajouter à la TIPP (taxe intérieur sur les produits pétroliers), à la TVA payée par tout consommateur final (plus de 50 des recettes fiscales de l’État), à l’impôt sur le revenu (un petit 17 %) payé par la moitié des contribuables (les autres étant exemptés) et au 18 % d’impôt sur les sociétés dont la taxe professionnelle[2]. Et parce que les charges sur le travail salarié sont lourdes : en 40 ans, la charge fiscale (prélèvements obligatoires), au delà des présentations démagogiques des diverses corporations de la société, atteint un niveau dangereux dans les diverses classes sociales pour des raisons parfois diamétralement opposées et difficilement compossibles.
Ceux qui ne payent pas l’impôt sur le revenu (il faut dire qu’ils auraient bien du mal à le faire) trouvent insupportable 19,6 % de TVA. Ceux qui payent un impôt sur le revenu exactement conforme à leur gains – les salariés purs – trouvent l’addition d’autant plus lourde qu’ils côtoient des non-salariés des vieilles professions libérales (ou des salariés qui ont la possibilité de faire passer leurs frais dans diverses sociétés) qui, eux, s’en tirent bien mieux. Observant les gains faramineux des 1 % des plus riches, ils rêvent d’une imposition rooseveltienne de 75 à 90 % des revenus des plus hautes tranches et vilipendent le « bouclier fiscal ». Les classes moyennes supérieures et moyennes-moyennes approuvent toutes les baisses d’impôts. Les nouvelles professions non-salariées et instables (les précaires de tout poil), qui oscillent entre des gains faramineux irréguliers pour quelques-uns et des gains plutôt faibles pour la plupart, quand ils ne peuvent pas compter sur le filet de rattrapage d’un régime intermittent rogné méthodiquement, souhaitent une remise à plat des avantages fiscaux des stables et une meilleure mutualisation des charges sociales. S’il y a 65 millions de Français et autant de sujets de mécontentement, la fiscalité n’y est pas pour rien. On pourrait se rassurer en se disant que le mouvement est répandu partout, et surtout chronique. Ce qui n’est pas exact. La tolérance à l’impôt varie selon les époques. Quand le caractère insupportable des impôts progresse, c’est toujours un symptôme de crise en gestation. Voir les précédentes crises fiscales de l’État qui ont préparé les révolutions anglaises, françaises.
La charge de la dette de l’État ne va pas diminuer dans les années à venir pour deux raisons. La première, d’ordre conjoncturel, tient au creusement de la dette mondiale des États dans la crise. Ces derniers devraient trouver 28 000 milliards de dollars chaque année de financement (soit 51 % du PIB). Avec les dépenses de soutien au système financier et à l’économie, l’endettement va croître au bas mot à 100 ou 130 % du PIB (le Japon en est à 180 %). Mais l’autre raison, rebelle à toutes les politiques vertueuses prônées par l’Union Européenne ou le FMI, tient à une transformation structurelle des économies. Qu’elles soient française ou suédoise, américaine ou britannique, la part des prélèvements obligatoires y joue un rôle de plus en plus important. Quand les Républicains hurlent au socialisme ou au communisme avec le projet Obama de protection sociale, ils ne font que se rendre compte d’un mouvement d’européanisation entamé paradoxalement dès la présidence Reagan dans les pays les plus libéraux.
De fait, les États sont tous pris par une crise des ciseaux : d’un côté le périmètre de leur implication augmente. Autrement dit, produire la population et son système complexe qui comprend l’éducation, la santé, les conditions de l’emploi, de l’activité économique en amont comme en aval mobilise de plus en plus de ressources. Que cela soit à la charge directe des collectivités locales, centrales ou fédérales ne change rien à l’affaire. En face de cela, les ressources produites par l’impôt fondent ou stagnent.
Malgré ces besoins croissants, on conçoit que les gouvernements y regardent à deux fois avant d’augmenter les impôts. Les promesses de baisse des impôts, ou de bouclier fiscal, ou de répartitions différentes des impôts à taux de prélèvement constant, lient les mains de la droite. La gauche s’est de son côté enferrée dans un autre obstacle. Elle défend le principe de l’impôt sur le revenu et la progressivité de ce dernier, garant de la redistribution. Or avec une assiette de l’impôt très réduite (la moitié ne le paient pas en France), elle est obligée de placer le curseur assez bas pour inclure au moins 25 % de la population, ce qui fait la moitié des imposables. La taxe carbone devant frapper tout le monde, avec la fiscalité que nous avons, dont certains points sensibles sont déjà la TIPP, constitue la goutte d’eau qui peut faire déborder le vase, tout en n’atteignant pas les niveaux dissuasifs requis. En particulier parce qu’il faudrait mettre en place des transports en commun (tramways, autobus) extrêmement denses pour que la population, que l’urbanisme a intelligemment étirée sur des centaines de kilomètres, puisse se rendre à son travail. D’où les « usines à gaz » de perception d’un impôt remboursé.
En fait, la crise fiscale implique de repenser de fond en comble la totalité de la fiscalité. Il y a donc un nœud gordien de la fiscalité. La droite est tentée par la démagogie d’une réduction d’impôts par la porte et se trouve obligée d’alourdir la fiscalité indirecte anti-redistributrice par la fenêtre. La gauche mécontente fortement une bonne moitié de son électorat des classes moyennes en fixant le seuil des riches qui doivent payer bien trop bas ou en soutenant mordicus des impôts symboliques qui rapportent à peine plus que ne coûte leur collecte, comme l’impôt sur les grandes fortunes, quand des mesures concernant les sociétés seraient plus efficientes, mais insuffisantes, et risquées lorsqu’elles portent sur une activité économique choyée pour ses emplois comme l’immobilier.
En fait, le système d’impôt appartient à un « ancien » monde économique : celui mis en place sous de Directoire et modernisé avec la TVA en 1954, par Maurice Lauré. Seuls l’ébranlement de ce système et l’invention d’un nouveau système permettront de sortir de ce pataquès. Nous ne rêvons pas de raser gratis : nous nous efforçons simplement d’ouvrir les yeux.
Où la taxe Tobin réapparaît
Deux semaines avant le sommet du G20 à Pittsburgh (le 12 septembre 2009), le Financial Times, qu’on ne saurait suspecter d’un amour débordant pour le fisc, titrait en première page sur la proposition de Peer Steinbrück, social-démocrate plutôt de droite, ministre des finances de la grande coalition, d’une taxe sur toutes les transactions financières de 0,005 %. Dans le Journal du Dimanche du 20 septembre, c’était au tour de Christine Lagarde, Ministre de l’économie et des finances, de qualifier la taxe Tobin de « belle idée », et à Bernard Kouchner d’entonner la même rengaine. La proposition allemande vite écartée par Angela Merkel comme électoraliste, concernait l’ensemble des transactions financières des banques, des compagnies d’assurance et des fonds de placements. Steinbrück y voyait le seul moyen de mettre un terme à « la dipsomanie de la bourse » et estimait que le coût de la crise ne peut pas être supporté seulement par les petits contribuables.
La taxe Tobin, du nom de l’économiste américain, prévoyait une taxation très faible de 0,05 à 1 % sur toutes les transactions financières internationales à l’échelle mondiale. Cette mesure était censée freiner la volatilité des marchés (ce qui a été contesté avec probablement quelque fondement). Elle a été adoptée sur le principe par la France, mise en pratique de façon fugace par le Brésil et faillit être adoptée à six voix près par le Parlement Européen. Personne n’a jamais contesté les ressources fiscales qu’elle procurerait. En juin 2008, Dean Baker un macroéconomiste du Center for Economy and Policy Research dans son blog, très sceptique sur une réforme sérieuse du système financier, écrivait : « Une modeste taxe sur les transactions financières pourrait lever facilement l’équivalent d’un point de PIB, soit 150 milliards de dollars[3]. » Par « modeste », Dean Baker entendait une taxe de 0,25 % sur le volume des transactions en bourse et de 0,02 % sur les assurances pour défaillances sur les swaps, qui n’aurait pas d’impact sur l’activité mais freinerait les activités purement spéculatives. Cet économiste, comme le Ministre allemand, étend la taxe Tobin aux transactions intérieures.
Une taxe sur toutes les transactions financières dans une économie de pollinisation
Il vaut la peine de faire un petit détour pour voir comment les impôts reflètent la conception qu’une société se fait de la richesse. Les impôts directs sur le capital (les sociétés), les profits, les revenus, frappent la richesse qui résulte du solde de flux, donc le revenu net, ou le capital net (ce qui reste entre deux exercices annuels). Les impôts indirects (la TVA, la TIPP) frappent la consommation finale des ménages. Si ces impôts sont neutres par rapport au volumes des flux, c’est parce qu’ils considèrent que les flux en eux-mêmes ne créent aucune richesse. Il faut donc les éliminer d’un double compte. La circulation n’est pas censée créer de la richesse.
Autrement dit, la richesse des abeilles ne se mesurerait qu’au miel qu’elles produisent, à ce que récolte l’apiculteur. Or la richesse réelle produite par l’abeille est la pollinisation qui représente 350 fois environ la valeur de leur production marchande de miel et de cire pour les bougies. Cette pollinisation se mesure à l’intensité de leur circulation dans les champs. Dans l’activité économique humaine, elle se voit par le nombre de transactions que les gens font, dont la multiplicité des transactions monétaires donne déjà un petit aperçu : la consommation, les échanges, les voyages, les loisirs.
Il en découle une conséquence non dénuée d’intérêt pour notre affaire. L’impôt qui frapperait cette forme de création de richesse (par la circulation) serait beaucoup plus intelligent et surtout rapporterait beaucoup plus. Enfin, last but not least, il présenterait aussi un énorme intérêt politique. Il permettrait de se passer des formes archaïques de l’impôt et du prélèvement obligatoire par un seul prélèvement qui frappe tout le monde également en proportion de ses transactions monétaires.
Puisque toute l’économie est bancarisée, passant par des cartes de crédit ou par des transactions, l’imposition à un taux uniforme (entre 0,5 et 1 %) de toutes les transactions financières permettrait la collecte en temps réel, avec une administration sérieusement réduite, de sommes équivalentes à l’actuel budget de l’État et au budget social de la nation. Dans un tel système, nul n’échapperait à l’impôt. Le citoyen consommateur moyen comme le millionnaire qui utilise une carte de crédit noire, sans le moindre nom, avec simplement une puce, pour payer une voiture de 250 000 € ou un collier de perles. Même, si, pour ce dernier, cela représente une contribution misérable au regard de ses deniers… Une taxe automatique sur toutes les transactions financières aurait aussi l’énorme avantage de contrôler tous les flux financiers[4]. Quid du cash ? Les transactions en cash sont aussi taxées dans ce dispositif car, aujourd’hui, d’où les gens retirent-ils le cash ? D’un distributeur.
La justification de ce système – qui laisse derrière lui le béta sur le prélèvement fiscal progressif, redistributif, direct ou indirect (tout est prélevé à la source) – est que nous avons basculé dans une économie où effectivement ce n’est pas la production du miel ni le produit marchand qui sont le fondement de la véritable richesse, mais la pollinisation à la fois écologique, économique et intellectuelle (la pollinisation humaine). La pratique correcte de l’impôt consiste à prélever de façon indolore sur la véritable richesse. Donc à partir du moment où se déplace le centre d’intérêt sur la richesse, bref à partir de l’avènement de la « nouvelle » économie politique – vers la pollinisation, la corailisation, le faire réseau – et dès lors qu’on tend à se désintéresser de l’« ancienne » économie parce qu’elle est marginale du point de vue de la quantité d’argent qu’elle représente, je peux cesser de prélever de l’impôt sur la personne ou sur son produit marchand. Le prélèvement s’effectuera sur toutes les transactions qui s’opèrent entre les différents types d’agents économiques.
Nouvelles prises, nouvelles donnes
Cette solution est efficace : elle lève les fonds gigantesques dont a besoin la puissance publique, en particulier pour les politiques écologiques en matière de transports non-polluants, d’énergies renouvelables, ainsi que pour un véritable new deal social. En déployant les implications sociales d’une politique de revenu d’existence (dont elle peut être vue comme le pendant fiscal), elle restaure le principe d’égalité entre citoyens. Tout citoyen, du plus pauvre au plus riche, contribue à la mesure de ses moyens effectifs (ses transactions monétaires). On restaure l’égalité devant l’impôt violée, aux yeux des riches, par la progressivité de la fiscalité et, beaucoup plus scandaleusement du côté des pauvres, par les modernes gabelles (la TVA sur toute consommation, même la plus indispensable à la vie). Actuellement, les pauvres sont considérés comme des assistés parce qu’ils ne payent pas l’impôt (autrefois on leur retirait âcrement le droit de vote). Ils pourront dire à Monsieur Pinaut qu’ils contribuent autant que lui à l’impôt proportionnellement.
Pour ceux qui feront remarquer qu’un tel système s’identifie avec la flat tax réclamée par les ultra-libéraux américains depuis des décennies – signant ainsi la mort d’un principe de progressivité fiscale synonyme de redistribution sociale – on précisera que la façon de collecter les sommes nécessaires à la bonne marche des services publics ne limite en rien notre faculté d’en concevoir et d’en organiser la distribution : même si un basculement de la fiscalité vers une taxation proportionnelle (flat, et non progressive) des transactions financières prenait d’abord l’apparence d’un « cadeau fiscal » fait aux plus riches (un de plus !), la redistribution de la manne ainsi obtenue devrait à l’évidence prendre la forme de transferts (de revenus, de services, de gratuité) de la part des plus riches en direction des moins favorisés. L’égalité serait bien moins à situer dans la source des prélèvements que dans leur destination fortement redistributive. Un tel impôt permettrait en réalité non seulement de capter une (petite) partie de la richesse produite par la circulation, mais aussi d’infléchir et de moduler les voies par lesquelles passe cette circulation. Ce qui compte, ce sont non seulement les nouvelles prises (en milliards d’euros) que générerait une telle fiscalité mais surtout les nouvelles donnes (en droits sociaux), les nouvelles affectations qu’elle permettrait de mettre en place
Nous savions qu’aujourd’hui la richesse des patrimoines ne s’évalue pas simplement à ce qui reste après les myriades de flux de placement ou d’optimisation de l’épargne. Les très gros gains des établissements financiers (qui ont repris déjà à Wall Street et ailleurs) s’opèrent sur la base de ces mouvements incessants de la finance. Pour 150 milliards de commerce extérieur et de PIB quotidiens, il y a 1 500 milliards de transactions de change et 2 800 milliards de produits dérivés échangés[5]. La sphère des flux financiers multiplie par 21 les flux des transactions du commerce extérieur et du PIB. Et cette disproportion gigantesque n’est pas une pure affaire de vent, contrairement à ce que disent nos apologues de la valeur concrète, le travail marchand. Elle traduit une captation par l’intelligence de la finance de marché d’une partie de la sphère de la richesse dont la base repose sur la pollinisation – en partie seulement, parce que le rapport entre la valeur du miel et de la cire et les effets de la pollinisation est 350 fois plus faible.
Cette proposition d’une taxe automatique et à la source de toutes les transactions monétaires – qui peut être montée à 2% pour faire face à une crise aussi exceptionnelle que l’actuelle – peut faire espérer d’en finir avec la pauvreté planétaire en tranchant le nœud gordien de la fiscalité, auquel la taxe carbone ne fait qu’ajouter une boucle supplémentaire.
Envoi : à ceux qui se plaindraient que cette taxation de toute transaction monétaire risque faire fuir la monétisation de l’économie et pousse à des échanges non-monétaires et à une diminution de la consommation, je répondrai que la décroissance intelligente de certains pans de notre économie en sera grandement facilitée. Paieront moins d’impôts ceux qui développeront des transactions non-marchandes et vivront plus intensément les échanges mentaux que l’achat de biens matériels. CQFD.