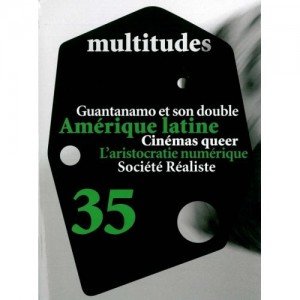Fin juin, pendant que j’écris cet article, la situation déjà tendue depuis plusieurs mois dans les centres de rétention, et notamment ceux de Vincennes 1 et 2, se dégrade plus encore. Suite au décès le 21 juin d’un retenu tunisien, des affrontements opposent les retenus et les forces de l’ordre, puis celles-ci et les soutiens venus manifester devant un CRA sécurisé par la police. Durant les premiers affrontements, un feu est déclenché que les policiers ne parviennent pas à éteindre et qui détruit les deux centres. Le sinistre ne fait que des blessés légers. Les autorités cherchent à recaser les occupants restants, ce qui entraîne le déplacement des occupantes d’un autre centre pour pouvoir accueillir des retenus de Vincennes dont près d’une centaine sont orientés vers Nîmes. La plupart seront libérés dans les jours qui suivront et rapatriés grâce à l’aide des associations de soutien, les pouvoirs publics refusant de prendre en charge le retour en région parisienne. Depuis, divers incidents et incendies ont été constatés en juillet et en août dans d’autres centres, notamment dans celui du Mesnil-Amelot.
Des protestations de retenus, jusqu’alors peu connues à l’extérieur des centres de rétention, se sont multipliées en France ces derniers mois( ). Les actions de contestation de cet arbitraire légalisé que constitue leur incarcération sont difficilement perceptibles mais parviennent néanmoins à sortir du huis clos rétentionnaire par l’intermédiaire de témoignages d’internés, de militants associatifs et de journalistes. L’incendie du CRA de Vincennes en juin donne une autre résonance à cette lutte. La soudaine visibilisation de la protestation dans les centres intervient alors que la politique répressive contre les étrangers s’accentue.
Environ 35 000 personnes passent chaque année en France par l’un des 22 centres officiels ou dans la centaine de locaux de rétention installés dans divers points du territoire, et plus de 25 000 étrangers sont expulsés. Ces espaces sont connectés avec un ensemble d’autres lieux (zones d’attente, foyers de travailleurs, centres d’accueil, jardins publics…) et de dispositifs qui permettent des arrestations d’étrangers illégalisés. La récente révolte des retenus contre leur privation de liberté, leurs conditions de détention et d’arrestation et leur possible déportation n’est pas un événement inédit et propre à la France. D’autres l’ont précédée – en Belgique, en Australie, pour les cas les plus récents –, suite à la généralisation de l’application de la mise à l’écart pour des populations catégorisées comme en surnombre dans la plupart des pays occidentaux qui enferment les étrangers à leur arrivée ou pour les déporter. Pour prendre la mesure de ce que révèlent sur la radicalisation xéno-raciale de l’État les mouvements de refus de ce nouvel ordre politique et policier, j’aborderai ce qui apparaît comme un devoir de violence qui s’impose aux forces de l’ordre, dans et au-delà des centres. J’évoquerai ensuite les formes de protestation des retenus et de leurs soutiens, que l’impuissance pousse au durcissement des modes d’action, faute de pouvoir globaliser la lutte et de lui donner toute sa dimension politique.
Un devoir de violence
La systématisation de la politique de refoulement des étrangers illégalisés, avec comme corollaire le développement et la pérennisation des centres de rétention administrative, se traduit par la généralisation du recours à la violence des différents types d’agents amenés à intervenir dans les procédures d’arrestation, de maintien en détention et d’expulsion. Leur intervention, qui pourrait s’apparenter à un devoir de violence et un permis de chasser et de haïr, est stimulée par la pression des pouvoirs publics. Elle peut aussi être envisagée comme l’indice de la fragmentation de la souveraineté déléguée aux acteurs de cette politique. La gestion répressive des étrangers est d’ailleurs privatisée de longue date dans de nombreux pays, et en voie de l’être en France. La brutalité, à la fois banalisée, institutionnalisée et dérégulée, s’inscrit dans un continuum de violence. Celle à laquelle recourent quotidiennement les gestionnaires de camps d’étrangers( ) prend place dans un processus qui commence avec les modalités et les conditions de traque, de rafle et d’interpellation des individus et se prolonge avec l’emploi de techniques mises au point pour faciliter les expulsions par avion ou par autobus. L’usage trivial de la force est rendu possible par la violence de la loi et des discours politiques contre les étrangers.
Le niveau de violence dans les centres de rétention administrative (CRA) semble plus élevé et moins prévisible que dans d’autres structures répressives et de contention comme les établissements pénitentiaires et les structures psychiatriques. Il peut être rapproché, en revanche, de la prise en charge des sans-abri, de l’éloignement de la prostitution ou de la résorption des zones d’habitats présentées comme insalubres. Ces procédures deviennent peu à peu des standards d’intervention( ) pour le traitement de catégories de population indésirables dont le nombre et le contour sont toujours plus larges( ). Elles doivent être pensées dans le cadre plus global des guerres asymétriques et des états de catastrophe lors desquels des procédures militaires sont appliquées aux civils.
Les insultes, les coups et les mauvais traitements sont fréquents dans les centres. L’utilisation de Tasers (pistolets à impulsion qui projettent des décharges électriques) lors des interventions policières à l’intérieur des centres révèle une escalade de la violence potentiellement sans limite( ). Comment réagiront les policiers en cas d’agression contre l’un des leurs ? Dans cette entreprise de séquestration publique, ils bénéficient jusqu’alors d’une totale impunité, accentuant les risques « d’usage disproportionné de la force ». Jusqu’où ira la nécessité proclamée d’un maintien de l’ordre dans les CRA, alors que des parlementaires et des groupuscules de la droite identitaire appellent à être « extrêmement dur avec l’immigration illégale » et que les organisations qui soutiennent les sans-papiers, tel le réseau éducation sans frontières (RESF), sont dénoncées comme des groupes « quasi terroristes » ?
En fait, les forces de l’ordre paraissent débordées à chaque protestation collective. L’intervention de brigades canines, en particulier lors des rondes de nuits, dans les chambres, indique aussi un usage de techniques d’intimidation qui ne peuvent s’envisager que dans le cadre de relations très limitées dans le temps ou vis-à-vis de publics particulièrement démunis ou infériorisés. Lorsque les maintenus refusent de regagner leur chambre ou manifestent leur mécontentement, à telle ou telle occasion, il est fréquent que des brigades de CRS interviennent et procèdent à des charges répétées, jusqu’à ce que le calme soit obtenu sous l’effet des gaz et des coups. Tout se passe comme si les policiers, les gendarmes et les différentes catégories de personnel qui interviennent dans l’industrie de la rétention avaient intériorisé l’absence de valeur des détenus. Par exemple, les agents enfilent des gants lorsqu’ils ont à approcher ou à toucher les individus. Cela dépasse la démarche prophylactique appliquée dans les structures de soins et correspond à une volonté de ne pas risquer d’être souillé et à un enrôlement dans une opération d’assainissement de la société par l’ablation et la mise à distance d’éléments impurs et nuisibles( ). La promiscuité entre les gestionnaires des centres, placés sur une ligne de démarcation entre le pur et l’impur, et les internés est ressentie par les premiers comme une exposition à la souillure, sentiment occasionnellement partagé par d’autres acteurs. Après une évasion du CRA de Vincennes en novembre 2007, les échos ont rapporté une tension policière particulière et de nombreuses violences contre les retenus. Les blessés ont été évacués, les « meneurs » transférés dans d’autres centres. Durant cette phase, le comportement du personnel médical à l’intérieur du centre et dans les services hospitaliers (refus de soins ou diagnostic superficiel, traitements bâclés, indifférenciés et inappropriés, délivrance de somnifères pour endormir les retenus récalcitrants…) a été dénoncé par des retenus.
Aux recours à la violence dans les situations de crise, il faut ajouter la violence quotidienne à l’intérieur des CRA. L’agressivité et le mépris s’expriment dans le face-à-face, à chaque interaction, entre les représentants de l’ordre et les retenus( ). Le pouvoir arbitraire est mis en scène dans chacun des espaces de la machine à expulser, depuis un guichet administratif quelconque jusqu’aux salles et aux couloirs des centres de déportation. Tout, du règlement intérieur de ces derniers à la configuration des locaux de rétention, doit exprimer le message répulsif de malvenue adressé à l’étranger et lui indiquer le chemin de la sortie de l’espace national. Les retenus des camps français relatent, en plus de l’angoisse mêlée d’ennui d’une attente dans l’incertitude, les cachets pour dormir, les stations debout contre les grillages, la surveillance permanente et les brimades, les alarmes actionnées en pleine nuit et les fouilles avec chiens, la lumière constante, les intrusions dans les chambres pour des comptages répétés, les destructions d’affaires personnelles, les affections non soignées, les mises à l’isolement.
Des retenus arrivent et repartent sans cesse. Ils arrivent après de nouveaux transferts, des arrestations. Ils repartent pour être expulsés, envoyés vers d’autres centres, parfois libérés. Ils sont maintenus dans un état de dromomanie aiguë qui participe d’une volonté de les désorienter avant déportation. Comme le dit un ex-retenu dans un documentaire : « On n’est pas dans un processus fixe. On vous change à tout moment »( ). Les conflits internes sont probables et des rumeurs circulent sur des tentatives d’infiltration par de « faux retenus » dans les centres. Les projets de mobilisation sont combattus par les gardes, qui tentent de cliver la population en fonction des nationalités ou de groupes ethniques (les « Chinois », les « Arabes », les « Noirs », etc.), selon des méthodes connues depuis la colonisation, et que l’on trouve aussi dans la gestion ethnique des foyers et des prisons.
On relate également des dérèglements dans le mode d’organisation et de gestion quotidienne de ces espaces confinés, alors que c’est précisément sur ce point qu’insistent les autorités pour proclamer leur respect des « droits des étrangers ». C’est le cas de la délivrance d’un repas complet unique par jour dans certains établissements et de pratiques de reconditionnement de la nourriture pour falsifier les dates de péremption( ). En fait de dérèglement, terme qui supposerait que ces espaces peuvent fonctionner autrement, l’internement administratif porte en lui une absence de règles débouchant toujours sur l’autonomisation des autorités gestionnaires vis-à-vis des règles de droit, donnant lieu à des marchés parallèles, au harcèlement moral et sexuel, et au triomphe prévaricateur et népotique des petits chefs. Le travail forcé comme punition, mais aussi comme compensation et en tant qu’activité occupationnelle, tel qu’il a été pratiqué jusque dans les années 1950 dans les lieux d’internement administratif et plus largement dans les différentes formes de camps d’étrangers, est remplacé par d’autres types de sanctions. Les faits relatés dans les CRA constituent des punitions supplémentaires, applicables à la fois collectivement, mais aussi selon l’arbitraire personnel du garde, pour ajouter à la privation de liberté et à l’expulsion, toujours imminente, des châtiments ciblés, humiliant et dégradant les individus. Les exécutants cherchent à proportionner la réalité de la pénitence infligée à la « faute » de la présence illégale et illégitime de l’étranger sur le territoire, pour lui donner une justification morale.
Nous assistons à la construction d’un contretype du clandestin qui puise ses racines dans les stéréotypes coloniaux et prolonge les catégories de population « à risque » dans les politiques publiques. Le processus de brutalisation dans les modes de traitement de ces groupes y trouve sa raison d’être et son modus operandi. Dès lors, la figure du clandestin présente des caractéristiques se combinant deux à deux et fonctionnant comme des injonctions emboîtées. Il est supposé « invisible » et doit être « détecté », « falsificateur » et doit être « confondu », « manipulateur » et doit être « débouté », « invasif » et doit être « repoussé », « prêt à tout » et doit être « brisé ». Les tentatives d’envahissement du territoire, dont il est censé être la preuve, doivent être combattues par un rationnement de son accès à l’espace, et son expulsion est présentée comme la seule sanction possible, puisque toute autre solution permettant son maintien sur le territoire apparaîtrait comme la récompense de son « crime ». Le clandestin incarne un étranger sur qui pèse des accusations apostasiques de pratiques contraires à l’identité nationale, et se trouve au revers de la carte des valeurs qui affiche quête de la dignité, lutte contre les discriminations et encouragement de la mixité. Le travail ne lui confère même plus une légitimité minimale, pas plus que le mariage avec un(e) citoyen(e) français(e). Peu à peu, les ponts entre l’étranger et le citoyen sont coupés par l’action de l’État.
Cette violence dans les centres, qui s’applique dans une opacité plus grande encore dans les locaux de rétention, s’intègre, on l’a dit, dans un continuum de brutalisation. Les étrangers illégalisés sont exposés à la férocité des mondes parallèles du travail, du logement, de la rue, dans lesquels ils évoluent quotidiennement. Elle devient paroxystique dans les dénonciations anonymes, les traques, les guets-apens, les kidnappings et les rafles collectives qui conduisent dans les centres et au-delà des frontières( ). Des hommes et des femmes sont arrachés à leur vie familiale, éducative, sociale, économique. Des enfants sont auscultés, internés et instrumentalisés( ). Ils se défenestrent parfois ou se jettent à l’eau, de rage impuissante et affolée. Les techniques de rafle, connues de longue date par les étrangers et les indigènes coloniaux en métropole, sont appliquées dans les quartiers parisiens ou marseillais comme Belleville, Stalingrad ou la Porte d’Aix. Citons cette souricière dressée à la gare de Villeneuve-Saint-Georges en région parisienne, en janvier 2008, ciblant les nombreux travailleurs sans papiers employés dans les chantiers proches( ). Des rafles sont aussi menées dans les foyers de travailleurs, selon des règles anciennes mais agencées suivant de nouveaux objectifs policiers. Les « contrôles d’occupation » conduits dans les foyers avec encerclement total avant six heures du matin et inspection des chambres par des brigades canines existent depuis longtemps, de même que les échanges de fichiers entre la police de l’air et des frontières (PAF) et les gestionnaires de foyers de travailleurs( ). Mais les agissements actuels rompent avec un relatif statu quo protecteur de ces espaces de logement, notamment dans les foyers africains. La rafle (115 interpellations, dont 105 sans-papiers) qui a eu lieu en février 2008 dans le foyer Terres au Curé dans le 12e arrondissement de Paris et celle devant le foyer Bara à Montreuil en mai 2008, témoignent de ce changement. Ces interventions ne sont plus un moyen de lutte cyclique et cynique contre le surpeuplement des foyers mais un procédé rodé de la chasse générale aux étrangers du Sud, avec ou sans papiers.
La violence de la loi se traduit dans le mode de traitement des dossiers d’étrangers par les instances judiciaires : procédures à la chaîne au tribunal administratif, en comparution immédiate et à l’issue presque toujours répressive sous les questions insultantes de juges convertis ou soumis aux nécessités de cette épuration raciale qui se dissimule de moins en moins – même si la justice reste malgré tout le seul recours pour faire reculer ponctuellement la machine administrative( ). La violence s’exacerbe dans les conditions de la déportation et du bannissement, où les expulsés, préalablement déstabilisés psychiquement et physiquement, sont drogués, bâillonnés, entravés, voire scotchés et assommés pour gagner la place d’avion ou d’autobus censés les reconduire. Les passagers, témoins de ces brutalités, sont intimidés s’ils réagissent, puis poursuivis lorsqu’ils sont récalcitrants, tout comme les soutiens peuvent être criminalisés. La violence potentielle dans le pays d’accueil, qui n’est pas toujours le pays d’origine, les cas sont nombreux, achève le processus de l’interdiction du territoire.
L’expression de cette violence, encouragée politiquement et institutionnellement surenchérie, est permise par le passage progressif des règles clandestines de la police dans la norme et l’insertion de l’hostilité à l’endroit de l’étranger dans l’ordre juridique intérieur( ). Elle vise à faire peur aux illégalisés et aux illégalisables, dans le prolongement d’une surveillance accrue, et à limiter les effets des mobilisations s’opposant à ce Golpe anti-étrangers.
Une résistance désarmée
Face à cette trivialisation de la brutalité, les modes de résistance des maintenus peuvent paraître dérisoires. S’ils s’apparentent pour certains aux mouvements dans les prisons à caractère politique en Irlande, en Espagne et en Israël( ), ils ne témoignent pas cependant d’une discipline et d’un savoir-faire de militants politiques aguerris( ). De plus, les civils supportent mal les traitements militarisés. Ces mobilisations de dernier recours doivent alors surmonter non seulement le fréquent état dépressif spécifique à la condition d’interné et s’arracher à l’atonie mais aussi résister aux effets déstructurants du harcèlement policier, avant l’arrestation et après celle-ci, avec des phases d’effondrement psychique. Elles témoignent à la fois des moyens extrêmement réduits dont disposent les protestataires et de leur potentiel jusqu’auboutisme.
En revanche, les étrangers retenus entrent en politique parce qu’ils perçoivent comme non légitime la sanction d’enfermement et la menace d’expulsion. Les témoignages répercutés par les associations de soutien et les travaux des quelques chercheurs qui ont pu enquêter dans les centres de rétention font état de formes de résistance multiples et plus ou moins coordonnées. Il y a d’abord les retenus qui retournent cette violence omniprésente contre eux-mêmes, par exemple en avalant des lames de rasoir. Leur impuissance rend possible l’ultima ratio de l’exposition du corps souffrant pour faire obstacle, coûte que coûte, à l’expulsion. Cela peut correspondre à un passage à l’acte individuel devant l’idiotie du réel de l’exfiltration policière et de la mise au ban. Mais cela peut aussi être l’expression collective de l’absurdité de la condition de retenu. Les maintenus en Australie, par exemple, ont lancé ces dernières années des mouvements de protestation durant lesquels ils se sont cousu les lèvres ou se sont mutilés en public ou devant des caméras( ). Les grèves de la faim sont devenues un mode classique de contestation de l’ordre étatique par les étrangers( ). Elles se développent actuellement dans et hors des centres. Un professeur de mathématiques sénégalais a entamé fin décembre 2007 une grève de la faim au CRA du Mesnil-Amelot avant d’être déplacé à Vincennes, puis libéré. Toujours à la fin décembre, une grève collective de la faim a débuté au centre de Vincennes. Une cinquantaine de grévistes ont lancé le mouvement et ont affiché des pancartes proclamant : « Non à la politique du chiffre. Égalité des droits, des papiers pour tous ». Ils ont été réprimés par plusieurs charges de CRS. Dans les jours suivants, des retenus du Mesnil-Amelot ont eux aussi entamé une grève de la faim. Ils ont rédigé un cahier de doléances, inscrit des revendications sur leurs vêtements et refusé de regagner leur chambre. Lorsque, fin janvier 2008, la révolte des retenus s’est intensifiée à Vincennes, ceux-ci ont refusé d’être comptés et de rentrer dans leur chambre, et ils y ont mis le feu. Ils ont jeté leur nourriture, et on a relevé plusieurs tentatives de suicide dans les jours qui ont suivi. Une nouvelle étape a été franchie en mai 2008 avec le vote en assemblée générale de retenus d’une grève de la faim collective à Vincennes. Le 4 mai, une manifestation a été déclenchée et des tissus blancs ont été accrochés aux grilles extérieures, alors qu’une centaine de personnes entamaient une grève de la faim.
Si l’on en croit les modalités de lutte observées dans d’autres dispositifs rétentionnaires contemporains ou concentrationnaires plus anciens, la seule issue du rapport de force se trouve pour les retenus dans la radicalisation des actions. Face à la volonté de la puissance publique de s’affranchir des règles de la société civile et des libertés individuelles, les illégalisés promis à la déportation ne peuvent répondre que par une mise en cause du fonctionnement concret et logistique du système rétentionnaire qui s’exprime par le refus de son ordre gestionnaire raciste et par un retournement de la violence contre soi, seule à même de mettre en évidence les contradictions avec les principes affichés de la démocratie libérale des sociétés dites ouvertes. Dans l’histoire des camps, les révoltes et les évasions ont été fréquentes et les modèles pour tenter d’anticiper sur les prolongements extrêmes de ce combat ne manquent pas( ). Les grèves de la faim peuvent se radicaliser et devenir systématiques, comme dans les prisons irlandaises et les camps de la guerre d’Algérie. Le taux de suicide dans les centres est d’ores et déjà six fois plus élevé que la moyenne. Les exemples d’autres systèmes rétentionnaires laissent penser que des vagues de mutilations, de suicides publics ou collectifs peuvent se développer. Pourtant, ces démarches d’autolyse, individuelles ou de groupe, sont pour l’heure sans débouchés politiques concrets, et les autorités anticipent et profitent de ces passages à l’acte pour accentuer leur pression. Sans protection, le clandestin peut ne pas être traité comme un sujet de droit et comme un acteur politique légitime avec lequel il faut négocier. Au contraire, les pouvoirs publics et leurs représentants considèrent cyniquement que tous les coups sont permis dans cette guerre.
Certes, ces mobilisations sont relayées par des soutiens extérieurs, familiaux, associatifs et militants, qui parviennent tant bien que mal à entrouvrir le monde de la rétention. Ils utilisent divers modes d’action dont certains paraissent innovants mais qui attestent, comme les actions des retenus, d’une grande faiblesse des moyens et des rares échos de ces luttes qui en ont pourtant grand besoin. De nouvelles formes d’action, tels les cercles de silence développés surtout par des religieux et des mouvements confessionnels, interpellent les passants de manière symbolique, par la simple présence de participants sur des places publiques, restant debout en formant une chaîne humaine immobile et silencieuse. Le groupe Chrétiens migrants a ainsi organisé des cercles de silence le 21 mai dernier. Un photographe, installé rue Charlot dans le quartier du Marais à Paris, a entrepris l’affichage progressif sur les murs de la rue de centaines de clichés qui associent un citoyen légal avec un illégal. Des réseaux de soutien se sont dotés de moyens de communication et d’activisme, tels La Télé et Le Quotidien des sans papiers, et plusieurs sites sur le Net, spécialisés et en réseau, tentent de relayer l’information comme des agences alternatives et sous forme plus défensive pour parer avec les moyens du bord aux rapts collectifs et aux séquestrations quotidiennes. L’un des modes de soutien direct, en plus de l’appui juridique, sont les visites et la tenue de parloirs sauvages aux abords des centres ; ils permettent aux militants et aux familles de communiquer avec des retenus lors des promenades.
Les manifestations restent privilégiées pour alerter et faire pression( ). Les associations savent que c’est un moyen qui permet parfois de faire reculer les autorités, notamment dans des cas d’arrestation et d’internement les plus scandaleux (lycéens, mères de famille, malades, etc.). C’est surtout Vincennes qui, en tant que premier CRA de France par la taille et la centralité, a suscité des marches de protestations régulières depuis le début de 2008, mais d’autres actions se sont produit devant des lieux comme le commissariat de Nantes ou le CRA de Rennes, à Saint-Jacques-de-la-Lande. On a aussi assisté ces derniers mois à des manifestations de Roms à Paris, notamment le 2 décembre 2007, pour protester contre les expulsions collectives. Plusieurs autres se sont déroulées depuis le déclenchement des émeutes dans les centres. Des sans-papiers ont marché vers le centre de rétention de Vincennes en partant de la Porte Dorée.
Mais les effets des actions de type défilé restent limités. Elles ne recueillent que peu d’échos et la police en profite pour appréhender les manifestants. Les groupes de soutien procèdent aussi à des manifestations électroniques. Des systèmes d’alerte sur Internet et par SMS ont été utilisés pour prévenir du déroulement d’une rafle dans tel ou tel quartier ou de l’évacuation en cours d’une église, permettant aux sympathisants de se rendre sur les lieux pour tenter d’enrayer les opérations policières. Des mails et des fax sont envoyés pour médiatiser une situation individuelle et faire réétudier le dossier d’un expulsable, tel ce lycéen de Vandœuvre placé en rétention à Palaiseau, ou encore pour exercer une pression épistolaire sur un haut fonctionnaire de la déportation par la diffusion sur des listes de son adresse électronique.
Aux manifestations s’ajoutent les occupations, celle des locaux de l’Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrants (ANAEM) en novembre 2007, d’un temple situé en face du ministère de l’immigration, des locaux de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) en mars 2008 ou encore de la Bourse du travail, rue Charlot, haut lieu de l’histoire politique de l’immigration, investie par plus de mille personnes depuis plusieurs mois. Mais les autorités comme les gestionnaires des locaux occupés réagissent de plus en plus rapidement et ces opérations doivent être soigneusement préparées pour espérer fonctionner, c’est-à-dire réussir à attirer l’attention des médias. On assiste aussi à des formes de mobilisation plus défensives dans la fonction publique. C’est ainsi qu’un réseau de travailleurs sociaux et d’inspecteurs du travail s’est constitué dans l’Isère pour dénoncer les injonctions préfectorales à prendre part à la chasse aux étrangers illégalisés( ). Ce ne sont d’ailleurs pas que les préfectures qui menacent. Un blâme consulaire a récemment été infligé à des médecins soignant des réfugiés et des sans-papiers.
À côté des mobilisations classiques, les soutiens juridiques et citoyens se sont multipliés, développant un asile sociétal contre l’État qui refuse ce rôle, en abritant des sans-papiers, en les défendant dans les différentes étapes de leur carrière administrative ou en contestant des décisions préfectorales. C’est notamment avec le Réseau éducation sans frontières (RESF) que s’est développé un ensemble de procédés pour résister aux expulsions, avec ceux que le Nouvel Observateur appelle les « rebelles anti-expulsions »( ). De fait, les actions de soutien et les organisations qui les portent sont exposées à l’épuisement d’une lutte sans fin contre un Moloch administrativo-politique qui cherche à les délégitimer, en arguant d’une part du caractère légal de cette frénésie xénophobe sécuritaire et, de l’autre, de l’irresponsabilité des militants mobilisés.
La radicalisation continue de l’action répressive de l’État porte en elle un risque fort de clivage et de concurrence entre différents types de soutien. Par exemple, le comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), qui apporte son aide juridique et sociale aux retenus dans les centres, est maintenant régulièrement mise en cause par d’autres associations qui se plaignent de ne pouvoir y accéder. Les discussions se sont intensifiées ces derniers mois au sein de l’organisation elle-même sur l’opportunité de maintenir sa présence en rétention, alors même que des représentants de la majorité parlementaire s’en prennent aujourd’hui à son action. Le ministère de l’immigration s’apprête à lui retirer l’exclusivité du marché public de l’aide juridique dans les CRA. Le plus grave pour les associations et les groupes de soutien aux étrangers et aux sans-papiers est que, lorsque ils apportent leur appui avec l’accord des autorités publiques, dans ces centres ou ailleurs, ils sont poussés à intérioriser certains des cadres d’analyse et de perception de l’institution répressive. Il leur faut s’intéresser en priorité au retenu, au demandeur d’asile ou au sans-papiers qui apparaît comme le plus digne, le plus crédible, celui qui a le plus de chances dans le labyrinthe minoen de l’obtention et de la régularisation. Les dispositifs de protection, qu’ils soient internationaux ou non gouvernementaux et plus largement les « opinions publiques », en rétraction sur ces thèmes, n’opèrent plus comme contrepoids. Ainsi, les mobilisations associatives contre la politique d’expulsion n’ont, dans l’ensemble, que des résultats modestes. Le manque de relais, l’inexpérience, les objectifs humanitaires de décence de certains groupes( ), ou politico-tactiques des partenaires institutionnels de ces luttes en sont quelques causes( ). Les autorités peuvent alors à loisir non seulement choisir « leurs » migrants mais aussi « leurs » associations, interlocuteurs renvoyés à une fonction de prestataires de services, qui ne peuvent se permettre de critiquer l’action publique qu’ils accompagnent.
Ces mouvements dans leur ensemble souffrent donc de plusieurs faiblesses propres à leur lutte et à ce type de mobilisations, mais aussi liées au contexte de plus en plus tendu. Il y a de prime abord une timidité théorique et politique qui caractérise les protestations des plus faibles( ). Face à l’exacerbation toujours plus vive des discours et des procédés de militarisation de la question immigrée et plus globalement de la question sociale, les revendications d’ouverture des frontières et d’égalité de traitement entre les citoyens et les étrangers sont devenues quasiment inaudibles et valent immédiatement censure et décrédibilisation à leurs porteurs. À cela s’ajoute une conversion intellectuelle et politique des élites démocratiques à l’idée d’une généralisation de dispositifs d’exception, non seulement pour les questions migratoires, selon l’équation « il y a trop d’étrangers en Europe », mais plus largement pour l’ensemble des questions de sécurité et de protection rapprochées et/ou à distance des sociétés post-industrielles. Cette politique génère un double effet sur les sociétés civiles des pays de départ des migrants postcoloniaux comme sur les fractions des populations des pays occidentaux issues de ces migrations. Les premières ont commencé à intérioriser un complexe de culpabilité vis-à-vis de l’émigration sous l’impact des durcissements des conditions de déplacement et des transferts de cadres et de techniques de contrôle des frontières. Les secondes vivent maintenant dans l’ombre du camp, comme le dit Martin French( ). La menace de la déportation de migrants installés de longue date vient faire fond sur les dispositifs de mise à l’écart dans les mondes urbain, scolaire, économique qui s’appliquent aux minorités visibles depuis l’après-guerre et plus encore depuis les décolonisations.
Nous pouvons tirer deux leçons essentielles de cette situation dans les centres de rétention administrative. L’extension sans fin des libertés policières s’y illustre de manière flagrante mais il serait naïf de penser qu’elle ne concerne que la seule population contrainte à la clandestinité. En effet, la rencontre de la culture de contrôle et de l’économie de marché permet maintenant la généralisation des techniques de surveillance à l’ensemble des citoyens à l’échelle européenne. La chasse aux étrangers constitue ainsi un cheval de Troie des institutions de maintien de l’ordre contre les libertés individuelles et politiques, dont l’édifice paraît toujours plus fragile. Pour cette raison, la lutte contre la rétention peut être envisagée, dans le contexte du récent pacte pour l’immigration à la fois répressif et utilitariste, comme visant non seulement à résorber le clivage instauré entre étrangers et citoyens mais plus largement à protéger les droits civiques de tous les ressortissants des démocraties européennes. Dans cette perspective, plus que la radicalisation, c’est la globalisation de la lutte ou son élargissement qui pourront contrecarrer cette politique. Les défenseurs des sans-papiers sont en cela à l’avant-garde.
Août 2008