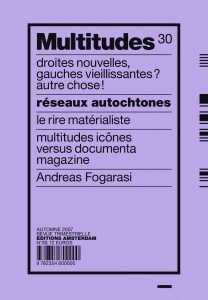Avec Pierre Vidal-Naquet et Gilles Deleuze, André Gorz fut, en France, l’un des rares alchimistes d’une pensée pour la gauche. En cela, il fut un « maître penseur » sans l’enflure que ce terme a pris depuis l’essai d’André Glucksmann. Tout en maigreur et en finesse, son visage m’a toujours fait penser à un portrait de Machiavel. Ou d’Ivan Illich, cet autre Autrichien qui passa, lui, l’Atlantique et dont la rencontre fut si décisive pour son débordement du socialisme. Je ne peux m’empêcher de réunir André Gorz, Ivan Illich et Michel de Certeau comme des esprits déjà dans la mondialisation, pas celle du marché, mais celle des mouvements étudiants, des communautés contestantes, de la place des Trois-Pouvoirs de Mexico à la Californie.
Au pays de feu les « grands intellectuels », il occupe une place à part. Sa présence n’a ni l’éclat aristocratique des enfants du sérail de la rue d’Ulm, ni le clinquant des « bêtes de scène » médiatiques qui passaient chez Bernard Pivot et, depuis, dans des émissions moins recommandables. Il a sans doute inventé, par son œuvre et sa vie, une figure beaucoup plus semblable à celle, professionnelle, du clerc moderne sans collier, sans église, sans la comédie des disciples. Quel André Gorz, Gérard Horst ou Michel Bosquet choisir ? L’écrivain, le philosophe, le secrétaire de Sartre, le moraliste qu’il fut dans sa jeunesse (Le Traître, Seuil, 1958) ? L’expert économique en questions de travail, de capitalisme, de la deuxième gauche et de la CFDT (Stratégie ouvrière et néocapitalisme, Seuil, 1964) ? L’auteur des Adieux au prolétariat (Galilée, 1980) ? Le journaliste qui fit le saut de l’Express au Nouvel Observateur, ce « révolutionnaire réformiste » ? Cet ingénieur de formation a produit l’un des rares rameaux de la pensée critique et marxiste qui ait passé la rampe internationale. De l’existentialisme, il a pris le feu intérieur de la subjectivité, concept auquel il ne renonça jamais et sur lequel repose l’idée d’une morale si fortement opposée aux fadaises du supplément d’âme sur fond de structuralisme sec.
Son influence fut intellectuelle et culturelle, et donc indirectement politique. Entre 1968 (les Cahiers de Mai, par exemple) et 1981, il est incontournable. Et souvent exaspéra car, comme beaucoup, j’attendais beaucoup de lui. Il avait une conscience aiguë des limites des idées et des schémas sur la classe politique, qu’elle soit institutionnelle ou révolutionnaire. Lorsque des militants du Mai rampant italien vinrent lui rendre visite après 1968 (c’étaient Giairo Daghini et Sergio Bologna, qui préparaient un article sur le caractère ouvrier du Mai français), il les reçut avec gentillesse et leur lança sur le pas de la porte : prévenez-moi quand la révolution éclatera ; et ces derniers de lui répondre : « tu l’entendras dans la rue ! » Libre vis-à-vis du socialisme réel bien avant 1956, puis vis-à-vis du maoïsme, jamais enrégimenté ni trop pétitionnaire, il fut discret mais inflexible sur le plan des idées, rigoureux, théorique mais pas dogmatique : sa curiosité lui faisait intégrer les Grundrisse de Marx et Emma Rothschild sur la crise du fordisme dans les usines américaines.
Après mai 1981, il prit ses distances, sans tapage, avec le triomphe kitsch de la première gauche sur la seconde. Il vécut mal le triomphe de la contre-révolution néolibérale, mais encore plus mal le long et besogneux égarement de la gauche incapable d’accoucher d’autre chose que la surenchère rhétorique néo-jauressienne ou le cynisme blairien. Il détestait l’affadissement médiatique qu’il vécut de l’intérieur.
Face à Sartre, puis Bourdieu, Foucault et Derrida, il n’était pas un pur produit du sérail français des grandes écoles, ni un académique. Sa culture Mitteleuropa en faisait un connaisseur de la culture allemande contemporaine, comme de l’Italie. Circonspect, porteur sans tapage ni moulin à vent de l’expérience terrible de la tourmente nazie, à laquelle il avait échappé de justesse, circonspect, parfois trop, sur le plan politique, il n’eut jamais les naïvetés (inconscientes ou délibérées) ni les rhétoriques des grands intellectuels, semblable à l’intelligence européenne qui s’était réfugiée en Angleterre depuis les années trente. La France lui offrit une gloire et une influence impalpables mais réelle. Je me demande s’il n’eût pas été davantage reconnu dans quelque Cambridge, en contact avec les nouvelles générations et enseignant au lieu de traîner trop longtemps dans les couloirs de la rue d’Aboukir.
Pourtant, c’est lorsque son influence déclina apparemment (quand ses idées n’eurent plus de résonances faciles avec l’air du temps) qu’il rompit avec le Nouvel Observateur (1983) qui lui avait donné une tribune extraordinaire pendant vingt ans, au moment où la seconde gauche bégayait, en pleines « années d’hiver » (années de plomb italiennes, échec du programme commun de la gauche, ascension fulgurante de la contre-réforme culturelle néolibérale). Il mûrit la pensée d’une voie alternative au capitalisme par l’intérieur et il porta sur ses fonts baptismaux la troisième gauche : celle de l’écologie politique (Écologie et Politique, Galilée, 1975), puis, près de vingt ans plus tard, celle de la sécession numérique (L’Immatériel, Galilée, 2003). Sans lui, on n’aurait jamais assisté à la greffe réussie entre la gauche anti-institutionnelle issue de Mai 1968 et l’écologie antiproductiviste, donc a-socialiste, dont est issu peu ou prou tout ce qui cherche encore une gauche digne de ce nom.
André Gorz, avec Félix Guattari et Jacques Robin, lui aussi disparu très récemment, sont les véritables artisans de la naissance des Verts européens (la seule force politique nouvelle depuis la deuxième guerre mondiale). Dans ses deux avant-derniers livres, Misères du présent, richesse du possible (Galilée, 1997) et L’Immatériel (Galilée, 2003), boudés par des médias mais qui trouvèrent un public, il se rapprocha de façon surprenante des positions défendues par Multitudes (sur les transformations du capitalisme contemporain) et fit quasiment une autocritique de ses positions précédentes sur le revenu d’existence, auquel il se rallia, mais comme toujours avec une singularité exceptionnelle. Rien n’était plus revigorant que de voir qu’un très vieux monsieur, retiré du monde dans un coin sauvage de l’Yonne, se passionnait pour les communautés du logiciel libre avec la même ferveur qu’il avait suivi les manifestations d’intelligence ouvrière trente ans auparavant. Ouverte par Carlo Vercellone, avec qui il entretint une correspondance régulière, la collaboration d’André Gorz avec Multitudes devait se prolonger par un long entretien portant sur l’ensemble de sa vie, que je voulais réaliser comme une archive filmée, ce qui impliquait de lire ou relire l’ensemble de son travail. Il s’y était dit prêt. C’est à moi que le temps aura manqué. Pas à lui.
Un souvenir et une remarque pour finir. Le premier pour rectifier une erreur grossière de l’intéressant article de Wikipedia (France) sur André Gorz.
En 1978, on était en pleine révolution iranienne. Les Temps modernes étaient secoués par la question du terrorisme en Europe occidentale. En 1977, l’irrésistible ascension vers le pouvoir du PCI s’était trouvée stoppée par un Mai italien. La violence néofasciste, nous le savons aujourd’hui, largement orchestrée par les services secrets italiens, touchait l’extrême gauche. Une grande partie des membres de la RAF s’étaient suicidés en prison. Les Brigades rouges avaient enlevé Aldo Moro en plein Rome. Les positions de Michel Foucault sur les mollahs iraniens interloquaient Sartre et pas seulement lui. André Gorz, qui jouait un rôle actif dans les Temps modernes et était très lié à Rossana Rossanda, qui dirigeait le quotidien Il Manifesto, n’était pas dupe de la violente campagne lancée par le PCI contre l’extrême gauche (dont le relais passait en France par Marcelle Padovani dans les colonnes du Nouvel Observateur). Il avait accepté la proposition que je lui avait faite d’un gros numéro spécial des Temps modernes, confectionné à partir d’une majorité de textes issus de tenants de l’autonomie ouvrière, issus de la dissolution en 1973 du groupe Potere operaio. C’était une nouveauté, car la revue s’était jusque-là surtout fait l’écho des groupes du Manifesto et de Lotta continua. L’idée du numéro était de montrer l’intérêt théorique de plusieurs analyses de cette composante que l’on appelait la gauche extra-parlementaire et les débats alors en cours dans une extrême gauche mouvementiste prise dans l’enclume d’un PCI devenu furieux depuis les événements de Bologne et la néo-faucille des Brigades rouges. J’avais rédigé une longue présentation de l’opéraïsme italien qui faisait suite à la publication d’Ouvriers et Capital de Mario Tronti chez Christian Bourgois et celle des Ouvriers contre l’État d’Antonio Negri chez Galilée. Cet épais numéro comprenait des textes d’Alberto Magnaghi sur l’usine diffuse, de Romano Alquati sur le syndicat et la question de l’éducation, de Sergio Bologna et quantité de matériaux plus documentaires illustrant la question de la violence diffuse. Nous présentâmes le numéro au cours de deux séances du comité de rédaction des Temps modernes qui se tenait dans l’appartement de Sartre. Un comité réduit à Sartre, Simone de Beauvoir, Benny Lévy, Jean Pouillon et André Gorz.
Benny Lévy, qui ne connaissait pas grand-chose à l’Italie, était occupé à démarquer les Temps modernes du double écueil de la tentation terroriste (que la Gauche prolétarienne avait vécu en première ligne, dans une France toutefois bien éloignée, comme l’Allemagne de la RAF, du degré de fermentation sociale de l’Italie, ce qui changeait beaucoup de choses) et de la tentation foucaldienne se rangeant du côté des centaines de milliers d’Iraniens et d’Iraniennes voilées qui se faisaient mitrailler sans rompre par l’armée du régime du Shah en train de s’effondrer. Il exigea de façon assez coupante, comme à son habitude, que le collectif qui apportait ce numéro spécial se démarque nettement en condamnant toute violence. Il demandait la même position sur l’Italie que sur la RAF allemande. Solidarité contre la répression (de type Secours rouge ou Comité d’action contre les prisons) mais associée à une condamnation politique des moyens, des méthodes.
André Gorz, qui en connaissait beaucoup plus sur l’Italie, était plus subtil. Il avait trop entendu cette dichotomie simpliste et populiste en France et commençait à douter de l’efficacité des analyses de Lotta continua, qui avaient eu toute la place dans les Temps modernes. Sa curiosité le poussait à entendre un autre son de cloche. Sartre également, qui intervint peu quand Benny Lévy eut pris la parole. Il avait manifesté une certaine curiosité, ce qui ne fut pas le cas de Simone de Beauvoir.
L’équipe qui avait préparé longuement ce numéro de 400 pages ne pouvait accepter l’injonction de Benny Lévy. Cela revenait à s’aligner sur la stratégie du PCI, qui consistait à amalgamer tout ce qui se trouvait sur sa gauche et le gênait aux Brigades rouges (sa propre caricature armée), bref tout ce qui se trouvait entre Lotta continua et le Parti de la nouvelle résistance prolétarienne, et qui coïncidait avec la grande majorité des collectifs. André Gorz lui non plus n’était pas d’accord. Mais ne s’exprima pas lors de la seconde réunion où nous expliquâmes à Benny Lévy les problèmes que soulevait sa demande. Le numéro ne fut pas publié. Rétrospectivement, c’est dommage. Mais Gorz démissionna des Temps modernes sur ce numéro, m’expliqua-t-il quelque temps plus tard.
C’était son énième et dernière rupture avec Sartre, qui mourut deux ans plus tard. Au fond, comme il avait combattu Jean Cau, autre bouillant et talentueux secrétaire de Sartre, qui finit très à droite, il combattait depuis 1971 Benny Lévy, dont tout le séparait sauf un pari commun sur la CFDT.
Entre son judaïsme compliqué (son père s’était converti au catholicisme), discret et foncièrement athée et celui plus tapageur et palinodique de Benny Lévy, qui allait servir de modèle à tant d’intellectuels revenus de leurs illusions de jeunesse, il y avait plus que le traditionnel fossé culturel (devenu un sujet de blague) entre le vieux Mitteleuropéen libéral ashkénaze et la nouvelle foi prosélyte d’un Séfarade quasi pied-noir. Benny Lévy avait longtemps été égyptien et avait rallié la France après Suez en 1956. Pourtant, tous deux avaient été naturalisés et avaient dû ruser, par pseudonyme interposé, avec la République.
Le deuxième souvenir, beaucoup plus tardif, fut ma dernière conversation téléphonique avec André Gorz, après mon compte rendu de son livre dans ÉcoRev. Il était désireux de discuter d’une redéfinition du capitalisme de la connaissance. Pour lui, la connaissance est toujours du côté de la réappropriation capitaliste par la codification numérique. Seul un savoir qui a fait sécession avec la science est libérateur. Ses positions sur le revenu d’existence, sur la libération, sur une réévaluation radicale de tout mouvement possible à partir des transformations radicales et du capitalisme et de ceux qui essaient d’inventer autre chose, en faisait un interlocuteur de Multitudes et d’ÉcoRev. Nous conclûmes, avec beaucoup de chaleur de part et d’autre, à la nécessité d’un grand entretien que je voulais filmer chez lui, puisqu’il ne pouvait venir à Paris. Il m’avait déjà expliqué, lorsque je l’avais sollicité pour qu’il participât à une table ronde, qu’il n’était jamais sûr du futur à vingt-quatre heures près. Il invoquait un état de santé très fragile. J’ai compris avec son dernier livre, Lettre à D. L’histoire d’un amour (Galilée, 2006), qu’il parlait d’elle ou de sa « meilleure part ».
Dernière remarque dont je ne peux me dispenser : le double suicide. 1980, le couple devenu infernal ou depuis toujours racinien, Louis Althusser et Hélène Rytmann, rate un double suicide non dominé qui devient un non-lieu de meurtre. Le socialisme est en train de s’écrouler.
2007 : le couple parfait, Gérard et Dorine donnent congé ensemble, sans tapage. André Gorz avait commencé par une vraie morale qui se moque de la morale. Il finit par l’amour serein et l’accompagnement qu’il avait clairement indiqué dans son ultime livre. Philémon et Baucis avaient demandé de ne pas être séparés dans la mort.
Les dieux grecs les exaucèrent en changeant le premier en chêne et la seconde en tilleul. Je ne sais si, dans les deux cents arbres qu’André Gorz raconte avoir planté dans la première maison où le couple s’était retiré, il y avait des chênes et des tilleuls.
André Gorz, pour mémoire s’il vous plaît.