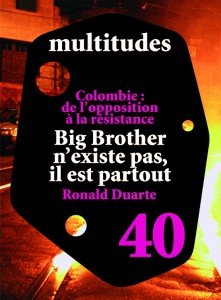« Le progrès consiste à être poussé en avant par la police » (Chesterton)
Frédéric Neyrat
Une hypothèse : à la conjuration du temps s’appareille aujourd’hui la fonction gouvernementale. Pas n’importe quel temps cependant, mais celui qui vient. Celui qui – éventuellement – pourrait venir ; rien n’est moins sûr, et nous verrons pourquoi. On appellera sociétés de clairvoyance les systèmes sociaux qui s’exercent à une telle fonction : élaborer une sorte de contre-investissement préventif de l’avenir susceptible de réorienter les techniques de contrôle et de surveillance existantes ou en construction. Pourquoi, et comment en est-on arrivé là ? Et sur quelle production imaginaire du temps repose cette machination ?
Car s’il est bien question, comme pour tous les genres de « sociétés », de machines et de technologies, et si celles-ci modèlent indubitablement les modalités d’exercice du pouvoir, ces dernières reposent en définitive sur un nouveau rapport à la temporalité dont les termes de surveillance et de contrôle ne parviennent pas à rendre compte. Seule l’élucidation de cette temporalité malveillante et de l’imaginaire aveugle qui la soutient nous permettra d’envisager un à-venir digne de ce nom. La clairvoyance technologiquement assistée ne produit en effet que l’assèchement du futur, c’est-à-dire l’impossibilité du présent. Voyance beaucoup trop claire ; Rimbaud perverti. Cécité programmée qui ne dit pas son nom.
Imaginaire de la surveillance
Dans son livre intitulé Surveillance globale, Éric Sadin définit les éléments qui composent un « continuum ininterrompu » de dispositifs de surveillance : généralisation de l’« interconnexion », de la géolocalisation (type GPS), de la vidéosurveillance, constitution de bases de données, développement de la biométrie, de « logiciels d’analyses comportementales », « miniaturisation des dispositifs », « présence de plus en plus grande de capteurs et d’étiquettes radio (RFID) », à quoi il ajoute aussi « menace terroriste » et « agressivité marketing »[1]. La difficulté consiste bien entendu à penser la consistance de ce « continuum », le rapport entre ce qu’Éric Sadin nomme ses « couches » – mais comment mettre, sur le même plan, terrorisme, marketing et technologies ?
On répondra que, justement, il n’y a pas qu’un seul plan, plutôt un enchevêtrement de contextes et de fonctions, d’institutions et d’acteurs, de visées politiques, étatiques et paraétatiques, policières, économiques, criminelles, et tout aussi bien artistiques. Mais parler de continuum indique l’existence d’une couche supplémentaire : l’état de lissage de l’enchevêtrement, une communication au moins potentielle entre les instances en jeu. Par exemple, la possibilité qu’un fichier constitué pour un usage commercial soit utilisé à des fins policières, et plus généralement la porosité des informations relatives aux comportements, aux déplacements, aux divers paramètres des existences individuelles et collectives. Parler de continuum indique d’abord et avant tout une difficulté de plus en plus grande à limiter l’étendue et la vitesse de récolte et de propagation des informations, autrement dit l’appauvrissement des filtres et des protections : on ne sait pas exactement qui peut voir, savoir, utiliser ces informations, et pour quelles fins. D’où la crainte d’une utilisation exponentielle de la surveillance à des fins de contrôle.
À ce sujet, on dira qu’il est important de rejeter la thèse d’un complot généralisé, d’un usage univoque des technologies de surveillance, si l’on entend par là la maîtrise et la mainmise initiale et finale d’un Acteur Unique qui porterait sur ses seules épaules la réalisation d’un Projet de Surveillance s’exerçant de Haut en Bas. Mais c’est tout simplement que ce type d’Acteur n’a jamais existé dans l’histoire humaine ! Un tel Grand Autre n’a de consistance qu’imaginaire, et la question semble réglée. Or le problème est le suivant : telle qu’elle se profile aujourd’hui, la surveillance est fondée sur une production d’imaginaire. Ce dernier terme est ontologiquement équivoque. Entendons-le, ici, comme lieu pour du semblable. Les « corps statistiques »[2] (pour reprendre une expression d’Antoinette Rouvroy et Thomas Berns) issus des bases de données, ces corps de données informationnelles constitués à partir d’éléments hétérogènes (nom, âge, profession, origine, description physique, goûts, lieux d’habitations, déplacements, activités bancaires, connexions sur l’Internet, etc.), sont des corps homogénéisés supposés aptes à décrire des comportements reproductibles et prédictibles. La dite « réalité » statistique est, en vérité, de l’ordre de la mise-en-lien imaginaire qui cherche à faire l’impasse sur tout réel, si on entend par ce dernier terme la survenue de l’improbable, voire de l’impossible – là où la statistique parie précisément sur le contraire : le probable et le possible. C’est dans ce sillage que s’inscrit le fameux data mining (fouilles de données), technique de collecte et de traitement d’informations ayant pour objectif de faire émerger de façon immanente, par son opération même, des corrélations – c’est-à-dire des connaissances sur tel ou tel comportement attendu. L’imaginaire repose bien entendu ici sur la nature des « données » qui, faut-il le rappeler, sont construites au préalable (par exemple, quelles relations entre tel achat et tel achat à tel moment). L’oubli de cette construction, de cette décision et de cette détermination préalable, conduirait à prendre pour argent comptant ce qu’on nous en dit.
L’effet des technologies de surveillance est de faire consister un certain type d’imaginaire à même les sociétés. C’est cet imaginaire qui s’impose aujourd’hui, et donne matière synthétique à une paranoïa qu’il faut déclarer pour le coup objective (objectivée). Et c’est sur ce fond de matière synthétique, de paranoïa objective et d’imaginaire de la surveillance que se mettent en place, parfois après-coup, les nouvelles formes de contrôle étatiques – on rappellera au passage la façon dont les services de sécurité ont très vite récupéré pour leur propre usage les techniques de data mining…
Syndrome Truman Show
Observons les effets de cet imaginaire synthétique. Dans un lycée de banlieue, un professeur de philosophie tente d’expliquer à ses élèves ce qu’il en est du rapport entre « liberté », « sécurité » et « technologies de l’information et de la communication ». Voulant capter leur attention, il décide de leur dire que leur classe est l’objet d’un « protocole expérimental tenu secret » : des caméras de surveillance bien camouflées enregistreraient leurs faits et gestes afin d’étudier minutieusement leurs comportements. Ces élèves sont d’abord étonnés que ce professeur leur apprenne l’existence de ces caméras, dans la mesure où cette expérimentation, a-t-il pourtant précisé, doit demeurer « secrète ». Puis ils commencent à chercher dans les angles de la salle, et au plafond, les endroits où ces caméras ont été dissimulées. Cette recherche et cette crédulité n’ont cependant rien de stupide, et montrent tout au contraire à quel point est intériorisée la possibilité d’une telle expérimentation. À l’heure où nous écrivons ces lignes (octobre 2009), nous apprenons que des caméras de surveillance devraient être installées dans des collèges du Rhône, notamment à Meyzieu, Vénissieux, Rillieux-la-Pape et dans le 8e arrondissement de Lyon. L’intégration subjective de cette possibilité implique que l’imaginaire de la surveillance est désormais une composante ordinaire de notre rapport au monde.
Ce que pourrait également laisser entendre le repérage par certains psychiatres nord-américains de ce qu’ils nomment le « syndrome Truman Show », du nom de ce long-métrage dans lequel Jim Carrey découvre tardivement qu’il a passé sa vie, et ce depuis sa naissance, dans un reality show retransmis en direct et en continu. Ces psychiatres font état de cas de patients qui se plaignent d’être filmés 24 heures sur 24 dans leur intimité, ou d’avoir été sélectionnés sans leur consentement pour des émissions de divertissement ; l’un d’entre eux menaçait de se tuer si on ne lui permettait pas de sortir de son programme télévisuel. Voilà ce qu’Antonin Artaud aurait appelé un « envoûtement »[3] ! Certes, la paranoïa n’est pas nouvelle, mais la forme qu’elle prend en fonction des époques fait souvent signe vers ce qui manque à la symbolisation pour des populations et des territoires spécifiques, bien au-delà des cas borderline. Car c’est bien une difficulté généralisée de symbolisation des bords et des lignes qui nous concerne tous aujourd’hui. À la différence des analyses qui semblent oublier cette dimension, on notera que Jim Carrey a somme toute eu la chance de pouvoir sortir de son émission permanente, c’est-à-dire la chance de profiter d’une limite entre deux dimensions : la vraie (True Man) et la fausse (Show). Film optimiste en définitive… Car cette chance s’amenuise lorsque les limites s’estompent, lorsque ce n’est plus l’espace qui est investi par la surveillance, ni même le temps passé ou le temps qui passe, mais le temps qui pourrait encore venir et qui n’a encore jamais eu lieu. C’est alors que le manque de Dehors risque de se faire cruellement sentir.
Futur climatisé
Cette dimension temporelle doit être minutieusement décrite. Regardons d’abord comment Deleuze faisait la différence entre les « sociétés disciplinaires » et les « sociétés de contrôle ». Les premières, comprenons-nous, investissaient massivement les sphères du passé, « on n’arrêtait pas de recommencer » écrit Deleuze, on n’arrêtait pas de replonger le corps dans des « moules, des moulages distinctifs »[4]. Le corps est mal fait, se disaient ces sociétés à la manière d’Artaud, et il faut le refaire, il faut recommencer son origine, une éducation qui a mal tourné – non pas pour que le corps « danse à l’envers » comme disait Artaud, mais pour qu’il produise à l’endroit où il faut, dans l’usine, dans l’université. Et s’il aura fallu recommencer sans cesse tout au long du XXe siècle (donc selon nous bien après la date butoir proposée par Deleuze (« début du XXe » dit-il), c’est parce que le programme ne pouvait qu’échouer – le programme de l’Homme Nouveau, le même que celui qui aura été expérimenté par Pol Pot, Mao ou Staline (un programme que certains voudraient aujourd’hui réactualiser, sans métaphore, intégralement, sous le nom de Post-humain). C’est en effet que le passé revient toujours, et le fantasme des sociétés disciplinaires est de faire table rase du passé ; de supprimer l’éventualité des spectres en quelque sorte…
Quant aux « sociétés de contrôle », c’est le présent qui était leur objet d’attention. « Les contrôles sont une modulation » écrit Deleuze, « comme un moulage auto-déformant qui changerait continûment, d’un instant à l’autre, ou comme un tamis dont les mailles changeraient d’un point à un autre ». Bien sûr, on pourrait croire que la modulation est affaire de devenir, mais on se demandera ce que peut signifier un tel devenir si, dans les sociétés de contrôle, « on n’en finit jamais avec rien » – avec la formation continue, la reformation, la requalification, le crédit et l’endettement, etc. Il est clair que la production de continuité est l’objectif de ces sociétés, autrement dit la mise en place d’un éternel présent, le « temps réel » comme on dit. Les sociétés de contrôle ont pour domaine d’application ce que Zygmunt Bauman a nommé la « vie liquide », dans laquelle les individus « sont en mouvement parce qu’ils doivent être en mouvement. Ils bougent parce qu’ils ne peuvent s’arrêter. Telles des bicyclettes, ils ne tiennent debout qu’en roulant. Ils semblent suivre le précepte de Lewis Caroll : « Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu’on peut pour rester au même endroit »[5]. Un tel « devenir » a ni plus ni moins pour ambition de supprimer le présent – la halte, l’inertie, une immobilité ne serait-ce que passagère, nécessaire pour sentir les contours de notre « éphémère destinée » (Freud).
Mais le futur est l’objet direct des sociétés de clairvoyance : ce n’est pas le passé qu’il s’agit de recommencer avec un nouveau moule, ni le présent qu’il faut moduler instant par instant au sein d’une continuité factice, c’est le futur qu’il s’agit de mouler ou de moduler avant même qu’il n’ait lieu, de façon préventive grâce à la dataveillance. Si, pour suivre encore le schéma deleuzien, les sociétés disciplinaires avaient le corps pour enjeu (bio-politique), et les sociétés de contrôle l’âme ou l’esprit (noo-politique), alors les sociétés de clairvoyance voudraient identifier la glande pinéale, c’est-à-dire quelque chose qui n’existe pas (ecto-politique). Et, pour citer un philosophe qui croyait fermement en l’existence de cette glande, on lira avec un drôle de regard ces quelques lignes qui datent du XVIIe siècle : « Et on peut aisément concevoir que ces images ou autres impressions se réunissent en cette glande par l’entremise des esprits qui remplissent les cavités du cerveau, mais il n’y a aucun autre endroit dans le corps où elles puissent ainsi être unies, sinon en suite de ce qu’elles le sont en cette glande »[6].
Neutralisation préventive
Imaginaire de la surveillance, reproductibilité et prédictibilité, annulation du futur, avons-nous dit – mais que voulons-nous dire exactement ? En quoi la surveillance contemporaine mériterait-elle d’être pensée bien plus à partir du temps que de l’espace ? Revenons à ces élèves, qui ne seraient pas surpris d’apprendre que leur classe est truffée de caméras. Ils sont en fait, comme tout le monde, les sujets d’un monde globalisé, où l’espace semble s’être rejoint lui-même, touchant ses bords et se transformant en une sorte de ruban de Moebius, surface unilatère qui rend indiscernables l’endroit et l’envers. Nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises d’analyser cette nouvelle donne topologique et topolitique[7], qui conduit à une fermeture de l’espace global, et le sentiment inquiétant qu’elle provoque d’une absence de Dehors. Cette absence est sans aucun doute erronée, mais ce leurre engendre l’espoir d’une nouvelle conquête, celle du temps. D’un temps qui échapperait à cette fermeture du globe, ni passé retenu dans la mémoire et les pierres sculptées, ni présent qui défile sous nos pieds ou sous nos yeux, mais à venir, encore absent, brisant l’autisme topologique contemporain. Comme si l’avenir était devenu le dernier des Dehors à exploiter, dans lequel il serait possible de fonder de nouvelles enclosures et bientôt n’en doutons pas de nouveaux droits de propriétés, voilà pourquoi la pré-vision serait passée au stade d’enjeu politique crucial.
Il serait certes idiot de considérer cet enjeu comme quelque chose de nouveau, et l’on connaît la formule d’Émile de Girardin, « gouverner, c’est prévoir », reprise – entre autres – par Pierre Mendès-France. Classiquement, on pourrait dire que la prévision prépare le présent pour un futur qui arrive. Or les sociétés de clairvoyance réparent le futur pour qu’un présent n’arrive pas. On peut qualifier cette prévision de préventive, elle cherche la neutralisation par avance, ou l’immunisation proactive : il s’agira toujours d’agir avant que quelque chose de véritablement ou de suffisamment autre puisse advenir. De la base de données ne devra s’élever aucun sommet imprédictible, aucun acte aberrant, qu’il soit politique ou commercial, qu’il concerne un trajet touristique, un déplacement pour aller travailler ou une manifestation. La neutralisation préventive est l’objectif par lequel s’opère la réorientation fonctionnelle de la surveillance et du contrôle par les sociétés de clairvoyance. Fondamentalement, il s’agit de produire la confusion de la vision et de la prévision, des sens et des pressentiments par l’automatisation de la perception, autrement dit par la détection.
Cette confusion est patente dans le domaine juridico-politique, comme nous avons pu pour partie l’analyser ailleurs[8] : 1/ déplacement des fondements du Droit de la catégorie de l’acte vers celle de l’intention – comme si l’enjeu désormais se déplaçait de la question de la requalification juridique d’un acte après qu’il a eu lieu vers l’éventualité de sa neutralisation préventive : empêcher l’acte avant qu’il ne se réalise en supposant certaine ce qui n’aurait pu être que la probabilité de sa survenue ; 2/ production du concept de terrorisme comme exception transportable, pouvant s’adapter à tout acte, toute intention, toute situation, toute personne, concept aussi flexible que le capitalisme contemporain ; 3/ apparition dans le discours pénal d’avatars linguistiques du terrorisme, ce signifiant majeur à tout faire, telle la notion de « dangerosité » comme prédisposition au crime ; 4/ lois qui agissent sur ces prédispositions, comme celle sur la « rétention de sûreté » du 25 février 2008, qui autorise l’enfermement dans des centres « médico-socio-judiciaires » de personnes déjà condamnées à plus de quinze ans de prison pour crime. Cette armature juridico-politique doit être comprise à la fois comme effet de la nouvelle donne topologique et tentative de la maîtriser.
C’est pour cette même raison topologique que l’on trouve, dans le domaine du marketing, les mêmes intentions – si l’on peut dire… – préventives que celles des États. La société Blue Eye Video se présente comme spécialiste des « analyses de fréquentation ». Sur son site, elle se définit de la sorte : « La mesure de files d’attente en temps réel vous permet d’identifier instantanément les points de congestion et de connaître le temps d’attente. L’analyse de la fréquentation vous offre la possibilité d’augmenter fortement la performance commerciale de votre réseau. Enfin, l’analyse du parcours marchand peut vous apporter une information d’une incroyable richesse : la compréhension du comportement des potentiels acheteurs en magasin. Le comptage est donc une valeur ajoutée à l’analyse de la fréquentation pour la distribution, les infrastructures d’accueil du public et pour les aéroports ».
Mais la « valeur ajoutée » pour l’État est indéniable, lorsque Blue Eye Vidéo dénombra à leur insu des manifestants lors d’un défilé à Grenoble : alors que la CGT en comptait plus de 60 000 et les RG 14 000, Blue Eye Video en recensait 21 000[9]… Le slogan de cette société est éclairant : « réduire l’attente par l’innovation ». Réduire l’attente – des Pouvoirs ? Réduire l’écart qui sépare encore un peu trop le marketing de la gouvernance, afin d’intensifier le continuum d’immunisation préventive ?
Histoire, souveraineté et virtualité
Dans une telle configuration, on se demandera s’il est tout simplement possible de sortir du schème de l’anticipation immuno-préventive. On ne pourra répondre à cette question qu’en élargissant le cadre d’analyse. Car le problème avec ces expressions de « sociétés » (de surveillance, de contrôle, etc.), c’est qu’elles nous collent à ce qu’elles analysent, sans distance suffisante. D’autant plus quand les technologies en jeu ont pour ambition, littéralement, de nous coller à la peau (puces RFID, mesures biométriques, etc.). Ouvrons l’espace, ouvrons le temps, creusons les dehors. Rappelons que ces « sociétés » ne définissent qu’une part variable de la constitution historique, celle-ci comprenant des processus au long cours. L’histoire est un agencement fait de rythmes distincts, plus ou moins lents ou rapides, pour partie décrochés les uns des autres, en interaction parfois différée ; de même que les changements n’affectent pas toujours la totalité d’un individu (coupure, fêlure, rupture, nous disent Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux (chap.8), ce n’est pas la même chose[10]). On se situe toujours aujourd’hui dans une certaine forme de capitalisme, qui a commencé au XVe siècle, et si les sources de la valeur ne sont plus les mêmes (« capitalisme cognitif »), le secret de l’accumulation primitive persiste assez pour se faire connaître pour l’invariant qu’il est : l’expropriation. Ajoutons à cet invariant tenace l’existence d’une histoire « quasi immobile », pour reprendre les mots de Fernand Braudel, cette « histoire des hommes et de leurs rapports serrés avec la terre qui les porte et les nourrit », « presque hors du temps »[11]. On dira dès lors que le syntagme « les sociétés » désigne la part qu’il a fallu faire varier pour que s’accordent entre elles, tant que faire se peut, les différentes strates et temporalités qui désajointent l’Histoire d’elle-même. « Les sociétés » signifient non pas la superstructure (étatico-juridique) face à l’infrastructure (capitaliste) – on ne dit pas la société – mais plutôt : des solutions juridiques, politiques, sociales, économiques, éducatives, communicationnelles, qui ont été élaborées pour ajointer les situations, pour relier la Terre et les hommes, le matériel et l’immatériel, le temps qu’il fait et le temps qui passe, le quasi-immuable et le périssable.
Mais il y a des solutions dont le statut consiste à étouffer la question, nier leur écart à celle-ci, donc empêcher la pensée qui aurait pu en émerger au profit d’un calcul s’y adaptant. Ainsi fonctionnent les Pouvoirs, dont toute l’intelligence – et elle existe – consiste à s’adapter sans changer, c’est-à-dire à nier les virtualités libératrices qui apparaissent à l’occasion d’un nouveau problème. On dira ainsi, par exemple, que les sociétés de souveraineté n’auront fait que dénier l’origine abyssale de la souveraineté une fois celle-ci décapitée (ou découverte par le retrait du divin) ; que les sociétés disciplinaires n’auront fait que transfuser la souveraineté au moment où celle-ci aurait pu être déconcentrée ; que les sociétés de contrôle n’auront fait que décentraliser la souveraineté alors que celle-ci aurait pu se dissoudre dans les réseaux. Il faut, de la même façon, comprendre les sociétés de clairvoyance comme un pareil exercice de la négation de virtualités libératrices. Au moment même où le partage des réseaux informatiques et des milieux naturels aurait pu s’avérer caduque, où de nouvelles formes de relations inédites auraient pu s’affirmer, les sociétés de clairvoyance font de la Relation un nouveau système de capture et d’assujettissement. Au moment même où le temps aurait pu se libérer, comme un enfant qui joue, dans un espace globalisé vraiment post-colonial, il devient investi par la répression. Les sociétés de clairvoyance se définissent par un investissement de l’axe temporel afin de segmenter l’espace globalisé des relations. C’est désormais le devenir du temps subjectif qui devient l’objet de la « puissance absolue et perpétuelle » (pour reprendre la célèbre formule de Bodin) des Républiques chronocratiques.
Conseil de la sentinelle : ne pas veiller trop tard
Nous disons qu’on ne pourra remettre en cause l’installation des sociétés de clairvoyance sans repenser l’ensemble des relations qui composent notre monde, de même que nos rapports à l’Histoire dans tous ses aspects. Il est à ce titre important de rappeler que la forclusion de l’a-venir opérée par les sociétés de clairvoyance est parallèle à un autre processus de destruction programmée du temps, météorologique celui-là. Tout se passe comme si les technologies d’anticipation préventive redoublaient le laisser-faire de la catastrophe écologico-climatique, en une sorte d’inversion cauchemardesque : là où il faudrait fixer avec certitude, pour le changer, l’horizon du désastre climatique, on fait comme si celui-ci n’existait pas ; là où il faudrait défixer les devenirs individuels et collectifs, on fait comme s’ils existaient. Dans les deux cas, nous vivons une sorte d’expropriation du temps. Faudrait-il exproprier les expropriateurs ? Mais comment entendre une telle formule à l’ère globale ?
Il faut l’entendre, justement, de façon globale, et s’attacher à comprendre les racines imaginaires de notre socle « social-historique », pour reprendre les termes de Cornélius Castoriadis. L’imaginaire aveugle des sociétés de clairvoyance consiste à ne pas voir l’impossible, l’irrémédiablement obscur, les failles, la multiplicité des temporalités, des rythmes et des devenirs, ces désajointements ontologiques par lesquels naissent et meurent les mondes. Comme s’il s’agissait d’un imaginaire se niant lui-même, fonctionnalisé au point d’être incapable de soutenir le régime d’absence qui est à l’origine de toute image. Pauvre et triste clairvoyance… L’imaginaire dont nous avons besoin aurait les paupières mi-closes, capables de regarder et de faire image sans se brûler les yeux au soleil de la transparence, dessinant les lignes au-delà desquelles seraient laissées dans l’ombre – délibérément – nos parts inchoatives. Cet imaginaire de la dissemblance, qui saurait couper l’état de veille au profit du rêve, du sommeil et des espaces vacants, est ce dont nous avons besoin pour prendre soin de nos corps et de nos âmes. Nos sociétés pourraient s’en inspirer.