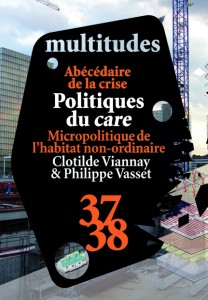Les pages qui suivent constituent le premier numéro d’un cahier sur la bande dessinée contemporaine, à paraître au sein de Multitudes tous les trois numéros.
Aujourd’hui, une part minoritaire mais bien réelle des auteurs de bande dessinée cherchent à inscrire leur pratique dans un cadre différent de la logique plastique et narrative qui a jusqu’alors prévalu dans leur domaine. C’est particulièrement vrai des auteurs publiés par les maisons d’édition «alternatives» et indépendantes, tournées vers une bande dessinée d’expérimentation et ouvertes au champ des pratiques artistiques contemporaines[1]. Nous pouvons alors observer l’apparition de formes de plus en plus expérimentales et novatrices, soutenues par des démarches d’« a-narration», de rupture avec la «monoforme» et le récit d’identification à structure linéaire, c’est-à-dire une remise en cause de plus en plus radicale et systématique des logiques et des codes qui ont été ceux de la bande dessinée pendant près d’un siècle.
Ces évolutions et cette tendance rendent nombre de productions récentes particulièrement riches et originales. Un espace alternatif dynamique et singulier émerge, bouleversant en profondeur la bande dessinée et ses thèmes, son graphisme, ses préoccupations et son audience.
Il nous a donc semblé intéressant de créer dans la revue Multitudes un espace pour donner la parole aux acteurs de ces évolutions et de rendre compte du foisonnement de la bande dessinée contemporaine, sans bien sûr exclure certains auteurs, dits plus « classiques », des productions passées et présentes.
Pour ce premier numéro, nous avons invité Ilan Manouach, auteur de nombreux livres dont les plus notables sont sans doute Les lieux et les choses qui entouraient les gens, désormais et Frag. Ces deux œuvres se distinguent par un jeu inédit sur la narration comme sur la forme graphique et elles font pleinement partie de cette dynamique particulière de la bande dessinée contemporaine allant vers l’expérimentation et la remise en cause des codes classiques de la narration. Poursuivant son travail d’exploration engagé dès La mort du cycliste, son premier livre, le travail publié ici est une intervention sur un classique de la bande dessinée, Petzi. En effaçant tous les personnages à l’exception d’un seul, de peu d’importance dans l’histoire, il transforme le sens d’une bande dessinée enfantine pleine de bon sentiments (illustrant une aventure de solidarité collective dans le but de reconstruire une maison) en un livre conceptuel, ironiquement intitulé vivre ensemble.
Les livres d’Ilan, particulièrement beaux et parfois difficiles d’accès au premier abord, portent la marque d’une réflexion et d’un questionnement pertinent et radical sur l’image et la bande dessinée contemporaines ; raison pour laquelle nous l’avons choisi pour inaugurer ce cahier. Nous espérons qu’il saura ouvrir au lecteur de nouveaux horizons sur cet espace singulier.
La bande dessinée d’Ilan Manouach : l’héritage du cinéma, l’usage de repères et la place du sens
Thomas Boivin[*] : Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier livre Petzi (vivre ensemble)?
Ilan Manouach :Vivre Ensemble est le remake boiteux de Petzi fermier. J’ai scanné la totalité de l’album et j’ai retiré tous les personnages, comme s’ils n’avaient jamais été dessinés, en les remplaçant par la texture du décor. Le seul personnage qui reste est Riki le pélican, un figurant de peu d’importance vers lequel sont tournés tous les phylactères de l’histoire. Il se balade tout seul dans un village, où se détruit puis se construit toute seule une maison, et Riki, simple spectateur, prononce les paroles de tous les personnages manquants.
Selon J-C. Menu[2], c’est un exercice oubapien de caractère lipogrammatique. Pour moi il s’agit d’une traduction dont la plus grande part du texte reste encore opaque au traducteur lui-même, où l’histoire devient l’obstacle à sa propre lisibilité.
J’ai reçu les droits de PIB Copenhague afin de publier cet album, Casterman m’a refusé les droits de traduction, donc j’ai dû procéder à une nouvelle traduction de cet album.
T. B. : Penses-tu t’arrêter là ? Ou y a-t-il d’autres livres, que tu souhaites faire, qui prolongent ce geste ?
I. M. : Je travaille actuellement sur une nouvelle adaptation. Il s’agit du Dernier des Mohicans, un des numéros de la série des Classiques Illustrés, très populaire en Grèce. Ils traitent d’habitude de la vie de grands personnages de l’Histoire, ou bien de contes, avec toujours un caractère moral et dessiné majoritairement par de médiocres professionnels. En Grèce, c’est toujours ce qu’il y a de plus populaire en bande dessinée.
Cette adaptation fait partie d’une approche narrative basée sur la transformation des récits existants suivant des manipulations simples et directes, à l’image des manipulations arithmétiques (addition, soustraction, multiplication). Après l’opération, le récit, qui est jusque-là un ensemble en complet équilibre et cohérent, se trouvera être l’image même du handicap (handicap aussi bien au niveau microscopique de la composition de l’image qu’au niveau macroscopique de la narration et de la didactique). L’équilibre morphologique de l’histoire devrait s’en trouver bouleversé.
Ses parties changeront de formes, tantôt hypertrophiées, tantôt rachitiques, montreront désormais l’incapacité du récit à communiquer son thème (une des données constantes de ma recherche) ou pire encore, son incapacité à ne pas trahir ses propres intentions morales. Le récit devient geste. Geste de regret, d’automutilation ou bien de digestion ostentatoire de ses propres ressources, l’image de sa propre avarice, l’icône de son repentir. Repentir de vouloir raconter la disparition de peuples, la destruction des civilisations sans tolérer sur son propre corps la moindre mutilation, la moindre écorce, de vouloir briser le silence, sans faire le vide en soi-même. La narration elle-même opaque devient une vitre poreuse entre le livre et le lecteur.
T. B. : Peux-tu nous parler plus largement de tes travaux à venir ?
I. M. : Je travaille actuellement sur un projet en collaboration avec Pedro Moura, critique et commissaire d’expositions au Portugal. Les textes de Moura, dont je fais l’illustration, sont inspirés d’un écrit de Walter Benjamin faisant référence à un tableau de Paul Klee, L’Angelus novus. Un autre projet est une série de livres sous le titre de Limbo.
T. B. : Les travaux à venir que tu cites, comme certains de tes précédents livres (La mort du cycliste, Les lieux et les choses) sont plus « dessinés » que Vivre ensemble ou Le dernier des mohicans. Quel rapport y a-t-il entre le fait de dessiner et le fait d’intervenir sur le travail d’un autre ?
I. M. : Je me suis aussi demandé pourquoi j’ai l’impression de m’éloigner du dessin, mais je commence à comprendre qu’il s’agit d’un faux problème. Dessiner ce n’est pas forcément prendre son crayon, tracer des lignes et joindre des points ou remplir des formes. Dessiner c’est agencer des formes, articuler des silences, bouleverser des fonctions, créer de nouveaux besoins narratifs, en gros réaménager un espace. Un détournement comme Vivre Ensemble et une bande dessinée classique comme Les Lieux et Les Choses ne sont pas si éloignés quand on comprend que les pages déjà imprimées de l’un et les pages blanches de l’autre sont un matériel de base, toujours à réaménager, les pages vierges étant à mon sens déjà lourdement structurées.
T. B. : Et lorsqu’il s’agit de « dessin » au sens le plus traditionnel, comment est-ce que tu t’y prends d’un point de vue pratique ?
I. M. : Le métier de dessinateur me paraît excessivement lent et fastidieux. Bien que l’espace de la feuille soit d’habitude petit, et l’objet final un livre, le processus des professionnels est ponctué d’un rituel rigoureux ou les étapes s’accumulent allant du découpage au repérage, du crayonné à l’encrage, du lettrage au scannage… J’essaye au contraire de rendre ce travail humainement compatible avec mon envie d’en finir avec l’objet, de brûler des étapes, de me satisfaire d’un procédé rapide et peut être moyennement efficace, mais qui s’adapte mieux à mes propres rythmes. Ainsi j’apprends parfois à donner moins d’importance à des aspects secondaires de cet artisanat et aussi à accepter ce que j’ai sous la main, indépendamment du style, et plus en fonction de mes envies du moment.
T. B. : Essayes-tu de prendre de la distance vis-à-vis des images plus construites ?
I. M. : Je ne reproche rien aux images construites. J’essaye de trouver une manière de rendre le travail de création plus facile, plus vivable et faisant partie de mon quotidien sans constituer une rupture.
T. B. : De manière générale, j’ai l’impression qu’il existe, chez toi comme chez d’autres, l’usage de certains thèmes, de certaines manies de mise en scène, de certains motifs.
I. M. : Il y a souvent des images qui me reviennent, des thèmes qui me sont familiers ou dont je me sens confortablement étranger.
T. B. : On pourrait même dire que, d’une certaine manière, c’est la répétition qui semble ton seul lien à la bande dessinée.
I. M. : La bande dessinée est encore hantée par un fantôme, qui vient du cinéma, et qui nous pousse à concevoir l’espace comme quelque chose où l’on peut naviguer comme avec une caméra. Un espace en 3D où l’on peut discerner des choses en profondeur, tourner autour des personnages, etc. La seule manière d’assurer une continuité en bande dessinée et d’entretenir une illusion d’un espace fluide, qui se trouve quand même disséqué par la nature même du support, passe donc par l’usage de repères. Une porte, une ombre, une convention de représentation sonore. Les repères deviennent des objets hypertrophiés de sens afin de rendre l’espace navigable comme l’est l’espace cinématographique. Ces objets sacrés, garant de continuité dans le royaume même du discontinu et de l’abstraction sont devenus les reliques d’un espace à défendre et à protéger qui n’est pas le mien et qui peut être n’est pas celui de la bande dessinée non plus. On peut dialoguer avec cette hypertrophie, mais pas la naturaliser.
T. B. : Mais comment ne pas créer de repère sans être abstrait ? Dans ce cas, est-ce que détruire les repères est pour toi un objectif ?
I. M. : Il ne s’agit pas d’éviter les repères à tout prix, ni d’avoir peur de devenir abstrait. La continuité et le sens, s’ils sont des besoins narratifs, doivent être défendus d’une manière plus éloquente et pas avec une garantie d’artifices. Ces conventions ne sont pas propres au médium, car ce sont celles héritées du cinéma. Et si, disons, la bande dessinée devait nier tout poids qui viendrait du cinéma, comme un acte d’indépendance fanatique, elle doit alors devenir abstraite. Abstraite pas au niveau du dessin, mais au niveau de son espace, des déplacements dynamiques, de la constance de ses caractères, de la fluidité des ombres et des lumières, etc. La dette au cinéma me semble beaucoup plus grande que celle à la littérature et au dessin. Détruire n’est pas un objectif, mais dialoguer avec ces conventions et ne pas défendre leur aspect naturel permet de mettre de l’intelligence dans un récit.
Dans un de mes prochains livres, le seul repère commun entre les images est la figure d’un crocodile qui se promène. Voici un repère vide qui ne garantit plus la défense d’un sens, et qui par la répétition de ses manifestations ne nous apprend rien, qui ne sert plus à naviguer, qui est lui-même soi-disant perdu dans la narration. La question des repères pose une question plus grande encore. La bande dessinée n’a pas encore vécu cette phase qui est peut-être indispensable à un art : essayer de s’autonomiser, de devenir compacte, et d’éliminer tous les subterfuges qui font qu’elle se dédie à des hommages. Il est possible que la bande dessinée soit un support bâtard de toute façon. Mais la peinture a vécu cette phase, avec les écrits par exemple de Greenberg, où défendre un espace à deux dimensions, celui de la toile, était devenu une religion et tout élément, qui donnait l’idée d’une profondeur, était considéré comme une pauvre concession. La musique aussi, au début du XXe siècle a dû renoncer à l’illustration et devenir son de nouveau, ne plus imiter le bruit des vagues, mais s’imiter elle-même. Ce sont des phases qui se consument dans un dogmatisme aveugle mais qui sont indispensables au mûrissement des pratiques artistiques et rien de pareil n’est jamais arrivé à l’histoire de la bande dessinée. Peut-être qu’en étant tellement en retard sur les mouvements contemporains de la pensée, en plein dans une époque méta-moderne désillusionnée, la défense d’un espace à soi paraît ne plus avoir aucun sens. Mais ce n’est pas sûr.
T. B. : Te préoccupes-tu tout de même parfois du « lecteur » Es-tu toi-même lecteur de bande dessinée ?
I. M. : Le lecteur est une construction, davantage même, dans le milieu indépendant où il demeure une construction fictive. Être lecteur veut dire affirmer de manière active sa disponibilité face à un livre. Si le lecteur est celui qui est avide de se retrouver, d’être dans un terrain familier, alors il ne m’intéresse pas. Je n’ai jamais appris ces codes, je n’ai jamais été moi-même un lecteur passionné, j’ai toujours préféré la musique. Quand on est lu par 300 personnes, on n’a rien à perdre et défendre des codes et des fonctions pour affirmer cette construction du lecteur est un non-sens.
T. B. : Est-ce ce désintérêt pour le lecteur qui permet le côté volontiers ésotérique d’une partie de ton travail ?
I. M. : Je pense qu’il y a un besoin vital de considérer les choses dans leur rapport avec le reste. Il n’y a rien de plus dur que d’accepter que l’être est fermé sur lui-même, qu’il constitue un miroir pour lui seul. Au début du siècle, une théorie physique essayait d’expliquer comment se répand la lumière et comment se transmet l’énergie. On avait inventé, afin de prouver la propagation de la lumière, l’existence d’un support matériel, une sorte de fluide qui était censé remplir le vide de l’univers, nommé « éther luminifère ». L’Éther, d’après le nom d’un dieu de la mythologie grecque, propageant la lumière dans le monde, est omniprésent. On avait là affaire à la forme la plus scientifique que pouvait trouver la foi.
Les théories du complot sont peut-être le nouveau substitut de l’éther. Les choses aussi déconnectées qu’elles puissent paraître font alors partie, même avec les plus grandes pressions et en dépit de toute logique, d’un large ensemble qui les dépasse toujours. Les méga-théories de conspiration (conspirer=respirer ensemble) mettent en relation un marché illicite de diamants, des transmetteurs radio silencieux, les dollars maçonniques et des complots sionistes afin d’assassiner les Noirs en inventant le SIDA.La théorie devient elle-même en quelque sorte l’éther d’un univers toujours à déchiffrer et c’est via cette théorie que cet univers peut se déplier. C’est une envie toujours en expansion parce qu’on n’est jamais assez conspirateur et l’on peut toujours croire d’avantage en la complicité des choses. Je m’intéresse à la forme que prennent les conspirations, elles sont un monument du langage, une ode à l’abstraction et à l’artificialité de tout espace naturel. J’ai envie de construire un espace absolument artificiel, où une unité est donnée aux éléments hétérogènes, par contiguïté physique, puisque les liens de proximité sont les plus forts dialectiquement et les forcent ainsi à faire partie d’un large ensemble. Si ce travail est perçu comme ésotérique, c’est parce qu’il incarne une foi, celle de l’appartenance sans condition à quelque chose de plus large.
T. B. : Une dernière question : comment appréhendes-tu l’idée que, peut-être un jour, la bande dessinée underground attirera suffisamment les regards pour devenir un enjeu pour les collectionneurs ? Comment gérer cette relation à l’art contemporain et à son marché ?
I. M. : Je ne trouve pas le débat sur l’insertion de la bande dessinée dans les enjeux de l’art contemporain très pertinent. Ce marché s’occupe de la bande dessinée en vendant des planches et des dessins avec le même intérêt que lorsqu’il vend des peintures, donc avec des « termes » qui sont déjà ancrés dans ce marché. Il n’a pas fait l’effort de créer une place à part entière. J’ai des doutes quant à ce qui est vraiment le support physique d’une bande dessinée. Je crains que ce ne soit absolument pas la planche originale, que, si support physique il y a, ce soit le livre, la page Web, le fanzine etc. L’idée de l’original disparaît, c’est un objet sans dimensions, un objet qui peut être exposé pour le seul intérêt archéologique. Le magnifier condamne la bande dessinée et plus encore la narration, un processus cérébral toujours à déchiffrer, à vivre sous l’ombre de la peinture ou de la gravure.
nclure des auteurs de bande dessinée dans des expositions d’art contemporain, c’est plus une manière de leur manifester un respect en les considérant comme des « artistes » qu’une preuve de la bonne volonté du marché à faire une nouvelle place et vraiment accepter ce support.
Notes
[ *] Thomas Boivin, auteur et éditeur. En 2008, il intègre la Cinquième Couche après plusieurs expériences de micro édition. Il y prépare aujourd’hui plusieurs livres : le premier, Antoine, sortira en 2010. Il a publié également deux articles sur la bande dessinée dans la Revue Internationale des Livres et des Idées. Après avoir participé à l’organisation de l’exposition « coup de grâce », il coordonne actuellement une exposition sur le dessin.
[ 1] De même, bien que son rôle ne soit pas volontiers mis en avant, la bande dessinée contemporaine occupe une place non négligeable dans le renouvellement du dessin.
[ 2] Auteur et dirigeant de L’Association, la plus connues des maisons d’édition indépendantes en bande dessinée.