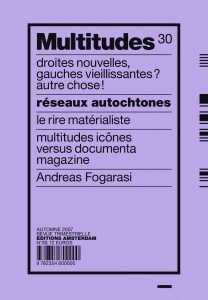Une des urgences épistémologiques et politiques en anthropologie aujourd’hui nous semble être d’argumenter l’infertilité des amalgames — de plus en plus courants — entre les revendications territoriales des peuples autochtones en termes d’indigénité et les revendications nationalistes où l’identité est crispée sur un essentialisme exclusif. Nous sommes convaincus par nos rencontres dans le Pacifique, en Australie, au Sahara, en Inde ou en Sibérie que les peuples autochtones cherchent à définir une souveraineté qui n’est pas celle de l’État, mais une manière d’être au monde qui relie par des connexions diverses, politiques ou ontologiques, ces 6 % de la population mondiale dont les représentants élaborent depuis vingt-cinq ans une charte des droits fondamentaux à l’ONU[1] . Plutôt que de se situer dans le postcolonialisme, les postures performatives autochtones cherchent à prendre au corps la colonisation qui, comme un virus, continue à se répandre là même où on l’a crue éradiquée. Le rejet actuel des revendications autochtones dans les milieux intellectuels qui se parent de droits de l’homme repose sur un dualisme primaire opposant essentialisme et cosmopolitisme. C’est un discours de droit occidental qui se cache derrière le masque de l’universalisme car il refuse d’écouter ce que les autochtones renvoient non comme altérité mais comme alternative. L’opposition certes n’est pas nouvelle — en 1982 lorsque Guy Scarpetta faisait son « Éloge du Cosmopolitisme » dans Art Press, il rejetait déjà les discours indigènes comme des survivances sans avenir, et en réponse à une lettre de lecteur se moquait des nostalgiques du bon sauvage, invoquant les artistes sous influence comme Artaud qui lui semblaient bien plus intéressants parce qu’ils étaient revenus de chez les Indiens plutôt que d’y être restés.
Empowerment
Seulement voilà, le sauvage qui nous intéresse n’est pas celui du mythe du « bon », ce serait plutôt l’irréductible, le monstrueux, celui qui résiste au nom d’autres formes de futur. Que ce soient les 8 millions de Mélanésiens qui viennent de se fédérer pour s’opposer à l’ingérence de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande à Fidji, les Mapuche du Chili et de l’Argentine qui sur Internet boycottent Benetton qui leur a interdit d’accéder à leur rivière pour pêcher, ou encore les Aborigènes d’Alice Springs qui refusent 60 millions de dollars offerts par le gouvernement australien à condition qu’ils abandonnent leur coopérative de logement, les peuples autochtones démontrent une époustouflante capacité de réponse à toutes nos injonctions de la modernité. Certes ils prennent tout ce que le reste du monde prend pour prétendument mieux vivre ou plutôt plus « vite », mais ils combinent tout cela autrement pour se l’approprier, par exemple en revendiquant le contrôle de leur patrimoine matériel et immatériel, la propriété intellectuelle de leurs savoirs, de leurs représentations et aussi de leurs écosystèmes, revendications avec lesquelles divers pouvoirs d’État ou privés sont contraints de jouer, comme nous le montre ici Chantal Spitz, poétesse, romancière et essayiste polynésienne. Lorsque l’anthropologue Marshall Sahlins reconnaît ces dispositifs autochtones consistant à refabriquer du social en bricolant des idées, des mots et des choses, une armada se lève en France, mais aussi dans le milieu anglo-saxon, pour en appeler à la fameuse distanciation qui à défaut d’être encore scientifique se suffit d’être eurocentrique. Comme si tout cela était du folklore, de la superstition, des tentatives magiques de l’impuissance face au grand manitou de la globalisation et son rouleau compresseur économique et technologique. La résistance culturelle est-elle forcément folklorique ? Que fit d’autre notre Renaissance en Occident ? L’Occident semble se moquer des tentatives des peuples autochtones qui s’ancrent dans des lieux (souvent mouvants) et demandent une souveraineté qui n’est pas nécessairement nationale mais s’affirme dans les réseaux d’alliance tant artistiques que politiques. Pourtant, ceux-là mêmes qui affichent le cynisme des blasés de l’histoire n’hésitent pas à s’appuyer en Europe sur la vieille culture, car sans elle nos avant-gardes artistiques n’existeraient pas comme telles car personne ne pourrait apprécier, rire et commenter toutes les références qui y sont cryptées. Sans références historiques et intellectuelles, il n’y aurait en fait plus d’objets d’art. Eh bien, pour les autochtones, c’est à nous d’apprendre à décrypter ce qui de leur point de vue les fait rire, ce qui est sérieux et « authentique » et ce qui a de la valeur à leurs yeux. L’humour n’a jamais été le monopole des colons. Il fut toujours une arme de résistance dans toutes les situations de conflit et d’oppression. Tous les peuples du monde ont connu des situations conflictuelles, qu’elles soient coloniales ou précoloniales. Aujourd’hui tout se mélange. Il y a de nouvelles élites de toutes origines et de toutes couleurs politiques : il y a des animosités ancestrales, des vendettas et de nouvelles fractures qui opposent de nouveaux ennemis, mais au fond la bataille est toujours la même : il s’agit d’articuler des marques mémorielles et des expérimentations sociales. En ce sens les performances autochtones sont authentiques lorsqu’elles font plaisir d’abord à ceux qui les imaginent et les pratiquent ou à tous ceux qui les consomment.
Présence
Le ministre australien Mal Brough dénonçait en 2006 le supposé « collectivisme » ou « communisme » des communautés aborigènes au nom de l’échec du collectivisme dans le monde, soit des systèmes dits communistes d’Europe ou d’ailleurs. Quoique certains fantasment sur le mythe du communisme primitif, l’utopie sociale que les communautés aborigènes ont essayé de construire durant ces trente dernières années n’avait rien à voir avec les systèmes totalitaires portés par un réseau de police secrète. Les communautés aborigènes offraient au contraire des réseaux de parenté où l’autonomie individuelle était valorisée et les alliances sans cesses renégociées. La sortie des réserves et le mouvement de retour à la terre des Aborigènes — plusieurs centaines de groupes de langues différentes — dans les années 1970-80, a fait émerger ces milliers de peintures aux formes et couleurs qui ont défié tant l’histoire que le marché de l’art contemporain : une vente, en mai 2007, a atteint le record d’un million de dollars. Toutes ces peintures cryptent des histoires complexes mais toutes sont ancrées dans un lieu ou un réseau de lieux, des sites sacrés, dits de Dreamings pour leurs auteurs, des « rêvants », soit des virtualités de vie qui lient les humains à d’autres existants dans des réseaux de récits à la fois passés, présents et futurs.
Djon Mundine, auteur du Memorial — 200 poteaux funéraires érigés en 1988 pour le deuil que représentait pour son peuple la commémoration du bicentenaire de la colonisation de l’Australie — rend hommage ici à deux artistes aborigènes décédés. La priorité accordée aux « devenirs » existentiels plutôt qu’à l’essence au sens de substance, fut la révélation de ces années. Félix Guattari repéra aussitôt ce qui, dans cette expérience, faisait écho avec sa quête cartographique de l’existence. L’identité territoriale des chasseurs-cueilleurs semi-nomades se définit déjà comme quelque chose en manque, lacking. Le pisteur qui chasse cherche des empreintes pour attraper le gibier : la trace de l’absence est la seule preuve de vérité qu’une action a eu lieu. Dans les langues aborigènes, des concepts fort complexes insistent souvent sur cette notion de trace qui est pensée comme la seule authenticité : l’image en ce sens est toujours vraie car elle fait trace d’une action qui l’a fait s’inscrire au sol, sur le corps ou un objet. Les Aborigènes qui sont nés sur la terre de leurs ancêtres ou ceux qui y ont grandi en étant amenés d’ailleurs discutent la légitimité de la diaspora non pas sur le principe du « détachement » physique (du fait des violences historiques) mais plutôt sur le principe du détachement performatif : autrement dit un descendant élevé ailleurs a « sa » place sur la terre de ses ancêtres où il n’a pas grandi à condition qu’il sache y lire les traces du passé auquel il prétend s’identifier. En ce sens, les descendants des Aborigènes déportés ont du mal à légitimer leurs droits sur la terre où ils ont été déportés, comme à Palm Island, île célèbre pour ses luttes contre l’injustice sociale, rapportées dans cette majeure. En revanche, le fait de revenir vivre sur la terre de ses ancêtres, de se faire initier ou de réapprendre la langue sont autant de signes de légitimité existentielle reconnus par le groupe comme preuves du lien d’appartenance (belonging) et de propriété par rapport à une terre d’origine. Cette définition de l’indigeneity (indigénité, autochtonie)[2] n’est pas tant ici une logique du sang que celle de l’inscription du corps actant et énonçant son appartenance. Autrement dit, ceux qui se vivent comme « déracinés » peuvent se réenraciner à condition que la terre les accepte. Pour cela, il faut négocier avec les vivants et les esprits totémiques. Le « totémisme » australien, par delà toutes ses variantes locales, insiste sur le fait que les hommes sont des avatars d’animaux, mais aussi de plantes et de tout ce qui est nommé dans la culture et la nature, y compris les lieux. À ce titre les lieux sont à la fois localisés et sujets à déplacement : ils se promènent avec leurs avatars sur des pistes de rêves qui laissent des traces identifiables et personnifiables. Les Yolngu appellent l’empreinte de pied luku, concept aussi utilisé pour les roues de voiture, l’ancre ou la voile car il s’agit d’articulations qui mettent en mouvement[3] .
Connexions
De tels systèmes de savoir autochtones restent des modèles pour penser aujourd’hui ce que Clifford appelle landedness, être de la terre comme se sentir chez soi, qu’il recommande de ne pas simplement opposer à la diaspora des exilés, l’être sans terre (landnessness). Pour se vivre comme exilé, il faut bien se sentir ancré quelque part, d’où la tension entre l’enracinement dans un lieu (to be rooted in) et l’acheminement par des lieux (routed through). Clifford, dans les deux extraits traduits ici, rejette la notion « d’invention de la culture » qui fit les heures glorieuses du postmodernisme des années 1980 et 1990, et propose la notion d’« articulations », principe des connexions qui, selon lui, traduit la métaphore océanienne des peuples du Pacifique.
Hélène Claudot-Hawad, qui parle ici des dispositifs furigraphiques du poète touareg Hawad et du rapport touareg au corps comme mouvement, souligne, quant à elle, l’importance de l’articulation comme fonction motrice. Plus que les parties et les organes, la métaphore touarègue des possibilités du monde est celle de la jointure et des enjeux des mobilités qui en dépendent. Repris dans cette perspective, la question du nomadisme n’est pas tant la question de déplacement en soi que celle des points d’arrêt et de départ, celle des droits de s’arrêter pour prendre soin de ses articulations, plus que de ses vieux os, celle des droits de repartir pour les faire vivre, les faire vibrer au son des chants évoquant les lieux et les gens que l’on quitte ou que l’on va retrouver, airs de liberté et de combats qui, comme le dit la chanson, s’incarne dans un ancrage : « Moi je sais ce que veut mon âme : être à l’ombre d’une tente dans le désert[4] … »
Exister
C’est l’une des particularités des voix autochtones que d’être les colporteuses en ce monde de l’inséparabilité de l’existence et de la résistance, de l’existence comme résistance. S’énoncer comme peuples autochtones, c’est déjà articuler une existence autre avec la résistance qui la rend possible. Autrement dit, pour les peuples autochtones, exister c’est déjà proposer autre chose, c’est donc déjà lutter. Dès lors les parts inévitables de concession à la domination sont aussi des parts de résistances en ce qu’elles maintiennent l’existence rétive. Et il faut donc composer, jouer l’ambiguïté des propos en fonction des contextes afin que le noyau de la vie autre subsiste. On le verra ici dans les propos diplomatiques d’É. D. Aïpine, président de l’Assemblée des peuples autochtones du Nord et vice-président de la Douma du district des Khantys-Mansis. Comme l’énonce la présentation de Dominique Samson Normand de Chambourg, les peuples autochtones du Nord sont « condamnés à vivre », c’est-à-dire à défendre sans cesse ce qu’ils sont, pour l’être.
Parfois les paroles sont plus libres, mais la réception difficile. Qui a entendu par exemple, dans les manifestations de 1995 contre la reprise des essais nucléaires français dans le Pacifique, la voix des Maohi : « Au nom de la fameuse maxime “liberté, égalité, fraternité”, l’État français refuse de reconnaître l’existence des peuples autochtones sous tutelle. Au nom de l’égalité, l’État français nie toute spécificité des peuples autochtones sur son territoire et, dans cette même logique, la France n’a toujours pas ratifié la convention 169 de l’OIT. Ainsi, seul l’individu est pris en compte, car il est plus facile à contrôler qu’un groupe avec ses traditions et ses solidarités. La France bafoue les droits des peuples à disposer d’eux-mêmes. La France utilise des peuples qu’elle a colonisés comme véritables cobayes. Après les essais dans le Sahara, terre des Touaregs, ces essais se font sur nos terres et c’est notre tour d’être les cobayes du nucléaire entre les mains d’un État qui n’hésite pas à employer des méthodes terroristes, comme tout le monde a pu le voir avec la tragédie du Rainbow Warrior. (…) Nos revendications sont celles des libertés fondamentales d’expression, de pensée et de réflexion que la France dénie à un peuple autochtone victime du colonialisme et de la barbarie nucléaire[5] . »
Avec les peuples autochtones, l’espace colonial persiste, cet espace qui configure les luttes lui résistant, et qui surtout inflige les termes du débat. C’est à partir des renfermements catégoriels qui nient les autoréférences, leurs déclinaisons et leurs mobilités, ainsi que le marché du travail, que Xavier Dias aborde ici la question des Adivasi de l’Inde (terme générique désignant les peuples autochtones qui représentent près de 70 millions d’individus répartis en plus de 200 groupes auto-désignés, principalement d’ouest en est, dans ce qui est communément appelé la tribal belt). Tout l’enjeu des réflexions et des mots « en pays dominé » est de leur faire dire autre chose, d’épuiser le sens des normes alitées des épistémès dominantes, afin de se doter de nouveaux sens, toujours fuyants, toujours en déplacement comme des groupes verbaux de guérilla. Qui a le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que ce qu’ils veulent dire, se demandait Alice.
D’autres mondes
Qui a le pouvoir de rejeter les appartenances revendiquées et les termes choisis pour les qualifier ? Qui a le pouvoir de les affirmer ? Au fond, le problème est ailleurs : il faut peut-être se demander qui a envie de se décaler, de ne pas s’interroger sur le statut des véridicités énoncées, mais d’écouter ce qui est dit à partir d’elles, de s’interroger sur leurs propositions, de savoir entrer en résonance. Telle est déjà la force du syntagme de peuples autochtones qui, au grand dam des États, n’a pas de définition, pas de norme, et qui relève, comme un ultime défi dont il nous faudra tirer un jour toutes les leçons épistémologiques et politiques, de la seule auto-identification. Les liens sont des reconnaissances sous forme de nouvelles alliances, des alliances entre égaux différents plutôt que ces solidarités toujours hiérarchiques qui se situent dans le confort de l’action de l’autre. Et si, face aux plaintes réflexes des douleurs viscérales d’une expérience coloniale héritée et quotidienne, l’empathie se présente, ces douleurs appellent radicalement une tout autre demande, celle d’apprendre de ce vécu qui dépasse le simple déroulement de la vie, d’apprendre de ce surplus de conscience fondatrice, non pour effacer l’expérience douloureuse dans un retour à la normalisation d’une réintégration à la société, à l’ordre mondial des choses, mais pour créer d’autres chemins. Ces douleurs lèvent le voile de la bestialité humaine qui masque les lieux, ces lieux « chamoizoniens » qui forment le deuxième monde, ces lieux qui sont autant d’endroits d’où repartir autrement.
Ce deuxième monde est fait de Lieux. Et ces Lieux se composent de côtés.
Corollaire : le côté est toujours en interface entre le premier monde et le monde deuxième. Cette interface est incertaine[6] »
Notes
[ 1] Update, n°70, juillet / août 2006 : www.docip.org/francais/update_fr/index.html ; version anglaise de la déclaration : www.humanrights.gov.au/social_justice/drip/index.html
[ 2] Voir B. Glowczewski et R. Henry (dirs.), Le Défi indigène. Entre spectacle et politique, Éditions Aux lieux d’être, 2007.
[ 3] B. Glowczewski, « Le paradigme aborigène : continuité, discontinuité, pensée réticulaire et ontopologie » (séminaire, Collège de France, 4 avril 2007), in Lucienne Strivay et Géraldine Le Roux (dirs.), La Revanche des genres. Approches de l’art contemporain australien, édition bilingue anglais / français, publications des Affaires culturelles de la Province de Liège (sortie pour l’exposition du même nom en octobre 2007) ; B. Glowczewski, Rêves en colère, Plon, coll. « Terre Humaine », 2004.
[ 4] Extrait de la chanson « Ezeref » du groupe Toumast, parole de Moussa Ag Keyna, www.toumast.com
[ 5] Organisation Hiti Tau, « Déclaration du peuple Maohi », in Tribal Act, n°5, Genève, 1995.
[ 6] Patrick Chamoiseau, Biblique des derniers gestes, Gallimard, coll. « Folio », 2002.