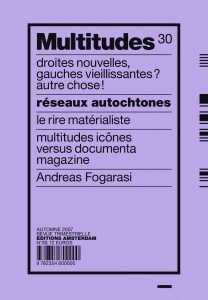Encres furigraphiques de Hawad
L’expérience de la domination et de la marginalisation — politique, économique, sociale, culturelle — ressentie par beaucoup de Touaregs dans l’ordre des États modernes se traduit par une image récurrente : celle d’un corps mutilé, amputé, blessé, empêché de se mouvoir. Face à la fragmentation et à la paralysie du corps social, territorial, individuel, revient l’idée qu’il faut le souder, le remembrer, le réemboîter pour lui restituer sa mobilité. Les discours, la poésie, les chants et autres expressions culturelles sont traversés par cette question lancinante : comment redonner corps au monde, c’est-à-dire le doter d’une charpente qui le rende intelligible et le remette en mouvement ?
Depuis plusieurs décennies, des initiatives aussi nombreuses que variées ont fait écho à cette interrogation, investissant des scènes d’action multiples, de l’insurrection armée au travail de l’imaginaire. Dans le domaine littéraire et artistique, j’évoquerai une démarche singulière : la « furigraphie » du peintre et poète touareg Hawad, présentée par ce dernier comme un « moyen de dépasser les limites, de contourner l’enfermement, de faire ricocher les échos de (s)es paysages et de construire des espaces inédits pour penser, ressentir et dire autrement le monde » (interview, 2004)[1]
Le corps du monde
La métaphore omniprésente du corps n’a rien de gratuit. Elle offre un modèle à penser le monde qui est d’ailleurs d’un usage classique dans nombre de sociétés. L’originalité de la conception touarègue est de se projeter dans un corps non pas statique mais toujours en mouvement. L’accent est mis sur les articulations qui permettent la motricité de l’organisme plutôt que sur ses parties constitutives. Dans cette logique, tout ce qui contribue à l’élasticité des jointures est valorisé, aussi bien dans les soins du corps, par exemple, que dans la pratique et la construction des liens sociaux ou des rapports à l’inconnu. C’est le blocage ou le dysfonctionnement de ces articulations qui rend le corps immobile et donc vulnérable.
Inculquée dès l’enfance, la « mise en corps » du monde connecte des réalités d’ordre divers dans une relation d’isomorphisme, permettant de passer d’un registre métaphorique à l’autre. Ainsi les entités politiques, sociales ou territoriales sont reliées à l’anatomie humaine : « poignet », « cuisse », « hanches », « poitrine »[2] … De même, les appellations des parties du corps structurent le vocabulaire de la parenté, comme le « ventre » et le « dos » désignant les parents matrilinéaires et patrilinéaires, ou les os et la chair, les vertèbres et les côtes (parents directs et collatéraux), l’utérus (parenté matrilinéaire) et le bassin (neveu)… Enfin, les objets inanimés qui forment l’environnement matériel de cette société ont également une structure corporelle qui se traduit par des dénominations explicites. Ce double processus de corporéité et d’incorporation du monde, que les opérations rituelles mettent particulièrement bien en évidence[3] marque les conceptions et la sensibilité certainement autant que les pratiques et les stratégies des acteurs sociaux. L’homologie de nature étant instaurée entre la société, le territoire, la maison et le corps, lorsque la dysharmonie survient dans un domaine, elle a des répercussions immédiates sur les autres. Le désordre social et politique se traduit par exemple par le désordre corporel et l’état de maladie. Le fait de diagnostiquer et de soigner correspond ici à la mise en œuvre de théories et de pratiques complexes qui agissent de manière pluridimensionnelle. Il s’agit de relancer le mouvement d’un organisme immobilisé dans sa course, autrement dit de lui permettre d’être à nouveau nomade en suivant le cycle universel. Le nomadisme, dans cette perspective, ne se réduit pas à un mode de vie itinérant associé à un type particulier d’économie (pastoralisme et commerce caravanier). Il représente également une pensée, une démarche intellectuelle, une compréhension particulière du monde qui permet de décrypter les réalités et d’agir sur elles. Selon cette vision, tous les éléments, les êtres, les choses, les moindres particules sont en mouvement, engagés dans un itinéraire cyclique rythmé par des étapes successives où se croisent des itinéraires variés. Franchir une étape, c’est se montrer capable de résoudre la contradiction entre ce qui est soi et ce qui n’est pas soi, opposition qui se manifeste sous des formes variées : l’identité et l’altérité, le connu et l’inconnu, la maison et le désert, la culture et la nature, le féminin et le masculin… Le but n’est pas d’éradiquer l’autre, mais d’être capable d’engager le dialogue avec lui pour convertir un ennemi potentiel en partenaire. C’est dans cette perspective qu’on dit que le cycle nomade « construit » la nature brute pour la transformer en abri protecteur.
5 En arpentant les sentiers du désert, les nomades ne font finalement que reproduire la marche universelle qui donne corps au monde, organisant le parcours autour des points stables que représentent, dans toutes leurs extensions symboliques, l’eau qui désaltère et l’abri qui protège.
Décupler l’horizon
Le corps en marche produit la multiplication des horizons. Au fil du parcours, sa forme évolue : elle résulte du travail d’équilibrage constant mené à chaque étape entre le connu et l’inconnu, pour continuer d’avancer. Dans son aspect achevé, ce corps symbolique présente un caractère androgyne et acéphale qui fait écho à de nombreux aspects de l’ordre social et met l’accent sur la supériorité de la fusion des contraires plutôt que sur leur état d’opposition. Savoir créer une relation avec l’altérité extrême, autrement dit pouvoir articuler les lointains, est un trait caractéristique des personnalités éminentes dans cette société. Cette faculté s’appuie sur des compétences multiples, notamment culturelles — comme la maîtrise de plusieurs langues, cultures et savoirs —, bagages que recevaient les élites touarègues[4] jusqu’à ce que leur mobilité et leurs possibilités de séjour dans divers espaces culturels ne soient fortement entravées.
Il est évident que cette aspiration nomade à des modes de fonctionnement multiglossiques, pluriculturels, polycentrés, dialogiques et dynamiques est difficilement conciliable avec la logique centralisatrice et unificatrice des États modernes qui s’inspire du modèle jacobin.
Différence et rivalité entre éléments pairs sont, dans cette théorie, les moteurs du mouvement tandis que la complémentarité entre éléments de force inégale rend compte de temporalités variées dans l’accomplissement de la marche. Aucune vie n’apparaît possible sans cette pluralité fondatrice. Un monde dont toutes les composantes seraient identiques deviendrait immobile. L’avancée dans les étapes du parcours est une épreuve qui exige sacrifice et transformation des êtres en mouvement. Renoncer à une partie de soi et adopter une partie de l’autre sont nécessaires pour négocier un accord avec l’altérité. Les sandales — à la fois empreinte identitaire et bouclier protecteur — que les Touaregs gravent sur les rochers des cols, au partage des territoires, est une figure symbolique de ce don nécessaire pour pénétrer dans le nouvel espace. Dans ce processus de changement et de métamorphose, seuls de solides bagages (la culture acquise par exemple) donnent l’ancrage nécessaire pour arrimer le voyageur et l’empêcher d’être happé par le pôle adverse. Ce schéma métaphorique rend compte efficacement des processus d’aliénation et de dépersonnalisation observables chez des individus ou des milieux fragilisés.
Ainsi, la philosophie nomade anticipe le changement. Elle spécule sur le renouvellement de l’horizon. Elle invalide l’idée d’une vérité unique ou d’un savoir absolu, en s’attachant au contraire à donner une place même au négligeable, à l’insignifiant, au refoulé, pour anticiper l’étape de demain, comme l’exprimait Karsa welet Elghelas[5], originaire de l’Adagh, en 1995 : « Nous, les Touaregs, dans nos stratégies et notre politique, même le fou a son rôle à jouer. S’il vient à toi, fais-le rentrer dans ta maison et retiens-le pour demain bâtir avec lui un autre univers. Il y a beaucoup d’éléments dans la vie. Aucun ne ressemble à l’autre et chacun a son rôle et son intérêt » (traduit du touareg).
Nomadiser, au sens concret autant qu’abstrait, revient donc à décupler les horizons, les identités, les étapes du parcours en « les enfilant comme les perles d’un collier » selon un assemblage inédit et choisi. C’est dans ce sens que tout ce qui bride la vue, tout ce qui rigidifie le regard, tout ce qui réduit les possibles, tout ce qui interrompt la marche, contrarie la bonne santé du monde.
Se réinventer dans les marges
Cette trame interprétative se retrouve à l’œuvre dans la démarche littéraire et artistique de Hawad. Sa poésie, comme celle d’autres auteurs touaregs contemporains[6] , met en scène les images du « pays déchiqueté », du corps démembré, du territoire haché. Hawad est né dans l’Aïr. Son parcours[7] est marqué par le sentiment pesant de la défaite de sa société face à l’intrusion coloniale et par la nécessité de résister à un ordre imposé par la force. Il fait l’expérience dans les années 1970 des arrestations arbitraires et de la prison en Algérie et au Niger, des violences physiques et des humiliations exercées sur les civils par les militaires, de la confiscation des droits individuels et collectifs, de l’interdiction de circuler, d’une mise sous surveillance constante par un agent de l’État nommé Abdou à Agadez. Pour garder raison dans la situation d’oppression, de chaos et de non-sens qu’il ressent, la poésie devient pour lui une nécessité vitale. Le contrôle sur les Touaregs dans les cinq États dont ils relèvent atteint alors son paroxysme, alimenté par l’obsession d’un soulèvement et d’une sécession, alors que l’extraction des ressources minières du Sahara sur les terres touarègues (l’uranium au Niger et le pétrole en Algérie et en Libye) sont en pleine expansion et représentent un enjeu économique national et international de premier plan. Dans ce climat destructif contre lequel il n’a pas les moyens concrets de lutter, il prend conscience que la seule chose qui fait écho à la topographie mentale, philosophique et politique de son espace confisqué se condense dans le décor géométrique des objets usuels qui l’entourent. Il commence à dessiner en s’appuyant sur les caractères tifinagh et leur logique graphique jusqu’à l’expression picturale actuelle détachée des signes, des mots et de leur usage immédiat : « Ma démarche est partie d’un outil hérité de mes ancêtres, les signes tifinagh dont je m’empare pour les pousser au bout de leur trajectoire. Je les détourne, les décompose et les recompose afin de les remettre en mouvement » (interview, 2004).
C’est, ainsi, pour se dégager des « barbelés qui castrent l’horizon » (Yasida, 1991[8], pour échapper à l’encerclement, pour contourner le modèle unique de la modernité politique avec ses « armée armes remparts / frontières flammes / chiffres décrets / religion pêchés grâces / qui excluent écartent balaient / jettent tranchent taillent châtrent / dépècent broient moulinent / brûlent toute vision / qui refuse de s’acoquiner / au regard du boucher » (Le Goût du sel gemme, 2006), que Hawad déchaîne sa plume « furigraphique ».
Il ne s’agit pas d’une riposte mimétique face à l’agression, ni d’un recours aux balises de l’adversaire, à son désir de frontière et de drapeau, de capitale ou de chef suprême. La furigraphie est pour lui une manière de refuser le fait accompli. Elle est écriture du Détournement d’horizon (titre paru chez Grèges en 2002), du débordement des cadres figés, une écriture qui permet de dépasser la douleur, en tirant tout azimut des rafales de mots capables de remettre la situation en mouvement et de trouver des alternatives d’une autre nature : « Transe foudre / ascension verticale / cabrement ruade libérés / de tout cadre panneau / menottes cellules / et règles de niveau » (2006).
Le but est de casser la syntaxe dominante et de rassembler autrement les morceaux de la fragmentation, de raccommoder selon une autre logique les lambeaux de la déchirure, de fabriquer un corps inédit.
Pour résister au chaos et au non-sens, Hawad recycle une méthode thérapeutique touarègue de détournement du mal : par la répétition frénétique des mots, des gestes, des sons et des images ressassés, amalgamés, pétris et transformés au rythme vertigineux et obsessionnel de la transe, ses personnages s’affranchissent des limites prescrites et cravachent la « jument de leurs désirs », le désir d’exister autrement que dans le scénario imposé par la force et le viol. Dans Sahara. Visions atomiques[9] (1998), ils luttent avec des armes de leur invention, mélange explosif et baroque, composé de tous les rebuts imaginaires possibles, chiffres trafiqués, voyelles détournées, syllabes glossolaliques, crottin de mule, phéromone de Satan, parchemin momifié, râles et cris de rage… Pour sortir de la confusion et de la folie, les hallucinations du chaos sont administrées au chaos lui-même. Désentravés, incontrôlables, imprévisibles, les êtres rendus à leur libre arbitre sont capables de désagréger les obus et les bombes, de détourner les bornes et les frontières, de transgresser les logiques destructrices, de libérer la parole et la pensée colonisées. Ils relèvent les effondrements, font grincer les emboîtements, dénouent les articulations, désentravent les prunelles blotties à l’abri des orbites, remodelant le monde à leur façon. Ils ne sont plus des créatures impuissantes et inertes travaillées par le « ruban du temps » et la « planche de l’espace », mais ceux qui apprivoisent et harmonisent à la cadence de leurs pas un espace-temps réversible, plurivalent, multidimensionnel. Ainsi renaissent-ils sous le portrait de l’homme qui se confond avec la terre mère serpent, l’homme nature, l’homme univers, l’Homme libre, pensant et agissant, qui s’empare de son destin pour choisir lui-même l’orientation de sa marche, l’homme qui en assumant sa mémoire a recouvré son humanité, « se portant lui-même et l’autre face du monde ».
La « furigraphie » (zardazgheneb) revendique l’idée de « fureur » associée à tout ce qui bouillonne, déborde, ricoche, se démultiplie de manière incontrôlable et imprévisible. Elle cherche à pulvériser la voie unique en une multitude d’issues, fourmillement « de tirs de verbe / ricochets démantelant le champ / et la visée de l’adversaire » (Le Coude grinçant de l’anarchie). Selon la même méthode, le personnage volcanique de Kokayad, dans Sept Fièvres et une lune[10], assourdit les tympans de l’écho « avec une langue fourchue qui dit des mots dissemblables par chacun de ses bouts portant sept autre langues, toutes encore multipliées en sept épines jusqu’à l’infini, paralysant le silence dans son gosier d’amphore romaine ».
La furigraphie, selon Hawad, permet d’échapper à deux pièges. Le premier est l’enlisement muséographique et le second l’abandon et l’oubli de soi au profit des modèles extérieurs : « On ne refuse pas la greffe, dit-il, mais à condition de conserver notre corps, car la greffe ne remplacera jamais le corps. »
Ses personnages sont hantés par la mémoire, une mémoire traumatique : « parole limon de la conscience / parole magma amalgame / lie du mercure monologue / plomb en fusion / encre grumeaux de l’exclusion » qui refuse d’être refoulée et taraude l’esprit en une « voix âpre stridente crevassée, voix au goût de sel gemme » (2006). Cette mémoire nourrit l’invention d’horizons alternatifs capables de l’intégrer et de l’apaiser. Elle oriente la métamorphose des acteurs des marges en personnages hybrides, « colombe mante mirage », seuls capables finalement de s’envoler et de planer au-delà des « franges des futurs et des destins » déjà tracés.
Hawad associe sa posture furigraphique à un autre concept qui relie les cordes du passé, du présent et du futur que tout individu noue dans son tissage personnel. À la disqualification de son monde, à la destruction de l’espace nomade, au figement ou à la négation de sa culture, il oppose ce qu’il appelle le « surnomadisme » — clin d’œil à son éducation nomade autant qu’au surréalisme — pour dépasser les vérités présentes et éphémères par un nomadisme décorporéisé, sans temps ni espace : « depuis longtemps roquettes, lances, fourches / de nos épaules / nomadisent hors de nos corps / pour soutenir les horizons » (1998). Il cherche ainsi à « raccommoder un espace-temps inédit » qui n’entrave pas la mobilité physique ou intellectuelle. Il s’agit pour lui de faire sortir du ghetto ses outils à penser le monde, de les externaliser et de les faire circuler sous la forme qu’il veut et non suivant celle que lui assigne l’œil extérieur « derrière la lunette / du fusil de (s)on père » : « Quitte l’arrière / de la gueule de ton fusil / ou est-ce l’unique fenêtre / par laquelle tu oses / me regarder ? » (2006).
La furigraphie est l’outil qui lui permet d’atteindre ces paysages inédits : « Écriture et parole furigraphiques / je tague un territoire / qui me restitue / les arcs et les flèches / axes tout azimut / des visions fiévreuses du futur / et de mes rages anciennes. » Cette démarche, difficile et exigeante, est la seule, dit Hawad, qui le « propulse hors de l’encerclement sans l’obliger à se trahir » (2006). Elle fait voler en éclats les images usées, les balises ankylosées, les cadres préfabriqués, et recompose le puzzle « pour qu’apparaissent d’autres imaginaires, d’autres eaux, d’autres points d’eau, les points d’eau d’autres images et d’autres couleurs, et encore d’autres situations et d’autres états nouveaux, qui n’ont encore jamais existé, sauf dans ce qui est à venir. Ainsi, poursuit-il, sans fin, je marche, ainsi je montre qu’il y a d’autres voix, d’autres images, formes, états, mémoires qui sont en nous et dont certains n’ont pas encore vu le jour. C’est tout un travail de “furigraphie”, de ressassement, de monologue obsessionnel et de choses par lesquelles l’être humain baratte la douleur qui est en lui » (interview, 2004).
Face à la destruction des mondes déclassés par l’ordre étatique moderne, il convoque sur sa scène poétique et picturale « les étoiles en plein jour », les « plumes (qui) irradient les rayons du soleil » (2006), les soleils souterrains ou les chevaux à roulettes, c’est-à-dire l’inimaginable, l’impossible, le non-sens et tout ce qui appartient au rebut et au désordre, unique recours pour remettre le monde nanti en mouvement : « Griffonne le monde fatras / débris déchets chutes désordre / poésie images fragmentées / pour un imaginaire / pareil à la balle du son / sautillant sur l’océan / miroir en flammes » (2006).
Face à l’arsenal de l’adversaire (« sabres mitraillettes obus » et « pets atomiques »), ses armes ne représentent qu’un bricolage dérisoire : « roquette explosive / grenade de nos cœurs / roquette bricolée / de rouille sang sueur mijotés / dans des épaves couscoussières » ne propulsant que des « marmites bourrées de croûtes d’orge oignon / ail et autres os de dattes galets / clous et tiques de nos poésies / les poésies calleuses et infectées / de nos blessures » (1998).
Il invente un style furigraphique effervescent qui se déploie en éruptions de mots lancés par rafales au rythme de la transe. Sciemment, il élude, détourne et affole les règles classiques de la syntaxe et ses relais grammaticaux. Quand le mouvement s’accélère, il évacue les mots de liaison, chasse les prépositions et autres lubrifiants pour retrouver le débit heurté et incontrôlé du verbe sans entrave : « Terrorisez la syntaxe / faites ricocher verbe sur verbe / et naîtra une épilepsie / de sons et de sens / toussant sur le silence / asthme harcèlement de feu » (2006).
Avec les fragments, les scories et les copeaux nus du monde établi, il esquisse des paysages inédits qui émergent dans un autre espace-temps, au-delà des frontières et des cadres mutilants, créant de nouveaux parcours nomades sans label ni étiquette institutionnalisés : « J’écris pour rendre à tout ce qui m’entoure sa mobilité, pour éperonner et provoquer les sens qui ont pris trop de poids et se sont arrêtés en barrant le chemin à tous les sens à naître. J’écris pour faire accoucher ce qui n’existe pas et estomper ce qui existe, noyer le sens obèse dans le sens avorton qui veut éclore. Il n’y a de signification et d’existence que dans l’ombre fugitive qui tangue et cherche sa forme et sa stature en traversant les tempêtes de provocation et de violence… » (Buveurs de braises[11], 1995 : 155).
Hawad poursuit l’idée que construire une pensée moderne est possible sans aliéner ses propres ressources. Il fait ricocher ses options dans tous les registres possibles, rédigeant dans sa propre langue — la tamajaght —, écrivant en tifinagh, alphabet touareg, projetant sur la toile les points-ancrages, les traits-parcours et les couleurs-espaces du vide de son nomadisme imaginaire, et s’appuyant sur la philosophie du mouvement, outils légués par ses ancêtres, mais poussés par lui hors des limites conventionnelles, détournés à des fins inédites, déplacés, dépaysés, recyclés, pour fabriquer une œuvre inclassable, n’appartenant à aucun genre labellisé par les institutions culturelles en place : « Je ne perpétue pas une tradition, je ne défends pas une culture, je prolonge l’âme de l’homme touareg que je suis, avec les outils forgés par mon éducation et par mon expérience » (1995 : 157-158).
Il appelle à « recoudre les déserts » et à repenser la modernité sur d’autres bases : « Nous chameaux / figure désert / vent rouge / nous dévorons les entraves / et les rouleaux de kilomètres / de barbelés / et les étoiles / Nous les avalons avec leur feu / dans les nuits sans fond / nuits de bourrasque / glace ensablée / écho de la poussière / et routes sirocco / nous recousons le désert / toi chameau / nous toi / et ne désirons ni guide / conducteur gouvernail / boussole GPS / gouverneur ni gouvernante » (2006).
Ainsi, la furigraphie rend le chaos chaotique : elle le projette dans l’espace littéraire ou pictural jusqu’au concassage de toute vérité, de toute représentation, de toute signification, de toute règle, de tout ordre établi, amalgamant le temps et l’espace, « agrégeant les ténèbres et le jour » (Sept Fièvres et une lune, 1995). Elle fragmente, démultiplie et renvoie tout ce qui est immobile à « l’entre-deux »[12], l’espace-temps du vide, le réservoir de toutes les virtualités, situé entre les mondes, entre les parcours nomades, entre les pas de la marche, « entre les tirs de balles ». Elle recrée l’élan qui permet de recycler et d’assembler autrement les fragments en une construction inédite qui rende corps au monde. Elle restitue à l’homme sa liberté et sa faculté de tracer lui-même les axes de son orientation, faisant écho à cette invocation touarègue ancienne :
Notes
[ *] Hawad. Écrivain et peintre touareg, est originaire de l’Aïr dans le Sahara central. Dans son œuvre foisonnante s’entrecroisent divers genres littéraires — poésie, geste épique, conte philosophique, théâtre — mettant en scène des mondes « infiniment en marche » qui se rencontrent, se métamorphosent, se recomposent pour continuer leur route. Le drame et la résistance du peuple touareg ou de tout peuple menacé d’extermination émaillent son univers de fiction. Parmi ses nombreux manuscrits tifinagh rédigés dans sa langue, la tamajaght, une quinzaine a été publiée en traduction, dont Détournement d’horizon (Grèges, 2002), Sahara. Visions atomiques (Paris-Méditerranée, 2003) et Le Goût du sel gemme (Grèges, 2006). Parallèlement à son parcours littéraire, Hawad mène un travail pictural qui relève de la même démarche « furigraphique », prolongeant sa philosophie de l’espace et de « l’égarement ». Il a exposé dans diverses villes de plusieurs continents (Europe, Amérique du Nord et du Sud, Afrique).
[ 1] Interview réalisée par Christiane Fioupou, professeur à l’université de Toulouse-Le Mirail, et diffusée sur le site universitaire : www.canalu.fr/canalu
[ 2] Voir H. Claudot-Hawad, Éperonner le monde. Nomadisme, cosmos et politique chez les Touaregs, Aix-en-Provence, Édisud, 2001, chapitre 1.
[ 3] Voir H. Claudot-Hawad, Touaregs. Portrait en fragments, Aix-en-Provence, Édisud, 1993, chapitre 12.
[ 4] Sur la fabrication des élites au Sahara, voir P. Bonte et H. Claudot-Hawad (dirs), « Savoirs et pouvoirs au Sahara. Formation et transformation des élites du monde nomade touareg et maure », in Nomadic Peoples, Vol. 2, n°s 1 / 2, Berghahn, 1998, 303 p.
[ 5] « Ma maison est ma nation qui est la maison du monde entier », in H. Claudot-Hawad et Hawad (dirs.), Touaregs. Voix solitaires sous l’horizon confisqué, Paris, Ethnies, 1996 : 1991-1996.
[ 6] Voir H. Claudot-Hawad et Hawad (dirs.), « Tourne-tête, le pays déchiqueté ». Anthrologie des chants et poèmes touaregs de résistance, 1980-1995, Amara, 1996.
[ 7] Voir Hawad, « L’élite que nous avons voulu raccommoder sur les cendres… après la création des États africains », in Nomadic Peoples, vol. 2, nos 1 / 2, Berghahn, 1998, p. 84-102.
[ 8] Hawad, Yasida, Éd. Noël Blandin, Paris, 1991, 62 p.
[ 9] Publié chez Paris-Méditerranée, Coll. « Les Pieds dans le plat », 1998.
[ 10] Publié chez L’Aphélie, Céret, 1995.
[ 11] Buveurs de braises, version originale en tamajaght et traduction française, Saint-Nazaire, MEET, 1995, 162 p.
[ 12] Sur ce concept essentiel de la philosophie du mouvement, voir H. Claudot-Hawad, 2001, op. cit. : chap. V.
[ 13] Enneg attaram aghil tazalgé afalla dadew d nek was tiwer tella nin wer telem tella