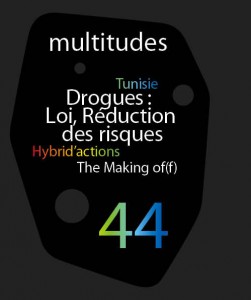Life Style – catalogue de décoration ou essai sur une esthétique-éthique de la vie contemporaine ? Rien de cela. Life Style est le titre d’un livre du designer canadien Bruce Mau qui nous mène à comprendre comment la guerre menée par le capitalisme contemporain est une guerre des images. Avant de présenter son portfolio, Bruce Mau décrit le panorama où il inscrit son activité professionnelle pour affirmer que la vieille infrastructure de l’image fait appel à un capital fortement concentré pour faire face à la grande échelle des projets modernes d’urbanisme qu’elle couronne symboliquement par d’imposants musées. Enchevêtrée à celle-ci, surgit alors une nouvelle infrastructure de l’image « dispersée, décentralisée et évolutive. Construite ou enrichie par les usagers eux-mêmes ou en réponse à eux, la nouvelle infrastructure de l’image est constituée par des systèmes, des accords, des alliances et des modèles[1] » composés à leur tour par des super-brands, cartes de crédit, clubs de fidélité, marketing démographique, Jeux Olympiques, compagnies aériennes internationales, circuits monétaires planétaires, business de photos et de médias, ou encore de software et d’Internet… À cela, nous ajoutons le circuit international de l’art avec ses anciennes et nouvelles institutions. Alors que la vieille infrastructure prétendait instaurer un projet civique collectif (nous supposons que Bruce Mau fait référence à la construction de la Nation associée à la production et à la consommation de masse et à l’organisation des classes autour de la relation salariale), par sa dispersion, décentralisation et évolution, la nouvelle infrastructure lance un défi à ceux qui refusent d’imaginer une vie réduite au shopping. Ambivalente, l’infrastructure globale de l’image est à la fois une totalité prédatrice et un espace ouvert à la puissance d’invention. Nous sommes plutôt d’accord avec Bruce Mau à ce sujet même si, plutôt que d’infrastructure, nous préférons parler d’un dispositif global de l’image. Nous allons voir que son extrême hétérogénéité ainsi que ses hybridations entre arts et médias servent d’abri à des pratiques ambiguës, mais aussi potentiellement émancipatrices.
Le grand designer et son « rhizome collaboratif »
En effet, face au pouvoir de l’économie globale de l’image, Bruce Mau propose un « design engagé ». Il nous présente alors son travail d’identité visuelle destiné à des institutions cognitives[2] emballé par une recette de transformation « de solides en flux » et « de constantes en variables ». Ces explications sont précédées par des pages dédiées aux identités performatives, dans l’art et dans la vie, de James Bond, d’Elvis Presley, de David Bowie et de Madonna. La force et la longévité de Madonna se trouverait ainsi dans le fait que sa forme de vie « shifts its mater[3] ». Mais quand elle le fait, Madonna incorpore des identités prêt-à-porter[4] – de la « vierge » à la « putain », ou bien encore la « mère dévouée à ses enfants » dans les magazines people. En dehors de cette réduction des « devenirs » et des « variations continues » théorisées par Deleuze et Guattari, Mau suggère que la « collaboration interne » entre associés et employés mis en réseaux dans son studio constitue un rhizome alors que la réalité de l’organisation de l’entreprise, si ouverte soit-elle, est tout autre. Quand il nous mène à considérer les objets de design comme des événements alors que cette production, si surprenante soit-elle, est tout autre. En matière de « collaboration externe », Mau nous présente des grands noms de l’urbanisme, de l’architecture, de l’art et de l’intellectualité en général appelés à s’associer aux projets du grand designer, et vice-versa : Rem Koolhaas et Frank Gehry pour l’urbanisme et l’architecture, Michael Snow et Douglas Gordon pour l’art, et Sanford Kwinter, Jonathan Crary, Michel Feher et Hal Foster pour la théorie.
Nous voyons se former devant nous un narratif spectaculaire de grands auteurs dont la prévisible coopération se trouve bien loin d’une libre expression du General intellect contemporain. Dans Design and Crime (and other Diatribes), Hal Foster nous présente Bruce Mau comme « un critique culturel, un guru futuriste ou encore un consultant pour des sociétés[5] » ou simplement un « surfeur » ! Il surfe effectivement sur les vagues de l’ambiguïté sans jamais assumer les « monstrueux » conflits de sa pratique. Son « collaborative editorial role » n’est autre que la revendication pour le designer du rôle d’« auteur[6] » au même titre que les autres partenaires au sein du dispositif global de l’image tel qu’il l’a décrit.
L’artiste de l’intime et sa médiatisation
Face à cette situation où la pratique et la critique de l’image se vident au fur et à mesure que les alliances à de grands noms s’amplifient, le dernière bastion de la résistance se trouverait-il dans l’interstice[7] de l’exposition d’art ? Tout récemment l’artiste française Sophie Calle a réalisé à Rio de Janeiro son exposition Prenez Soin de Vous où elle propose à 107 femmes[8] d’interpréter, sous un angle professionnel, un e-mail de rupture envoyé par l’écrivain Grégoire Bouillier à l’artiste. Qui sont ces femmes ? Chef de police, écrivaine, enseignante, clown, danseuse de tango, actrices… des femmes connues mais aussi des femmes quelconques. Les moyens employés sont eux-mêmes quelconques : photos, vidéos, textes, etc. Bien qu’éloigné de la grande narration construite par Bruce Mau – avec les « grands » de l’urbanisme, de l’architecture et de l’art –, se dégage de cet ensemble de points de vue sur le e-mail et, surtout, de cet ensemble de photos mettant en scène des personnages en pose de lecture d’un document qui ne leur est pas adressé (mais, certes, à qui il aurait pu être adressé) un contrôle inattendu étant donné qu’il s’agit d’une situation parmi les moins contrôlables que l’on puisse vivre – celle de la rupture amoureuse. C’est peut-être pour le fuir que Calle se lance à la recherche d’un commissaire d’exposition par une petite annonce dans Libération. Plus qu’une composition polyphonique de 107 femmes, la mise en espace de leurs points de vue prend alors la forme d’une organisation par Daniel Buren. À peine débarrassée du contrôle de l’espace qui « interstitionnalise » son œuvre, l’artiste semble avoir du mal à se débarrasser du contrôle des discours médiatiques autour de l’exposition de son intimité. C’est comme si plus elle s’éloignait du rôle d’auteur en s’absentant de son œuvre (plus précisément en donnant voix à plusieurs femmes et en accordant à un chef d’orchestre la mise en installation), plus elle devait se faire présente dans les médias. Il serait donc erroné de penser ces espaces et ces discours comme extérieurs à l’œuvre qui devient alors dispositif artistique-médiatique. Nous pouvons parler d’une « médiatisation de l’art » qui n’est pas étrangère à la pratique artistique même (et qui ne la disqualifie pas plus qu’elle ne la qualifie). Ici, à la « finition » parfaite de l’œuvre s’associe la parfaite « finalisation » du dispositif qui accorde peu de liberté à la réception du public. Ceci renforce la perception généralisée que l’art a perdu sa dimension événementielle (au-delà d’une particularité de l’art de Sophie Calle) et confirme à son tour la capture des « purs moyens » par le capitalisme contemporain[9].
Et si…
Il semble que nous nous trouvons, dans les deux cas cités, bien loin de l’expérimentation collaborative de l’image ou création de wik’images. Et si la puissance événementielle du dispositif global de l’image résidait justement dans l’hybridation entre arts et médias entendue comme articulation entre fins et moyens dans le commun, et surtout comme son ouverture radicale ? L’on pourrait admettre comme hypothèse – en relativisant l’autonomie de l’art défendue par les théories formalistes du modernisme – que cette ouverture peut provenir des apports des nouvelles technologies et, surtout, des usages que la multitude fait des nouveaux médias. Contrairement, par exemple, à Nicolas Bourriaud qui, dans son Esthétique Relationnelle, attribue à la communication le nettoyage des relations non fonctionnelles (et il n’est pas le seul[10]), Reinaldo Laddaga présente dans son Estetica de la Emergencia[11] la crise de l’art moderne dans un contexte de transformations paradigmatiques de la communication. Tandis que la formation des États modernes a favorisé les technologies d’unification et homogénéisation des Nations, le processus de globalisation en cours privilégie des technologies sociales imédiatement trans-nationales. Le rite ponctuel de la télévision (moyen de communication moderne qui correspond à une production centralisée – souvent oligopoliste, voire monopoliste –, à la distribution de masse et à l’émission à sens unique) s’articule avec le flux continu d’Internet (expérimentation décentralisée, non hiérarchisée, en réseau). Mais Internet lui-même est pris dans le conflit « ouvertures (disclosures) versus clôtures (enclosures) », c’est-à-dire aux réductions du multiple à l’Un et de l’imprévisible au prévisible, au moyen de hiérarchisations qui se reconstituent rapidement. Il influence toutefois des domaines très variés : nous pouvons parler d’une « culture du réseau » où la présence des nouvelles technologies dont Internet peut être directe ou indirecte, articuler le local au global sans passer par le national, faire tenir ensemble sans totalisation c’est-à-dire créer un « tout distributif » plutôt qu’un « tout collectif[12] ». Les bouleversements dans le champ de la communication sont en partie responsables d’un nouveau régime des arts : un régime esthétique où la production et la jouissance individuelle de l’œuvre artistique s’articule à son tour avec des projets collaboratifs – tels que Venus, Vyborg et Park Fiction entre autres analysés par Laddaga – qui mélangent pratiques artistiques ou non, avec leurs différentes façon de créer et d’être, en quelque sorte, créateur. Ce paradigme esthétique, d’ailleurs déjà annoncé par Félix Guattari, n’affirme pas la création comme un monopole de l’art (même si « interstitionnalisé » pour dissimuler son caractère institutionnalisé et corporativiste), mais comme un machinisme transversal à tous les domaines. Machinisme amplifié par les nouvelles technologies qui ne mènent pas nécessairement à un Big Brother (centralisation du contrôle social) mais plutôt à « une réappropriation individuelle, collective et un usage interactif des machines d’information, de communication, d’intelligence, d’art et de culture[13] », c’est-à-dire à un nouveau Big Bang ou explosion de la création du commun.
L’art des nouveaux médias et l’image à code ouvert
Dans ce sens, depuis les années 90, l’engouement des artistes envers Internet donne naissance à un Net.art ou, en termes plus généraux, à un « art des nouveaux médias ». Au-delà des processus d’appropriations, de détournements, de collages, de remix et de samplings – hybridations amplifiées par les nouvelles technologies –, la parodie et, tout spécialement, celle de l’entreprise est assez fréquente (Airworld, par Jennifer et Kevin McCoy en 1999 ; etoy.share par Etoy en 2000 entre autres depuis). Aujourd’hui, plutôt que d’exploiter la main d’œuvre pour réaliser de la plus-value, l’entreprise capture la libre coopération des cerveaux en dehors de ses murs, c’est-à-dire, dans toute l’extension de la métropole. La perception par les artistes de cette capture est alors mise en scène, ou plutôt, mise en écran. Dans le cas de la production d’images, l’« entreprise » ne se résume pas à l’industrie audiovisuelle ou aux agences de design, de publicité et de marketing (formes organisationnelles plutôt en crise), mais s’étend sous forme d’un dispositif global que nous avons ici introduit avec Bruce Mau et dont les institutions sont constamment ré-actualisées et revalorisées par le capitalisme contemporain. Entre autres institutions 2.0, naissent ainsi à tout moment des musées de dernière génération qui exploitent des concepts tels que l’« interactivité » ainsi que des fonds mi-publics mi-privés, mi-locaux mi-globaux. Et fleurissent plus que jamais Biennales et Triennales comme des « Ambassades de l’Art » malheureusement encore ignorées par Julian Assange…
Les « arts des nouveaux médias » – et, pourquoi pas, les « médias des nouveaux arts » ? – se réclament alors d’une pratique où une multiplicité de faiseurs d’images se rapproche d’une multiplicité de récepteurs d’images (ou publics), à l’image même de ce qui se passe entre développeurs et usagers du software libre. La caractéristique qui unit ces différentes pratiques est celle d’une collaboration qui dilue la signature d’auteur et le statut d’originalité. Ceci n’implique pas la disparition des singularités expressives qui, au contraire, se constituent dans les ébats et débats des réseaux sociaux et technologiques même lorsqu’elles ne correspondent pas à une « forme auteur ». Leurs hybridations en collectifs, associations, mouvements et rhizomes échappent à la transformation de la création sociale en œuvre individuelle, du processus ouvert en produit exclusif, de la copie libre en contrefaçon ou piratage, du bien commun en propriété privée, entre autres opérations du capitalisme.
La force de création et de réalisation de la coopération des cerveaux ne dépend pas de l’entreprise, mais de l’accès aux « biens communs[14] » nous dit Lazzarato qui cite la santé, les nouvelles technologies dont Internet, les sciences et le savoir en général. À ces biens communs, nous ajoutons l’image (forme de savoir ou savoirs en formes!). Ces pratiques de l’image défient le vecteur copyright : s’ensuivent des poursuites aux artistes d’une part, mais surtout une détermination encore plus forte de ceux-ci à le combattre par des pratiques « à code ouvert » – comme c’est le cas du projet Opus (www.opus.commons.net) qui, aux images en commun, associe également textes et sons –, voire des pratiques « hackers » (et oui, le hacker a le sens de l’esthétique et de l’éthique[15]). Au-delà de l’autonomie de l’art, la monstrueuse hybridation entre (pratiquants d’) arts et médias ouvre la possibilité de créer un dispositif global de l’image qui sorte de l’ambiguïté et devienne effectivement distributif. Avec des Wikifuites de partout…
Sur le même sujet
- Pour une musique de résistance Théorie du Stone
- La Critique institutionnelle, le pouvoir constituant et le long souffle de la pratique instituante
- Le modèle américain de la désobéissance civile, de Thoreau à nos jours
- La terre en Nouvelle-Calédonie : pollution, appartenance et propriété intellectuelle
- L’exode habite au coin de la rue