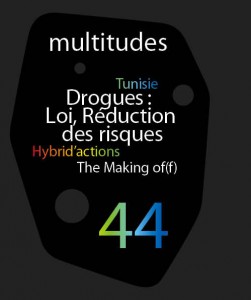En cinquante ans, de 1960 à 2010, l’utopie cyborg est devenue une vérité paradoxale de notre planète connectée. Son idéal d’hybridation de l’homme et de la machine s’incarne désormais dans le chevauchement permanent du réel et du virtuel comme dans la confusion de nos mondes intérieurs et extérieurs à la faveur du tout Internet et des promesses manipulatoires de la biogénétique. Hier figure purement spéculative, aujourd’hui fiction en actes, notre devenir cyborg se concrétise à des années lumières de la surface chromée des Robocop et autres Terminator de notre imaginaire collectif.
1960 – 1985 – 2010 : les trois premiers âges du cyborg
1960. Deux Dupont et Dupont de la recherche américaine, Kline et Clynes, inventent le terme cyborg dans un article pour une revue scientifique : Astronautics[1]. Plutôt que de tenter de répliquer, via la tenue du cosmonaute, notre environnement naturel, en l’occurrence l’atmosphère terrestre, ou bien de construire demain des bulles habitables au cœur de l’espace, ils défendent l’idée de transformer l’homme. De lui offrir de nouvelles capacités pour qu’il vive tout « naturellement » demain dans les univers extraterrestres aussi facilement qu’une daurade dans son océan Atlantique. Enfant de l’ère des drogues comme méthode rationnelle de mutation, de la guerre froide et de la course à l’exploration spatiale, le cyborg est donc moins l’équivalent des Cybermen de la série Dr Who (robots dont il ne subsiste de leur origine humanoïde qu’un cerveau dépourvu d’émotion), qu’un être humain de chair, de sang et d’os augmenté par la science et la technologie.
1985. Une génération après Kline et Clynes, Donna Haraway publie son Manifeste Cyborg, texte cultissime sous-titré Science, technologie et féminisme socialiste à la fin du XXe siècle. Le cyborg, « organisme cybernétique, hybride de machine et de vivant », devient sous sa plume corrosive une création sociale et politique. Sculpture de soi par la grâce des bistouris de la technologie, il prend la figure d’une femme assumant son devenir monstre aux yeux de la société dominante, d’une créature fabriquée en un bel éclat de rire féministe, jubilant d’avoir décidé de perdre toute référence à la mère Nature ou au Paradis perdu. Ce cyborg-là est lui aussi un « post-humain » avant la lettre, être de rupture, construit selon les règles de l’utopie créatrice. Sauf que le cyborg de la cyberféministe a troqué l’objectivité de la science contre la subjectivité d’une poésie politique qui s’assume comme fiction pour mieux décoder puis changer notre rapport au monde et la société qui en est le fruit.
2010. Vingt-cinq ans plus tard, soit une génération de plus, un jeune designer, architecte et réalisateur de films, Keiichi Matsuda, conçoit « 10 règles des cités pour cyborgs ». Et là, pour la première fois, tandis que l’Internet devient le nouvel air de nos métropoles qui se muent en technopoles, l’on se dit : le cyborg n’est plus seulement un être utopique. Non qu’il ait perdu sa dimension fantasmatique, sa qualité d’incarnation d’un désir scientifique ou politique de fabrication de soi au-delà des codes de la morale, de la religion ou simplement des contraintes admises de notre corps. Mais, à lire le plaidoyer ou les interviews de Matsuda et de personnages qui ont grandi comme lui avec les jeux vidéo, le mobile et la toile, on se rend compte à quel point le nouvel Eldorado numérique, ses rêves en actes de réalité augmentée ou d’Internet des objets concrétisent la silhouette de ce cyborg, qu’il s’agisse du mutant rationnel des deux chercheurs de 1960 ou de l’hybride vital et diabolique de Donna Haraway en 1985. Car Keiichi Matsuda et ses pairs du Net parlent au présent, et non au futur prophétique, de cet organisme cybernétique qui devient peu à peu le nôtre, de leur hybride à eux, fait de réel et de virtuel, de machine et de vivant.
« Je veux mon implant Google maintenant ! »
Arika Millikan est journaliste au magazine américain Wired, temple païen de notre monde connecté. À la toute fin de la décennie qui vient de s’achever, dans le cadre d’un blog proposant « 50 posts à propos des cyborgs[2] » pour le cinquantième anniversaire de l’homme augmenté tel qu’imaginé en totale logique par Kline et Clynes, elle a écrit un texte dont le titre semble un poème à la gloire de notre post-humanité : « Je suis un cyborg et je veux dès maintenant mon implant Google ». Elle s’y met d’abord en scène dans une conférence sur le thème de ce que pourrait être Google en 2020[3]. Là voilà qui dialogue avec Hal Varian, « Chief Economist » au sein de la firme de Mountain View :
Hal : Aujourd’hui, vous associez Google à votre ordinateur, bien sûr. Mais aussi désormais à tout ce que vous pouvez faire avec Google sur votre mobile, c’est l’étape suivante. Et je crois – certains riront peut-être –, je pense qu’il y aura un jour un implant. Ce ne sera pas nécessairement un implant Google, mais plus largement un implant dédié au Web, vous permettant d’accéder à Internet par la simple pensée.
Arikia : Prévenez-moi dès qu’il sera prêt.
Hal : Vous voulez votre implant ?
Arikia : Je le veux tout de suite (rires).
Puis la discussion rebondit avec le ponte de Google au prénom prédestiné – Hal, merveilleux clin d’œil à l’ordinateur qui devient fou du vaisseau spatial du film 2001 L’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick. Personne, du côté de la compagnie californienne, ne travaille effectivement sur le projet d’un implant, avec gros budget à la clef. Mais il y a des équipes, en revanche, qui phosphorent sur le principe d’une connexion permanente au réseau devant permettre aux données de s’inscrire sur le ou les verres de lunettes. L’implant, chez Google, on ne le fabrique pas encore, mais on y pense sans cesse. Et de fait, cette puce qui s’enficherait pas loin de notre ciboulot pour que la connexion devienne un sixième sens, est une évidence pour Arikia : « J’ai eu mon premier ordinateur et ma première connexion Internet à huit ans, en 1994, explique-t-elle dans son article, mon esprit s’est construit et a appris à naviguer d’un même élan dans le monde physique et le monde en ligne (…). Considérant la façon dont Internet a littéralement façonné mon cerveau, je pourrais d’ores et déjà me considérer comme un cyborg. » Et d’enfoncer le clou (virtuel) : « Aujourd’hui, je suis connectée en permanence au Web. Les rares exceptions à la règle me causent une anxiété atroce. Je travaille en ligne. Je joue en ligne. Je fais l’amour en ligne. Je dors avec mon smartphone au pied de mon lit, m’extirpant régulièrement de mon sommeil pour checker mes mails (j’appelle ça parfois le « dreamailing »). Mais je ne suis pas assez connectée. Je crève d’envie d’une existence où les batteries ne s’éteindraient jamais, avec des connexions sans fil qui jamais ne nous lâcheraient et où le temps entre poser une question et en obtenir la réponse serait proche de zéro. Si je pouvais être branchée sur le Net 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je le ferais et je pense que beaucoup de mes pairs internautes feraient de même… Alors, Hal, s’il te plaît, dépêche-toi avec ton implant Google, car nous sommes terriblement impatients[4]. »
L’électronomade est un cyborg préhistorique
Le designer Keiichi Matsuda est de la même génération que la journaliste Arika Millikan. Pour lui comme pour elle, il n’y a pas débat quant au devenir cyborg de l’électronomade d’aujourd’hui, pour lequel la connexion continue au Web est comme une seconde « nature ».
Détail fort signifiant des deux vidéos de prospective qu’il a publiées sur YouTube en 2010 : c’est, sans smartphone ni casque de réalité augmentée, que les personnages de Domestic Robocop et d’Augmented City 3D [5] naviguent dans une avalanche de signes, d’icônes, de boutons, de graphiques et de symboles numériques, qui seront notre nouvelle atmosphère, apparaissant à notre demande devant nos yeux au rythme de nos tribulations au cœur de l’environnement urbain. L’imaginaire qui s’esquisse ici est celui du cyborg de Kline et Clynes, en ce sens que les êtres humains qui évoluent dans Domestic Robocop et Augmented City 3D exercent d’étranges pouvoirs dans la cuisine ou la bibliothèque, la rue ou les transports en commun, sans pour autant qu’ils ne semblent porter d’armure techno. Autrement dit : les outils de « l’augmentation » de l’homme et de la femme ne sont pas perceptibles aux observateurs que nous sommes. En revanche, force est de constater deux nuances. La première, c’est l’identité de l’univers à découvrir, à explorer : il ne s’agit pas du paysage totalement inconnu de quelque galaxie lointaine, mais un monde urbain qui, a priori, nous serait plutôt familier, du moins dans son essence. La seconde différence tient à la qualité de la technique induite par le devenir cyborg : ni radiation savamment choisie ni capsules de drogues à ingurgiter régulièrement pour transformer peu à peu l’organisme, mais simples adjuvants numériques, pustules mécaniques branchées sur les paradis du Net, qui, à voir les deux films, s’ajouteraient de façon invisible ou presque à notre personne. Il y a là comme un hommage post mortem au pape du LSD et gourou psychédélique Timothy Leary, qui pensait que les magies du nouveau monde numérique et leur capacité à altérer nos perceptions pourraient remplacer la sorcellerie des psychotropes « naturels » ou biochimiques.
De fait, en 2011, ce sont des appareils on ne peut plus visibles, Netbooks, tablettes tactiles et autres rutilants smartphones qui deviennent les extensions numériques de notre système nerveux. Mais ces terminaux et leurs interfaces appartiennent à l’âge préhistorique de notre hybridation de chair et de technologie, appelée à prendre une toute autre dimension lorsque Internet sera pour nous aussi « naturel » et accessible, de partout et tout le temps, que l’électricité. L’étape d’après nos terminaux mobiles pourrait être ce prototype de lunettes de réalité augmentée mis au point par des ingénieurs japonais, le StarkHUD 2020, qui ressemble aux « lunettes en verres miroirs » de la littérature cyberpunk de la deuxième partie des années 1980. Ou des dispositifs comme le AR Walker du géant de la téléphonie nippone NTT Docomo, lui aussi à l’état de prototype : ne pesant qu’une dizaine de grammes, il se fixe sur n’importe quel type de monture. Une fois la mécanique lilliputienne activée, les informations s’affichent sur le verre droit des lunettes, évitant à l’utilisateur de regarder l’écran de son smartphone. Car ce smartphone, muni d’un navigateur GPS pour la géolocalisation et branché sur le Net, est en quelque sorte le cerveau de l’AR Walker. D’autres, enfin, travaillent à des systèmes de projection laser directement sur la rétine de l’œil[6]. Quoi qu’il en soit de ces relais technologiques potentiels de l’immédiat à venir, l’horizon de la réalité augmentée et de cet Internet « everyware[7] » qui en est le langage, semble sans équivoque celui qu’esquisse Keiichi Matsuda dans ses vidéos : toujours plus proche de la relation directe au cerveau de l’être humain, à la façon des « périphériques d’apprentissage électronique intégrés » (ou « papies ») et des « modules mimétiques enfichables » (ou « mamies ») de l’écrivain cyberpunk George Alec Effinger dans Gravité à la manque[8].
Le terme de « réalité augmentée » mérite qu’on s’y arrête. Se niche en son euphémisme comme une astuce de l’évolution techno-humaine. L’expression se concentre en effet sur l’augmentation non de l’homme mais de sa réalité – comme si notre réalité gangrenée de fictions pouvait être objective et comme si l’on pouvait agir sur notre environnement proche sans pour autant transformer notre être ! Opérant un focus sur le caractère extérieur de la mutation, cette expression de « réalité augmentée » court-circuite notre peur du Golem ou surtout du monstre du docteur Frankenstein, héritage séculaire de notre imaginaire judéo-chrétien. Dans nos civilisations occidentales, la transformation de l’homme par l’homme, voire la fabrication du vivant sans besoin de Dieu, qui ferait donc de nous l’égal de la divinité créatrice, restent de l’ordre du tabou ou du moins de l’indicible. De l’inavouable. Prendre le scalpel pour nous « améliorer » n’est acceptable, selon les règles de notre ordre moral, qu’à des fins médicales : faute de mieux, pour sauver des vies… Dès lors, c’est en maquillant par le langage la vérité post-humaine du cyborg que des termes comme « réalité augmentée » voire « Internet des objets » la rendent acceptable, et permettent à l’humain de se sculpter lui-même et d’enrichir son être de prothèses machiniques sans la moindre justification humanitaire.
D’ailleurs les Japonais, à l’inverse des populations d’origine européenne, n’ont guère besoin de l’excuse médicale ou de l’artifice édulcorant des mots pour explorer à satiété les multiples avatars de l’augmentation de l’homme par la machine et les manipulations de la science. Leur culture, en effet, ne pose aucune différence de nature mais juste de degrés entre la pierre de silicium, la fleur, le robot et Superman, autrement dit entre la matière inerte, le végétal, l’animal et l’humanoïde plus ou moins sophistiqué. D’où la facilité avec laquelle un Keiichi Matsuda imagine les dix règles de son utopie réaliste de la cité pour les cyborgs que nous sommes, notre expérience quotidienne s’enrichissant dorénavant des multiples signes de nos réalités construites et médiatisées par la technologie. Car l’essence de cette hybridation dont nous sommes les cobayes consentants ne se joue ni purement et simplement dans le sens d’une réalité augmentée qui laisserait l’homme inchangé, ni dans celui d’un homme augmenté sans que son environnement ne soit transformé, mais à la fois dans l’un et l’autre sens, avec en perspective l’invisibilité, la transparence totale de l’appareillage artificiel associé à notre corps, que ce soit via des nanopuces RFID[9] sous la peau ou des modules à enficher près du cerveau.
Le cyborg de Donna Haraway dans la cité de Keiichi Matsuda
« Les dichotomies qui opposent corps et esprit, organisme et machine, public et privé, nature et culture, hommes et femmes, primitifs et civilisés, sont toutes idéologiquement discutables », écrivait en 1985 Donna Haraway, qui ajoutait, déroulant sa pensée du monde des idées à l’anticipation de renversements de l’ordre bourgeois qui n’en étaient alors qu’à leurs prémisses : « La maison, le lieu de travail, le marché, l’arène publique, le corps lui-même : tout fait aujourd’hui l’objet de ces dispersions et connexions polymorphes presque infinies[10] ». Ving-cinq ans après ce manifeste visionnaire, Keiichi Matsuda prend acte de l’explosion des frontières entre le public et le privé, le bureau et la maison, l’extérieur et l’intérieur mais aussi l’organisme et la machine à l’aube du tsunami numérique. Là où Haraway en appelait au détournement du phénomène de « cyborgisation » du monde par « l’informatique de la domination » au profit de la capacité des femmes à se libérer des codes de production et de reproduction de la « domination masculine, raciste et capitaliste », Matsuda se l’approprie à des fins de bouleversement des codes du vivre ensemble urbain.
Le premier de ses dix principes de cités adaptées au « dernier modèle de cyborg, le CY-2010 », sonne de façon paradoxale. Il a pour titre « Déprogrammer ». Déprogrammer non pas les ordinateurs mais la mécanique des architectes et leur manie d’assigner tous les lieux à une identité, à une fonction précise et figée pour toujours. Car il s’agit, pour reprendre sa troisième règle, de « designer des espaces, et non des murs », afin de laisser nos yeux, nos oreilles voire tous nos sens et in fine notre esprit recomposer notre environnement de vie selon nos lubies par la grâce de l’augmentation de la réalité. Certes, il nous faudra toujours des toilettes bien définies comme telles. Mais pour le reste, selon le jeune designer et architecte, toutes les pièces de nos maisons et de nos entreprises pourraient être transformées à loisir et selon les moments en « salle à manger », « salle de conférence », « librairie », « boutique », ou pourquoi pas (mais ça il ne le dit pas) « chambre à coucher » avec par exemple canapés pliables et jeux de lumières différents. Les lieux seront « liquides », s’adaptant en permanence à nos humeurs grâce aux prodiges du virtuel, entre le calme et la frénésie, à nos activités, seuls ou au contraire avec des collègues, notre compagnon ou nos enfants. Nous pourrons d’ailleurs décider nous-mêmes de transformer tel mur, telle affiche ou telle image de notre contexte immédiat au fur et à mesure de nos pas, via le re-façonnage du réel que permettraient nos lentilles, nos lunettes à transmuter ce que nous percevons… ou pourquoi pas notre implant Google !
« Le cyborg est un moi postmoderne individuel et collectif, qui a été démantelé et ré-assemblé. Le moi que doivent coder les féministes[11] », affirme Haraway. Matsuda se situe effectivement dans cette lignée constructiviste, mais avec une nuance : le code, pour lui, sert moins aux individus afin qu’ils se programment eux-mêmes qu’à la déprogrammation puis à la reprogrammation de l’environnement proche tel qu’ils le perçoivent. La féministe s’attaque au corps humain lui-même, mais elle ne le fait que par une puissante figure de rhétorique, d’une fiction permettant de décoder le réel et d’agir sur lui. Le designer, une génération plus tard, est à la fois plus modeste et plus ambitieux. Il est plus modeste qu’elle, car le cœur de son anti-utopie, de son manifeste de jeux, d’événements multiples, de transformation et d’extension des espaces publics est de l’ordre de la perception. L’électronomade passe au prisme de ses désirs ou de ses besoins la réalité qu’il perçoit. Autrement dit : il vit une mutation du voir et du sentir, pilotée par ses soins, mais pas une mutation de sa chair pesante. Matsuda est à l’inverse plus ambitieux qu’Haraway, parce qu’il ne se contente pas d’un roman opérationnel, d’une fiction à même de changer le monde. Le codage, tel qu’il le met en scène dans ses films comme dans son texte, se concrétise via la danse des 0 et des 1 au cœur de notre vie réelle, même si elle ne signe que la préhistoire de notre devenir cyborg. Il s’inscrit dans une zone floue, une toute nouvelle couche de réalité ou d’e-réalité à l’intersection de l’intérieur et de l’extérieur de chacun, pleine d’informations, de décryptages, mais aussi potentiellement d’altérations de nos perceptions, donc de nous-mêmes, au-delà même de notre surface.
Déjà en 1985, Haraway affirmait : « Nos meilleures machines sont faites de soleil, toute légères et propres car elles ne sont que signaux, vagues électromagnétiques, section du spectre. Elles sont éminemment portables, mobiles – un sujet d’immense douleur à Détroit et Singapour. Matériels et opaques, les gens sont loin de cette fluidité. Les cyborgs sont éther, quintessence. C’est justement leur ubiquité et leur invisibilité, qui font des cyborgs ces machines meurtrières. Difficiles à voir matériellement, ils échappent aussi au regard politique. Ils ont trait à la conscience – ou à sa simulation[12]. » Vingt-cinq ans plus tard, c’est cette prémonition, cet éclair lumineux de la militante que Matsuda concrétise, mais de façon moins radicale voire plus ambiguë, car en prise directe avec l’exercice de son métier de designer et d’architecte. Donna Haraway frappe les esprits de ses lecteurs d’une vision de l’extérieur de leur monde, pour mieux les secouer avant qu’ils ne soient entièrement soumis à « l’informatique de la domination ». Elle en appelle à un détournement politique de ce biopouvoir à la puissance surmultipliée. Le jeune Keiichi Matsuda, qui vit entre Tokyo et Londres, ne peut se satisfaire d’un manifeste, aussi nécessaire soit-il. Car lui se trouve dans l’obligation de transiger avec son réel au quotidien. Il navigue à la fois au-dedans et au-dehors de cette informatique de la domination, elle-même très trouble. Il est tout autant acteur que critique de notre devenir cyborg. Face à l’absence de toute fin politique qu’incarne Arika Millikan et son implant Google, il met en scène les risques de l’éternelle manipulation par les marques et leurs logiques d’addiction, d’une vie « diminuée » et non « augmentée ». D’une manière forcément mutante et imprédictible, les songes scientifiques de Kline et Clynes d’il y a un demi-siècle et les rêves poético-politiques de Haraway il y a une génération prennent corps peu à peu. Matsuda en prend acte, et c’est pourquoi il tente de construire une « anti-utopie » post-situationniste, non seulement à penser mais à vivre hic & nunc par le CY-2010 et ses futurs modèles plus sophistiqués.
Machines humanoïdes ou corps mutants ?
Le manifeste « contre-nature » de Donna Haraway reste un point référence, plus impertinent que jamais à l’heure de la « réalité augmentée », de « l’Internet des objets », de la biogénétique, des nanotechnologies et des rêves de maîtrise scientiste qui les accompagnent. Sa clé réside dans l’incertitude même du devenir qu’il trace : « La politique du cyborg est la lutte pour le langage et la lutte contre la communication parfaite, contre le code unique qui traduit parfaitement chaque sens, dogme du phallocentrisme. C’est pourquoi la politique du cyborg insiste sur le bruit et préconise la pollution, jouissance des fusions illégitimes de l’être humain et de la machine[13]. »
Sur ce registre, les visions de techno-prophètes comme le roboticien Hans Moravec, contemporaines de son Manifeste cyborg, seraient son antithèse à l’inverse légitime : non pas la réinvention de la femme à partir d’un réencodage de ce que nous avons de plus fondamentalement humain, débarrassée du mythe du retour à l’origine, mais les retrouvailles de l’homme avec le Paradis perdu par la grâce de l’implant final ou, plus fou, du téléchargement de notre esprit dans la carcasse d’un robot, par exemple arborescent, à la « colossale intelligence », à la « coordination extraordinaire », à la « rapidité astronomique » et à « l’immense sensibilité à son environnement ». Soit un enjeu que Moravec résumait ainsi en 1988 : « Trouver un procédé qui permette de doter un individu de tous les avantages de la machine sans qu’il perde son identité personnelle. Beaucoup de gens ne vivent aujourd’hui que grâce à un arsenal croissant d’organes artificiels et autres pièces de rechange. Un jour, grâce en particulier aux progrès des techniques robotiques, ces pièces de rechange seront meilleures que les originaux. Alors, pourquoi ne pas tout remplacer – c’est-à-dire transplanter un cerveau humain dans un corps robotique à cet effet ? Cette solution nous libèrerait de l’essentiel de nos limitations physiques. Malheureusement, elle ne changerait rien à notre principal handicap, l’intelligence limitée du cerveau humain. Dans ce scénario, notre cerveau est transplanté hors du corps. Existe-t-il à l’inverse un moyen d’extirper notre esprit de notre cerveau[14] ? »… Et le chercheur, très sérieusement, de répondre par la positive.
Le Robocop en « downloading » du scientifique Moravec peut-il seulement être qualifié de cyborg ? Paradoxalement, en 1993, l’artiste ORLAN n’est-elle pas bien plus cyborg que lui quand elle engage son corps dans Omniprésence ? Lorsqu’elle joue littéralement sa peau pour une opération de chirurgie esthétique visant à transformer radicalement son visage par deux implants au niveau de ses tempes, elle clame et réclame son droit à une singularité absolue. Là où Moravec reste abstrait, idéologique, et ne met en jeu que sa réputation, elle transforme sa théorie en acte, au cœur du réel le plus tangible. Qu’on l’apprécie ou non, cette construction d’une réalité on ne peut plus charnelle creuse toute la différence. Aux dangereux délires du roboticien, de l’ordre de la pure spéculation sous sa carapace objectiviste, ORLAN répond par la subjectivité d’une monstrueuse beauté qu’elle met en forme devant le parterre de l’art et de la bonne société. « Ceci est mon corps…Ceci est mon logiciel… », raconte-t-elle au travers d’une autre de ses œuvres. Héritière de Donna Haraway, ORLAN est la Madone des Self-hybridations, selon le nom des mutations informatiques de son visage en multiples icônes précolombiennes, africaines et amérindiennes[15]. Sur le registre du bio-art, que la Dame infiniment sculptée a effleuré récemment de son Manteau d’Arlequin, œuvre constituée d’un mariage de ses propres cellules avec celles d’animaux, il faudrait également citer Alba, lapine fluo car transgénique d’Eduardo Kac, qu’il a « commandée » et qu’il aurait lâchée au cœur du monde pour que chacun accepte sa réalité d’animal cyborg, si le labo ayant mené l’opération de transplantation d’un gène de méduse n’avait pas refusé l’indispensable mise en liberté de ce mutant. Kac anticipe notre devenir cyborg selon sa facette la plus vitale : il érige en œuvres des organismes vivants qu’il transforme et manipule pour montrer – au sens propre – notre humanité future, composée d’êtres hybrides génétiquement ou électroniquement modifiés, mêlant les spécificités de l’homme, du végétal, de l’animal et de la machine[16]. Au risque de l’incompréhension voire du dérapage, ORLAN et Éduardo Kac choisissent leurs corps mutants contre les Super héros et les machines humanoïdes de « l’informatique de la domination ». Ils détournent à leurs propres fins les armes du pouvoir, et ainsi se mettent en danger. Ce qu’ils racontent, eux comme Keiichi Matsuda, c’est que l’hybridation, en elle-même, n’a pas la moindre valeur. Elle n’est qu’un procédé d’époque, qui se joue des ADN et des mariages des dieux et déesses du numérique. Il convient de s’en emparer, au-dedans comme surtout au-dehors des forces dominantes. L’enjeu est de ne pas laisser ce potentiel de l’hybridation tous azimuts entre les mains des instances de l’abrutissement généralisé. C’est ce que Keiichi Matsuda accomplit avec ses cités pour cyborgs de l’ère Internet, et ce qu’ont parfois réussi en pionniers ORLAN et Éduardo Kac. Inscrivant leur devenir cyborg au présent, mettant en actes leur fiction de l’à venir au-delà des mots, ils tissent une histoire vécue que peuvent s’approprier les gosses de l’ère du tout numérique et de la biogénétique. Pour qu’à leur tour, ils hybrident leur monde et pourquoi pas leur être en toute singularité.