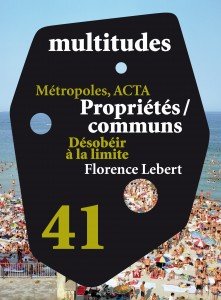Les raisons de se révolter ne manquent pas, il existe une multitude de causes justes et on trouvera toujours des militants pour les servir. Mais on ne se révolte pas n’importe comment : s’engager dans un combat contre l’injustice, l’inégalité ou la domination est une activité qu’il faut justifier et qui doit s’exprimer sous une forme d’action politique acceptable. Dans une démocratie, le spectre de la contestation d’un pouvoir en place va du vote à l’insurrection, en passant par l’abstention, le boycott, la pétition, la manifestation, la grève, l’usage modéré ou symbolique de la violence, l’émeute. Une autre forme d’action politique est la désobéissance civile, devenue un peu suspecte depuis la fin des grands mouvements des années 1970-1980 qui lui ont donné ses lettres de noblesse et dont la légitimité se justifiait presque d’elle-même (guerre du Viêt-Nam, droits civiques, ségrégation raciale, homosexualité, droit des femmes, avortement)[1]. Deux arguments expliquent cette suspicion : la désobéissance serait l’expression d’une sensibilité froissée et sans lendemain puisqu’elle n’est pas articulée à un projet de changement de majorité politique ; elle porterait toujours en elle le danger de saper le fondement de la démocratie, en rendant légitimes des actions de type identique, mais dont l’objet est d’en finir avec l’État de droit[2]. Ce sont ces deux arguments que cet article entend discuter, en cherchant à établir la nature intrinsèquement politique de la désobéissance civile, puis à dégager le motif politique qui se trouve à l’arrière plan de la prolifération des actes qui s’en revendiquent aujourd’hui en France.
Le savoir-faire politique des citoyens
Tout laisse à penser que les citoyens (ou, pour être plus précis, ceux d’entre eux qui participent à des « minorités actives ») savent quand, comment et pourquoi adopter la modalité de protestation la plus appropriée pour faire connaître leur désaccord avec ceux qui les dirigent ou les gouvernent. L’existence de ce savoir-faire se vérifie aisément. Prenons un exemple : soit une décision prise par la direction d’une firme multinationale de fermer une usine en France en mettant ses ouvriers au chômage. En réaction à cette décision, des formes d’action admises sont immédiatement mobilisées : occupation, manifestation, grève, voire séquestration du directeur de l’entreprise ou de celui des ressources humaines. Ces protestations (lorsqu’il y en a, c’est-à-dire lorsque cette annonce brutale ne rencontre pas la résignation des salariés) sont normalement relayées par les syndicats, les partis politiques, les élus locaux voire nationaux qui jurent, s’ils reconnaissent l’indécence de cette fermeture, de défendre les victimes d’une décision indigne et d’intervenir pour maintenir le site et sauvegarder l’emploi. Bref, tout ce qui constitue l’ordinaire de l’activité d’opposition dans une démocratie est mis en branle, en accord avec une convention : l’expression d’un désaccord politique s’inscrit dans un système d’alternance où une minorité admet de respecter la règle de la majorité.
Revenons à la fermeture de l’usine et supposons que les salariés se mettent à retenir des membres de la direction plus longtemps qu’il n’est communément admis ; ou décident de bloquer les stocks (pour autant qu’il y en ait encore) avant de commencer à les vendre de façon sauvage. Et les choses peuvent évoluer plus durement encore s’ils menacent de détruire les installations industrielles, contre l’avis des syndicats et les appels au calme des responsables politiques ou des autorités. On quitte alors les figures imposées de l’opposition pour entrer dans un autre registre de l’action politique, qui intègre le recours à la violence.
C’est ce registre qu’adoptent les militants qui luttent contre le développement des Organismes Génétiquement Modifiés en fauchant les champs de maïs ou de betteraves pour exiger l’arrêt de ce genre de culture en plein air ; ou ceux de Droit au Logement, qui installent des campements de tentes dans les rues ou procèdent à des réquisitions d’immeubles vides. Le choix de la violation de la propriété privée et de la détérioration matérielle volontaire est, en ce cas, ouvertement revendiqué : il vise à mettre publiquement en cause la légitimité de politiques publiques qui autorisent à semer et à consommer des plantes censées représenter une menace grave pour l’humanité ; ou ne prennent pas la mesure des problèmes que rencontrent les mal logés et les sans abri. Cette forme d’action peut s’articuler à celle que mène une opposition et se traduire, parfois, en décisions gouvernementales (moratoire sur les cultures d’OGM ou droit opposable au logement par exemple). Mais elle peut également rejeter cette articulation et se radicaliser : c’est le cas lorsqu’un groupe d’individus décide de se livrer à des violences organisées (affrontements délibérés contre la police, pillages, ou mises à sac lors de manifestations autorisées), des actes de sabotage (faire sauter des caténaires par exemple) ou des assassinats (comme dans les « années de plomb » d’après 1968) pour manifester sa révolte contre un système qu’il abomine.
À l’autre pôle du spectre, on trouve des formes d’action politique qui rejettent l’usage de la violence tout en se situant délibérément hors du système représentatif. C’est par exemple le cas de l’engagement de citoyens qui viennent spontanément en aide à des étrangers en situation irrégulière, même s’ils sont informés du risque qu’ils courent d’être poursuivis et sanctionnés, ou de faire l’objet d’un fichage et d’un harcèlement de la part de la police ou de la justice. À un degré d’engagement supérieur, cette aide peut prendre l’allure d’une action politique qui cherche à contraindre les pouvoirs publics, en les forçant à faire procéder à des inculpations et à des jugements, à décider l’arrêt des mesures répressives à l’égard de clandestins, à mettre un terme à l’arbitraire des procédures de régularisation ou à réviser la législation sur l’accueil des étrangers. Une dernière sorte d’action politique non-violente consiste à se mettre délibérément en infraction en refusant de remplir une obligation légale ou réglementaire au motif qu’elle est inacceptable, indigne ou injuste.
Deux types d’activistes adoptent aujourd’hui cette forme d’action. Le premier regroupe ceux qui se nomment des « désobéisseurs » et qui exigent, en se mettant pacifiquement hors la loi, le retrait d’une disposition qu’ils jugent attentatoire à un principe de l’humanité ou de la démocratie. Le second, ceux qui se nomment des « désobéissants »[3], assoit sa protestation sur une «action directe non-violente» qui rompt avec les modes traditionnels de la mobilisation politique qu’ils jugent obsolètes et inefficaces à une époque où la couverture médiatique d’un événement est devenue l’aune à laquelle on apprécie la force d’une revendication. Ces désobéissants espèrent faire aboutir la lutte plus rapidement en utilisant des tactiques inédites et en exploitant les ressources qu’offre le « buzz » que crée une médiatisation conçue et réalisée de façon professionnelle.
En somme, les formes d’action politique dont les citoyens savent se servir dans l’espace d’une démocratie représentative prennent trois allures : celle des opposants, celle des « désobéissants » et celle des « désobéisseurs ». Et seule cette dernière correspond à la désobéissance civile stricto sensu. Quelle en est donc la singularité ?
Les attributs de la désobéissance civile
Avant d’être un problème théorique de droit, de philosophie morale ou de science politique, la désobéissance civile est une forme d’action politique, dont on peut admettre que ceux qui y recourent savent approximativement ce qu’ils ont à faire quand ils s’y engagent. Elle ne se donne pas pour objectif de changer de régime ou de renverser un gouvernement. Ce que les actes qui l’expriment visent est le retrait d’une loi ou d’un texte réglementaire considéré comme néfaste ou scélérat. L’étroitesse de ce genre de revendication conduit souvent à lui dénier tout caractère politique.
Un tel déni semble un peu déraisonnable, ne serait-ce que parce que ceux qui décident de commettre un acte de désobéissance civile mettent leur savoir-faire politique à contribution pour que leur geste soit compris pour ce qu’il est par ceux auxquels il s’adresse. Quels sont les éléments de ce savoir-faire ? Le premier est, aussi banal que cela puisse paraître, l’existence d’une démocratie dans laquelle l’indépendance de la justice est une pratique établie. Cette condition est exigeante : dans un régime démocratique où la justice est encore sous le contrôle du politique, le refus de se conformer à la loi pour des raisons de convenance personnelle (conscience, dégoût, éthique, etc.) risque vite d’être réduit à un simple délit. Un second élément est de s’assurer que l’acte posé présente quatre attributs. Le premier est d’être public : un refus d’obtempérer qui reste cantonné dans le for intérieur d’une conscience ou s’exprime de façon solitaire et isolée évoque d’autres figures, comme celles de l’insoumis, du rebelle, de l’ermite ou de la personnalité caractérielle. Le second est d’être personnel : la désobéissance engage la responsabilité d’un individu qui accepte – voire sollicite – en la commettant la sanction qui accompagne son infraction. Le troisième attribut tient au caractère général de la protestation qu’il exprime : un refus de se plier à une obligation légale doit être formulé au nom d’un ensemble d’individus qui ressentent une semblable aversion à l’idée d’avoir à la respecter. Un quatrième attribut accompagne le précédent : la contestation de la légitimité d’une obligation doit être exprimée au nom de principes politiques ou d’impératifs moraux « supérieurs » à ceux sur lesquels repose la légalité d’une loi d’État.
Un dernier élément de savoir-faire doit être mobilisé pour qu’un acte soit qualifié de désobéissance civile : déplacer l’affrontement du champ politique vers celui de la justice. En contrevenant ostensiblement à une prescription considérée comme anachronique, injuste voire illégale, les désobéisseurs mettent les juges en demeure de statuer (même si cette demande ne se concrétise pas souvent) sur la légitimité d’une prescription légale ou réglementaire.
L’essentiel des caractéristiques qui viennent d’être détaillées figure dans la définition que Hugo Bedau a formulée au tout début des années 1960 : « Un individu commet un acte de désobéissance civile si et seulement si il agit de façon illégale, publique, non-violente, et délibérée dans l’intention de s’opposer à une des lois, politiques ou décisions de son gouvernement »[4]. Cette définition a été reprise par John Rawls, qui l’a enrichie en analysant les conditions spécifiquement politiques que cette forme d’action doit satisfaire.
Un droit à la désobéissance ?
Pour Rawls, la désobéissance civile est une affaire qui ne peut se réduire à une question de droit. Être en démocratie, c’est, pour ses citoyens, éprouver quotidiennement le fait que les « institutions de base » de la société dans laquelle ils vivent sont justes, c’est-à-dire que les libertés de conscience, d’association, d’expression des opinions et de manifestation de la désapprobation y sont effectivement garanties ; que la justice y est réellement un pouvoir indépendant et intègre ; que l’alternance politique s’y réalise régulièrement[5]. Dans un tel système, la désobéissance devrait en principe être exclue puisque, selon Rawls, « le devoir de civilité impose d’accepter les défauts des institutions, dans une mesure raisonnable, et de ne pas chercher à trop en profiter […] dans une situation presque juste du moins, il y a normalement un devoir (et, pour certains aussi, une obligation) d’obéir à des lois injustes à condition qu’elles ne dépassent pas un certain degré d’injustice »[6]. Le problème que pose la désobéissance est donc moins celui de la justification de la contestation des fondements de la démocratie que celui de la légitimité dont jouissent ceux qui fixent les limites du raisonnable en matière politique et les critères retenus pour définir un état de « presque justice ». Ou, comme le dit Rawls, celui de savoir à partir de « quand le devoir d’obéir aux lois promulguées par une majorité législative (ou à des décrets issus d’une telle majorité) cesse-t-il d’être une obligation face au droit de défendre ses libertés et au devoir de lutter contre l’injustice ? »[7] Pour lui, cette question est de nature pratique : chaque citoyen se la pose et y apporte ses propres réponses. Et c’est exactement ce qui se produit lorsque des actes de désobéissance civile (comme ceux qui ont ponctués la lutte pour les droits civiques et contre la guerre au Viêt-Nam dans les États-Unis des années 1960) ouvrent un débat public sur le bien-fondé de la protestation qu’ils expriment. Pour Rawls, la désobéissance a une utilité : elle est « un des moyens de stabiliser un système constitutionnel, même si c’est par définition un moyen illégal. Quand elle est utilisée de manière limitée et à bon escient, elle aide à maintenir et à renforcer des institutions justes tout comme des élections libres et régulières ainsi qu’un pouvoir judiciaire indépendant ayant le pouvoir d’interpréter la constitution… Que les citoyens soient prêts à recourir à la désobéissance civile justifiée conduit à stabiliser une société bien ordonnée ou presque juste »[8]. Bref, ce qui est déterminant pour Rawls n’est pas la résolution individuelle de celui qui désobéit pour être en accord avec son sens de la justice, mais le travail accompli pour préserver le caractère juste des institutions de base de la société.
Arendt admet elle aussi le bien fondé des mouvements de contestation qui ont secoué l’Amérique des années 1960, mais elle les envisage sous un tout autre angle. Afin de mettre un terme à un affrontement funeste, elle propose de « régulariser » la désobéissance civile en l’assimilant à une expression du droit d’association garanti par la Constitution américaine. Ce qui reviendrait à accorder aux groupes prônant cette forme d’action un statut identique à celui de ces innombrables lobbies qui plaident, officiellement, la cause d’intérêts privés auprès des gouvernants et des parlementaires. Arendt ne semble pas voir que sa proposition entre en contradiction avec le concept même de désobéissance, qui suppose une réaction émotionnelle imprévisible face à une prescription obligeant à se conduire de façon inique, abjecte ou intolérable[9]. Mais il y a plus : instituer un droit à la désobéissance est une démarche risquée quand on ne peut pas savoir à l’avance de quel refus elle sera l’émanation. Car une fois ce droit institué, comment pourrait-on en interdire la jouissance à des individus ou des organisations qui rejettent les principes mêmes de la démocratie ? Pour parer ce danger, il faut donc adopter une démarche plus prudente : s’il fallait envisager l’institution d’un droit à la désobéissance, dit Ronald Dworkin, il conviendrait tout d’abord de fixer très précisément les critères qu’un citoyen devra faire valoir devant un tribunal pour que son éventuel refus d’appliquer les prescriptions d’un texte législatif ou réglementaire puisse être jugé effectivement conforme à ce droit[10].
La perspective de Rawls est plus analytique que prescriptive. Pour lui, la désobéissance civile est « un acte politique, pas seulement au sens où elle vise la majorité qui a le pouvoir politique, mais parce qu’elle est guidée et justifiée par des principes politiques, c’est-à-dire par les principes de justice qui gouvernent la constitution et, d’une manière générale, les institutions de la société »[11]. De ce point de vue, elle est une forme d’action politique normale. Cette position n’est toutefois pas unanimement partagée. Certains voient en effet dans ces gestes de révolte qu’ils jugent incohérents le signe d’une véritable panne de la « république représentative »[12] et de ses rouages établis, reflétant la distance de plus en plus prononcée qui s’est instaurée entre les élites et le peuple, ou pire, le symptôme d’une pathologie[13] quant ce n’est la marque de l’aggravation de la défiance traditionnelle des citoyens à l’endroit du personnel politique qui les représentent ou les gouvernent[14]. Mais, pour qui suit Rawls, ces jugements alarmistes reposent sur une idée fausse selon laquelle la désobéissance civile, ne respectant pas les règles de la démocratie représentative, n’appartiendrait pas au registre des formes d’action politique légitimes. Cette idée est fausse tout simplement parce qu’elle ignore un fait d’observation : les actes de désobéissance, loin d’être des mouvements d’humeur irrationnels ou dangereux, mettent au jour le souci des citoyens d’exercer leur vigilance à l’égard du contenu pratique (et pas simplement symbolique) des textes législatifs et réglementaires[15].
On peut donc prolonger l’analyse de Rawls un peu au-delà de ce qu’il aurait admis et dire que la désobéissance civile exprime, directement dans l’action, la conception ordinaire que les citoyens se font de l’étendue des droits et des libertés qu’un régime démocratique devrait leur garantir. Et c’est exactement ce dont atteste les revendications exprimées aujourd’hui par ceux qui se mettent délibérément en infraction pour se soustraire à l’obligation d’appliquer une instruction qu’ils jugent inacceptable.
Performance et démocratie
La France contemporaine vit sans doute un moment marqué par une élévation atypique du nombre d’actes de désobéissance civile. Et sans que personne ne sache si ce phénomène n’est qu’un effet de mode ou s’il va modifier durablement les pratiques de la démocratie représentative, la liste des groupes qui adoptent cette forme d’action politique s’allonge : professionnels de secteur public qui refusent de transmettre leurs dossiers au maire dans le cadre de la politique de Prévention de la délinquance ; membres du Réseau Éducation Sans Frontière qui assistent les élèves étrangers menacés d’expulsion ; militants associatifs qui viennent en aide aux clandestins ; agents de Pôle Emploi qui refusent de se plier à l’obligation de contrôler la régularité du séjour en France d’un étranger demandeur d’emploi et d’en informer la préfecture de police, ou de communiquer des noms de chômeurs afin de procéder à leur radiation ; personnes qui refusent de se soumettre à un prélèvement A.D.N. à la suite d’une interpellation par la police ; inspecteurs du travail qui refusent de traquer les étrangers en situation illégale sur leur lieu de travail ; enseignants qui refusent de remettre les maquettes de leurs masters, qui « retiennent » les notations ou suspendent leur participation aux instances d’évaluation ; masseurs-kinésithérapeutes qui refusent de s’inscrire à un Ordre nouvellement crée ; parents, proches et médecins qui déclarent ouvertement avoir pratiqué l’euthanasie. Et la liste n’est pas exhaustive…
Cette situation anomique porte les natures inquiètes à s’alarmer et à dresser un tableau catastrophiste d’un état politique gravement délabré. Une observation plus lucide conduit cependant à une appréciation moins dramatique car, loin d’être un déni du politique, ces actes de désobéissance civile en appellent généralement à un respect plus scrupuleux des droits et des libertés qui devrait être assurés en démocratie[16]. Ce qui arrive lorsque s’exprime une réaction viscérale à l’indignité et à l’injustice, comme dans le cas exemplaire de la défense des droits des étrangers sans papiers et de leurs enfants. Mais c’est également le cas lorsque des agents de l’État refusent de suivre des instructions dont ils ont le sentiment qu’elles font peser des menaces sur l’égal accès des citoyens à des besoins fondamentaux (santé, éducation, justice, etc.) ; ou nuisent aux libertés individuelles ; ou dégradent la qualité des prestations offertes aux usagers d’un service public. La désobéissance civile prend alors une allure un peu inédite : boycott des opérations de numérisation (comme la procédure Base élèves[17]) ou refus de produire ou de communiquer de données indispensables à l’exécution des procédures légales ou administratives (blocage des saisies informatiques ou retenue des notes ou des évaluations). La nature politique de ces actes reste mystérieuse : de quel genre de protestation sont-ils l’émanation ? Pour le comprendre, il faut les rapporter au mouvement de réforme qui affecte les démocraties de droit social depuis près de quarante années maintenant.
L’exercice du pouvoir s’accompagne généralement d’un discours de légitimation, qui peut être formulé, selon le moment de l’histoire d’une société, en se servant de multiples registres : on peut gouverner en mettant en avant la tradition, l’égalité, la justice, la grandeur, la souveraineté, la ségrégation, la religion, la guerre, la nation, la croissance économique, etc. Au tournant des années 1970, un nouveau registre de légitimation a fait son apparition dans les pays développés : gouverner au résultat – en entendant la notion de résultat au sens particulier de mesure de la performance de l’action publique selon le degré de réalisation d’objectifs chiffrés[18]. On peut comprendre cette innovation de trois manières. La première renvoie à un problème de légitimité : s’engager à rendre des comptes sur l’action conduite vise à réhabiliter le politique ; la seconde est interne au monde du pouvoir exécutif et de la haute administration d’État : exiger des « résultats » des services qu’on dirige est un procédé qui permet de vaincre la résistance que les bureaucraties opposent traditionnellement à tout changement qui vient remettre en cause les pouvoirs et les habitudes qui s’y sont installées[19]. La troisième manière de comprendre l’introduction de la « culture du résultat » rapporte à une volonté d’insuffler un peu d’esprit d’entreprise, de rentabilité et de compétition dans ces univers assoupis par la routine et la sécurité de l’emploi que seraient les administrations d’État, en alignant les règles du travail qui y prévalent sur celles qui sont en vigueur dans le monde économique[20].
Gouverner au résultat nomme donc une manière de conduire les affaires publiques qui se résume en une analogie : l’État doit être géré comme on gère une entreprise. Cette analogie n’est pas purement rhétorique – ou idéologique. Elle se traduit dans les réformes qui bouleversent le travail des administrations : accroissement des tâches sous couvert de simplification et de « dématérialisation » des démarches administratives ; multiplication des obligations de renseigner des bases de données ; concentration des pouvoirs dans les mains de directeurs dont l’autorité est renforcée ; réduction des marges de manœuvre des personnels d’exécution ; limitation de la souveraineté des professionnels de la justice, du soin, de l’enseignement ou de la recherche par la standardisation de leurs pratiques.
Ce bouleversement est contemporain de la réduction programmée des prérogatives de l’État. Cette concomitance crée une confusion. Alors que ces deux lignes de changement sont partiellement liées entre elles, elles sont rapportées à la victoire du néo-libéralisme et à ses corollaires : la déréglementation au service des forces du capital financier, la concurrence comme mode de régulation des rapports sociaux, la marchandisation du service public et sa privatisation. Cette explication conduit à ignorer un phénomène politique dont les effets sont autrement déterminants : l’imposition de la logique du résultat et de la performance dans l’ordre du politique. L’un de ces effets est la transformation de la manière de gouverner : la quantification de l’action publique permet de mettre en œuvre des méthodes de management assurant que les décisions de l’exécutif se traduiront effectivement en actes (comme c’est le cas avec le système d’évaluation des performances institué par la loi organique de 2001)[21]. Le second effet est la modification de l’attitude des gouvernants : la quantification les dotent de certitudes au sujet de la validité absolue des mesures qu’ils prennent et favorisent le développement de comportements fermes et autoritaires[22].
Ce durcissement est une des sources des actes de désobéissance civile dont on observe aujourd’hui la prolifération. Il suscite ces réactions d’agents et de professionnels de services publics confrontés à la morgue et au mépris de managers qui leur imposent des manières de faire plus « performantes », sans s’arrêter à leurs remarques sur les conditions requises pour remplir leur mission ou exercer leur métier de façon correcte. On peut également rapporter à cet usage gestionnaire de la quantification le refus de ces agents et professionnels de suivre des instructions qui les rebutent : faire prendre conscience des effets destructeurs que la numérisation du politique produit sur la conception de la vocation de l’État et des services qu’il doit rendre à ses citoyens.
Voilà qui nous rapproche de la nature politique des actes de désobéissance civile provoqués par l’imposition de la logique du résultat et de la performance dans l’action publique. C’est que cette imposition fait subir une même expérience aux agents et professionnels de service public : celle de la dépossession[23]. Et cette expérience est ressentie dans trois domaines : celui du métier (les procédures d’évaluation produisent une description de l’activité professionnelle qui ne correspond pas aux manières de faire établies ou aux règles de l’art reconnues) ; celui de la langue (les citoyens ne savent plus très bien de quoi ils parlent lorsqu’ils emploient des mots ordinaires – efficacité, équité, responsabilité, liberté, autonomie, qualité, résultat, transparence, etc. – dont les gouvernants se servent pour nommer des techniques de gouvernement dont l’application produit des effets contraires à ce que leur nom laisserait supposer) ; celui de la voix[24] (les critiques ou les doléances que les agents expriment au sujet de la manière dont les affaires publiques devraient être conduites comptent de moins en moins aux yeux des gouvernants).
Les actes de désobéissance civile motivés par le refus de la logique du résultat et de la performance sont politiques dans la mesure où ils combattent la dépossession de soi que provoque la réforme de l’État. Cette caractérisation bute néanmoins sur une difficulté : comment établir le lien entre le refus de renseigner un fichier informatique dans un service d’un établissement administratif et la dénonciation globale d’une manière de gouverner dont on prétend qu’elle remet en cause la vocation de l’État et les principes démocratiques ? Et on retrouve là le paradoxe de la désobéissance civile : en rendant public leur refus de se plier aux instructions qu’ils jugent inacceptables, ceux qui recourent à cette forme d’action savent que le rôle qu’ils se donnent est celui d’être des vigies de la démocratie. Et la question reste ouverte : est-ce un rôle politique ? J’ai essayé de montrer que c’en était bien un, à sa propre manière.