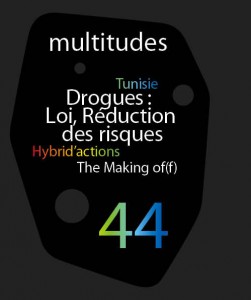Dans le livre, L’esthétique de la résistance, il y a un passage où le lecteur peut lire comment un groupe de jeunes, déambulant dans un musée, observe avec un vif intérêt les œuvres qui se dressent devant eux. Il pourrait s’agir d’une représentation de la victoire des Romains dans la patte levée d’un cheval qui va pour écraser un homme à terre. Alors que cette représentation est là pour signifier la victoire et la supériorité de l’un sur l’autre (d’une armée sur une autre), annonçant l’essor d’un nouvel empire, victoire de Rome sur Athènes, les hommes qui se tiennent là, debout, pourraient se saisir de tout autre chose de la représentation. Le courage, la résistance, la vaillance de celui qui est à terre, et qui désormais est soumis à la domination et à la puissance de l’autre. Se concentrant bien plus sur le visage de celui qui se tient sous la patte du cheval que sur le dominant celui qui tient les rênes.
Hybridation historique
Dans cet extrait, Peter Weiss évoque pour le lecteur la complexité tant de l’image que du temps. Car, si le « vainqueur », le dominant est celui qui est censé concentrer tous les regards et les souvenirs, marquant l’histoire par sa puissance, il se trouve que, dans le même temps, le vaincu porte aussi en lui la potentialité d’attirer l’attention ou la mémoire. Cette représentation dualiste s’est égrenée dans la représentation et la construction historique depuis l’aube des temps, et elle s’est propagée en portant en elle cette imbrication de contraires même lorsque la figure allongée du vaincu a progressivement disparu de la représentation[1].
Cette évocation rapide permet de souligner l’hybridation historique dans laquelle se constitue la mémoire et qui a aussi parcouru la réflexion philosophique. Les uns insistant sur le vainqueur, comme Nietzsche pour qui la mémoire se fait par le marquage aux fers rouges des corps et des âmes ; ou sur le vaincu comme Benjamin qui souligne la potentialité de surgissement de l’expérience de liberté des vaincus par sa réappropriation via les images dialectiques venues du passé. Dans un passé plus proche, Aimé Césaire, ou Oswald de Andrade ont ouvert une réflexion sur la créolisation, le métissage du monde, via l’incorporation de l’autre dans une culture qui, apparaissant comme mineure, va envelopper et avaler le dominant[2].
Cette vision de l’histoire qui se fait dans l’apparition et l’appropriation du contradictoire et de l’hétérogène s’articule, par son écho, sa résonance, dans la subjectivité des êtres. Non seulement, elle est riche de potentialité quant à la considération d’un monde commun, mais elle surgit aussi dans sa relation d’intimité à l’expérience des êtres et à leur subjectivité. Elle se cristallise dans la question comment les êtres vivent et comprennent l’histoire qui les traverse ?
Subjectivité trouée
Cette impossibilité à défaire ce qui est mêlé se trouve également chez Adorno qui indique cette indissociable communauté de la souffrance de l’un et de la victoire de l’autre dans la représentation. Il le fait en usant de l’image de la trace, le vaincu, celui qui est déchu, a encore sur son visage la trace de la souffrance qu’implique la victoire de l’autre. Dans ces images, la dualité est aussi marquée par une caractéristique : la violence et les effets qu’elles produisent sur les êtres.
Ainsi, les éléments d’une histoire, sa forme hétérogène, ses formes hétérogènes même, se jouent d’abord dans une sorte de magma aussi vif que confus que l’individu traverse avec autant de difficultés que de ténacité. Il est ainsi impossible de ne pas aborder les effets et résonances de l’histoire qui n’est jamais claire comme le récit posé sur le papier par l’effort acharné de l’historien. Car l’histoire provoque dans la subjectivité et l’expérience des êtres des effets et pas seulement de souffrance ou de mutilation[3]. Ces effets sont plus troubles, plus complexes. Cette opacité historique de l’instant, et qui souvent se poursuit pour ceux qui en sont les acteurs, connaît d’autant plus d’obscurité que l’événement vécu est un événement de violence. En effet, lorsque l’histoire reflète aussi la violence des groupes, des États, des êtres, elle est alors production de césures, d’accrocs, de flou ou de trouble pour les êtres et leur subjectivité.
Cet entremêlement des événements, des forces, agit aussi sur l’expérience de ceux qui les vivent et il forge aussi, tout à la fois et d’étrange manière, repères et perte de repères pour les êtres. Souvent, leurs subjectivités se trouvent alors morcelées, décousues, trouées et souvent souffrantes. Les pratiques artistiques ont alors ce pouvoir de rendre compte de la subjectivité, fractionnée, paradoxale, trouée, perdue, irradiée et annihilée, rendue immobile et sidérée. Ainsi, dans la série Bringing the War Home: In Vietnam, de l’artiste, Martha Rosler, il y a le télescopage d’intérieurs de la middle class américaine, avec son confort, ses articles ménagers, son ordre et ses rêves, dans lesquels surgissent abruptement la juxtaposition des images découpées de la guerre du Vietnam, ses soldats, ses morts, toutes les marques de la guerre, mais tout cela dans une sorte d’inquiétante coexistence de formes contraires et pourtant coexistantes.
Le sauve-la-vie des images
Dans cette complexité des temps et des expériences, les pratiques artistiques, venant prendre en charge l’expérience de la violence, élaborent alors un passage, une pensée et une compréhension des événements vécus. Elles se constituent dans l’effort de faire surgir par la mise en forme d’un fragment une élaboration de l’Histoire et du vécu. Ce faisant, elles réalisent aussi le dépassement de l’événement dans sa forme traumatique. C’est pourquoi elles sont chargées de la potentialité d’être des pratiques sauve-la-vie. Pour leurs auteurs, les témoins et aussi les spectateurs actifs de cette mise en forme, les pratiques artistiques sont aussi la proposition fragmentée (compréhension) de l’événement (incompréhensible)[4]. Le fait de saisir l’Histoire et l’expérience de la violence rencontre alors cet enjeu des pratiques artistiques de permettre un sauvetage et une critique du réel. Sauvetage de l’expérience humaine, de « rescatar » l’humain traversé par la violence, en cherchant à faire de l’expérience une élaboration commune et partagée par tous ceux qui participent « à l’acte de culture »[5]. Critique de la violence, car, par cette mise en forme de l’expérience de violence, les pratiques artistiques vont chercher à défaire la violence. Défaire de la violence subie, mais aussi se défaire de la violence qui ne se dit pas (le déni de la violence entrain de se faire) et surtout par l’élaboration de cette expérience, des trous, des mutilations, des troubles qu’elle impose à la subjectivité : les pratiques artistiques réalisent une forme esthétique sur le mode de l’apparition qui peut avoir pour effet une sortie de l’inertie, du silence et de la souffrance en les travaillant. Raison pour laquelle le potentiel des pratiques artistiques s’inscrit dans sa potentialité utopique.
Les deux films choisis ici, Prvi Deo et Notre Nazi, sont deux pratiques visuelles fortement marquées par cette qualité d’élaboration de la violence. Toutes deux ont opéré dans le même temps sur cette ligne de crête du sauvetage : dégageant dans le même temps un sauvetage et une critique.
Images sensibles, entrelacs d’éthique et d’esthétique
Florence Lazar, Prvi Deo
Florence Lazar a une manière bien à elle de faire des « images », films, vidéos ou photographies. Débutant sa carrière d’artiste comme photographe, elle a initié une pratique vidéo avec la réalisation de films tournés en Ex-Yougoslavie. Ainsi, il est impossible de ne pas remarquer combien cette pratique (forme) est liée à une histoire et à un territoire, et en deçà, à un désir : celui de témoigner[6].
Le film, Prvi Deo, co-réalisé avec Raphaël Grisey, intervient à la fin d’un cycle qui a débuté en 1999 avec Confrontations. Pendant de nombreuses années, elle a filmé en imposant un protocole assez strict et minimaliste où la caméra se pose et pour ainsi dire ne bouge plus (Les paysans, Otpor) ou alors capte le réel avec une grande économie de moyen (Champagne, Les femmes en noir, Le lieu de la langue). Des vidéos où l’image se laisse porter par la mise en présence de ces êtres par les mots et les gestes ou les visages, qui concentrent l’intérêt de cette artiste qui s’attache avec une grande simplicité à les saisir, faisant émerger de manière saisissante le réel.
Ainsi, Les paysans est une vidéo où les gestes, leur répétition, crée le trouble entre une très forte esthétisation d’un plan prolongé et la puissance des paroles : celui qui parle évoque dans le dénuement de sa vie quotidienne l’impact de la guerre dans les plis les plus simples de son existence. De la même manière, dans la vidéo, Otpor, Florence Lazar tient sa caméra alors que les jeunes pris en face-à-face avec la caméra dévoilent leur expérience par la parole, ils se tiennent devant un fond blanc, un mur qui les porte et les supporte alors qu’une grande immobilité – celle de l’artiste et de sa caméra – leur font face, ils vont et viennent dans l’image. Les images semblent ainsi saisies dans une sorte d’immobilité, comme si l’artiste détournait le sens de la pratique. La plupart des autres pièces vidéos peuvent aussi être saisies dans ce rapport à une économie de moyens, une caméra qui filme un plan souvent fixe et le surgissement conjoint de détails et d’une forme esthétique qui s’accompagne de la force du propos des êtres simples et singuliers. L’image et le son s’accompagnent dans une sorte de solidarité assez rare, ni la parole et sa force, ni l’image et sa beauté n’absorbent le spectateur, mais elles se lient dans une relation d’équilibre faisant surgir le témoignage. Tout cela faisant des images sensibles, donnant du sens aux choses simples, au plus petit détail et en découvrant tout à la fois l’intensité de la vie traversée par la guerre.
Si pendant de nombreuses années, ce protocole s’est imposé à l’artiste, comme expression manifeste aussi d’une immobilité devant le réel, trouvant la justesse dans l’expression retenue. Dix ans après, le caractère tragique de cette guerre qui détruit tant les êtres que le vivre ensemble, avec Prvi deo, connaît comme une métamorphose de sa pratique, le passage à une forme plus dense, entrelaçant des images et des plans venant de différentes sources. Tout d’un coup, avec l’apparition de Prvi Deo, l’artiste mêle à cette réserve de la caméra, une mobilité nouvelle : elle sort ce film de ce protocole qui accompagnait la réalisation de pièces courtes et elle l’articule à des passages de déambulations, de mouvements, de cheminements. Avec ce film, d’un autre format, taillé pour le grand écran, la vision qu’elle a de cette guerre est désormais rendue par une hétérogénéité nouvelle des images. La forme esthétique est alors renouvelée. Elle s’autorise le mouvement, elle imbrique des images, alternant cette particularité de la forme statique et celle du parcours. Elle réussit à déterritorialiser sa pratique, et ce faisant, les chemins, en bus, en voiture, les marches désormais voient le jour. Sans doute, le spectateur peut-il voir pour la première fois le lâcher prise de l’artiste, la manière dont elle-même sillonne ce pays et cherche à en saisir une impression. D’une certaine manière, le film fait alors plus place au flou, à l’imprécis et même à l’indécis. Par cette inflexion esthétique, il y a alors dans l’image une place pour la perte. Pour ce qui manque.
Désormais, c’est comme si l’image était plus éloignée de la forme photographique et tournée plus fortement vers la problématique du montage. Si les premières pièces peuvent nous faire penser à la vidéo en boucle d’une jeune femme se protégeant d’une déflagration de Johan Van Der Keuken ; ce passage par une mixité dans l’image et la mise en présence de la déambulation fait plus penser aux films de Claude Lanzmann. Alors que les films courts et stables offraient par la parole des personnes filmées une mise en présence pudique et puissante de la guerre ; Prvi Deo met lui à jour dans la crudité de la lumière la question des massacres et du déroulement des faits. Non seulement, il s’agit de saisir la retranscription de l’Histoire en suivant les premiers pas du tribunal international, des débats lors du procès, mais très vite apparaît aussi la question des corps, des charniers, la disparition et la mort des personnes, qui s’accompagnent également par la capture des images des bourreaux et de leur place dans le tribunal.
Alors que les premiers films sont saisis dans leur nécessité de faire face aux non-dits ou aux dénis, Prvi Deo, est lui déjà dans un passage du temps, il filme les images du premier procès contre les bourreaux, le premier jalon pour rendre visible une histoire et une guerre par la retranscription de témoignages. Cherchant à démêler les responsabilités, et, le vrai du faux.
La présence des corps, filmés dans une morgue, et qui sont là, à côté de ceux de la Deuxième Guerre mondiale, les mémoriaux captés par l’artiste, les luttes pour le souvenir des femmes en noir, tout concourt à faire de ce film un film de mémoire. Le statut de cette réalisation a donc profondément changé en faisant place à l’hétérogénéité dans et de l’image[7]. Du même coup, il y a un renforcement de l’alliance subtile, que, tel un orfèvre, Florence Lazar entretient dans ces vidéos où elle entrelace l’éthique et l’esthétique[8] faisant de sa pratique artistique une pratique profondément sensible et assumée d’une image-mouvement qui ne cède en rien devant les clichés et parvient à saisir la guerre, son horreur, de manière aussi subtile que réservée. Loin d’un pathos forcé, elle remplit ces films de visages frappés et luttant, de mains au travail, que rien n’arrête, de paroles aussi justes que simples. Tout comme les personnes filmées qui se tiennent debout malgré leur souffrance, ces films font œuvre de résistance et cela sans rien abandonner de la forme esthétique des images.
Un des enjeux de Florence Lazar a été de ne pas laisser dans l’invisibilité la situation de violence qui traversait le pays. Elle a travaillé dans le sens de vouloir faire œuvre de trace et elle a refusé la banalisation et le déni de la réception d’une situation de massacre. L’enjeu éthique de sa pratique esthétique est donc majeur, il irrigue les films et le parcours de cette artiste, et dans le même temps, indique cet usage de l’image comme lutte contre l’invisibilité. Cette direction artistique est ainsi marquée par ce double accent éthique et esthétique. Faisant de l’image une trace, un témoin d’une histoire trouble que, dans son univers de réception, le champ artistique et français tendait à exclure cette guerre et sa compréhension de son « cadre », l’artiste a poursuivi un travail tenace.
Robert Kramer, Notre Nazi
Bien que Florence Lazar se positionne comme artiste et que Robert Kramer se tienne, lui, dans une posture de cinéaste, réalisateur de documentaires, la mise en lien de leurs travaux permet d’ouvrir cette thématique des entrelacs de l’image filmée enroulant éthique et esthétique et dont les caractéristiques sont de permettre le saisissement de l’hybridation historique.
Le film de Robert Kramer, participe à la mise en explosion des limites qui enferment les pratiques cinématographiques. Car, fidèle à sa pratique, il poursuit son travail, en se glissant sur le tournage du film, Wundkanal, de Thomas Harlan, et pour ainsi dire dans son film[9]. Ce faisant, le cinéaste entretient en réalisant le film, Notre nazi, plusieurs dialogues. Le premier est un dialogue avec un autre cinéaste, un échange sur la pratique cinématographique, le second se fait avec le nazi, un échange posant un point de vue historique inaltérable de la part de Kramer, et enfin le troisième avec lui-même, recoupant une réflexion éthique à travers et par l’image. Tous trois se mêlant et ne se séparant pas clairement.
Le film dans son ensemble est un incroyable exploit, car il s’agit de filmer le film et la rétention d’un nazi par Harlan, réalisateur et aussi fils de réalisateur nazi. En effet, profitant de son nom et de sa filiation, Harlan a fait venir un nazi sous prétexte de faire un film dont celui-ci serait le héros, mais en réalité il a un tout autre objectif. Le dessein d’Harlan est de réussir à faire dire à ce nazi ses regrets, son abjuration de ses actions dans l’extermination et la mort de personnes. Malgré les échanges et le bras de fer musclé avec Harlan, cette autocritique ne vient pas, conduisant le réalisateur allemand à user de tous les moyens possibles, dont le rapt et le harcèlement, pour obtenir un mot de compassion ou de regret. Il devient alors le prisonnier de son propre malaise, de cette hérédité insupportable, d’être le fils d’un cinéaste nazi, et mis en porte-à-faux avec sa propre violence devant ce silence buté du nazi.
La violence devenant de plus en plus dense sur le plateau, il se retrouve avec une rébellion de la part de son équipe qui ne supporte plus la manière dont il affronte ce nazi, qui leur apparaît comme un « pauvre vieillard, affaibli et vulnérable », et ce malgré le fait qu’il soit dans le même temps un monstre qui résiste avec acharnement à la situation. Ainsi, devant le spectateur se déroulent des scènes ahurissantes où Robert Kramer filme Thomas Harlan essayant de convaincre des membres de la communauté juive du bien fondé de son action. Il exprime son appréciation de ce nazi en expliquant que c’est un être ignoble, l’un des pires que l’humanité ait porté et dans le même temps, il explique comment il va le pousser dans ses retranchements afin de lui faire dire ses regrets et son erreur à avoir participé activement au IIIe Reich.
La violence et la tension devant la mise en échec d’Harlan son impossibilité de passer outre les moyens pour obtenir une fin : voir la culpabilité dans les paroles du nazi. Mais elle ne vient jamais, créant une situation tragique poussant à bout Harlan qui ne peut accepter l’absence de « rédemption » que la position toujours réitérée du nazi qui reste un nazi crée en lui. Un gouffre de désespoir s’ouvre devant le spectateur. Le témoignage bascule dans l’imprévu, l’action dans une situation de crise. Dans cette action qui se déroule et dont personne ne sait bien comment elle va finir, il y a un télescopage entre des manières de faire, un cinéma qui échoue avec Harlan et un cinéma qui naît avec Kramer.
Le face-à-face entre le nazi et Kramer est le moment clé du film. Dans un faisceau de lumière et alors que l’obscurité l’entoure, le nazi est assis, face à Kramer, le long déroulé de ses crimes a été dit, un silence se fait, brisé par le nazi, qui cherche pour ainsi dire un appui auprès de Kramer : « que pensez-vous de tout cela ? » demande-t-il à Robert Kramer. Celui-ci, sans la moindre hésitation, répond, « je pense que vous êtes un salaud ». Cette phrase clôt l’entame d’une discussion – il n’y a aucune discussion possible avec Robert Kramer. Laissant le nazi désemparé, car il cherchait sans doute un autre soutien, profitant de son état physique et de sa situation de séquestré par Harlan, le nazi avait jusqu’à cet instant réussi à renverser les relations. En effet, une certaine empathie a saisi l’équipe du tournage qui s’est révoltée face aux mauvais traitements et à la violence dont fait preuve Harlan.
Cette stratégie de renversement du bourreau n’atteint pas le cinéaste américain Robert Kramer, malgré la tension, il réussit à tenir une position éthique sans le moindre trouble : il a jugé et tranché, il ne négocie pas avec le nazi. Il lui fait face. Il peut le filmer, mais il le filme sans le moindre doute, il s’agit d’un bourreau. C’est la première fois où le nazi est véritablement désemparé car il n’a pas réussi à retourner Kramer. Il y a dans cet échange comme une double confirmation tant de l’éthique que de l’esthétique : la forme pour saisir cet homme n’est pas anéanti face à sa monstruosité, l’image résiste par l’ancrage de cette pratique dans l’entrelacs de l’éthique et de l’esthétique. Ce faisant, il y a comme un sauvetage de l’image : l’image si facilement manipulable, comme le nazi réussi à la manipuler avec Harlan, et si facilement critiquable, est, dans le même temps, sauvée par Kramer, car il parvient à tenir une politique de l’image (esthétique), là où nombreux sombreraient dans l’image (l’esthétique) de la politique. En effet, cette scène est une situation de prise de position éthique fondamentale : il ne dialogue pas avec le nazi, il ne cherche pas à le convaincre ou à attendre de lui des regrets.
Cette non-attente a pour impact de créer une véritable césure entre la caméra et le nazi. Aucun doute possible n’existe après ce face-à-face, il n’y a ni pardon, ni rédemption possibles. Il y a l’intériorisation d’une césure historique fondamentale – l’expérience de la barbarie et l’existence des camps d’extermination – par le réalisateur et à travers lui par le film. Pour Kramer, il n’y a aucun sauvetage possible de cet homme qui est un nazi. Raison pour laquelle il y a une rupture par le film des deux réalisateurs, Harlan espérant quelque chose d’impossible, et Kramer ayant intériorisé la césure.
Cette posture éthique de Kramer est très proche de l’idée de Vladimir Jankélévitch, dans L’imprescriptible, qui énonce justement que personne ne peut pardonner à la place des victimes. Cette position intellectuelle défendue par le philosophe est d’une certaine manière déterminante ici : car là où, Harlan cherche à revenir sur les faits pour trouver une éventuelle réconciliation par le regret du bourreau ; Kramer a définitivement coupé court à cette attente impossible. « Il fait avec », si j’ose dire. Car sa caméra, ses films prennent en charge le passé tel qu’il est, sans chercher à le « re-jouer », mais plutôt en portant cette tragédie. Innervant sa pratique. Il y a donc comme un jeu de miroir entre les deux cinéastes. Les deux postures. Dans lequel une brèche a été entaillée. Entre deux positions, l’une conduisant à une impasse, éthique et cinématographique, l’autre, ouvrant sur une suite intégrant la rupture historique que représente l’existence des camps d’extermination. D’ailleurs, le terme « notre nazi » indique comme un mot d’esprit, un certain humour et aussi une « prise de possession » que nous pouvons comprendre comme le fait que le nazisme fait partie de notre histoire et de la nécessité à le prendre en charge. Ce nazi est comme la relique du passé, mais un passé sur lequel Kramer ne revient pas, il l’assume dans l’intégrité de sa pratique de faiseur d’images.
Ce qui nous échappe
Ainsi, par le fragment, les pratiques artistiques affrontent l’Histoire dans sa complexité, mais elles ont peut-être, ce que les Grecs évoquaient, un pouvoir de catharsis, celui qui permet une tentative d’élaboration de ce qui tout à la fois échappe et peut provoquer la désorientation subjective. Et que, pourtant et malgré tout, les pratiques cherchent toujours à atteindre. Prendre l’événement à bras le corps, faire face à la violence, c’est alors un geste qui se tient dans cet effort de sauvetage et de critique. Il s’offre alors aux êtres comme un principe d’espérance. À nous de nous en saisir.