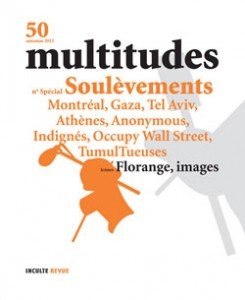À moins de pouvoir produire une apparence d’infini par votre désordre, vous n’aurez que le désordre sans la magnificence.
Edmund Burke
Le Québec est traversé depuis quelques mois par un mouvement de contestation sociale d’une ampleur inédite. La séquence historique des événements peut se résumer ainsi : une grève étudiante préparée de longue haleine est déclenchée au mois de février 2012, appuyée, entre autres, sur de solides études largement médiatisées produites par l’IRIS[[« Faut-il vraiment augmenter les frais de scolarité? » http://www.iris-recherche.qc.ca/publications/faut-il_vraiment_augmenter_les_frais_de_scolarite .
Voir également « L’endettement étudiant : une bulle spéculative? »
http://www.iris-recherche.qc.ca/publications/l%E2%80%99endettement-etudiant-une-bulle-speculative qui remettent en cause le bien-fondé de la hausse des frais de scolarité et la logique néolibérale qui lui préside. Cette grève se bute à un gouvernement particulièrement obstiné qui, pendant de longs mois, se refuse à toute négociation sérieuse, pour finalement se réfugier dans le mutisme d’une loi spéciale tellement déraisonnable que la police n’a, pour l’heure, encore osé faire aucune arrestation en son nom, tellement les chances sont faibles qu’elle reçoive l’assentiment de la cour. Et parce que cette loi 78 s’attaque directement à la liberté d’association et de libre expression de tous, de larges pans de la population qui ne s’étaient pas sentis de manifester jusqu’alors sont spontanément descendus dans les rues et y retournent désormais soir après soir pour manifester au son des casseroles leur mécontentement et leur attachement au bien commun et aux valeurs fondamentales de la démocratie.
Les racines du printemps érable
Cette lecture linéaire des événements ne suffit bien sûr pas à se saisir de la puissance créative et protéiforme qui anime le mouvement. Si le « printemps érable », selon la formule pleine d’humour lancée par quelques étudiants en design motivés de l’UQAM, n’a pas grand-chose à voir avec la gravité des insurrections du « printemps arabe », celles-ci ont, comme le mouvement occupy ou celui des indignés espagnols, sans contredit contribué à l’ampleur et la persistance de la mobilisation. De même, on ne peut préjuger des effets qu’aura le printemps québécois suite à l’écho qu’il trouve désormais à l’international. On peut, par exemple, se questionner sur la présence de nombreux drapeaux québécois et même patriotes et l’absence quasi-totale de drapeaux canadiens (sans parler de la recrudescence du nombre de drapeaux noirs et rouges des luttes transversales anarchistes ou communistes) ; et tirer les conclusions qui s’imposent concernant le minimum de sentiment d’appartenance nécessaire pour que de telles luttes puissent émerger, et l’expression d’un irrémédiable dégoût pour l’anti-projet de société du gouvernement conservateur de Stephen Harper.
De même, il ne faudrait surtout pas sous-évaluer la puissance de la tradition du syndicalisme étudiant québécois, et l’immense travail de préparation et de coordination réalisé par les associations étudiantes. Mais la consistance affective du mouvement ne s’y réduit pas, tant il est vrai que les mouvements de résistance ne constituent pas des processus qui s’étendent de proche en proche, mais « quelque chose qui prend corps comme une musique, et dont les foyers, même dispersés dans le temps et dans l’espace, parviennent à imposer le rythme de leur vibration propre. »[[Comité Invisible, Mise au point, 2009, www.bloom0101.org.
La multitude incontrôlée ?…
C’est quelque chose que même les commentateurs les plus obtus et hostiles au mouvement étudiant pressentent confusément, lorsqu’ils décrivent avec dédain et « lucidité » ces masses orageuses qui, emportées par la ferveur populaire, sont accusées de ne savoir plus maîtriser leur pulsion de rassemblement et d’accumuler pêle-mêle les motifs de révolte, oubliant du même coup la raison initiale de leur colère. Clameur du petit peuple à laquelle ils opposent la vertu du souverain détachement, qui leur assure une position de surplomb paternaliste et pastorale. Le spectre de la multitude hystérique et incontrôlée est, depuis Hobbes et sans doute bien avant, la menace que l’on se plaît à invoquer de manière préemptive chaque fois qu’il s’agit de justifier une conception transcendante de l’ordre que le gouvernement ne manquera pas de « restaurer ». La méfiance soi-disant éclairée des tenants d’une telle posture se situe d’ailleurs à l’exact opposé de « l’hypothèse de confiance » que Jacques Rancière ou, dans des termes similaires, Isabelle Stengers postulent à la base des luttes pour l’émancipation.[[Voir Jacques Rancière, « Communistes sans communisme? », in Alain Badiou et Slavok Zizek (éds.), L’idée du communisme, Lignes, Paris, 2010, et Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, Les empêcheurs de Tourner en rond et La découverte, Paris, 2009.
De fait, quiconque a participé au moins une fois à une manifestation pacifique qui a supposément « mal tourné » sait : 1. qu’il n’y a désormais que les téléspectateurs gavés comme des oies pour encore croire que la police n’est là que pour limiter les débordements ; 2. combien il peut être malaisant de voir se creuser l’écart schizophrénique entre les représentations de désordre et de chaos entretenues à flots médiatiques tendus et cette subtile alchimie éprouvée au cœur de la foule en marche – joie du commun sensible et partagé. Car quelque chose s’y passe, quelque chose a lieu qui s’organise sur un mode an-archique et intensif, des devenirs-révolutionnaires qui se conforment mal au caractère unidimensionnel des explications causales, des trésors d’ingéniosité, des chorégraphies spontanées, des gestes singuliers qui prolifèrent à l’intérieur de l’élément historique donné, mais qui ne s’y limitent pas. Le cœur battant du mouvement a des raisons que la raison désengagée ne veut pas connaître, ne connaît pas.
… ou le peuple en essaim
À la bonne vieille image d’un corps social dont il faudrait discipliner le vil instinct grégaire, Frédéric Bisson en oppose une autre, beaucoup plus adaptée à l’ère des réseaux sociaux pour décrire le potentiel transindividuel de ce qu’il appelle le « peuple en essaim » : « Le corps du peuple en essaim n’est ni homomorphe, ni amorphe, mais métamorphe. Faits d’individus et de groupes qui poussent à travers sa chair comme des organes indéterminés et imprévisible, le corps glorieux de la multitude se contracte et se dilate comme un nuage d’étourneaux. »[[Frédéric Bisson, « Le peuple en essaim », Multitudes 45. Du commun au comme-un, Éditions Amsterdam, Paris, 2011, p. 80 Il est bon de garder cette image en tête lorsqu’on entend des policiers québécois parler de « national geographic » pour décrire les manifestants « détaler comme des gazelles » sous le coup de leurs matraques et de leurs bombes assourdissantes