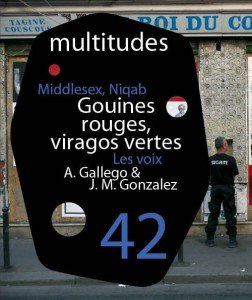L’éthique du care a été l’objet d’un certain nombre de critiques, dont certaines (parmi les plus habiles) prenaient pour prétexte l’idée que le care ne serait pas féministe mais au contraire durcirait, voire essentialiserait, une distinction, une différence femme/homme, en lui donnant un contenu moral : les femmes représentant l’attention à autrui et au proche, contre les hommes emblématisant autonomie et impartialité ; les femmes dans les activités de soin à domicile, les hommes dans la vie active ; les femmes dans le privé, les hommes dans la vie publique. L’éthique du care, en voulant valoriser les qualités d’attention à autrui et les activités de souci des autres, serait alors la reprise ou la confirmation de ces stéréotypes. Nous voudrions montrer ici qu’au contraire, l’éthique du care est une radicalisation du féminisme, car elle permet de mettre en évidence les problèmes les plus cruciaux aujourd’hui que doivent affronter les femmes. Que le sexisme se soit concentré, ces derniers temps, sur ou contre l’idée de care (qualifications typiques de « nunucherie américaine », « maternalisme réactionnaire »…) ; que les attaques contre le care aient pris la forme d’une défense d’un « bon » féminisme (Michel Onfray dans une notule du Monde enjoignant les bonnes femmes à relire « leurs classiques », comme Beauvoir) ; que certaines « officielles » du féminisme aient recentré leur problématique sur la critique du care (Elisabeth Badinter) comme retour du « maternalisme », que des femmes ministres sortent des discours confondants « contre » le care et « pour » l’égalité républicaine qui les a promues, montre bien que l’éthique du care touche à un point névralgique des rapports de sexe – et particulièrement ici en France, où le fond universaliste, avec son compagnon différentialiste, constitue l’obstacle principal à l’amélioration de la situation des femmes. L’autre obstacle est le degré très faible de la pensée critique dans le domaine du féminisme : on est très loin d’avoir même commencé d’accepter, voire d’assimiler le féminisme dans la classe intellectuelle. Les objections récentes au care, produites dans cet espace, ou demi-monde, bien spécifique situé à l’intersection de l’intellectuel et du politique, sont des preuves de la faiblesse de la réflexion féministe publique, qui contraste avec la vivacité des mouvements et actions présentes[1].
C’est donc le moment de faire un point sur la différence introduite par le care dans le féminisme. Car pour nous, le care est triplement subversif :
– il introduit une différence en philosophie morale, qui constitute une rupture avec toute une tradition dominante.
– il oblige à faire attention à des réalités négligées et par là à ce que nous valorisons, ou pas, comme activités humaines.
– il faire revenir sur le devant de la scène le différentialisme, par la radicalité de sa mise en cause des catégories masculines rehaussées en universel.
La subversion de l’éthique
On commence aujourd’hui à se rendre compte de l’importance de l’idée et de la pratique du care, qu’il s’agisse des attitudes morales de souci des autres, d’attention, ou encore des pratiques de soin à autrui et de services domestiques quotidiens. Mais on n’a peut-être pas entièrement intégré le point central de l’œuvre de Carol Gilligan, commencée avec le best-seller Une si grande différence[2] et poursuivie jusqu’aujourd’hui, avec The Deepening Darkness. L’idée de « moralité féminine » est en effet si provocante et évidente à la fois qu’on oublie qu’elle est d’abord féministe : et qu’il s’agit à travers cette idée de revendiquer une autre forme de moralité, une voix différente, qui est présente en chacun mais qui est précisément négligée parce qu’elle est d’abord, empiriquement, celle des femmes, et concerne des activités féminines au sens où elle sont réservées aux femmes[3].
Les éthiques du care affirment l’importance des soins et de l’attention portés aux autres, en particulier ceux dont la vie et le bien-être dépendent d’une attention particularisée, continue, quotidienne. Elles s’appuient sur une analyse des conditions historiques qui ont favorisé une division du travail moral en vertu de laquelle les activités de soins ont été socialement et moralement dévalorisées. L’assignation des femmes à la sphère domestique a renforcé le rejet de ces activités et de ces préoccupations hors de la sphère publique, les réduisant au rang de sentiments privés dénués de portée morale et politique.
Les perspectives du care sont ainsi porteuses d’une revendication fondamentale concernant l’importance du care pour la vie humaine. L’éthique du care constitue par là une mise en cause radicale de l’éthique dominante.
Une voix différente a ouvert explicitement la perspective d’une « voix morale différente », revendiquée comme étant celle des femmes, et a ouvert un nouveau champ de réflexion, morale et féministe, tout en mettant enfin en rivalité voire à égalité éthique de la justice et éthique du care, une moralité centrée sur l’équité, l’impartialité et l’autonomie et une moralité formulée « d’une voix différente », reconnue le plus souvent dans l’expérience des femmes, et fondée non sur des principes mais une question : comment faire, dans telle situation, pour préserver et entretenir les relations humaines qui y sont en jeu ? Et, comment le faire sans renforcer les inégalités de genre, de classe et de race ? Cela requiert un examen des situations particulières et, comme le dit Gilligan, « un mode de pensée plus contextuel et narratif que formel et abstrait ». Cette conception de la morale, pour Gilligan, se définit par un souci fondamental du bien-être d’autrui, et centre le développement moral sur l’attention aux responsabilités et à la nature des rapports humains. La morale conçue comme justice centre par contre le développement moral sur la compréhension et la mise en œuvre des droits et des règles, comme l’a montré Lawrence Kohlberg, dont Gilligan fut la collègue et qui a inspiré ses critiques[4].
L’éthique du care est liée à des conditions concrètes, au lieu d’être générale et abstraite. En cela, elle est liée à un tournant qu’on pourrait dire particulariste de la philosophie morale, à une contestation récente de la philosophie morale contemporaine, en tant que recherche et énonciation de principes généraux à mettre en œuvre dans nos vies morales[5]. Entendue d’une voix différente, la morale ne se fonde pas sur des principes universels mais part d’expériences rattachées au quotidien et des problèmes moraux de personnes réelles dans leur vie ordinaire. Elle trouve sa meilleure expression, non pas sous la forme d’une théorie, mais sous celle d’une activité : le care comme action (taking care, caring for) et comme travail, autant que comme attitude, comme perception et attention au détail non perçus, ou plutôt présents sous nos yeux, mais non remarqués parce que trop proches, comme fil conducteur assurant l’entretien (en plusieurs sens, dont celui de la conversation et de la conservation) d’un monde humain.
La force des travaux de Gilligan est d’abord d’avoir fait exploser le débat moral, en mettant en question le monopole de la justice, installé depuis Rawls mais sans doute bien avant, dans le champ de la moralité[6]. La voix de la justice, a-t-elle dit dans un premier temps, nie leur voix propre aux sujets qui expriment une compréhension des questions morales qui s’écarte de la voie dominante. La révolution de la voix différente s’accomplit au moment où Gilligan fait entrer en scène la voix d’Amy, 11 ans, dans le cadre de ses entretiens. Le jugement moral d’Amy, écrit Gilligan, est fondé sur l’attention à toutes les données du problème, il constitue en cela une alternative intéressante au raisonnement moral rationnel représenté par Jake, le garçon de 11 ans interrogé aussi.
« Sa vision du monde est constituée de relations humaines qui se tissent et dont la trame forme un tout cohérent, et non pas d’individus isolés et indépendants dont les rapports sont régis par des systèmes de règles. Les deux enfants reconnaissent la nécessité d’un accord, mais lui pense y parvenir de “façon impersonnelle par les intermédiaires de la logique et de la loi”, tandis qu’elle “personnellement grâce à la communication dans les rapports humains”. »[7]
Dans l’éthique dominante, la pensée d’Amy est moins morale que celle de Jake – voire pas morale du tout. Elle ne s’intéresse pas aux actions en tant que telles, abstraitement, mais à leur contexte et à la préservation de la vie. Pour elle, il n’est pas prioritaire de justifier ce qu’on fait (car comment savons-nous vraiment si nous avons bien agi ?), mais de faire passer l’intérêt des autres avant le sien. Pour elle, la morale n’est pas une question de division bien/mal agir, mais de savoir « ce qui est important ». « Vous devez décider ce qui est le plus important : cette personne, cette chose, ou vous-même » (p. 65).
Avant de se demander si en différenciant ces deux voix, on est au bord d’une division entre morale féminine et masculine, il faut (et c’est tout le génie de Gilligan d’avoir posé la question en ces termes) se demander pourquoi la vision morale d’Amy est minoritaire et considérée très vite comme non morale, ou confuse. Et pourquoi certaines questions sont considérées comme importantes, et d’autres pas (qu’est-ce qui est important, franchir le Rubicon, ramasser ses chaussettes, ou organiser la meilleure façon de prendre soin de ses parents.) Le care est une révolution en tant qu’il nous contraint à intégrer dans le moral, et même à placer au cœur du moral, des données ordinaires comme celles-là. La voix d’Amy, le fait qu’elle résonne (par instants, ou constamment) en chacun, homme ou femme, avec justesse, exprime cette aspiration.
Entendre et reconnaître cela suppose de reconnaître que la dépendance et la vulnérabilité sont des traits de la condition de tous. La perspective du care est donc indissociablement éthique et politique, elle élabore une analyse des relations sociales organisées autour de la dépendance et de la vulnérabilité, points aveugles de l’éthique de la justice.
La subversion politique du care
Les analyses du care ont ainsi pour vocation de donner forme à des questions qui ne trouvaient pas leur place dans le débat public et d’infléchir ou de transformer la définition de ce qui compte d’un point de vue éthique et politique. Chez les auteurs de tous ces travaux, Carol Gilligan et Joan Tronto d’abord, on trouve une critique féministe des théories morales et politiques majoritaires, notamment celle de la justice de Rawls. L’intérêt de ces critiques est d’avoir fait apparaître dans le champ moral et politique, des voix subalternes, jusqu’alors disqualifiées. Ces voix demandent qui décide de ce qui est important moralement et politiquement et de ce qui l’est moins – et qui est donc rejeté, selon les circonstances, dans la «moralité des femmes», les histoires de bons sentiments, les solidarités familiales ou de voisinage. Ces voix ne sont pas seulement celles des femmes mais de toutes les catégories sociales désavantagées, ethnicisées, racialisées. Ce sont les voix de toutes les personnes qui réalisent majoritairement le travail de care dans la sphère domestique et dans les institutions de soin, c’est-à-dire qui s’occupent pratiquement des besoins d’autres qu’elles-mêmes, officiellement dépendants ou non. Toutes ces personnes qui réalisent un travail indispensable et vital sont mal payées, mal considérées, leurs besoins ignorés, leurs savoirs et savoir-faire rabaissés et déniés. Nounous, auxiliaires de vie, femmes de ménage, aidants familiaux… avec ou sans papiers, rémunérées ou non, composent cette armée invisible reléguée dans les coulisses d’un monde de la performance, qui veut les ignorer. Les plus performants sont alors ceux qui parviennent trop bien à ne pas voir en quoi leur succès et l’extension de leurs capacités d’action dépendent de qui les sert.
Le care est un concept critique, qui révèle des positions de pouvoir, et agace. Pourquoi ? Parce qu’il soulève une difficulté, qui est celle du sens véritable de la morale. Il ne suffit pas pour cela d’invoquer la solidarité, le soin, l’attention aux autres, comme cela a été fait de façon irréfléchie et moralisante, par ceux et celles qui revendiquent soudain le care comme par ceux qui le rejettent. Une telle modification éthique et politique par le care ne peut advenir sans un changement radical de vision. Il faut aller jusqu’au bout de l’idée critique et radicale – féministe donc – qui était à la source de l’éthique du care : que les éthiques majoritaires, et leur articulation au politique, sont le produit et l’expression d’une pratique sociale qui dévalorise l’attitude et le travail de care et par là les réserve prioritairement aux femmes, aux pauvres, aux immigrés. La force de l’éthique du care était dès son introduction par Carol Gilligan de faire place aux sentiments, et au souci des autres, dans la politique et la justice : mais faute d’une compréhension de la dimension politique des sentiments, et de l’expérience concrète du travail de care, l’appel à une « société du soin » est aussi vain que conformiste. Il ne s’agit pas de préconiser l’idée creuse d’un « soin mutuel » mais plutôt de questionner « qui fait quoi et comment ».
La réflexion sur le care n’ouvre pas tant sur de nouvelles approches en morale que sur une transformation du statut même et du sens de l’éthique. Le care ramène la morale à son terrain propre, celui de nos pratiques – à la façon dont Wittgenstein veut ramener les mots de leur usage métaphysique à leur usage quotidien, là où ils veulent dire quelque chose pour nous[8]. S’il y a une morale, elle se montre, non pas dans une réalité morale ou des règles préexistantes ou énumérables, mais dans l’immanence même des situations, des affects et des pratiques. Pas de care sans expression de la voix de chacun : c’est toute l’importance du concept de voix différente.
« Une éthique féministe du care est une voix différente parce que c’est une voix qui ne véhicule pas les normes et les valeurs du patriarcat ; c’est une voix qui n’est pas gouvernée par la dichotomie et la hiérarchie du genre, mais qui articule les normes et les valeurs démocratiques (l’importance du fait que tous aient une voix, soient aux prises avec des conflits dans la relation). »[9]
Considérer l’importance sociale, morale et politique du care oblige bien sûr à faire référence aux « femmes », l’une des catégories auxquelles le travail du care a été principalement assigné. Or parler des femmes serait faire usage d’une catégorie « suspecte », suspicion s’étendant à toute théorie qui en assume l’existence. « À cet égard, toutes les théories féministes deviennent suspectes, hormis celles qui récusent la possibilité d’une large entreprise théorique de libération. »[10]
Ce que Gilligan a montré c’est l’incapacité du langage de la justice à prendre en compte comme moralement pertinents les expériences et les points de vue des femmes. Ces expériences et les points de vue moraux qu’elles produisent sont alors disqualifiées comme déficientes ou marginales. Si l’on exclut que les femmes soient moralement déficientes, alors on peut faire l’hypothèse d’une « voix différente » ; d’une orientation morale qui identifie et traite autrement les problèmes moraux que ne le fait le langage de la justice. C’est à cette tâche d’articulation et d’explicitation que se consacrent les analyses en termes de care. Ces analyses spécifient certaines des limites de l’éthique de la justice, et font valoir, de façon critique, l’injustice radicale de l’ignorance d’une expression féminine.
Il est assez curieux, alors, qu’on ait considéré que l’approche de Gilligan était « essentialiste » ; l’immédiateté, en France, d’une telle lecture signale déjà assez l’existence des préjugés qui grèvent toute réflexion critique sur le caractère dominant d’une certaine conception morale, et la prégnance des stéréotypes de genre qui vont assigner certaines caractéristiques et certaines tâches aux femmes. Gilligan a pourtant clairement montré la flexibilité de son approche : elle fait de la justice et du care deux tonalités ou voix, peut-être rivales, mais présentes en chacun. La voix du care étant moins rapidement étouffée chez les filles que chez les garçons.
« La perspective de la justice, souvent prise comme synonyme de raisonnement moral, est recadrée comme une manière de voir les problèmes moraux et la perspective du care est mise en évidence comme une vision ou un cadre alternatif. La distinction entre justice et care comme perspectives ou orientations morales alternatives est fondée empiriquement sur l’observation qu’un déplacement du centre d’attention, de préoccupations de justice vers des préoccupations de sollicitude, change la définition de ce qui constitue un problème moral, et amène à voir la même situation de façons différentes. »[11]
Tous ceux qui n’ont pas leur voix dans la définition de la justice sont concernés par la perte de la voix. Comme dit Gilligan dans une récente conférence :
« Ce qui m’amène au deuxième point important : le care et le caring ne sont pas des questions de femmes ; ce sont des préoccupations humaines. Nous resterons perplexes face à son intransigeance apparente si nous ne faisons pas apparaître explicitement la nature genrée du débat care/justice. Et nous ne parviendrons pas à avancer vers la prise en compte des vraies questions, à savoir : comment les questions de justice et de droits croisent les questions de care et de responsabilité. »[12]
Un tel déplacement est important parce qu’empiriquement fondé. Les prétentions de l’éthique de la justice à couvrir en totalité le domaine moral sont contestées par les données empiriques produites par Gilligan, et la force de son premier ouvrage était de les faire voir (faire voir ce qui est sous nos yeux, à nos pieds dit Wittgenstein ; ou encore, pour reprendre une expression de Foucault : faire voir le visible).
Les données fournies par Gilligan rendent difficile de nier l’évidence : le fait que le langage de la justice à lui seul est inapte à saisir les préoccupations morales des personnes interrogées, leurs expériences et leur point de vue. La thèse de Gilligan fait valoir que ces expériences et ces préoccupations différentes constituent une orientation morale différente dotée d’une cohérence que le langage du care permet de saisir.
À l’opposé d’une conception impartiale de la justice, le care soutient l’idée qu’il existe une perspective morale différente. La notion de care, recouvrant à la fois des activités très pratiques et des sentiments ou une sensibilité, une attention soutenue à l’égard d’autrui et un sens des responsabilités, rompt avec une conception de la justice qui exclurait la texture affective de nos engagements les plus concrets, ce qui fait le grain de la morale quotidienne. De ce point de vue, les deux orientations morales différentes que sont la justice et le care doivent être conjuguées pour une justice réaliste.
La théorie du care ne vise pas à situer la pitié et la compassion, la sollicitude ou la bienveillance comme des vertus subsidiaires adoucissant une conception froide des relations sociales, conception impartiale de la justice basée sur la primauté des droits d’individus autonomes, séparés et rationnels. Cette description correspondrait plutôt à ce qu’on appelle désormais la sollicitude (une sorte de supplément de sentiment à prendre en compte, avec des pincettes, dans le cadre de la morale dominante) : c’est le care vu précisément, dans la perspective dite de la justice, ou dans le discours politique dominant qui l’a immédiatement pris pour cible.
Une telle domination, qu’il s’agit de décrire et pas seulement de poser, se marque dans les jugements intellectuels qu’on va appliquer immanquablement à ces éthiques différentes (qualifiées très vite d’ « anti-théoriques », ou, dans un autre registre, d’ « essentialistes ») et au discours philosophiques qui viendrait les soutenir, et qui valoriserait la place de l’expérience, le fait que chaque situation est particulière. Cet effet de flou et de confusion est caractéristique de l’impression que fait le discours d’Amy, y compris à elle-même lorsqu’elle n’est pas entendue. La constitution de critères intellectuels fait partie intégrante de la domination du paradigme de la justice, qui va ainsi placer la voix du care en position marginale.
« En tant que perspective morale, le care est moins élaboré, et il n’existe pas, dans la théorie morale, de vocabulaire tout prêt pour décrire ses termes. »[13]
Il est important alors d’entendre la voix différente, et d’essayer de l’entendre comme la voix fondamentale, pas comme une déviation ou une déficience : entendre la voix de la justice comme celle du care en évitant ces deux malentendus :
« Celle de la justice comme identification de l’humain au masculin, injuste dans son omission des femmes, et celle du care comme oubli de soi, indifférent (uncaring) dans son incapacité à représenter l’activité et l’agentivité du care. »[14]
L’idée d’un biais masculin généralisé dans la connaissance est très forte, va bien au-delà d’un simple constat de l’exclusion de fait des femmes du processus historique de constitution de la connaissance, ou du caractère sexiste, ou inséparable d’une situation de subordination féminine, de nombre de théories et conceptions de la nature humaine. La critique de Rawls par le communautarisme – du sujet impartial par le sujet situé, etc. – est un élément comparable de la discussion. C’est un thème dont les prolongements philosophiques se sont multipliés, que ce soit dans les approches historiques de la science (Kuhn), dans l’idée de « seconde nature » (McDowell), dans une lecture sociale de Wittgenstein (Winch, Taylor). Notons que des figures centrales de l’épistémologie féministe, comme Sandra Harding, ont fait leurs premières armes dans l’étude de l’holisme épistémologique qui affirmerait, dans sa lecture la plus radicale, la dépendance, non seulement des connaissances, mais de toute expérience, par rapport à un cadre ou un schème conceptuel accepté. La conquête de la légitimité institutionnelle des études féministes en philosophie passait certainement par cette orientation épistémologique, qui les intégrait à un débat plus général, et balisé, sur la locatedness de la connaissance. Mais une telle orientation se devait d’être dépassée et radicalisée sur son terrain même, assez banal : les thèses féministes se sont progressivement chargées d’une argumentation supplémentaire, fondée sur l’affirmation d’un étouffement de la voix féminine, qui ne serait absolument pas prise en compte, non seulement dans l’élaboration du savoir, mais aussi dans les notions mêmes de connaissance, d’objectivité, de neutralité. C’est sur ce point que les théories féministes sont les plus fragiles, mais soulèvent un point intéressant, comme l’ont vu, entre autres, Cora Diamond et Annette Baier. C’est l’idée de neutralité qui est en elle-même biaisée. L’universalisme est alors non un beau principe mais une thèse patriarcale, qui n’a rien à voir avec l’universel (lequel compte évidemment pour les femmes) : l’universalisme, en somme, est un particularisme érigé en universel. Le féminisme a d’abord pour tâche, critique – et c’est tout le travail de l’éthique du care – de montrer que ce qui est ainsi désigné comme universel n’est que le point de vue particulier de ceux qui sont en position d’autonomie, ou de pouvoir.
À l’universalisme, on ne saurait alors opposer le différentialisme, qui n’en est que le double inversé. Cependant, l’idée d’une différence de l’expérience des femmes est l’argument de fond (et la fragilité essentielle) de l’épistémologie féministe, qui en tire sa critique des notions même de connaissance et d’[15]objectivité[16]. Le défaut de la thèse d’un biais masculin n’est pas sa fragilité, ni même sa fausseté (elle est probablement exacte) : c’est sa trop grande généralité. Il faut partir, dit Diamond, de « l’observation des femmes et des hommes, pas de théories sur un biais masculin généralisé »[17]. Comment faire cette observation ? Il y a bien un cas concret où l’on voit à la fois la différence d’expérience et de théorisation entre hommes et femmes, et où l’on peut décrire précisément la domination d’un certain mode de théorisation, affirmé par là comme universel : c’est celui de la morale. On touche alors à l’enjeu de la recherche de Gilligan, qui a montré de telles différences empiriques sur le terrain, permettant alors de mettre en évidence le privilège accordé à une morale particulière. L’hypothèse de la voix morale différente est de fait la première démonstration convaincante d’un biais masculin – dans la définition même de la justice – comme de ses conséquences radicalement injustes.
Faire entendre la voix féministe
De telles affirmations sont simplement inaudibles ici. Disons-le : la situation particulière qui est celle de la France, pour le féminisme, est d’une arriération de la classe intellectuelle avant tout – nom que l’on peut donner aussi à une situation de domination, ou à la forme que prend la domination masculine dans le champ intellectuel. Il est de rigueur en France, dans le monde académique et dans le demi-monde intellectuel, de présenter les théories féministes américaines comme grotesques, et de dénigrer de même tout ce qui peut ici s’en rapprocher – par l’accusation de « différentialisme », surtout, fléau dont nous protègeraient les préservatifs bien français que sont la fraternité, l’égalité, l’universalité. Ce qui est apparu récemment à propos des discussions sur le care est bien le recours systématique à ces notions, affirmées toujours dans leur supériorité par rapport aux thèses féministes, certainement par leur connotation masculine (« fraternité »).
On a vu alterner les revendications – plus ou moins informées – de l’éthique du care par un Parti Socialiste en mal d’idée, et les commentaires, successivement ironiques, acerbes, puis injurieux de la classe politique (de droite comme de gauche). Commentaires repris et suivis servilement par les figures du demi-monde intellectuel pour qui les idées n’existent que lorsqu’elles sont estampillées et mises sur le second marché par les partis politiques et les journalistes. Tout se passe comme si la mention du care avait en quelque sorte ouvert les vannes, et « décomplexé » une forme d’expression machiste qui jusqu’alors ne se manifestait pas de façon aussi forte. Est-ce la liberté offerte enfin d’attaquer le féminin en tant que tel, puisqu’il est revendiqué dans le care ? Est-ce la possibilité enfin ouverte d’attaquer le féminisme par le féminisme, en s’appuyant sur un universalisme consensuel ?
Les chercheuses qui travaillent dans le champ académique sur le care ont l’habitude de la manœuvre : on rabaisse la nouveauté et la radicalité du care en en reformulant le propos dans des termes familiers, que ce soit pour dire que la question du care a déjà été traitée en termes de solidarité, etc. et n’a pas besoin de l’angle féministe, ou pour revenir au discours politiques bien connu : les «bons» sentiments – donc ridicules – qui fleurissent dans l’espace confiné de la Famille – donc mineurs – n’ont rien à dire par rapport aux « vrais » problèmes éthiques et politiques. Le retour à un discours apparemment neutre et universel est la meilleure façon de rester ignorant de ses propres impensés de genre, ceux-là même qui organisent toute la série des dualismes – raison/émotion, esprit/corps, culture/nature, Blanc/couleur – que Gilligan conteste dans Une voix différente. Une caractéristique de l’accueil de la question du care en France, c’est qu’on essaie toujours de la rapporter ou de la réduire à de la pensée française : Ricœur, Levinas, Beauvoir. Pourquoi pas. Mais pourquoi aussi cette référence systématique à la vérité issue d’une tradition française (et masculine), qu’on n’a jamais imposée à des auteurs américains comme Rawls ? Les thèses de Rawls, qui fut rappelons-le une des premières cibles des éthiques du care (qui contestaient l’universalité et la transparence revendiquées de ses principes), sont entrées dans le débat public et intellectuel selon les mêmes modalités que celles de Gilligan : tout le monde prétend connaître ses idées et savoir ce qu’il faut en penser, rares sont ceux qui l’ont lu. La différence, c’est que Rawls ne fait pas ricaner – devinez pourquoi.
Les critiques du care confondent le care avec l’idée que la femme serait par essence figée dans une posture de sacrifice et d’abnégation. Mais, on l’a vu, c’est précisément cet essentialisme que combat le care. Notons que Gilligan a conçu l’idée du care et de la « voix différente » en écoutant des jeunes hommes parler de leurs questionnements éthiques devant la perspective d’être incorporés dans l’armée américaine au Vietnam. Elle défend le droit de se faire entendre, pour chaque voix, et le pluralisme des voix morales. Il est assez étonnant d’entendre attaquer le care par l’affirmation de ce qu’il soutient véritablement – l’égalité et la démocratie véritables. Mais une véritable égalité, de parole, et réelle – pas l’égalité théorique que donnerait par exemple le titre partagé de citoyen.
« Dans une société et une culture démocratiques, basées sur l’égalité des voix et le débat ouvert, le care est une éthique féministe : une éthique conduisant à une démocratie libérée du patriarcat et des maux qui lui sont associés, le racisme, le sexisme, l’homophobie, et d’autres formes d’intolérance et d’absence de care. Une éthique féministe du care est une voix différente parce que c’est une voix qui ne véhicule pas les normes et les valeurs du patriarcat ; c’est une voix qui n’est pas gouvernée par la dichotomie et la hiérarchie du genre, mais qui articule les normes et les valeurs démocratiques. »[18]
Ici on touche malheureusement au cœur du problème, à savoir le blocage du débat intellectuel sur le genre en France par la référence, y compris chez les femmes qui se prétendent féministes, à l’universalisme et à l’égalité. C’est bien une opposition systématique universalisme/différentialisme, aussi néfaste que tous les dualismes que critique Gilligan, qui structure le débat français sur le féminisme. Il ne s’agit d’ailleurs pas tant d’un débat que d’un système de repoussoir, le chiffon rouge du différentialisme agité dès lors qu’on veut défendre une position crédible et réaliste en ce domaine. Le débat sur la parité l’a bien montré. De même le refus voire le mépris du féminisme radical chez certaines des représentantes les plus actives ou visibles en France de la réflexion sur le statut des femmes, l’insistance actuelle sur des thèmes comme la famille au détriment de thèmes comme la domination et ‘un féminisme centré sur les femmes. D’où la surprenante convergence des thématiques de la presse féminine et des discours féministes grand public, toujours préoccupés centralement de la préservation des liens et de la conversation entre hommes et femmes.
Tout se passe comme si des positions féministes radicales et revendicatives étaient de toute façon ridicules, périmées et réservées à des harpies frustrées, et qu’un féminisme adulte et recevable consistait à comprendre que la question fondamentale est non plus celle de la lutte des sexes, mais celle du rapport des sexes. L’idée qui se fait jour depuis le XXIe siècle dans le monde intellectuel[19] est qu’un féminisme centré sur la femme n’a pas de sens, que le féminisme sous sa forme agressive est devenu inadapté, au moins à la France, où la civilité et l’harmonie des rapports inter-genres rendent possible une négociation (à moyen ou à long terme) d’une meilleure situation de la femme. Un exemple de cet état d’esprit majoritaire est la résistance permanente à la mise en place de règles et de quotas dans le recrutement des personnels – dont on peut aisément témoigner au moins dans deux domaines symboliquement importants, le monde académique et le monde politique, où la France, avec ses airs de supériorité égalitariste, est particulièrement arriérée. Dans ces domaines, comme en d’autres, une difficulté supplémentaire est l’attitude des femmes qui elles-mêmes, arrivées en position de pouvoir, considèrent qu’il serait dévalorisant de soutenir les autres femmes.
On est donc perplexe devant les évidences acceptées d’une classe intellectuelle, hommes et femmes confondus, qui pense au fond avoir résolu la question du féminisme, ou qui s’imagine qu’en France cette question est posée en termes spécifiques et se résout de façon « civilisée ». Bien des figures féminines de la vie intellectuelle semblent, en dépit de leurs précautions et dénégations, revenir, sous couvert d’universel, à une référence masculine, dans leur refus même d’entendre, ou au moins d’exprimer, une voix spécifiquement féminine. Nous ne parlerons pas ici des femmes qui préfèrent jouer carrément la carte misogyne, et tirer parti du fait que c’est là un coup super gagnant en France : présenter les hommes comme des victimes, c’est le succès assuré.
La motivation du féminisme ou du « non-féminisme » je préférerais dire, à la française, est de sortir d’un discours féministe revendicatif et centré sur la femme (associé commodément au féminisme américain et à son cortège d’abus rituellement signalés, en général le politiquement correct et le puritanisme antipornographie) pour envisager la subtilité des rapports entre sexes. D’où deux problématiques dominantes, complémentaires, celle de l’égalité citoyenne (les femmes sont par définition égales de l’homme, de par leur statut de citoyen français et n’ont donc pas à revendiquer de droits spécifiques puisqu’elles les ont, ces droits) et celle du mérite républicain (on n’a pas à favoriser les femmes, ce serait injuste ; il faut qu’on puisse, pour citer encore une fois le génie Onfray dans son article du Monde, « dire qu’une femme est nulle »). Le point commun à ces problématiques est leur récusation, ou leur contournement, de l’idée, traditionnellement centrale dans le féminisme, d’une domination masculine. La femme a les mêmes droits que l’homme, reste simplement à les faire mieux respecter dans les faits. Le féminisme en tant que doctrine de la domination doit être dépassé par la réflexion « post-féministe », comme l’a été le marxisme par la réflexion politique libérale dominante dans le monde capitaliste. Pourtant, au plan de la réflexion intellectuelle, le féminisme est sans doute en encore plus mauvaise posture. Qui oserait expliquer (au moins publiquement) qu’on a bien le droit de considérer qu’un ouvrier est moins « bon » qu’un dirigeant d’entreprise et de ne pas se poser la question de savoir ce que veut dire « bon », et ce que nous entendons par là, et ce qui nous conduit à considérer quelqu’un comme bon ou pas bon ? Et pourtant, même dans le milieu « intellectuel de gauche », il est parfaitement acceptable, et même recommandé si on veut avoir l’air rigoureux, de dire qu’on a bien « le droit » de considérer qu’une femme est « nulle » ou moins bonne qu’un homme.
Là intervient l’éthique du care. Beaucoup de théories féministes l’ont affirmé, mais aucune ne l’a montré empiriquement comme celle de Gilligan : les critères qui disent ce qui est bien, mal, valorisable, méprisable se présentent comme universels mais sont de fait ceux d’une société patriarcale : des critères masculins, au sens de valeurs issues de la domination masculine et destinés à la confirmer. La force de l’analyse de Gilligan est bien dans sa démonstration du caractère genré de nos jugements de valeur, moraux et intellectuels, et de l’injustice d’une situation où les critères sont eux-mêmes toujours en défaveur d’une classe, d’un sexe, etcetc. dans leur objectivité même. Comme l’a bien vu la juriste américaine Catherine MacKinnon, les enjeux initiaux du féminisme ne sont pas étrangers à ceux du marxisme, au sens où l’un et l’autre partent du constat d’une oppression et d’une injustice radicale.
« Le marxisme et le féminisme produisent des explications de la façon dont des arrangements sociaux de disparité systématique et cumulative peuvent être intérieurement rationnels et pourtant absolument injustes. Tous deux sont des théories du pouvoir, de ses dérives sociales et de sa mauvaise distribution. Tous deux sont des théories de l’inégalité sociale. »[20].
C’est là l’enjeu actuel d’une réflexion sur le féminisme en France. Quoique les problématiques liées au féminisme et à l’égalité des sexes (droits des femmes, travail des femmes, chômage des femmes, retraite des femmes, représentation des femmes) n’aient jamais été aussi présentes, notamment dans la vie politique, elles sont détachées de toute revendication d’ensemble et de tout discours sur la domination et l’égalité. Heureuse exception française, qui s’accompagne d’un état comparativement lamentable de la représentation des femmes en politique, et d’une pesante domination masculine dans le monde intellectuel ! Outre la prétention qu’il y a à penser la France systématiquement supérieure dans ce genre de domaine, on peut se demander pourquoi le respect dont sont entourées, dans le monde intellectuel, les théories politiques ou philosophiques américaines, exclut systématiquement la réflexion féministe américaine.
Tout se passe comme si les femmes françaises, sous les dehors d’une maturité plus grande due à la qualité revendiquée de leurs relations avec les hommes, étaient restées, d’une certaine façon, en admiration devant un modèle masculin. La référence extatique à l’universalisme, par exemple (comme l’a bien vu Marie-Jo Bonnet[21] à propos du refoulement de la relation entre femmes), n’est souvent que le masque d’une fascination pour le masculin au niveau duquel on veut se hisser et si possible rester la seule à y être arrivée (par son propre mérite, bien sûr). C’est ce que montre, au-delà de toute discussion sur le fond (linguistique et social) de l’affaire, la sensation de dévalorisation suscitée – chez les femmes elles-mêmes – par la féminisation des noms de métier prestigieux. Par exemple, une femme citée par M.-J. Bonnet : « Je tiens X pour une artiste à part entière, je dirais même un grand artiste, car l’utilisation du féminin est réductrice… Lorsqu’on dit une artiste, d’une certaine façon, on descend d’un cran. » Une pharmacienne, à la même époque, écrivait au Monde pour se plaindre de sa nouvelle dénomination, au motif que « la pharmacienne, c’est la femme du pharmacien ». Ce qui surprend dans ce désir de rester au niveau des hommes, c’est moins ce qu’il trahit d’admiration ridicule pour les figures masculines, que ce qu’il révèle d’un mépris social pour d’autres femmes (d’accord pour parler de bouchère, ou de maîtresse d’école, pas d’écrivaine ou de maîtresse de conférences). On a parfois l’impression que le discours universaliste est prétexte à une survalorisation du masculin, comme norme à atteindre, et que, une fois atteinte, on ne veut surtout pas laisser d’autres femmes approcher notamment de façon « imméritée » c’est-à-dire par des mesures discriminatoires. Toute la difficulté de l’universalisme est là, et c’est le problème politique du féminisme. La femme qui arrive à une position de pouvoir refusera l’idée qu’elle y est en tant que femme (et pas, par exemple, en tant que citoyen, intellectuel etc.) et ne se donnera pas pour tâche de parler pour les autres femmes. La question est bien celle de l’expression, de trouver des voix pour les femmes.[22]
La question de l’inégalité entre femmes est peut-être le problème le plus urgent auquel le « féminisme » à la française devrait se confronter. Un des problèmes qu’il faut affronter en France – et c’est bien, pour une fois, le problème des femmes – est cette façon dont l’universalisme sert à certaines de prétexte et d’argumentaire pour concilier une forme de féminisme et une forme de mépris social (j’y suis arrivée toute seule et les autres doivent se débrouiller aussi), argumentaire sous-jacent à toutes sortes de positions (contre les quotas, la discrimination positive, etc.) qui sont défendues par des femmes elles-mêmes.
Extension du domaine du care
C’est là encore que le care sert de révélateur, et la dernière subversion du care. De fait, l’autonomisation de certaines femmes en France – notamment des femmes « puissantes » qui souvent parlent au nom des femmes – par le travail, et parallèlement par le développement des systèmes de garde d’enfants, des services à domicile, etc. s’est aussi faite, si l’on ose dire, sur un modèle masculin. Au sens où cette autonomie s’est faite non, on s’en doute, par un transfert des tâches aux hommes, ou une meilleure répartition, mais par la mise d’autres femmes au service des femmes. Il ne s’agit évidemment pas d’ironiser sur ces femmes, devenues employeuses (car c’est toujours à elles de porter la charge morale, et administrative, de l’emploi à domicile)[23]. Bien plutôt, comme souvent dans le care, de faire voir ce qui est juste sous notre nez : que les tâches de care, traditionnellement dévolues aux femmes (au foyer) existent toujours même si nous, occidentaux favorisés, en sommes dispensés et préférons payer pour cela ; que ces tâches sont assumées par des populations immigrées et dévalorisées, qui perpétuent la dévaluation morale du travail de care, et les catégorisations morales qui vont avec.
Quand bien même les analyses du care – dans une perspective politique – s’attachent à déconnecter ou désintriquer genre et morale, elles ne peuvent ignorer l’entremêlement complexe entre ces deux termes ni les circonstances historiques sociales et politiques qui ont mis le care au cœur de la plupart des expériences vécues par des femmes. Ce qui peut être mis au crédit de la thèse de la voix différente, c’est bien l’élargissement des réflexions sur le rapport entre genre et morale, qui aboutissent inévitablement à problématiser le genre comme vecteur de moralisation.
Par la place centrale qu’elle accorde à la vulnérabilité des personnes, de toutes les personnes, la perspective du care comporte une visée éthique qui ne se résume pas à une bienveillance active pour les proches, mais constitue une véritable révolution dans la perception et la valorisation des activités humaines.
Cette prise en compte rappelle l’importance qu’il y a à repenser ensemble care et délégation du travail, ou service. Car la division sociale – et aujourd’hui mondiale – du travail de care risque de donner l’illusion que l’on peut distinguer aisément un care « émotionnel » – attentif aux besoins affectifs des personnes particulières – et un care « de service » qui peut être délégué et acheté. Le premier serait alors l’apanage des femmes blanches bourgeoises, tandis que le second reste délimité par tout ce que les premières ne prennent pas en charge, en résumé « le sale boulot » qui revient aux « autres ». Le premier permet de concentrer les critiques du care, quand le second permet d’ignorer l’existence du care.
Si la question du care fait aujourd’hui irruption dans l’espace public, c’est aussi que l’entrée massive des femmes sur le marché du travail met en crise les voies traditionnelles de fourniture du care. Qu’il soit fourni dans la sphère domestique, par les institutions publiques, ou par le marché, le care est produit par des femmes dont les positions sociales restent le plus souvent précaires. Infirmières, aides à domicile, aides-soignantes, travailleuses sociales,… sans parler de tous ces autres métiers de care qui se dévalorisent à la vitesse et exactement à la mesure de leur féminisation : enseignantes, médecins généralistes, etc. La crise du care est à la fois celle des care givers traditionnels qui assument une charge de plus en plus lourde du fait de l’allongement de la durée de vie. Celle des conditions de plus en plus difficiles dans lesquelles s’effectuent les activités de soin, sous l’effet des politiques qui les encadrent. Celle enfin, la plus préoccupante, de la « fuite du care » des pays pauvres vers les plus riches.[24]
On touche alors à la limite des beaux discours sur la valorisation, voire l’empowerment des travailleurs du care (de Tronto à Aubry). Car il faut reconnaître que ce travail, personne ne souhaite positivement le faire – surtout pas, on l’imagine, les politiques et intellectuels qui prônent une « société du soin ».
L’éthique du care visait, dans les années 1980, à renouveler le féminisme, par une prise de conscience des différences et inégalités entre femmes. Mais elle reste ancrée dans le féminisme, et c’est ce que rappellent, désagréablement, le mot et l’idée – notamment à tous ceux qui veulent oublier qu’ils sont dépendants du care pour leur autonomie et leur liberté. C’est pour toutes ces raisons et subversions que la voix différente reste, encore pour longtemps, notre actualité.