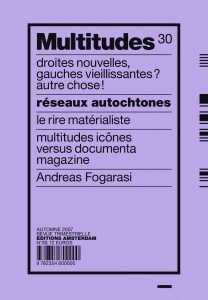Un repas, un dimanche comme les autres, une famille comme les autres[1]. Entre les nouvelles, les souvenirs et les remarques s’invitent quelques blagues faciles à l’humour aussi gras que le gigot d’agneau aux flageolets et les rires complaisants. Le moment est à la détente et la finesse en vacances. Il ne fait pas bon dans ces cas-là s’extirper de la connivence. Le rire fait partie des réjouissances et malheur au trouble-fête qui mesure la cruauté de ces amusements coutumiers.
Blondes, Arabes, juifs, Belges, politiques, prostituées. La caricature est poussée à son paroxysme, la nuance écartée, la charité oubliée. Le rire semble à ce moment-là posséder ce pouvoir inouï de réunir l’oncle raciste et le neveu gauchiste, de briser les clivages les plus épidermiques autour de la gaudriole. Pis, nous rions aussi, laissant un instant la lucidité au placard, faisant fi de notre belle conscience morale. Nous nous laissons porter joyeusement par ce mouvement dans lequel le proche se réjouit sur le dos du lointain. Et nous aimons ça.
Le plaisir de rire est-il foncièrement malsain ? Bergson l’avait bien affirmé : « (Le rire) a pour fonction d’intimider en humiliant. Il n’y réussirait pas si la nature n’avait laissé à cet effet, dans les meilleurs d’entre les hommes, un petit fond de méchanceté, ou tout au moins de malice[2]. » Ce phénomène, si innocent en apparence, ne serait donc toujours qu’une moquerie déguisée, qu’un instrument inconscient de coercition. La société corrigerait grâce à lui, sans l’ombre d’une pitié et, parfois, injustement, toute « raideur du caractère »[3], toute inadaptation à la vie, inadaptation nuisible au bon fonctionnement de la vie en commun. Dans cette vision profondément pessimiste, le rieur se transforme en un policier involontaire de l’ordre social, le « plaisir de rire (en une) intention inavouée d’humilier »[4. Je repense alors à la semaine dernière, à ce garçon de café qui fit tomber son plateau surchargé au milieu de la salle et qui essuya les rires des consommateurs en même temps que ses chaussures. Il fera plus attention à l’avenir. C’est certain. Le souvenir cuisant de la honte restera marqué au fer rouge.
Quelque chose résiste pourtant à cette analyse d’une lucidité implacable. Peut-être n’est-ce que le signe d’un besoin vital d’illusion sur soi-même. Il ne fait jamais plaisir de se savoir l’instrument involontaire et brutal de la morale grégaire alors que l’on travaille chaque jour à se construire une personnalité autonome, critique et singulière. Comment faire alors ? S’interdire de rire ? Quelle existence terne cela promet ! Une habile casuistique calmerait efficacement la conscience ; le rire, après tout, ne serait-il pas une saine décontraction de l’intelligence, un relâchement nécessaire pour un esprit critique lourdement sollicité ? La solution est séduisante, mais reste à la surface pour mieux éviter les pièges d’une recherche en profondeur.
Le portrait que livre Bergson du rieur est implacable. Pas de rieur sans cette « insensibilité »[5], cette « anesthésie du cœur »[6]. Le rire exile de l’éthique. Le rieur met de côté le respect pendant qu’autrui perd sa dignité. Cela ne peut durer que l’espace d’un instant, mais pendant ce cours laps de temps une déchirure se crée dans les rapports humains en place. Prenons le rire insolent, au sens étymologique de l’insolens latin : insolite, effronté, orgueilleux, et, parfois aussi, excessif. Le rire manifeste alors un plaisir tout particulier. Plus qu’un rire libérateur, c’est le rire de la libération provisoire d’un joug pesant. C’est le rire des élèves de M. Laubreck, héros malheureux d’un texte de jeunesse de Sartre, « Jésus la Chouette ». Professeur sans autorité et sans conviction, « il se lançait (pendant un cours de grec) dans un monologue insignifiant et long, contant des aventures qui lui étaient arrivées dans sa jeunesse. Mais nous ne l’écoutions plus : “Il est lancé”, disait Herbaut en ricanant et nous causions à voix basse en lui jetant des coups d’œil sournois. (…) Souvent, devant sa traduction ampoulée et inexacte, nous pouffions de rire. Il avait alors un sursaut de rage, puis subitement calmé levait vers nous un regard morne et continuait tristement l’explication. Il se rattrapait lorsque le texte prêtait aux digressions, partait brillamment vers des considérations philosophiques et idéales, s’agitait sur sa chaire, et, avec de grands gestes balayeurs, il semblait un Démiurge dictant les lois du monde, un pied sur le Soleil et l’autre sur la Lune. Mais à mes yeux railleurs et méchants il était simplement ridicule[7]. »
M. Laubreck restera risible jusqu’à son enterrement, enfermé dans son personnage, comique malgré lui, devant un public sans indulgence. Le risible, comédien involontaire, se donne en spectacle, entre en représentation. Il est l’insociable, l’excentrique, le vaniteux. La misanthropie d’Alceste n’est comique que par son intransigeance ; isolé au milieu d’un monde dont il ne souffre l’hypocrisie, le personnage de Molière est risible dans son incapacité à s’adapter aux pratiques de ses semblables ; le désert auquel il aspire à la fin de la pièce n’est en somme qu’une matérialisation de ce one man’s land dans lequel ses semblables s’amusent à le voir s’agiter en vain. Inattentif à la vie, à autrui et à lui-même[8], il crée une barrière émotionnelle infranchissable entre le rieur et lui. Ils ne font plus monde commun. Le jeune élève de M. Laubreck ne peut plus admirer son professeur. Ce dernier est enfermé sur cette scène de comédie permanente qu’est devenue sa vie, il n’est plus digne de respect dans le sens où, si l’on suit la définition de Kant, ce sentiment moral est à la fois analogue à la crainte et à l’inclination. M. Laubreck n’est ni aimé ni craint. Pis, il n’est même plus capable de susciter ni l’un ni l’autre. Pour qu’une situation ou une personne soit risible, il faut qu’elle ne touche pas affectivement. L’éthique est mise en suspens par le rire ; la première vise à établir un certain type de relations interpersonnelles que le second détruit. Dans le rire, autrui n’est plus cet alter ego, cet autre soi-même. Il est ce que l’on ne veut absolument pas être, cet individu vaniteux, stupide, incapable de comprendre ce que nous, à distance, comprenons. Le risible fait les mauvais choix, il mésuse de son libre arbitre. À la racine de tout rire, on retrouve l’angoisse, cet affect si puissant, ce vertige inquiétant devant le champ des possibles, l’angoisse que nous aussi nous aurions fait le mauvais choix, que nous aurions pu être à la place du risible. M. Laubreck est risible à plein temps parce qu’il est, pour ses élèves, un raté à plein temps. Le rire de ses élèves met à distance cette existence possible dont ils ne veulent pas, eux qui ont, comme on dit, toute la vie devant eux. Il exorcise donc leur angoisse. Soulagement de ne pas être à la place de celui qui se fourvoie, absence de cette pénibilité qu’autrui endure, en un mot cathartique, le plaisir qu’il apporte est négatif.
Rire d’un de ses amis entraînerait-il que, le temps de la blague, il n’est plus mon ami ? Si je m’amuse à ses dépens, c’est que je pense qu’il est intimement convaincu que foncièrement je ne lui veux aucun mal et surtout qu’il rira avec moi. Je présuppose qu’il saura rire de lui-même. La fracture entre le rieur et le risible n’est pas irrémédiable. Le risible peut revenir dans le monde commun s’il intègre le camp des rieurs, s’il sait se faire spectateur de lui-même et mettre à distance son manque de jugement. Le rire crée en effet une communauté affective que l’on ressent particulièrement dans une salle de spectacle. Entrez en retard pendant la représentation d’une comédie et vous sentirez l’ambiance qui s’est installée parmi les spectateurs. Vous ressentirez cette légère impression de déranger. Avant de vous asseoir et de participer au concert de rires, vous serez encore un intrus. Confortablement installé dans votre fauteuil, vous sentirez alors les vagues de rires vous submerger et la contagion vous gagner car le rire est communicatif, comme si l’on avait peur d’être exclu de cette communion que le spectacle instaure.
Mais cette communauté se construit avant toutes choses autour de références communes. Bergson n’a pas manqué de souligner que « le rire cache une arrière-pensée d’entente, (…) de complicité, avec d’autres rieurs, réels ou imaginaires »[9] et qu’il est relatif à une société donnée, à un groupe social déterminé[10]. Derrière la convivialité se cache la connivence. En cela, le rire peut rassembler autant qu’il peut éloigner. Le comique de situation s’appuie couramment sur des stéréotypes, des lieux communs, souvent difficilement compréhensibles par des étrangers et parfois dirigés contre eux. Là encore, la frontière entre l’humour et la méchanceté pure se fait pour le moins ténue. Tout dépend de l’intention avec laquelle les stéréotypes sont manipulés. Le rire raciste, par exemple, utilise le pouvoir d’exclusion du rire pour servir son entreprise d’affirmation identitaire et de rejet de l’autre. Le rire raciste ne vise pas un défaut accidentel comme dans le rire analysé jusqu’à présent. Ce n’est le choix de personne de naître anglais, arabe ou polonais. Le rire raciste attaque des défauts qu’il juge essentiels aux autres : l’Anglais est perfide, l’Arabe voleur, le Polonais alcoolique. Les préjugés passent alors pour des certitudes et la frontière entre le rieur et le risible se superpose aux frontières nationales, régionales, sociales, ethniques, religieuses. Le rire se fait défensif et, plus que jamais, stigmatise ce plaisir de ne pas être à la place de l’autre. S’il libère d’une angoisse, c’est de l’angoisse éprouvée devant cet étranger si étrange et donc si menaçant que l’on ne comprend pas, que l’on ne veut pas comprendre. Les préjugés rassurent, rendent la vie simple, dispensent d’aller vers l’inconnu. Le rire se fait alors réaction réactionnaire, manifestation de l’attachement à une Humanité réduite à une multitude d’étiquettes réconfortantes et factices.
Le rire n’est-il au fond que cette passion triste ? Le constat serait définitivement désespérant si l’humour ne volait pas à tire d’aile vers des cieux moins sombres que l’épais brouillard xénophobe par lequel je viens de le faire passer. Certes, les stéréotypes, les lieux communs, une culture commune sont nécessaires au rire, mais ce dernier est aussi une arme précieuse pour les remettre en question. Rire de quelqu’un dans la vie et rire d’un comédien sur scène sont deux expériences radicalement différentes. Dans un spectacle comique, on ne rit pas d’une personne, mais d’un personnage. Le rapport éthique en est profondément modifié. Souvenons-nous de l’ambition de Molière dans la préface de Tartuffe : « corriger les vices des hommes ». Le personnage comique représente une incarnation d’un ou de plusieurs défauts de l’humaine condition. Le rire garde alors sa fonction de mise à distance, du moins en partie. L’art de l’auteur comique est en effet de jouer de cette sécurité que se donne le spectateur en refusant l’identification, pour mieux lui retourner le défaut qu’il ne veut pas partager avec le personnage. Le comique algérien Fellag formule une analyse très juste de son travail : « Tout le temps du spectacle que je donne, je vais jouer du marteau-piqueur, si je puis utiliser cette image. Je vais lancer une bombe. L’important est de faire passer cela de façon à me faufiler entre les mécanismes de résistance des spectateurs pour atteindre l’endroit, le nœud des nerfs qui déclenchent le rire. Car le rire n’est qu’un mécanisme nerveux qui acquiesce, qui dit : “Oui, bravo, je suis d’accord !” C’est une réaction qui se déclenche quand le spectateur se sent percé à jour et se dit : “Merde, je suis découvert, il a deviné que moi aussi je suis lâche, que moi aussi j’ai des préjugés, j’ai mes cachotteries, etc.”[11] » Le rieur n’est pas celui qui corrige, c’est lui qui est corrigé dès qu’il prend conscience que la frontière qu’il établit entre lui et le personnage est intenable. Il rit toujours de lui-même, en définitive. Le plaisir de rire devient alors un moyen plaisant de se remettre en cause, ou tout du moins, une première étape joyeuse vers un examen de ses préjugés.
Le rire, sans faire plus de bruit que lui-même, peut conduire alors sur la voie de la philosophie. Bien avant les Lumières, l’Antiquité avait bien compris que l’on pouvait instruire tout en divertissant. Les anecdotes sur Diogène et Aristippe marient ludique et didactique au service de l’éthique. Elles n’ont, en vérité, rien d’anecdotique, de superficiel, de superflu, d’accessoire, du moins pour celui qui outrepasse le premier degré. Car à vouloir cacher le sérieux sous le comique, on court toujours le risque que personne ne le trouve et les petits apologues du cynique de Sinope et de l’hédoniste de Cyrène passeront aisément pour des bons mots à ressortir en fin de banquet. Pourtant, c’est une véritable propédeutique à la philosophie qui se déploie dans ces petites histoires. Pensons à un de ces coups d’éclat dont étaient coutumiers Aristippe et Diogène :
Le comique ici, à première vue, n’a rien d’intellectuel. On rit du crachat comme de la bonne vieille tarte à la crème, en imaginant la tête déconfite de Simos. On rit aussi de voir le puissant, le riche, le vaniteux remis à sa place. La vis comica est banale. Elle s’appuie sur des thèmes comiques populaires pour créer une complicité entre le lecteur et Aristippe, qui met ainsi les rieurs de son côté. La connivence se met en place, propice à l’acceptation d’une critique plus radicale. Car se moquer ponctuellement de la vanité et du goût pour la richesse est une chose, en faire des valeurs que l’on est prêt à mettre en pratique dans sa vie quotidienne en est une autre. Ne nous arrive-t-il jamais d’être vaniteux ? Ne sommes-nous jamais fiers d’une nouvelle acquisition ? L’anecdote n’est que le déclencheur d’une prise de conscience. Pour Aristippe ou Diogène, cracher à la face du Phrygien manifeste une critique de l’attachement aux biens personnels, à une époque où l’idée selon laquelle la pauvreté favorisait le bonheur était totalement absurde. Le message éthique se fait implicite, se laisse déduire, ne s’impose pas avec la froideur d’une leçon de morale. Libre au rieur de suivre Aristippe ou Diogène, de s’engager dans une réflexion philosophique sur les principes qui régissent sa vie.
Bergson concluait son ouvrage par une très belle métaphore maritime où l’amertume du rire se voyait soulignée. De l’amertume, il y en a sûrement pour celui qui se trouve incapable de dépasser la remise en cause des valeurs et de leur en substituer de nouvelles. Prisonnier d’une lucidité stérile, il arbore ce cynisme (au sens moderne[13]) cher à Cioran. Politesse du désespoir, le rire se déploie alors dans toute sa négativité : toute situation, toute valeur sont sujettes au sarcasme, ostensiblement rejetées comme autant d’illusions moribondes auxquelles le rieur ne veut et ne peut plus croire. L’amour, la mort, les mœurs, la religion, l’hypocrisie représentent autant de cibles de choix pour un Karl Kraus, un Roland Jaccard ou un Guido Ceronetti. En faisant de la société entière la scène de la comédie humaine, en se voulant le spectateur solitaire de la bêtise ordinaire, le rieur nihiliste s’isole et expérimente ainsi le pouvoir d’exclusion du rire poussé à son paroxysme : ce n’est plus un homme ou un groupe qu’il met à distance, c’est le monde entier ! Le plaisir de rire se montre dès lors profondément antisocial.
Le rire prend donc de multiples visages. Répressif, comme chez Bergson, il se met au service de la société contre l’individu. Révolté, il se met au service de l’individu contre la société. Les dictatures ont depuis longtemps compris que le plaisir de rire n’a rien d’innocent et que la censure se doit de couper court à toute velléité satirique. Comme l’écrivait Wittgenstein, « l’humour n’est pas une humeur, c’est une vision du monde. Et c’est pourquoi, si l’on a raison de dire que l’humour fut banni de l’Allemagne nazie, cela ne signifie pas simplement que l’on n’y était pas de bonne humeur, mais quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus important[14]. »
Notes
[ 1] Je limiterai volontairement mon analyse aux comiques de situation et de caractère. Le comique verbal me semble relever en effet d’un autre type de plaisir, né de l’expérimentation des règles phonétiques, syntaxiques et grammaticales. Son étude dépasserait le cadre de cet article et demanderait une étude de l’ouvrage de Freud, Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient.
[ 2] Henri Bergson, Le Rire (1899), PUF, 2004, p. 151.
[ 3] Ibid., p. 15.
[ 4] Ibid., p. 104.
[ 5] Ibid., p. 3.
[ 6] Ibid., p. 4.
[ 7] Jean-Paul Sartre, « Jésus la Chouette », in M. Contat et M Rybalka (dirs.), Écrits de Jeunesse, Gallimard, 1990, p. 76-77.
[ 8] Henri Bergson, Le Rire, op. cit., p.66.
[ 9] Ibid., p. 5.
[ 10] Ibid., p. 135-136.
[ 11] In Philosophie Magazine, novembre 2006, n° 5, p. 29.
[ 12] Diogène Laërce, Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, Flammarion, coll. Garnier-Flammarion, t. 2, p. 75.
[ 13] Pour une distinction entre cynismes antique et moderne, voir Peter Sloterdijk, Critique de la raison cynique, trad. par Hans Hildenbrand, Christian Bourgois, 2000.
[ 14] Ludwig Wittgenstein, Remarques mêlées, trad. G. Granel, TER, 1990, p. 97.