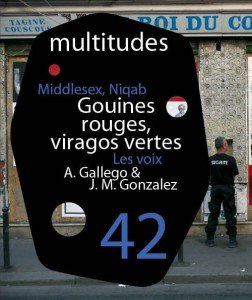Comment évoquer, sans risquer de rendre à ce terme son acception latine de « tirer à soi », un courant féministe qui n’a de cesse d’engager des parties de cache-cache avec tout ce qui s’apparente de près ou de loin à du cadre, à du formel ? Comment saisir, sans dénaturer, l’essentiel d’un phénomène qui pratique une forme d’« auto-volatilisation » constante et présenter, sans ratures, un groupe social dont les pratiques relèvent du palimpseste ? Pourquoi chercher une cohésion, si difficile à justifier, pour parler d’un courant qui met un point d’honneur à ne pas se constituer en mouvement cohérent et qui partant de là ne nous laisse même pas un nom auquel nous aurions pu nous raccrocher. On l’aura compris, il s’agira donc ici de présenter une des nombreuses voies(x ?) permettant d’appréhender un courant par essence polyphonique.
Afin de disposer d’une prise, aussi labile qu’elle fût, pour décrire un réseau féministe disparate, informel et « underground », et parce que dans de nombreux cas, ses membres en reconnaissent l’influence, nous avons choisi de mettre ses manifestations françaises en perspective avec les pratiques d’une faction punk féministe nord-américaine qui a vu le jour au début des années 1990 appelée Riot Grrrls. La parenté nous a semblé d’autant plus défendable que les Ladyfest (que nous évoquerons plus loin), qui constituent l’une des formes les plus visibles de l’activisme féministe des collectifs français, furent originellement institués aux États-Unis, en 2000, par certaines des initiatrices du phénomène Riot Grrrls. Nous nous autoriserons donc un préambule « hors les murs », avant de nous pencher plus spécifiquement sur le cas français, en tentant de mettre en relief les facettes multiples de ce féminisme interstitiel, aussi vivace que fuyant.
Un féminisme jeune, ouvert et musical
Le courant Riot Grrrls est donc né dans la petite ville d’Olympia, état de Washington, au Nord Ouest des États-Unis, petite ville connue pour son université « contre-culturelle » et expérimentale, ainsi que pour la fécondité et l’inventivité de la scène musicale locale. À la fin des années 1980, la scène punk américaine, notamment sous l’influence de groupes hardcore, est devenue très masculine, très violente et très codée, laissant loin derrière elle les principes de ce mouvement. Dans ce contexte hostile, quelques jeunes femmes (elles ont globalement entre 15 et 25 ans), décident de se mobiliser pour faire entendre leur voix. Le slogan accrocheur lancé par les premières Riot Grrrls, « Revolution Grrrl style now ! » résume assez bien l’état d’esprit dans lequel celles-ci veulent inscrire leurs actions. Il s’agit, en effet, de dénoncer et combattre frontalement le sexisme dans le monde de la musique et dans le reste de la société, de se ménager un espace dans la production culturelle qui est jusqu’alors tacitement dénié aux femmes. À cette prise de position féministe, s’ajoute la posture anti-capitaliste caractéristique du punk, notamment manifestée par l’obédience à une « esth-éthique » Do-It-Yourself, la volonté de se tenir à l’écart des réseaux de communication de masse et la remise en cause de la précellence accordée à la qualité du produit fini par rapport au processus créatif.
Le réseau s’organise progressivement de manière informelle autour d’une scène musicale indépendante et d’une production littéraire abondante prenant la forme de fanzines qui, à une époque où l’usage de l’Internet n’est pas encore banalisé, constituent un vecteur d’échanges vital pour le mouvement. Des réunions hebdomadaires non-mixtes du type des groupes de prise de conscience féministes des années 70 sont également organisées. En août 1991, un festival, est organisé avec des concerts, mais aussi de nombreuses discussions autour de sujets variés (sexisme, homophobie, racisme, validisme, pour en citer quelques-uns) et ateliers d’échanges de savoirs. Le mouvement se fédère un peu plus ce qui commence à lui donner davantage de visibilité. À partir de ce moment-là, en partie grâce à une couverture médiatique à l’égard de laquelle les jeunes femmes nourrissent pourtant une franche circonspection, des collectifs se créent dans plusieurs villes des États-Unis et les idées des Riot Grrrls s’expatrient vers l’Angleterre.
Le féminisme que ces jeunes femmes s’emploient à diffuser est davantage pratique, pour ainsi dire, que théorique. Dans bon nombre de témoignages des protagonistes de ce mouvement, on trouve l’intention de développer une forme de féminisme qui répondrait davantage aux attentes que pourrait manifester un public jeune, d’extraire le féminisme d’un contexte qu’elles jugent trop académique et d’en exprimer une facette dans le domaine culturel. Ainsi, par exemple, Corin Tucker (chanteuse-guitariste du groupe Heavens to Betsy) affirme :
« The whole point of Riot Grrrl is that we were able to rewrite feminism for the twenty first century…For teenagers there wasn’t any real access to feminism. It was written in a language that was very academic, that was inaccessible to young women. And we took these ideas and rewrote them in our own vernacular. »
Il s’agit en effet d’une sorte de féminisme introductif, d’une incitation au « click ». Il s’agit aussi et surtout d’encourager un maximum de jeunes femmes à s’associer, à parler, écrire, créer, échanger : la conception qu’ont les Riot Grrrls de la révolution est pour ainsi dire épidémique et quotidienne. De cette volonté de rendre le mouvement participatif résulte une forme récurrente d’ambivalence, de suspens, de floutage des intentions et des discours, ménageant en quelque sorte un jeu, un espace lâche autorisant d’éventuelles ré-interprétations par d’autres jeunes femmes. Et de fait, la variété des contenus des fanzines, de la nature des collectifs qui se sont formés, la multiplicité des manifestes qui ont été produits, reflètent ce refus d’instaurer une bannière d’intentions communes, cet accent mis sur la nécessité de reconnaître la diversité des expériences individuelles et fait de cette culture un courant polymorphe et évasif. Ainsi par exemple, Kathleen Hanna explique :
« Part of the point was to challenge hierachies of all kinds. We didn’t have a “statement” we were all willing to agree with, and we didn’t even want to do that, because we didn’t want to be a corporation or a corporate identity […]It was not cohesive and easily consumable. We didn’t have […] a sentence that encapsulated it, we didn’t have one unified goal, we didn’t have one way to dress or look. »
Par ailleurs, comme le souligne Marion Leonard, les Riot Grrrls ont également cultivé l’ambivalence et la contradiction dans le but de se prémunir d’une récupération trop immédiate de leur culture par les médias de masse. Car, dès les premiers temps, la question de la représentation de leurs pratiques est au cœur de leurs préoccupations et va jusqu’à modeler la (ou plutôt l’a-) structure du mouvement. La plurivocité qu’elles s’emploient à cultiver et la variété des intentions dont elles investissent leurs pratiques, participe d’un désir de ne pas se laisser digérer par l’appareil médiatique par le biais d’une étiquette réductrice. Dans cette même perspective, elles disqualifient une forme de posture hiératique de contestation, préférant se livrer à des ajustements constants de positionnements. Dans son fanzine Ablaze !#10 Karren affirme ainsi : « We are aware of the dialectical nature of protest, which ensures that dissenters are relegated to the role of ‘other’, thus playing a necessary supportive role to the mainstream ideology. We refuse to give credibility to traditional modes of protest. » Néanmoins, malgré toutes les stratégies mises en place, les médias de masse auront raison des Riot Grrrls première mouture, qui finiront par être minées par des dissensions internes liées à ces questions et mettront un terme à leurs activités les plus visibles vers le milieu des années 1990.
Cependant une nouvelle initiative trouvera de nombreux échos partout dans le monde, insufflant un nouveau dynamisme à cette forme mouvante et instable de féminisme. En 2000 certaines des activistes Riot Grrrls de la première heure collaborent à nouveau pour organiser sur plusieurs jours, à nouveau à Olympia, un festival féministe qu’elles nomment Ladyfest et décrivent en ces termes : « a non-profit, community based event designed by and for women to showcase, celebrate and encourage the artistic, organisational and political works and talents of women ». Cet événement s’étale sur six jours et s’inscrit dans la lignée du festival Riot Grrrl quelques années auparavant, en proposant discussions, ateliers, concerts, performances et expositions. Les organisatrices mettent dès le départ l’accent sur leur volonté de faire du Ladyfest un festival nomade pour ainsi dire. Ainsi Tobi Vail (anciennement batteuse de Bikini Kill, membre de nombreux autres groupes par la suite, et co-organisatrice du premier Ladyfest) affirme :
« Ladyfest was deliberately created… with strategy in mind […] It became clear that we should try to create something that could be reproduced by women in their own communities […] We tried to develop a method that would foster localism. » Il semble que la méthode ait fonctionné puisque depuis, plus de cent Ladyfest ont eu lieu partout dans le monde, prenant des formes variées.
Les ladyfest françaises
En France, sept de ces événements se sont tenus entre 2003 et 2010, dans les villes de Grenoble, Dijon, Toulouse (à trois reprises), Nantes et Bordeaux. La nature de chacune de ces Ladyfest est restée semblable à celle du premier festival américain, toutes restant des manifestations, à but non-lucratif, organisées par des associations ou des collectifs informels féministes et consistant en des concerts, discussions, ateliers, performances, lectures, projections vidéo et expositions, les politiques de mixité variant selon les villes et la nature des activités proposées. Excepté dans le cas du Ladyfest Bordeaux, tous les festivals ont été auto-financés. L’accélération de la fréquence de ceux-ci (cinq ont eu lieu entre 2008 et 2010) témoigne de la vivacité des réseaux impliqués, et rend compte d’une certaine appétence pour cette forme de mobilisation féministe de la part d’une population dont le spectre d’âge s’est élargi (entre dix-huit et quarante ans en majeure partie). En règle générale, ces événements drainent une assistance qui dépasse le niveau strictement local, et révèlent l’existence de liens entre différents réseaux, plus ou moins « underground », à un niveau national et transnational. Les Ladyfest constituent à cet égard des moments de rencontres et d’échanges entre différents pôles, moments qui ponctuent des parcours activistes collectifs plus quotidiens et plus locaux prenant des formes diverses. Ce caractère hétéroclite favorise ainsi l’émergence de nouvelles idées et les influences mutuelles rendent ces événements évolutifs tant dans la forme que dans le fond.
Dans de nombreux cas l’influence des actions et des productions culturelles des Riot Grrrls est avérée et assumée. Bien qu’elle ne soit bien évidemment pas l’unique composante des Ladyfest, la tradition Riot Grrrl entre en jeu dans une sorte de base de référence culturelle commune. L’idéologie Do-It-Yourself chère aux Riot Grrrls occupe notamment une place fondamentale dans ces réseaux « underground » contestataires qui refusent souvent de composer avec les moyens et les cadres de la société capitaliste et hétéropatriarcale. La mise en oeuvre de cette idéologie s’applique non seulement au domaine de la production culturelle (comme cela était essentiellement le cas pour les Riot Grrrls) qu’elle soit musicale, littéraire, ou autre, mais elle se double d’un caractère politique en participant au développement de modes de vie et de consommation alternatifs.
Ainsi, d’une part, la valorisation d’une forme d’amateurisme et de simplicité, palpable dans les productions des formations musicales et dans les fanzines, contribue à créer un climat galvanisant et à encourager chacun-e à s’approprier le processus créatif. D’autre part, les ateliers, lors des Ladyfest, par exemple, constituent le biais par lequel une forme de théorie de la pratique s’échafaude et se dissémine. À titre d’exemple, on peut mentionner quelques intitulés d’ateliers proposés lors des Ladyfest français qui illustrent cette volonté de s’extraire d’une dépendance générée par un système qui fractionne et spécialise : atelier réparation de vélo, mécanique, atelier : « fabrique ton gode toi-même », auto-examen gynécologique, autodéfense, atelier : « fais ton pain toi-même », fanzine et sérigraphie/platrogravure, forge et soudure, fabrication de pochoirs, reliure, sonorisation. Dans un esprit similaire, pendant certains festivals (à Toulouse par exemple) des sessions de récupération d’aliments en fin de marché sont organisées et des groupes de volontaires se chargent de cuisiner pour l’assistance un repas proposé à prix libre.
Enfin, bien plus que ce n’était le cas aux États-Unis, ce réseau féministe cultive de nombreuses accointances avec la culture du squatt, incarnation par excellence de l’idéologie Do-It-Yourself appliquée au quotidien. À Toulouse, le réseau s’est progressivement élargi et a pu perdurer grâce à l’existence de squatts tels que le « Clandé » ou les « Pavillons Sauvages », qui offrent des espaces de liberté et de gratuité indispensables pour la tenue de ce genre d’événements (en effet les organisatrices s’attachent pour la plupart à ce que les bénéfices, servant principalement à défrayer les groupes et acheter du matériel, proviennent de dons volontaires). Dans de nombreuses villes, des collectifs ont par ailleurs ouvert des squatts d’habitation féministes, comme à Grenoble par exemple.
Un réseau circulatoire sans tête
Tout comme les Riot Grrrls, le réseau féministe underground français accorde une grande importance à la question identitaire et à la variété des expériences de vie et des ressentis. De la même manière que les premières s’attachaient à mettre en cause toutes les hiérarchies, le courant actuel n’a de cesse de mettre en perspective toutes les formes d’oppression et d’y reconnaître des mécanismes similaires. La lutte contre le racisme, l’homophobie, la transphobie, le classisme, le validisme, les tyrannies esthétiques, se joint en effet constamment à la lutte contre le sexisme. La question des tactiques à mettre en place en vue d’une éventuelle convergence des luttes est régulièrement débattue lors de discussions. Il faut noter ici que ce réseau féministe est en lien étroit avec les réseaux queer et « transpédégouines », une affinité qui se vérifiait déjà entre les Riot Grrrls et le courant punk « queercore » dans les années 1990 aux États-Unis.
Cette attention particulière accordée à la diversité des parcours et cette sensibilité à la multiplicité des oppressions potentiellement subies débouchent également sur une volonté expresse de ne pas donner d’identité au mouvement, de ne pas le circonscrire, de ne pas établir de discours prédominant afin que personne ne parle au nom de personne. Il résulte de cela, un réseau mouvant et protéiforme, dont l’une des seules véritables caractéristiques réside dans l’aspect circulatoire des idées et des pratiques développées. De plus, cette circulation participe aussi d’une sorte de tactique de diffraction, de brouillage de pistes, liée à une volonté de ne pas se laisser saisir, figer dans une catégorie de plus.
Ainsi, ce réseau tire sa force de ce que chacun-e de ses protagonistes additionne sa personne à un socle de valeurs communes qui s’actualise, se réajuste et se nourrit précisément de ce flux constant. Il s’agit en quelque sorte d’un « work in progress » dont l’objectif est de le rester, d’un activisme de la ponctualité, dont la forme est éphémère mais les occasions nombreuses. Cet aspect circulatoire, presque intéractionniste, se vérifie à différents niveaux : d’un point de vue géographique, d’abord, comme peut l’illustrer le concept même du Ladyfest, mais également parce qu’une grande partie des protagonistes de ces réseaux font elles-mêmes montre d’une grande mobilité et regardent rarement à la dépense kilométrique lorsque se tient un événement. Circulation des savoirs, des savoirs-faire et des informations également, grâce aux ateliers et discussions, mais aussi par le biais des fanzines. En conséquence de cela, ce sont aussi les influences culturelles, pratiques et théoriques qui voyagent et remodèlent constamment les expressions locales de cette forme de féminisme. Ceci est vérifiable à un niveau formel : les collectifs locaux s’inspirent de ce qui a été fait ailleurs pour se constituer ou mettre en place des actions, et à leur tour inspireront d’autres collectifs par la suite. Ceci est également vrai à un niveau idéel, dans la mesure où la variété de la nature des collectifs autorise constamment la germination de nouvelles problématiques de réflexion. On peut enfin le constater dans le champ culturel et notamment musical : aux influences punks américaines se surajoutent les tendances plus récentes « électro » et « électro-clash » londoniennes ou berlinoises, ou encore les apports de la culture hip-hop française ou américaine par exemple.
Si cette prédisposition au changement est en partie la traduction d’un désir d’ouverture et de constant renouveau, il semble également qu’elle soit envisagée comme une stratégie d’atomisation du mouvement visant à déjouer les pièges d’une opposition frontale à un système essentialisant. De la même façon que les Riot Grrrls disqualifiaient l’efficace d’une conception dialectique de la protestation, tout donne à penser que l’activisme polymorphe pratiqué par les réseaux féministes underground français et plus généralement européens témoigne d’une tentative de contournement des logiques dominantes. Il s’agit d’une contestation, par à-coups, oscillatoire, qui joue avec la visibilité et l’invisibilité en s’engageant dans une sorte de taquinerie subversive pour tenter d’agacer un système hégémonique. Il semble y avoir une espèce de volonté de se trouver là où l’on ne s’attendait pas à ce qu’il puisse y avoir quelque chose, d’utiliser des tactiques dont on ne pensait pas qu’elles pouvaient servir autrement. Il faut souligner à ce propos qu’un certain usage est fait du « détournement », un « détournement » empreint d’ambivalence là encore, qui, de la même manière que la résistance qu’opposent ces féministes n’est pas complètement frontale, ne verse pas intégralement dans la dérision accusatrice. Cette culture s’inspire par exemple largement de certains aspects de la culture de masse télé- ou radio-diffusée, et reconnaît et assume l’impact des médias sur leurs goûts et pratiques. Enfin, le recours massif au second degré et à l’autodérision relève de cette même agacerie, de cette même jonglerie avec l’acceptable et l’inconvenant, bien que ceux-ci ressortissent aussi à un relativisme prudent vis-à-vis de tous les types d’assertions et d’un désengagement vis-à-vis du concept de certitude que pourrait incarner le discours au premier degré.
Un féminisme des interstices
Le féminisme que nous venons de tenter de décrire dans cet exposé, exposé qui reste à envisager avec toute la circonspection et le relativisme requis, est ainsi en quelque sorte interstitiel, disruptif. Il constitue une « interférence parasitaire » pour reprendre les termes de Dick Hebdige dans la mécanique bien huilée des logiques en cours, une sorte de neige télévisuelle fugace mais se manifestant à intervalles réguliers. À la fois présent et absent au monde, il s’est ménagé un espace parallèle, qui interagit avec parcimonie avec un espace principal appréhendé comme globalement hostile. Il s’agit d’un féminisme qui squatte les espaces sur lesquels Big Brother a oublié ou négligé de jeter un oeil. Tout en inscrivant leurs actions dans un domaine très pratique, les protagonistes de ces réseaux s’adonnent également à un genre d’activisme de l’absurde, un activisme qui tente de dénicher des parcelles où les logiques en cours ont un peu desserré leur prise. Reste à savoir jusqu’à quelles contrées mènera la course-poursuite.