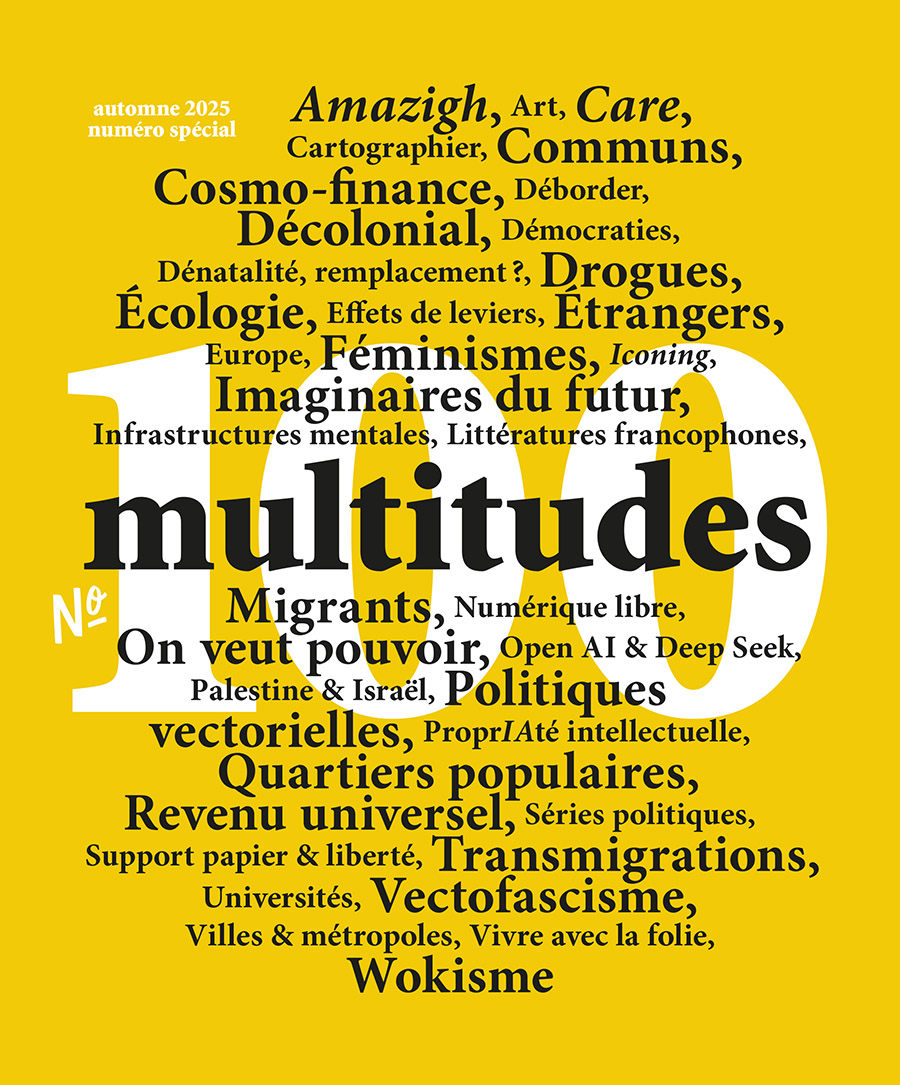Quand l’art c’est la vie Artistes-chercheurs et biotech, par Pentecost Claire
En 2000, Eduardo Kac déclare à la télévision qu’il a commandité la « création » d’un lapin transgénique. En 2004, l’artiste Steve Kurtz est détenu par le FBI, soupçonné de « bioterrorisme » en raison du matériel scientifique qu’il utilise dans des installations conçues pour démystifier la biotechnologie. Ce contraste entre un artiste-publicitaire qui fait … Continuer la lecture de Quand l’art c’est la vie Artistes-chercheurs et biotech →
L’Extradisciplinaire Vers une nouvelle critique institutionnelle, par Raunig Gerald
Quelle est la logique, le besoin ou le désir qui pousse de plus en plus d’artistes à s’aventurer en dehors de leur propre discipline, définie par la notion de réflexivité libre et d’esthétique pure, incarnée par le circuit école-galerie-magazine-musée, et hantée par le souvenir des deux genres normatifs, la peinture et la sculpture ? Il … Continuer la lecture de L’Extradisciplinaire Vers une nouvelle critique institutionnelle →
Présentation, par Holmes Brian
Dans une séquence surprenante de l’installation vidéo Corridor X, l’image passe brusquement d’un moniteur de contrôle de la chaîne Eurovision à une séance de maquillage sous l’œil des caméras, puis à une salle remplie de journalistes, puis encore à un écran d’ordinateur où l’on joue au solitaire. Nous sommes dans le centre officiel des médias … Continuer la lecture de Présentation →
Le genre est obsolète, par Brassier Ray
L’étiquette « noise » désigne moins un no man’s land dans le paysage des genres musicaux qu’un lieu d’interférences multiples et multidirectionnelles. Quoique souvent menacées de tomber dans la complaisance facile et le stéréotype, les pratiques relevant du noise conduisent, chez leurs meilleurs adeptes, à une pulvérisation systématique, joyeuse et libératrice des clichés ressassés par … Continuer la lecture de Le genre est obsolète →
Le Double Sens de la destitution, par Nowotny Stefan
En partant des textes du Colectivo Situaciones sur les mouvements d’insurrection de décembre 2001 en Argentine, cet article cherche à reposer la question de la critique institutionnelle à partir d’une réflexion sur des pratiques destituantes. Loin de se laisser réduire à la visée d’une réinstitution, c’est-à-dire d’un remplissage des fonctions classiques de pouvoir politique, ces … Continuer la lecture de Le Double Sens de la destitution →
L’animal pris au piège, par Gibourg Pascal
En 2005 paraissaient sur le site de la revue Multitudes, écrites par la main du philosophe italien Giorgio Agamben, les lignes suivantes : « Les journaux ne laissent aucun doute : qui voudra désormais se rendre aux États-Unis avec un visa sera fiché et devra laisser ses empreintes digitales en entrant dans le pays. Personnellement, je n’ai aucune … Continuer la lecture de L’animal pris au piège →
Universités : une réforme à inventer ?, par Revue Multitudes
Interprétons un instant la mobilisation politique qu’ont connue les universités, au cours de ces derniers mois, comme le signe d’une agitation qui travaille la société française. Et si l’enjeu réel des grèves, blocages, suspensions de cours, fermetures administratives, manifestations, prises de positions publiques et autres assemblées générales, était bien moins de lutter contre une loi … Continuer la lecture de Universités : une réforme à inventer ? →
De la vie en milieu précaire (ou : comment en finir avec la vie nue), par Revel Judith
Entre la fin octobre et le début novembre 2005, nous avons été nombreux à hésiter sur la lecture politique à donner de ce qui se passait dans les banlieues. Non pas que la révolte ait été en soi une surprise – de ce point de vue, la question portait davantage sur ce qui avait fait … Continuer la lecture de De la vie en milieu précaire (ou : comment en finir avec la vie nue) →
Danses de Birgit Jürgenssen, par Futscher Edith
L’article analyse la série photographique Danse macabre avec jeune fille de Birgit Jürgenssen selon deux axes : le concept de masque et l’enchevêtrement de deux thèmes iconographiques. En s’inscrivant dans un espace archaïsant, où apparaissent des éléments burlesques, les photographies de Jürgenssen des années 1979 et 1980 sont, comme chez Bakhtine, un éclat de rire … Continuer la lecture de Danses de Birgit Jürgenssen →
Re-présentation de Birgit Jürgenssen (-), par Zapperi Giovanna
Partir d’un peu loin, c’est-à-dire au plus près de nous. (Et d’elle, qui notait dans son Journal, à la toute dernière page, des mots d’Empire dans la toute récente traduction allemande.) Pour ce faire, voler dans la Préface de Logiques des mondes, second volet de l’Opus Magnum d’Alain Badiou, à son corps défendant donc, cet … Continuer la lecture de Re-présentation de Birgit Jürgenssen (-) →
Revenu garanti et puissance d’agir, par Ceccaldi Jérôme
La question des fondements d’un revenu garanti n’est pas une question d’experts, réservée aux spécialistes du capitalisme historique ou de la crise de l’État-providence. Par delà la caution élégante ou l’habillage théorique qu’elle peut fournir, la philosophie de Spinoza, en tant qu’elle se formule comme projet d’augmentation de la puissance d’agir, permet à la fois … Continuer la lecture de Revenu garanti et puissance d’agir →
Quelles sont les conditions nécessaires pour l’émergence de multiples récits du monde ? Penser le revenu garanti à travers l’histoire des luttes des femmes et de la théorie féministe, par Corsani Antonella
Dans une perspective critique du discours sur le revenu garanti, je dessine ici les traces d’un parcours me conduisant à en percevoir quelques limites. Le revenu garanti comme problème. Comme objet à questionner. En même temps, en traversant les frontières des disciplines, et notamment dans un au-delà de l’économie politique et de sa critique, je … Continuer la lecture de Quelles sont les conditions nécessaires pour l’émergence de multiples récits du monde ? Penser le revenu garanti à travers l’histoire des luttes des femmes et de la théorie féministe →
Inventer le commun des hommes, par Revel Judith et Negri Toni
Partons d’un constat très simple, puisqu’il est parfois plus facile de raisonner en commençant par la fin : nous vivons aujourd’hui dans un monde où produire est devenu un acte commun. Certains d’entre nous ont encore en tête des pans entiers d’analyses foucaldiennes sur la double tenaille que l’industrialisation impose aux corps et aux têtes des … Continuer la lecture de Inventer le commun des hommes →
Nouvelles droites, gauches vieillissantes, et (malgré tout) un peu d’optimisme de la raison, par Yves Citton et Revel Judith
Rien n’est plus difficile que de se trouver face à la sempiternelle question du « Que faire ? » Cet en-tête est une tentative à quatre mains — pas toujours d’accord entre elles, et reliées à encore bien davantage de têtes souvent dissonantes — pour raisonner à voix haute, au sortir de six mois de … Continuer la lecture de Nouvelles droites, gauches vieillissantes, et (malgré tout) un peu d’optimisme de la raison →
Le Chapitre manquant d’Empire La réorganisation postmoderne de la colonisation dans le capitalisme postfordiste, par Castro-Gómez Santiago
ll manque à Empire une analyse du passage du colonial au postcolonial. À en croire Hardt et Negri, l’hégémonie du travail immatériel renverrait au passé les dichotomies centres/périphéries et les formes de domination coloniale. La faille se trouve dans leur généalogie de la modernité : en ne prêtant attention qu’à l’Europe, en ignorant le système-monde, … Continuer la lecture de Le Chapitre manquant d’Empire La réorganisation postmoderne de la colonisation dans le capitalisme postfordiste →
Temps historique et sémantique politique dans la critique postcoloniale, par Mezzadra Sandro
Notre expérience du monde oscille entre deux pôles, l’unification-globalisation et les turbulences. Les études postcoloniales se tiennent à la jonction, c’est tout leur intérêt. Elles remettent moins en cause la modernité que le schéma européen de la modernité, abstrait dans sa substance, linéaire dans le temps et l’espace (extension du centre aux périphéries). Les meilleures … Continuer la lecture de Temps historique et sémantique politique dans la critique postcoloniale →
Les Implications des altérités épistémiques dans la redéfinition du capitalisme global: transmodernité, pensée-frontalière et colonialité globale, par Grosfoguel Ramon
Malgré la décolonisation formelle, une colonialité globale perdure sous des formes multiples et imbriquées : les dominations fondées sur le genre, la race, les pratiques sexuelles, la langue, la spiritualité, etc. La décolonisation du monde appelle une politique nouvelle, qui, au-delà des affirmations identitaires (cultural studies) et des relations de travail (marxisme), donne toute leur … Continuer la lecture de Les Implications des altérités épistémiques dans la redéfinition du capitalisme global: transmodernité, pensée-frontalière et colonialité globale →
Race, classe, genre et sexualité : entre puissance d’agir et ambivalence coloniale, par Mc Clintock Anne
Sans rejeter tout à fait la perspective de Bhabha (qui voit dans l’imitation (mimicry) des colonisés et l’ambivalence du discours colonial le lieu d’une faille structurelle du colonialisme, lequel travaillerait ainsi à sa propre subversion), l’auteure refuse de considérer que le repérage de telles failles structurelles suffise à déterminer les sources de la puissance d’agir … Continuer la lecture de Race, classe, genre et sexualité : entre puissance d’agir et ambivalence coloniale →
La Démocratie sexuelle et le conflit des civilisations, par Fassin Eric
Dans le monde postcolonial, et plus particulièrement depuis le 11-septembre 2001, une norme libérale occidentale renouvelée ajoute aux droits de l’homme la « démocratie sexuelle » (une conception lisse de la féminité à laquelle tend à s’adjoindre une conception lisse de l’homosexualité). Imbriquée à la norme antiraciste, cette « démocratie sexuelle » tend un piège … Continuer la lecture de La Démocratie sexuelle et le conflit des civilisations →
Pratique de la guerre symbolique pour une politique de la vie en la première personne, par Martin Jérôme
Entretien ( inédit) avec Emma Cosse, Stany Grelet, Philippe Mangeot, Jérôme Martin militants de ACT UP Paris, réalisé par Antonella Corsani Le sida comme combat politique ( 1) AC : L’histoire de ACT UP est étroitement liée à celle du sida, à l’évolution de l’épidémie, aux progrès dans la recherche sur le sida, mais aussi … Continuer la lecture de Pratique de la guerre symbolique pour une politique de la vie en la première personne →
La Confédération paysanne au tournant, par Bourgeais Jo
L’originalité de la Confédération paysanne, c’est de ne pas défendre tout et n’importe quoi sous prétexte qu’il s’agit « d’intérêts » agricoles. C’est le refus du corporatisme, idéologie utilisée pour défendre l’intérêt des gros agriculteurs, des propriétaires, de tous les conservateurs qui détiennent les pouvoirs en agriculture. Aujourd’hui, les firmes agroalimentaires savent aussi utiliser les … Continuer la lecture de La Confédération paysanne au tournant →
Une histoire-mouvement, par Aspe Bernard
Sur Yann Moulier Boutang, De l’esclavage au salariat. Économie historique du salariat bridé, Paris, PUF et Actuel Marx, 1998. Ce livre a pour contenu la liberté obstinée, que les formes multiples de contrainte n’ont jamais réussi à effacer. Il se présente comme une synthèse de ce qu’a pu amener de plus riche l’analyse des systèmes-mondes, … Continuer la lecture de Une histoire-mouvement →
” L’associational revolution “, par Tubaro Paola
Partout dans le monde, les années 1990 auront vu le tiers-secteur gagner en popularité. À suivre Lester M. Salomon, un des plus grands spécialistes en la matière, cette dernière décennie aurait été celle de l’associational revolution,le tiers-secteur acquérant à la fin du xxème siècle un rôle aussi important que celui joué autrefois par les États-Nations. … Continuer la lecture de ” L’associational revolution “ →